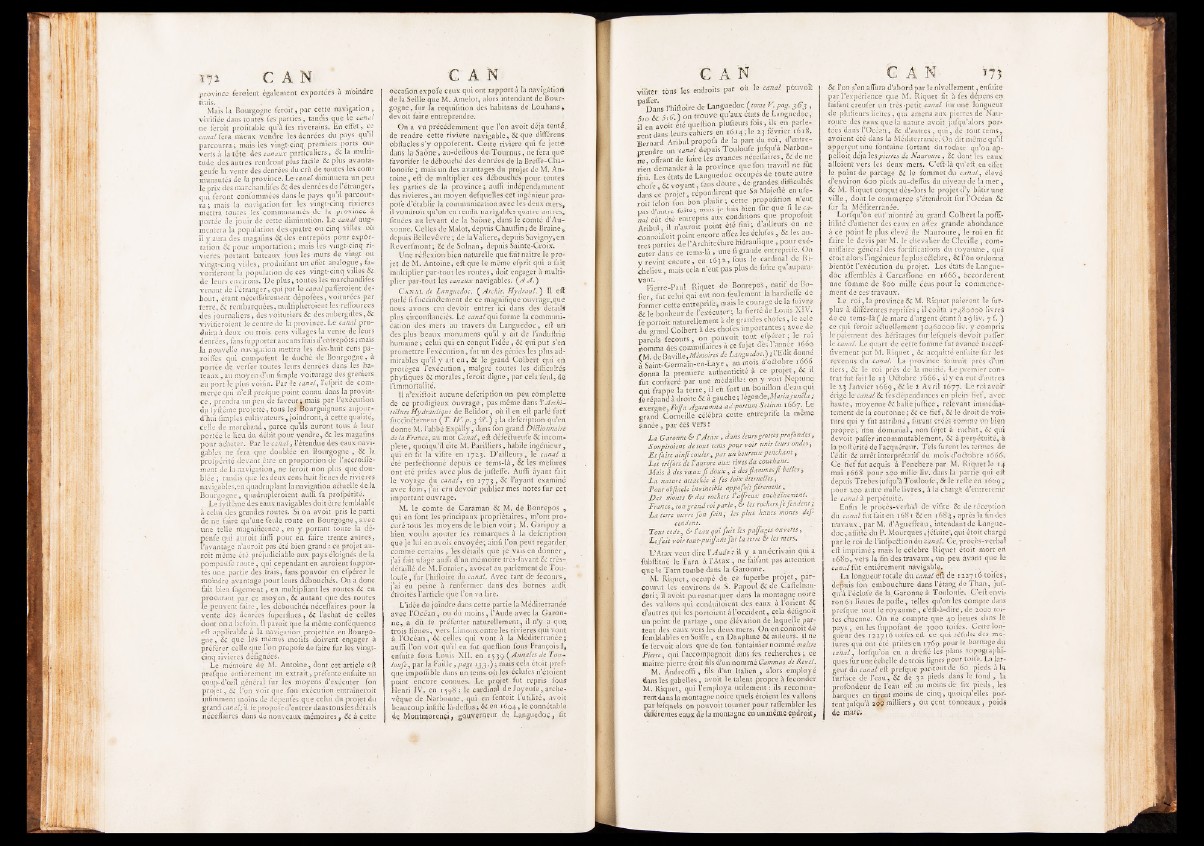
province feroierit également exportées à moindre
irais. . , .
Mais la Bourgogne feroit , par cette navigation,
vivifiée dans toutes Tes parties, tandis que le canal
-ne feroit .profitable qu’à fes riverains. En effet, ce
canal fera mieux vendre les denrées du pays qu il
parcourra.-; mais les vingt-cinq premiers ports ou1*
verts à la tête' des canaux particuliers, & la multitude
des autres rendront plus facile & plus avanta-
geufe la vente des denrées du cru de toutes-les communautés
de la province. Le canal diminuera un peu
le prix des marchandées & des denrées de l’étranger,
qui feront corifommées dans le pays qu’il parcourra
; mais la navigation fur les vingt-cinq rivières
mettra toutes les communautés de ia province à
portée de jouir de cette diminution. Le candi augmentera
la population des quatre ou cinq villes où
il y aura des magafins & des entrepôts pour exportation
& pour importation ; mais les -vingt-cinq rivières
portant bateaux fous les -murs de vingt ou
vingt-cinq villes, produifant un effet analogue, fa-
voriferont la population de ces vingt-cinq villes ôc
de leurs environs. D e plus, toutes les marchandifes
venant de l’étranger, qui par le canal pafleroient de1
bout, étant néceflàirement dépofées, voiturées par
ferre, & rembarquées, multiplieroient les-reflources
des journaliers, des voituriers &C des aubergiftes, &
vivifieroient le centre de la province. Le canal produira
à deux -ou trois cens villages-la vente de leurs
denrées , fans fupporter aucuns frais d’entrepôts ; mais
la nouvelle navigation mettra les dix-huit cens pa-
xoifl.es qui composent le duché de Bourgogne, A
portée de verfer toutes leurs denrées dans les -bateaux
, au moyen d’un fimple voiturage des greniers
-au port le plus voifin. Par le canal, l’efprit de commerce
qui n’eft prefque point connu dans la provinc
e , prendra Un peu de faveur jamais par l’exécution
du fyftême projetté, tous les^Bourguignons aujourd’hui
fîmples cultivateurs, joindront,à cette qualité,
celle de marchand, parce qu’ils auront tous à leur
portée le lieu du débit pour vendre, Si les magafins
pour acheter. Par le -canal, l’étendue des eaux navigables
ne fera que doublée en Bourgogne , & la
profpérité devant être en proportion de l’accroiffe-
menf de la-navigation, ne feroit non plus que dou*-
blée ; tandis que les deux cens huit lieues de rivières
navigables,en quadruplant la navigation actuelle de la
Bourgogne, quadrupleroient aufli fa profpérité^
Le fyftême des eaux navigables doit être femblable
à celui des grandes routes. Si on avpit pris le parti
de ne faire qu’une feule route en Bourgogne, avec
une telle magnificence , en y portant toute la dé^-
penfe qui auroit fuffi pour en faire trente autres,
l’avantage n’auroit pas été bien grand : ce projet auroit
même été préjudiciable aux pays éloignés de la
pompeùfe route, qui cependant en auroient fuppor-
tés une partie des frais, fans pouvoir en efpérer le
moindre avantage pour leurs débouchés. On a donc
fait bien fagement, en multipliant les routes ôc en
jrocurant par ce moyen, & autant que des routes
e peuvent faire, les débouchés néceffaires pour la
vente des denrées fuperfiues, & l’achat de celles
dont on a befoin. Il paroît que la même eonféquence
eft applicable à la navigation projettée en Bourgogne
, & que les mêmes motifs doivent engager à
préférer celle que l’on propofe de faire fur les vingt-
cinq rivières défignées.
Le mémoire de M. Antoine, dont cet article eft
prefque entièrement un extrait, préfente enfuite un
çoup-d’oéil général fur les moyens d’exécuter fon
projet, & l’on voit que fon exécution entraîneroit
infiniment moins de déoenfes que celui du projet du
grand canal; il fe propofe d’entrer dans tous les détails
néceffaires dans de nouveaux mémoires, ôc à eeî.te
o’ccafio’ri expofe ceux qui ont rapport à ta navigation
de la Seille que M. Amelot, alors intendant de Boiu>.
gagne, fur la requifition des habitans de Louhans >
devait faire entreprendre.
On a vu précédemment que l’on avoit déjà tenté.
de. rendre cette riviere navigable, & que diftêrens
obftacles s’y oppoferent. Cette riviere qui fe jettè
dans la Saône, air-deffous de.Tournus, ne fera que
favorifer le débouché des denrées de la Breffe-Cha-
lonoife ; mais un des avantages du projet de M. Antoine
, eft de multiplier ces débouchés- pour, toutes
les parties dé la province ; aufli indépendamment
des rivières, âu moyen defquelles cet ingénieur propofe
d’établir la communication avec les deux mers,
il voudtoit qu’on en rendît navigables quatre autres,
fituées au levant de la Saône, dans le comté d’Au-
xonne. Celles de Malot, depuis Chauffin ; de Braine -,
depuis Bellevêvre ; de laValiere, depuis Savigny,en
Reverfmont; ôc de Solnan, depuis Sainte-Croix.
Une réflexion bien naturelle que fait naître le projet
de M. Antoine, eft que le même efprit qui a fait
multiplier par-tout les routes, doit engager à multiplier
par-tout les canaux navigables; {AA.')
C anal de Languedoc. ( A'rchit. Hydtaul. ) Il eft
parlé fi fucCin&ement de ce magnifique ouvrage,que
nous avons cru devoir entrer ici dans des' détails
plus GÎrconftanciés. Le canàl qui forme la communication
des mers au travers du Languedoc, eft uft
des plus beaux monumens qu’il y ait de i’ihduftrié
humaine ; celui qui en conçut l’idée , & qui put .s’eri
promettre l’exécution, tut un des génies les plus admirables
qu’il y ait eu , & le grand Colbert qui eii
protégea l’execution, malgré toutes les difficultés
phyfiqués & morales, feroit digrte, par cela feul, dé
l’immortalité.
il n’éxiftoit aucune defcription un peu complettê
de ce prodigieux ouvrage, pas même dans YArchi-
tecture Hydraulique de Beiidor, où il en.eft parlé fort
fuccinflément (T . IF .p.^38.') ; la defcription qu’ea
donne M. l’abbé Expilly, dans fon grand Diclionnaïré
de la France, au mot Canal, èft défieéhieufe &incom-i
plete, quoiqu’il cite M. Parilliers, habile ingénieur,
qui en fit la vifite en 1723. D ’ailleurs, le canal à
été perfectionné depuis ce tems-là, & les mefures
ont été prifies avec plus de jufteffe. Aufli ayant fait
le voyage du canal, en 1773, & l’ayant examiné
avec foin, j’ai cru devoir publier mes hôtes fur cet
important ouvrage.' '
M. le comte de Caranian & M. de Bonrejpos ,
qui eh font les principaux propriétaires, m’ont pro-r
cîiré tous les moyens de le bien voir; M. Garipuy à
bien voulu ajouter fes remarques à la defcription
que je lui en avois envoyée; ainfi l’ori peut regarder
comme certains, les détails que je vais en donner ,
j’ai fait ufàge aufli d’un mémoire t'rès-favant & très-
détaillé de M. Fornier, avocat au parlement de Tou-
loufe, fur l’hiftoire du canal. Avec tant de fécôurs,
j’ai èu peiné à renfermer dans des bornés aufli
étroites l’article que l’on va lire.
. L’idée de joindre dans cette partie la Méditerranée
avec l’O céan, on dû moins, l’Aude avec la Garonne,,
a du fe préfenter naturellement, il n’y a que;
trois lieues, vers Limoux entre les rivières qui vont
à l’Océan, & celles qui vont à la Méditerranée}
aufli l’on voit qu’il en fut queftion fous François I,
enfuite fous Louis XII. en .1539 ( Annales de Tou-
loufe, par la Faille, page / .).; mais cela etoit prefque
impoflible dans un teins où les éclufes n’étoient
point encore connues. Le projet fut repris fous
Henri IV. en 1598 : le cardinal de: Joyeufe, archevêque
de Narbonne, qui en fentoit l’utilité, avoit
beaucoup infifté ià-deffus ; & en 1604 ■> Ie connétable
1 Montmorençi, gQUYçrqeur de Languedoc, fit
’yïftter toupies endroits -par oii le piuMÎl
PaDans l’hiftoire de'Languedoï (umt V.pog. 3 6 ÿ ,
5,0 -) on trouve qu’aux états de Languedoc,
il en avoit été queftion plufieurs fois , ils en parle-,
s-ent dans leurs cahiers- en 1614 ; le 13 février 1618,
Bernard Aribul propofa de la. part du ro i, d entreprendre
un canal depuis Tôuloufe jufqu à Narbonne
offrant de faire les avances néceffaires; & de ne
rien demander à la province que fon travail ne fut
fini. Les états de Languedoc occupes de toute autre,
th o fe , & voyant, lins doute . de,grandes difficultés
dans ce projet, répondirent que Sa Majefté en ufe-
roit félon fon bon plaifir; cette propolition neut
pas d'autre fuite; mais je ivus bien fur que fi «
m m été entrepris a « conditions que propofo.t
Aribul, il n’auroit point été fini ; d ajlleuts on ne,
«onnoiffoit point encore aflez.les eclufes, & les autres
parties de MMM— hidrauliqne , pô,ur eM-
cuter dans ce tems-là , une fi grandé éntrepnfe. On
y revint encore, en lôglid fods k ca,rdjnal de H
ih eiieu, mais cela :veu: pas plus de faite qu auparavant.
, ; ' ■ I : ' I -r i n
Pierre-Paul Riquet de Bonrepos, natif de Uo-
fser;, fut celui qui eut non-feulement la hardielie de
former cette entreprife; mais le courage de
& le: bônhettr de l ’exécuter ; la fierte U n XIV..
fè portoit naturellement à de grandes ehofes, le te e
du grand Colbert à des èïtpfe importantes ; avec de,
pareils fecours , 011 ppiivort tput efperet; le toi
nomma des commiffaires à ce fu,ct des 1 annee 1660
(M. de Baville,Mémoires de Languedoc.) ;lEd it donne
à Saint-Germain-en-Laye ; ati mois, d’oftobre 1666
donna la première authenticité à ce projet, & il
fut confàcré par une médaille: on y .voit Neptune
qui frappe la terre, il en fort un bouillon deau qui
?e répand à droite & à gauche ; légende,Marmjimfa,;,
exergue, Foffa Apanunjui adponum Sttium 1667. Le
grand Corneille célébra cette efttrepnfe la meme
ânnée, par ces vers :
U Garonne & V A ta x, àans Uursÿottis profondes ,
Soupiroient dilout tems pourvoir unir leurs ondes,
E t faire ainfi couler, par un heufeux penchant,
Les tréfôrs de Vaurore aux rives dit cùuchaht.
Mais à des voeux JÎ dôuic, d des faminesf bellis ;
La nature attachée a fes lôix èarnellès y
Pour obfdcle invincible oppofoiî fieremeUt,
Des monts & des rochers l'affreux enchaînement.
France, ton grand roi parle, & lis rochers fe fendent,
■ La terre ouvre fon feîn ; Us plus hauts monts dej-
cefideht.
Tout cede, & l'eau qui fuit Us paffages ouverts,
'Le fait voir toüt-puîjjarlt fiti là terre 6’ les mers.
L’Atax veut dire Y Aude: il y a uniécrivain qui a
ïubftitué le Tarn à l’Atax , ne faifant pas attentiori
que le Tarn tombe daris la Garonne... j...
M. Riquet, occupé de ce fuperbe projet,.parcourut
les environs de S. Papoul & de Caftelnati-1
dari; il avoit pu remarquer dans la montagne noire
des vallons qui conduilôient des eaux à l’orient &
d’autres qui lës portoient à l’occident, cela défignoit
•un point de partage , une élévation de laquelle partent
des eaux vers les deux mers. On ençônnoit de
femblables en Suiffe , en Dauphiné & ailleurs. Il rie
fefervoit alors que de fon fontainier nomme maître
Pierre, qui l’accortipagnoit dans fes .recherches j cê
maître pierre é.toit fils d’un nommé Ganimas de Reyel.
M. Andreofli , fils d’un Italien , alors employé
dans les gabèlles, avoit le talent propre à féconder,
M. Riquet, qui l’employa utilement : ils reconnurent
.dans la montagne noire quels étoient les yallons
par lfefquels on pouvoit tourner pour raffembler les
différentes eajix dé la montagne, en vui meme endroit ;
& l’on s’en affura d’abord par le nivellement, ênfuitè
par l ’expérience que M. Riquet fit à fes dépens en
faifant çreufer un très-petit canal fur une longueur
de plufieurs lieues, qui amena aux pierres de Nau-
rpure des eaux que la nature avoit jufqu’alors por*
fées dans'rOcéan, & d’autres, qui, de tout tems,
avoient été dans la Méditerranée. On dit même qu’il
a-pperçut une fontaine fortant du rocher quson ap-
pelloit déjà les pierres de Nauroure, & dont les eaux
alloient vers les deux mers. C ’eft-là qu’eft. en effet
le point de partage & le fommet.du canal., élevé
d’environ 600 pieds au-deffus du niveau de la mer ,
& M. Riquet conçut dès-lors le projet d’y bâtir une
ville , dont le commerce s ’étendroit fur l ’Océan ôc
fiir la Méditerranée.
Lorfqu’ôn eut' montré àu grand Colbert là pofli-
bilité d’anieher des eaux en àffez grande abo'ndancé
à cê point le plus élevé de Nauroure, le roi en fit
faire le devis par M. le chevalier de Clevifle , cbm-
iriiflàire général des fortifications du royaume, qui
étoit alors l’ingénieur le plus célébré, & l’Ôn ordonna
bientôt l’exécution du projet. Les états de Languedoc
afferriblés à Carcâffone en 1666, accordèrent
Une fournie dè 8oô mille écus pour le cbriiirience-
ihe'nt de ces'travaux.
Le r o i , Ia provinée& M'. Riquet paiêrent le fiif-
plus à différentes reprîfes ; il éoîità X7480Ö0Ó livreà
de ce tems-là ( le marc d’argent étant à 29 liv. 7 f. )
ce qui feroit aâuellement 30460000 liv. y compris
le paiement dés héritages fur lefquels dev’oit pafféfi
le canal. Le quart de cettê fournie fut àvanc'é fiicceft1
livement par M. Riquet, & acquitté enfuite fur Ie§
revenus du cahal. La province fournit- près d’uri
tiers, & le roi près de la moitié. -Le premier contrat
fut fait le 15 Oôiobre iî5è6 , il y en eut d’autres
le 13 Janvier 1669, & le 1 Avril 1677. Le roi avoit.
érigé-le c<z72<z/& fes dépendances en plein fief, avefc
haute, moyenne & baffe ju ftice, relevant immédiatement
de la couronne ; & ce fief, & le droit de voiture
qui y fut attribué, furent créés comme Un bien
propre.; ifôn domanial, non frijet à rachat’, & qui
devoit paffer incommutableihent, & à-perpétuité, à
la poftérité de l’acquérèrir. Tels furent les termes dè
l’édit & arrêt interprétatif dû mois d’oûobre 1666'.
Ce fief fut acquis à l’encherè par M. Riquet le 14
mai i6é8 pour 2Ó0 mille liv. dans là partie qui eft
depuis Trebes jufqu’à Toûloufe, & le reftëèri 1669,
pour 200 autre mille livres, à la chargé d’entretenir
le canal à perpétuité.
Enfin le procès-verbal de vifite & de réception
du canal fut fait en 1681 & en 1684, après la fin des
travaux , par M. d’Aguéffeàû , intendant de Languedoc
, affilié clu P; Mourques ; jéfuitê-, qui étoit chargé
par le roi de l’infpeéliôiidit canal. Ce. procès-verbal
eft imprimé; mais le célébré Riquet étoit mort eri
1680, vers la fin des travaux, ûn peu ayant que le
canal fût entièrement navigable.
■ La longueur totale du canal du; de 1227*6 toifes^
depuis fon embouchure dans l’étàng de Than, juf-
qu’à l’écluie de la,Garonne à Touloufe, C.’eft envi-
ron61 lieues de pofte, telles qu’on les compte dans
prefque tout le royaume , e’éft-à-dirë , de 2000 toiles
chacune'* On ne compte què 40 lieues dans .le
pays ; en les fuppofànt de 3000 toifes. Cette longueur
des 122716 toifes.ell ce qui refaite des. mefures
qui ont été prifeç en 1769. pour le bornage du
canal, iorfqu’dn en a dréffé les plans topographiques
fur une échelle de trois lignes pour, toile. La largeur
du canal eft: prêfqüè par-tout de 60 pieds à la
furface de', l’eàu, & de 3 2 pieds dans le fond, la
profondeur de l’eau eft au moins dé fix pieds, les
barques en tirent moins de cinq, quoiqu’elles portent
jufqu’à 209 milliers ? où çent tonneaux, poids
dé marc.