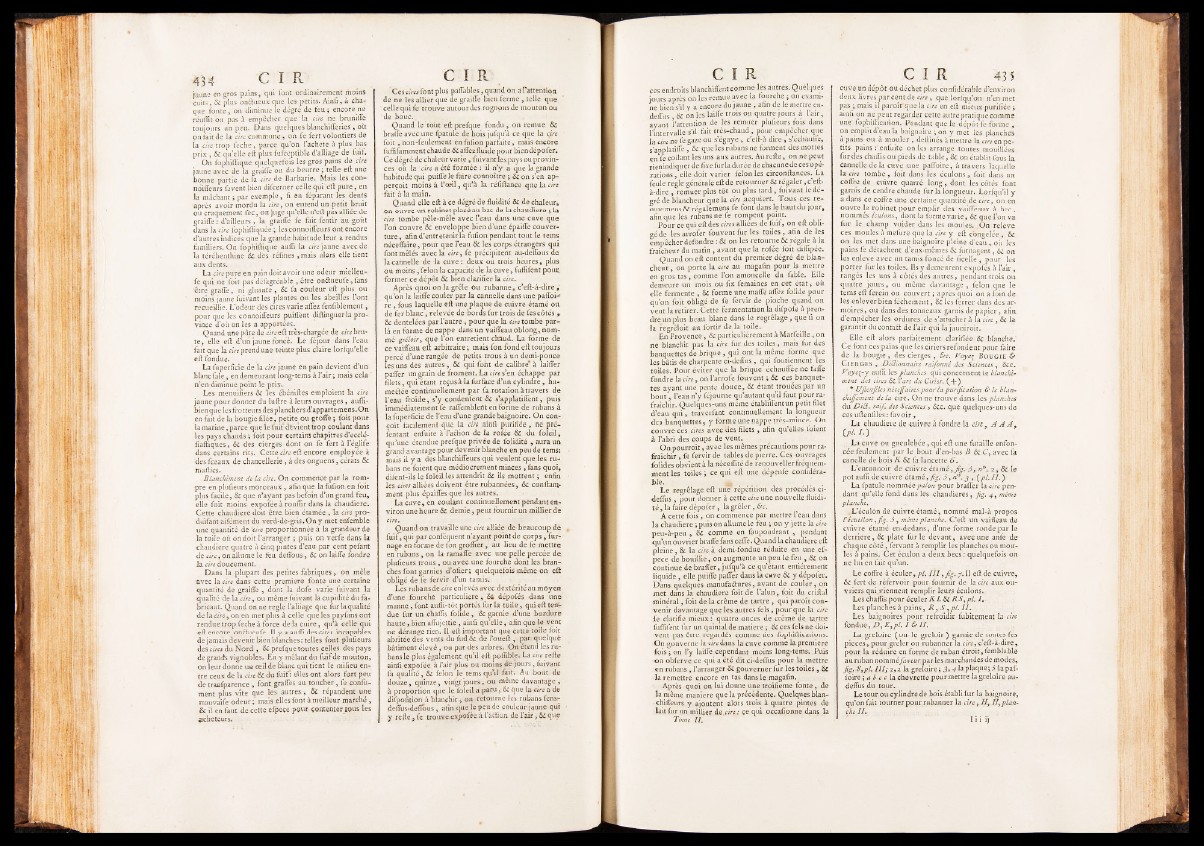
raime en gros pains, qui font ordinairement moins
•cuits, 6c plus on&ueux que les petits. Ainfi, à chaque
fonte , on diminue le dégré de feu ; encore rie
réuflît-on pas à empêcher que la cire ne bruniffe
toujours un peu. Dans quelques blanchifferies', où
on fait de la are commune, on fe fert volontiers de
la cire trop feche, parce qu’on l’achete à plus bas
prix , & qu’elle eft plus fufceptible d’alliage de fuif.
On lo phi (tique quelquefois les gros pains de cire
jaune avec de la graille ou du beurre ; telle eft une
bonne partie de la cire de Barbarie. Mais les con-
nôiffeurs favent bien difcerner celle qui eft pure, en
la mâchant ; par exemple, fi en féparant les dents
après avoir mordu la cire, on entend un petit bruit
ou craquement fec, on juge qu’elle n’eft pas alliée de
graille : d’ailleurs , la grailfe fe fait fenti'r 'au goût
dans la cire fophiftiquée ; les connoiffeurs ont encore
d’autres indices que la grande habitude leur a rendus
familiers. On fophiftique aufli la cite jaune avec de
la térébenthine 6c des réfines , mais alors elle tient
aux dents. .
La cire pure en pain doit avoir une odeur mielleu-
fe qui ne foit pas défagréable , être onftueule, fans
'être graffe, ni gluante , & fa couleur eft plus ou
moins jaune fuivant les plantes ou les abeilles l’ont
recueillie. L’odeur des cires varie allez fenfiblement,
pour que les connoiffeurs puiffent diftinguer la province
d’où ori les a apportées.
Quand une pâte de cire eft très-chargée de cire brute,
elle eft d’un jaune foncé. Le féjour dans l’eàu
fait que la cire prend une teinte plus claire lorfqu’elle
eft fondue.
La fuperficie de la cire jaune en pain devient d’un
blanc fale, en demeurant long-teriis à l’air ; mais cela '
n’en diminue point le prix.
Les menuifiers & les ébéniftes emploient la cire
jaune pour donner du luftre à leurs ouvrages, aufli-
bienque les frotteurs des planchers d’appartemens. On
en fait de la bougie filée, petite ou groffe ; foit pour
la marine, parce que le fuif dévient trop coulant dans
les pays chauds ; foit pour certains chapitres d’ecclé-
fiaftiques, 6c des cierges dont on fe fert à l’églife
dans certains rits. Cette cire eft encore employée à
des fceaux de chancellerie, à des onguens, cérats 6c
inaftics.
Blanchiment de La cire. On commence par la rompre
en plufieurs morceaux, afin que la fufion en foit
plus facile, 6c que n’aÿant pas befoin d’un grand feu,
elle foit moins expofée à rouflir daris la chaudière.
Cette chaudière doit être bien étamée , la cire pro-
duifant aifément du verd-de-gris.Ony met enfemble
une quantité de 'cire proportionnée à la grandeur de
la toile où on doit l’arranger ; puis on verfe dans la
chaudière quatre à cinq pintes d’eau par cent pefant
de cire, on allume le feu deffous, & on laiffe fondre
la cire doucement.
Dans la plupart des petites fabriques, on mêle
•avec la cire dans cette première fonte une certaine
quantité de graiffe , dont la dofe varie fuivant la
qualité de la cire, ou même fuivant la cupidité du fabricant.
Quand on ne réglé l’aliiage que fur la qualité
de la cire, on en met plus à celle que les payfans ont
rendue trop feche à force de la cuire, qu’à celle qui
eft encore onctueufe. Il y a auffi des cires incapables
de jamais devenir bien blanches : telles font plufieurs
des cires du lSford , 6c prefque toutes celles des pays
de grands vignobles. En y mêlant du fuif de mouton,
on leur donne un oeil de blanc qui tient le milieu entre
ceux de la cire & du fuif:: elles ont alors fort peu
de tranfparence , font grades au toucher, fe confû-
ment plus vite que les autres, 6c répandent une
mauvaife odeur; mais elles font à meilleur marché ,
& il en faut de cette efpeçe pour çontenter tous les
acheteurs.
Ces cires font plus paffables, quand ôn à l’attention
de ne les allier que de graiffe bien ferme , telle que \
celle qui fe trouve-autour des rognons de mouton ou
de bouc.,
Quand le fout'eft prefque fondu , on remue 6c
brade avec une fpatule de bois jufqu’à ce que la cire
foit , nori-feulement en fufion parfaite, mais encore
fuffifammentchaude 6c affezfluide pour biendépofer.
Ce dégré de chaleur varie, fuivant les pays ou provinces
où la cire a été formée : il n’y a que la grande
habitude qui puiffe le faire connoître ; 6c on s’en ap-
perçoit moins à l’oe il, qu’à la réfiftance que la cire
fait à la main.
Quand elle eft à ce dégré de fluidité 6c de chaleur,
ôn ouvre un robinet placé au bas de la chaudière ; la
cire tombe pêle-mêle avec l’eau dans une cuve que
l’on couvre 6c enveloppe bien d’une épaiffe couverture,
afin d’entretenir la fufion pendant tout le tems
néceffaire, pour que l’eau & les corps étrangers qui
font mêlés avec la cire , fe précipitent au-deffous de
la cannelle de -la cuve : deux ou trois heures, plus
ou moins, félon la capacité de la cuve , fuffifent pour;
former ce dépôt 6c bien clarifier la cire.
Après quoi on la .grêle Ou rubanne, c’éft-à-dire
qu’on la laiffe couler par la cannelle dans une paffoi--
re , fous laquelle eft une plaque de cuivre étamé ou
de fer blanc, relevée de bords fur trois de fes côtés »
6c dentelées par l’autre , pour que la cire tombe par-
là en forme de nappe dans un vaiffeau oblong, nom-?
mé gré loir, que l’on entretient châud. La forme dé
ce vaiffeau eft arbitraire ; mais fon fond eft toujours
percé d’une rangée de petits trous à un demi-pouce
les uns des autres, 6c qui font de calibre* à laiffer
paffer un grain de froment. La cire s’en échappe par
filets, qui étant reçus à la furface d’un cylindre, hu-
meûée continuellement par fa rotation à travers de
l’eau froide, s’y condenfent 6c s’applatiffent, puis
immédiatement fe raffemblent en forme de rubans à
la fuperficie de l ’eau d’une grande baignoire. On conçoit
facilement que la cire ainfi purifiée , ne pré-
fentant enfuite à faction de la rofée 6c du foleil,
qu’une étendue prefque privée de folidité ., aura un
grand avantage pour devenir blanche en peu de tems:
mais il ÿ a des blanchiffeurs qui veulent que les rubans
ne foient que médiocrement minces , fans quoi,
difent-ils le foleil les attendrit & ils mottent ; enfin
les cires alliées doivent être rubannées, & confiant-
ment plus épaiffes que les autres.
La cuve, en coulant continuellement pendant en*
viron une heure 6c demie, peut fournir un millier de
cire.Q
uand on travaille une cire alliée de beaucoup dè
fuif, qui par conféquent n’ayant point de corps, fur-
nage en forme de fon groflier, au lieu de fe mettre
en rubans, on la ramaffe avec une pelle percée de,
plufieurs trous, ou avec une fourche dont les branches
font garnies d’ofîer ; quelquefois même on eft
obligé de fe fervir d’un tamis;, .
Les rubans de cire enlevés avec dextérité au.moyen
d’une fourche particulière , dépofés dans une
manne, font auffi-tôt portés fur la toile, qui eft tenb
due fur un chaflis folide, 6c garnie d’une bordure
haute, bien affujettie , ainfi qu’elle, afin que le vent
ne dérange rien. Il eft important que cette toile foit
abritée des vents du fud 6c de l’oueft , par quelquè
bâtiment élevé , ou par des arbres:. On étend les rubans
le plus également.qu’il eft poflible..La cire refte
ainfi expofée à l’air plus ou moins de jours, fuivant
fa qualité, 6c félon le tems qu’il fait-* Au .bout de
douze, quinze, vingt jours, ou meme davantage ,
à proportion que le loleila paru .j,6c que la cire a de
difpofition à blanchir, on retourne les rubans fensr
deffùs-deflôus, afin que.le peu de couleür jaune qui
. v refte, fe trouve expofee,a 1 action- de 1 air, 6c que
ces endroits blanchiffent comme les autres; Quélqiiés
jours après on les remue avec la fourche ; on examine
bien s’il y a encore du jaune , afin de le mettre en- j
deffus 6c on les laiffe trois ou quatre jours à l’air,
ayant l’attention de les remuer plufieurs fois dans
l’intervalle s’il fait trèsrehaud , pour empêcher que
la cire ne fe gaze ou s’égaye , c’eft-à dire , s’échauffe,
s’aoplatiffe , 6c que les rubans ne forment des mottes
en fe collant les uns aux autres. Au refte, on ne peut
rienindiquer de fixe fur la durée de chacune de cesopér-
rations, elle doit varier félonies circonftanees. La
feule réglé générale eft de retourner 6c régaler, c’eft-
à-dire , remuer plus tôt ou plus tard, fuivant le degré
de blancheur que la cire acquiert. Tous ces remue
mens Ôtrégalemens fe font dans le haut du jour,
afin que les rubans ne fe rompent point.
Pour ce qui eft des cires alliées de fuif, on eft obligé
de les arrofer fouvent fur les toiles , afin de les
empêcher defondre : & on les retourne 6c régale à la
fraîcheur du matin, avant que la rofee foit diflipee.
Quand on eft content du premier dégré de blancheur
on porte la cire au magafin pour la mettre
en gros tas, comme l’on amoncelle du fable. Elle
demeure un mois, ou fix femaines en cet état, où
elle fermente , 6c forme une maffe affez folide pour
qu’on foit obligé de fe fervir de pioche quand on
veut la retirer. Cette fermentation la difpofe à prendre
un plus beau blanc dans le regrêlage, que fi on
la regrêloit au fortir de la toile.
En Provence, 6c particuliérement à Marfeille , on
ne blanchit pas la cire fur: .des toiles , mais fur des
banquettes de brique , qui ont la même forme que
les bâtis de charpente ci-deffus , qui foutiennent les
toiles. Pour éviter que la brique échauffée ne faffe
fondre la cire, on l’arrofe fou vent ; 6c ces banquettes
ayant une pente douce, 6c étant trouees par un
b ou t, l’eau n’y féjourne qu’autant qu’il faut pour rafraîchir.
Quelquesruns même établiffentun petit filet
d’ eau qui, traverfant continuellement la longueur
des banquettes, y forme une nappe très-mince. On
couvre ces cires avec des filets , afin qu’elles foient
à l’abri des coups de vent.
On pourroit, avec les mêmes précautions pour rafraîchir
,.fe fervir de tables de pierre..Ces ouvrages
folides obvient à la néceflité de renouvellerfréquem-
mentles toiles; ce qui eft une dépenfe confidérable.,
H H H H
Le regrêlage eft une répétition des procédés ci-
deffus , pour donner à cette cire une nouvelle fluidit
é , la faire dépofer , la grêler, &c.
A cette fois , on commence par mettre l’eau dans
la chaudière ; puis on allume le feu ; on y jette la cire
peu-à-peu , 6c cojnme en faupoudrant , pendant
qu’un ouvrier braffe fans ceffe. Quand la chaudière eft
pleine, & la cire: à demi-fondue réduite en une e£-
pece de bouillie, on augmente un peu les .feu , 6c on
continue de braffer, jufqu’à ce qu’étant entièrement
liquide , elle puiffe paffer dans la cuve 6c y dépofer.
Dans quelques manufactures, avant de couler,.on
met dans la chaudière foit de l’alun, foit du criftal
minéral, foit de la crème de tartre, qui paroît convenir
davantage que les autres fels, pour que la cire
fe clarifie mieux: quatre onces de crème de. tartre
fuffifent fur un quintal de matière ; & ces fels ne doivent
pas être, regardés comme des fophiftications.
On gouverne la cire dans la cuve comme la première
fois; on l’y laiffe cependant moins long-tems. .Puis
on obferve ce qui a été dit cbdeffus pour la mettre
en rubans , l’arranger 6c gouverner fur les toiles , 6c
la remettre encore en tas dans le magafin.. ■.
Après quoi on lui donne une troifieme fonte, de
la même maniéré que la précédente. Quelques blan-
- chiffeurs y ajoutent aldrs trois^ à quatre pintes de
lait fur un millier de.cire ; ce qui occasionne dans la
Tome II.
cutfe un dépôt ou déchet plus confidéràble d’environ
dqux livres par cent de cire , que. lorfqu’on n’en met
pas ; mais il paroîr que la cire en eft mieux purifiée ;
ainfi on ne peut regarder cette autre pratique comme
une’ fophlftication. Pendant que le. dépôt fe forme ,
on emplit d eau la baignoire ; on y met fes planches
à pains ou à mouler , deftinés à mettre la cire en petits
pains enfuite on les arrange toutes mouillées
fur des ehaffis ou pieds de table, 6c on établit fous la
Cannelle de la cuve une paffoire, à .travers laquelle
la cire tombe, foit dans les. éculons * foit dans un
coffre de cuivre quarré long, dont les côtés font
garnis de cendre chaude fur la longueur. Lorfqu’il y
a dans ce coffre une Certaine quantité de cire,, on en
ouvre le robinet pour emplir des vaiffeaux à b ec,
nommés éculons, dont la forme varie, & quei’on va
fur le champ vtiider dans fes moules. .On releve
ces moules à melùre que la cire y eft congelée , 6c
on les met dans une-baignoire pleine d’eati, où les
pains fe détachent d’eux-piêmes 6c furnagent, 6c on
les enleve avec un tamis foncé de ficelle , pour les
porter fur les toiles. Ils y demeurent expofés à l’air ,
rangés fes uns à côtés des autres, pendant trois ou
quatre jours, ou même davantage , félon que le
tenus eft ferein ou couvert ; après quoi on a foin de
les enlever bien féchement, 6c les ferrer dans des armoires,
ou dans des tonneaux garnis de papier, afin
d’empêcher les ordures de s’attacher à la cire , & la
garantir du contact de l’air qui la jauniroir.
Elfe eft alors parfaitement clarifiée & blanche.'
Ce font ces pains que fes ciriers refondent pour faire
de la bougie, des cierges , &c. Foye^ Bougie &
CiERGES , Dictionnaire raifonné des Sciences,- 6cc.
Voye^-y aufli les planches qui concernent le blanchiment
des cires 6c Yart du Cirier, ( + )
* Ujienjîles néceffaires,pour la purification & le blan-
chijfement delà cire. On ne trouve dans.fes planches
du Dicl. raif. des Sciences, 6cc. que quelques-uns de
ces uftenfiles : favoir,
La chaudière de cuivre à fondre la cire r A A A ,
La cuve ou gueulebée, qui eft une futaille enfoncée:
feulement par le bout d’en-bas B 6c C , avec fa
canelle de bois K 6c fa lancette 6 .
L’entonnoir de cuivre étamé , fig, 5 yn°, a , 6c le
pot aufli de cuivre étamé, Jzg. 5 , n°. j , ( pl. I I .y
La fpatule nommée palon pour braffer la cire pendant
qu’elle fond dans les chaudières,. fig. 4 , même
planche
.L’éculon de cuivre étamé ,' nommé mal-à propos
récuèllon,fig. 6 , même planche. C ’eft un vaiffeau de
cuivre étamé en-dedans, d’une forme ronde .par le
derrière, 6c plate fur ie devant, avec une ànfe cfe
chaque cô té, fervant à remplir les planches 011 moules
à pains. Cet eculon a deux becs : quelquefois on
ne lui en fait qu’un.
Le coffre à éculer, pl. I I I , fig. y.il eft de cuivre,
6c fert de réfervoir pour fournir de la cire aux ouvriers.
qui.viennent remplir leurs éculons.
Les chaflis pour éculer K L 6c R S,pl. Z4.
Les planches à pains, R , S ,p l. II.
Les baignoires pour, refroidir fubitement la dre
fondue, D , EfPl . I & I I .
La greloire (ou le greloir) garnie de toutes fes
pièces, pour greler ou rubanner la cire, c’eft-à-dire,
pour la réduire en forme de ruban étroit, femblable
au ruban nommèfaveur, par les marchandes de modes,
fig. 8,pl. III; 2 ,2 la greloire ; J , 4 la plaque;. J Ja paffoire
; a b ç c la chevrette pour mettre la greloire au-
deffus du tour.
Le tour ou cylindre de hois.établi lur la baignoire,
qu’on fait tourner pour rubanner la cire, H , H, planche
IL
I i i ij