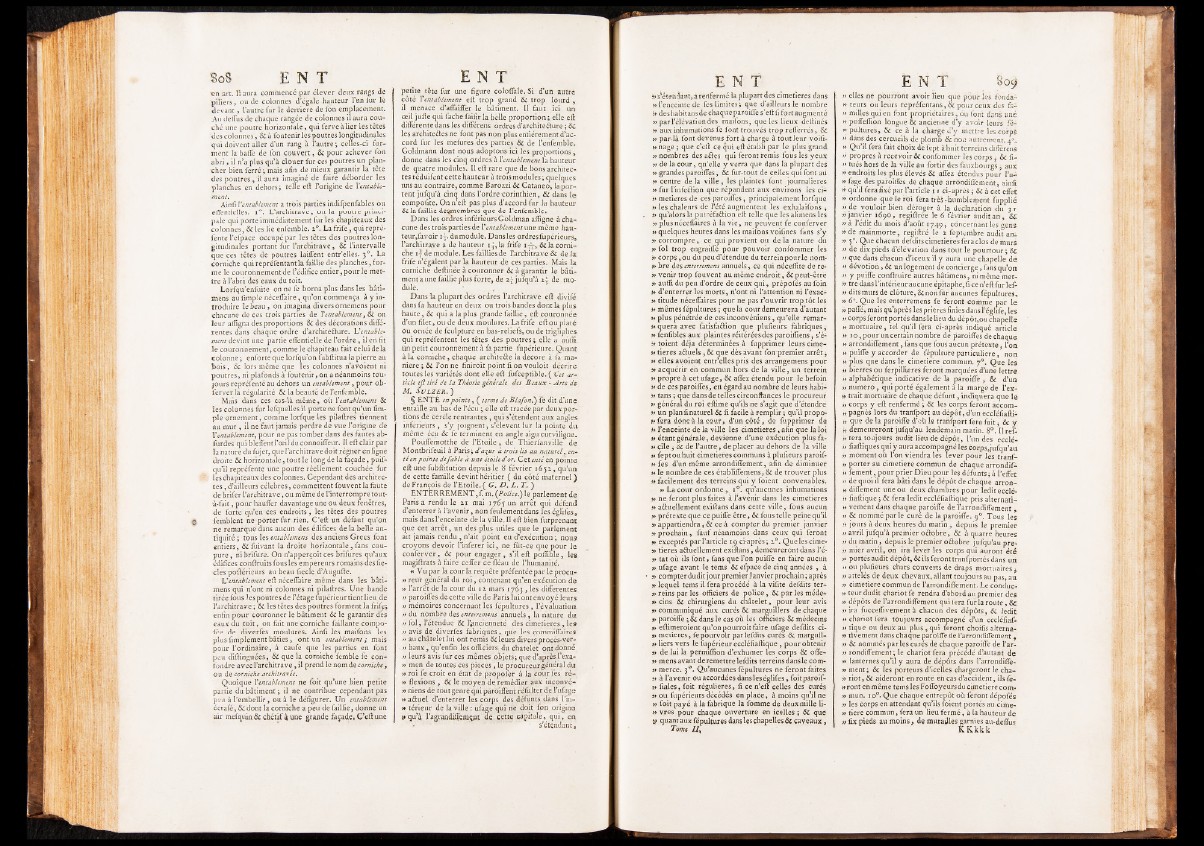
SoS ENT
x>n art. Il aura commencé par élever deux rangs de
.piliers, ou de colonnes d’égale hauteur l’an Bar le
•devant, l’autre fur le derrière de fon emplacement.
Au deffus de chaque rangée de Colonnes il aura couché
une poutre horizontale, qui ferveàlier les têtes
des colonnes, 8t à foütenirles poutres longitudinales
qui doivent aller d’un rang à l’autre ; celles-ci forment
la balfe de fön couvert, 8c pour achever fön
abri, il n’a plus qu’ à clouer fur ces poutres un plancher
bien ferré; mais afin de mieux garantir là tête
des poutres, il aura imaginé de faire déborder lès
planches en dehors; telle eft l’origine de l’entablement.
Ainfî Véritablement a trois partiès indifpenfables ou
effentielles. i° . L’architrave, ou la poutre principale
qui porte immédiatement fur les chapiteaux des
colonnes, & les lie enfembie. z°. La frife, qui repréfente
l’efpace occupé par les têtes dès poutres longitudinales
portant fur l’architrave, 8c l’intervalle
que ces têtes de poutres laiffent entr’elles. 30. La
corniche quirèpré'fentàntlà faillie des planches,forme
le couronnement de l’édifice entier, pour le mettre
à l’abri des eaux du toit.
Lorfqu’enfuite on ne fe borna plus dans les bâtî-
fiiens au fimple néceffairè, qu’on commença à y introduire
le beau, on imagina divers ôrnemens pour
chacune de ces trois parties de l’entablement, 8c on
leur affigna des proportions 8c des décorations différentes
dans chaque ordre d’arChitèfture. \Jentable-
ment devint une partie effentielle dé l’ordre , il ert fit
le couronnement, comme le chapiteau fait celui delà
colonne ; enforte que lorfqu’on fubftitua la pierre au
b o is , 8c lors même que les colonnes n’avoient ni
poutres , ni plafonds à foutenir, on a néanmoins toujours
repréfenté au dehors un entablement, pour ob-
ferver la régularité & la beauté de l’enfemble.
Mais dans ces cas-là même, oit l’entablement &
les colonnes fur lefquelles il porte ne font qu’ un fimple
ornement, comme lorfque les pilaftres tiennent
au mur , il ne faut jamais perdre de vue l’origine dé
Xentablement^ pour ne pas tomber dans des fautes âb-
furdes qui bleffent l’oeil du connoiffeur» Il eft clair par
la nature du fujet, que l’architrave doit régner en ligné
droite & horizontale, tout le long de la façade, puif-
qu’il repréfente une poutre réellement couchée fur
les chapiteaux des colonnes. Cependant des architectes
, d’ailleurs célébrés, commettent fou vent la faute
de brifer l’architrave, ou même de l’interrompre tout-
■ à-fait, pour hauffer davantage une ou deux fenêtres,
de forte qu’en ces endroits, les têtes des poutres
femblent ne porter fur rien. C ’ eft un défaut qu’on
ne remarque dans aucun des édifices de la belle antiquité
; tous les entablemens des anciens Grecs font
entiers, & fuivant la droite horizontale, fans coupure
, nibrifure. On n’apperçoit ces brifures qu’aux
édifices conftruits fous les empereurs romains des fie-
cles poftérieurs au beau fiecle d’Augufte.
L’entablement eft néceffaire même dans les bâti-
mens qui n’ont ni colonnes ni pilaftres. Une bande
tirée fous lès poutres de l’étage lupérieur tient lieu de
l’architrave ; 8c les têtes des poutres forment la frifi?;
enfin pour couronner le bâtiment & le garantir des
eaux du toit, on fait une corniche faillante compo-
fée de diverfes moulures. Ainfi les maifons les
plus fimplement bâties, ont un entablement ; mais
pour l’ordinaire, à caufe que les parties en font
peu diftinguées, 8c que la corniche femble fe confondre
avec l’architrave, il prend le nom de corniche,
ou de corniche architravée.
Quoique Ventablement ne foit qu’une bien petite
partie du bâtiment ; il ne contribue cependant pas
peu à l’embellir, ou à le défigurer. Un entablement
écrafé, 8c dont la corniche a peu de faillie, donne un
air mefquin 8c chétif 4 une grande façade« C ’eft une
E N T
petite tête fur une figure coloffale. Si d’un autre
côté Ventablement eft trop grand & trop lourd ,
il menace d’affaiffer le bâtiment. Il faut ici un
oeil jufte qui fâche faifir la belle proportion ; elle eft
différente dans les différens ordres d’architeûure ; 8c
les architeÛes ne font pas non plus entièrement d’accord
fur les mefures des parties 8c de l’enfemble.
Goldmann dont nous adoptons ici les proportions ,
donne dans les cinq ordres à Ventablement la hauteur
de quatre modules. Il eft rare que de bons architectes
réduifent cettehauteur à trois modules; quelques
uns au contraire, comme Barozzi 8c Cataneo, la portent
jufqu’à cinq dans l’ordre corinthien, 8c dans le
compofite. On n’eft pas plus d’accord fur la hauteur
8c la faillie de§membres que de l ’enfemble.
Dans les ordres inférieurs Goldman aflïgne à chacune
des trois parties de Ventablement une même hauteur
,favoir i f . dumodule. Dans les ordres fupérieurs,
l’architraye a de hauteur iÿ,Ia frife i~ , & la corniche
i f de module. Les faillies de Farchitrave 8c de la
frife n’égalent par la hauteur de ces parties. Mais la
corniche deftinée à couronner 8c à garantir le bâtiment
aune faillie plus forte, de 1 ~ juiqu’à z f de modulé.
• ,
Dans la plupart aès ordres l’architrave eft divifé
dans fa hauteur en deux ou trois bandes dont la plus
haute, 8c qui a la plus grande faillie, eft couronnée
d’un filet , ou de deux moulures. La frife eft ou platë
OU ornée de fculpture en bas-reliefs, ou de trigliphes
qui repréfentent les têtes des poutres; elle a aûfli
un petit couronnement à fa partie fupérieure. Quant
à la corniche, chaque architecte la décoré à' fa- maniéré
; 8c l’on ne finiroit point fi on vouloit décrire
toutes les variétés dont elle eft fufceptible. ( 'Cet article
ejl tiré de la Théorie générale des Beaux - Arts de
M. SULZER. )
§ ENTÉ en pointe, ( terme de Blafort,) fè dit d’une
entaillé au bas de l’éeu ; elle eft tracée par deux portions
de cercle rentrantes , qui s’étendent aux angles
inférieurs , s’y joignent, s’élèvent fur la pointe du
même écu 8c fe terminent en angle aigu curviligne.
Pouffemotthe de l’Etoile, de Thierfanville de
Montbrifeuil à Paris; d’azur à trois lis au naturel, ente
en pointe de fable a une étoiledVor. Cet enté en pointe
eft urte fubftitution depuis le 8 février 1652, qu’un
de cette famille devint héritier ( du côté maternel )
de François de l’Etoile. ( G. D . L. T. )
ENTERREMENT,f. m. (Police.') le parlement de
Paris a rendu le 21 mai 1765 un arrêt qui défend
d’enterrer à l ’avenir, non feulement dans les èglifes,
mais dans l’enceinte de la ville. Il eft bien furprenant
que cet arrêt, un des plus utiles que le parlement
ait jamais rendu , n’ait point eu d’exécution ; nou9
croyons devoir l’inferer ici, ne fut-ce que pour le
conferver, 8c pour engager , s’il eft poffible, les
magiftrats à faire ceffer ce fléau de l’humanité.
« Vu par la cour la réquête préfentée par le procu-
» reu'r général du ro i, contenant qu’en exécution de
» l’arrêt de la cour du 12 mars 1763 , les differentes
» paroiffes de cette ville de Paris lui ont envoyé leurs
» mémoires concernant les fépultures , l’évaluation
>> du nombre des enterremens annuels , la nature du
» fo l, l’étendue 8c l’ancienneté des cimètiei'es , les
» avis de diverfes fabriques, que les çommiffaires
b au châtelet lui ont remis 8c leurs divers procès-ver-
i » baux, qu’enfin les officièrs du çhatelet ont donné
» leurs avis fur ces mêmes objets; que d’après, l’exa-
» men de toutes ces pièces, le pr ocur eur général du
» roi fe croit en état de propofer à la cour fes ré-
» flexions , & le moyen de remédier aux inconvé-
» niens de tout genre qui pâroiffent réfiilter de Pufage
» aétuel d’enterrer les corps des défunts dans l’in—
» térieur de la ville : ufage qui ne doit; fon origine
if qu’à; lagraadifferasflt de cettq capitale, qui, en
. ‘ ' -.‘ A** **• s'étendant,
E N T
bs^étehdànt, a renfermé la plupart des cimetières dans
» l’enceinte de.fes limites; q,uè d’ailleurs le nombre
» des habitans de chaque paroiffe s’eft fi fort augmenté
» par l’élévation des maifons * que les lieux deftinés
» aux inhumations fe font trouvés trop refferrés, 8c
» par-là font devenus fort à charge à tout leur voifi-
» nage ; que c’eft ce qui eft établi par le plus grand
» nombres des aûes qui feront remis fous les yeux
» de la cour, qu’elle y verra que dans la plupart des
» grandes paroiffes, 8c fur-tout de celles qui font aii
» centre delà ville* les plaintes font journalières
» fur l’infeftion que répandent aux environs les ci-
» metieres de ces paroiffes, principalement lorfqiié
» les chaleurs de l’été augmentent les exhalaifons *
b qu’alors la putréfaction eft telle que les alimens les
» plus néceffaires à la v ie , ne peuvent fe conferver
» quelques heures dans les maifons voifines fans s’y
» corrompre, ce qui provient ou de la nature du
» fol trop engraiffé pour pouvoir confommer les
» corps ,011 du peu d’étendue du terreinpourle nom*
b bre des enterremens annuels * ce qui néceflite de re-
» venir trop fouvent au même endroit, 8c peut-être
» aufli du peu d’ordre de ceux qui, prépofés au foin
b d’enterrer les morts, n’ont ni l’attention ni l’exac-
» titude néceffaires pour ne pas r’ouvrir trop tôt les
b mêmes fépultures ; que la cour demeurera d’autant
» plus pénétrée de ces inconvéniens, qu’elle remar-
» quera avec fatisfadion que plufieurs fabriques ;
» fenfibles aux plaintes réitérées des paroiffiens, s’é-
» toient déjà déterminées à fupprimer leurs cime-
» tieres aCtuels, 8c que dès avant fompremier arrêt ;
» elles avoient entr’elles pris des arrangemens pour
b acquérir én commun hors de la ville, un terrein
» propre à cet ufage, & affez étendu pour le befoin
» de ces paroiffes, eti égard au nombre de leurs habi-
» tans ; qiie dans de telles çirconftances le procureur
>> général du roi eftime qu’ils ne s’agit que d’étendrë
» un plan fi naturel & fi facile à remplir ; qu’il propos
» fera donc à la cour, d’un côté * de fupprimer de*
h l’enceinte de la ville les cimetiereS, afin que la loi
» étant générale, devienne d’une exécution plus fa-
» cile * 6c de l’autre, de placer au dehors de la ville
» feptouhuit cimetières communs à plufieurs paroif-
» fes d’un même arrondiffement, afin de diminuer
» le nombre de ces établiffemens, & de trouver plus
» facilement des terreins qui y foient convenables.
» La cour ordonne, i° . qu’aucunes inhumations
»> ne feront plus faites à l’avenir dans les cimetières
» actuellement exiftans dans cette ville, fous aucun
» prétexte que ce puiffe être, & fous telle peine qu’il
» appartiendra * & ce à compter du premier janvier
» prochain, fauf néanmoins dans ceux qui feront
» exceptés par l’article 19 çi-après; 20. Que les cime*
*> tieres actuellement exiftans, demeureront dans l’é*
» tat oit ils font, fans que l’on puiffe en faire aucun
» ufage avant le tems & efpace de cinq années , à
» compter dudit jour premier Janvier prochain ; après
» lequel tems il fera procédé à la vifite defdits ter-
» reins par les officiers de police, & par les médê**
» cins & chirurgiens du châtelet, pour leur avis
» communiqué aux curés & marguillers de chaque
» paroiffe ; & dans le cas où les officiers 8c médecins
» eftimeroient qu’on pourroit faire ufage defdits ci-
» metieres, fe pourvoir par lefdits curés & marguil-
» liers vers le lupérieur eccléfiaftique, pour obtenir
» de lui la permiffion d’exhumer les corps 8c offe-
» mens avant de remettre lefdits terreins dans le com-
» merce. 30. Qu’aucunes fépultures ne feront faites
» à l’avenir ou accordées dans les églifes, foitparoif-
» fiales, foit régulières, fi ce n’eft celles des curés
» ou fupérieurs décédés en place, à moins qu’il ne
»> foit payé à la fabrique la fomme de deux mille li-
» vres pour chaque ouverture en icelles ; & que
ÿ quant aux fépultures dans les chapelles & caveaux,
Tome //,
E N T
» elles ne pourront avoir lieu que pour les fonda-
» teurs bu leurs repréfentanS, & pour ceux des fa-
» milles qui en font propriétairés, bu font dans uné
» poffeffion longue 8c ancienne d’y avoir leurs fé-
» piiltureâ, & ce à là charge d’v mettre les corpà
>> dans des cercueils de plomb & non autrement. 40;
» Qu’il fera fait choix de fept à huit tèrreins différens
>> propres à recevoir 8c confommer lés corps 9 8c fi-
» tués hors de la vijle au fortir des fàuxbburgs ; aux
>> endroits les plus élevés 8c âffez étèndus pour l’u-
» fage des paroiffes .de chaque arrondiffement; ainli
>> qu’il fera fixé par l’article 11 ciraprès ; & à cét effet
» ordonne que le rOi fera trèÜ.-humblement fupplié
» de vouloir bien déroger à la déclaration du 31
»janvier 169b, regiftrée le 6 février audit,an, 8c
» à l’édit du mois d’août 1749, concernant les gens
»de mainmorte; regiftré le 2 feptembre audit an;
» 5°. Que chacun defdits cimetières fera clos de murâ
» dé dix pieds d’élévation dâns tout le pourtour ; 8c
» que dans chacun d’iceiix il ÿ aura une chapelle dé
» dévotion, 8c un logement de concierge, fahs qu’on
» y puiffe çonftruire autres bâtimens, ni même met-
b tr e dans l’intérieur aucune épitaphe; fi ce n’eft fur lef-
» dits murs de clôture, & non fur aucunes fépultures.
» 6°. Que les enterremens fe feront comme par le
» paffé, mais qu’après les prières finies dans l’églife, les
»corps feront portés dahs le lieu du dépôt,ou chapelle
» mortuaire * tel qu’il fera ci-après indiqué article
» 10, pour un certain nombre de paroiffes de chaque
b arrondiffement, fans que fous aucun prétexte, l’on
» puiffe y accorder de fépulture particulière, non
» plus que dans l e . cimetiere commun. 70. Que les
» bierres ou ferpillieres feront marquées d’une lettre
» alphabétique indicative de la paroiffe ; & d’un
» numéro, qui porté également à la marge de f ex-
» trait mortuaire de chaque défunt, indiquera que lè
» corps y eft renfermé ; 8c les corps feront àccom-
»> pagnés lors du tranfport au dépôt * d’un ëccléfiafti-
» que de la paroiffe d’où le tranfport fera fait, 8c y
» demeureront jufqu’au lendemain matin. 8°. il ref-
» fera toujours audit lieu de dépôt, l’un des ecclé-
» fiaftiques qui y aura accompagné les corps,jufqu’aU
» moment où l’on viendra les lever pour les tranf-
» porter au cimetiere commun de chaque arrondif-
b fement, pour prier Dieu pour les défunts ; à l’effet
» de quoi il fera bâti dans le dépôt de chaque arron-
» diffement une ou deux chambres pour ledit ecclé-
>» fiaftique ; & fera ledit eccléfiaftiqùe pris aîternati-
» vement dans chaque paroiffe de l’arrondiffement ,
» 8c nommé par le curé de la paroiffe; 90. Tous les
» jours à deux heures du matin, depuis le premier
» avril jùfqu’à premier oftobre, 8c à quatre heures
b du matin ; depuis le premier oétobre jufqù’au pre-
b mier avril, on ira lever les corps qui auront été
b portés audit dépôt,&ilsferonttranfpbrtés dans un
» ou plufieurs chars couverts de draps mortuaires ;
» attelés de deux chevaux, allant toujours au pas, au
» cimetiere commun de l’arrondiffement. Le cônduc-
» teur dudit chariot fe rendra d’abord au premier des
» dépôts de l’arrondiffement qui fera fur la route , 8c
»ira fucceflivement à chacun des dépôts, & ledit
» chariot fera toujours accompagné d’un eCcléfia£
» tiqué ou deux au plus * qui feront choifis alterna-
» rivement dans chaque paroiffe de l’arrondiffement,
» 8c nommés par les cures de chaque paroiffe de Par-
» rbndiffement; le chariot fera précédé d’autant de
» lanternes qu’il y aura de dépôts dans l’arrondiffe-
» ment; & les porteurs d’icelles chargeront le cha-
b riot, 8c aideront en route eh cas d’accident, ils fe-
» ront en même tems les Foffoÿeùrsdu cimetiere com-
» mun. io°. Que chaque entrepôt où feront dépofés
» lés corps en attendant qu’ils loient portés au.cime-
» tiere commun, fera un lieu fermé, à la hauteur de
» fix pieds au moins, de murailles garnies au-deffus
K K k k k