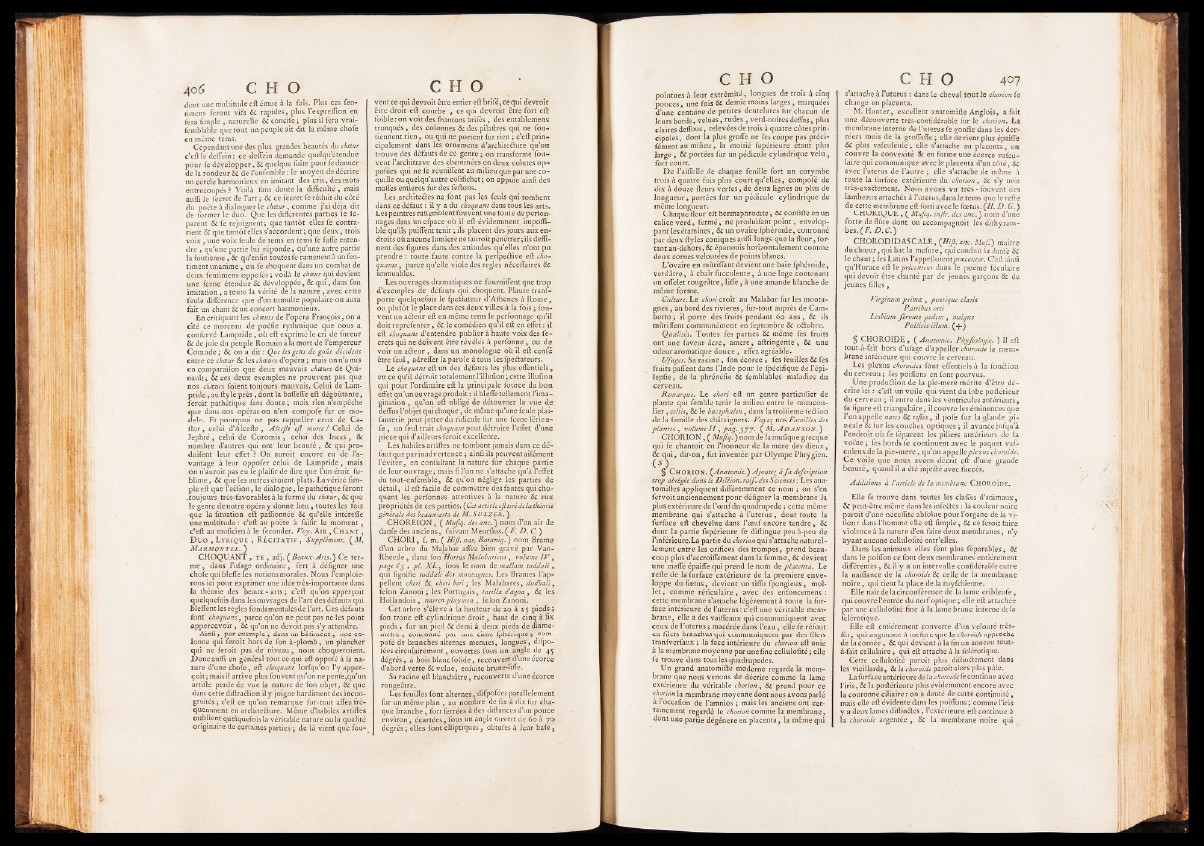
dont une multitude eft émue à la fois. Plus ces fen-
timens feront vifs & rapides, plus l’expreffion en
fera fimple , naturelle & concife ; plus il fera vraisemblable
que tout un peuple ait dit la même chofe
en même tems.
Cependant une des plus grandes beautés du choeur
c’ eft le deffein : ce deffein demande quelqu’étendue
pour fe développer, & quelque fuite pour fedonner •
de la rondeur & de l’enfemble : le moyen de décrire
un cercle harmonieux en imitant des cris, des mots
entrecoupés ? Voilà fans doute la difficulté , mais
auffi le fecret de l’art ; & ce fecret fe réduit du côté
du poëte à dialoguer le choeur y comme j’ai déjà dit
de former le duo. Que les différentes parties fe fé-
parent & fe rejoignent; que tantôt elles fe contrarient
& que tantôt elles s?accordent; que deux, trois
v o ix , une voix feule de tems en tems fe faffe entendre
, qu’une partie lui réponde, qu’une autre partie
la foutienne , & qu’enfin toutes fe ramènent à un fen-
timent unanime, ou fe choquent dans un combat de
deux fentimens oppofés ; voilà le choeur qui devient
une fcene étendue & développée, & q ui, dans fon
imitation, a toute la vérité de la nature , avec cette
feule différence que d’un tumulte populaire on aura
fait un chant & un concert harmonieux.
En critiquant les choeurs de l’opéra François, on a
cité ce morceau de poéfie rythmique que nous a
confervé Lampride, où eft exprimé le cri de fureur
& de joie du peuple Romain à la mort de l’empereur
Comode ; & on a dit : Que les gens de goût décident
entre ce choeur & les choeurs d’opéra ; mais on n’a mis
en comparaifon que deux mauvais choeurs de Qui-
nault ; & ces deux exemples ne prouvent pas que
nos choeurs foient toujours mauvais. Celui de Lampride
, au ftyle p rès, dont la baffeffe eft dégoûtante,
feroit pathétique fans doute ; mais rien n’empêche
que dans nos opéras on n’en compofe fur ce modèle.
Et pourquoi ne pas rappeller ceux de Ca-
fto r, celui d’Alcefte, Alcejle efl morte ! Celui de
Jephté, celui de Coromis , celui des Incas, &
nombre d’autres qui ont leur beauté , & qui pro-
duifent leur effet ? On auroit encore eu de l’avantage
à leur oppofer celui de Lampride, mais
on n’auroit pas eu le plaifir de dire que l’un étoit fu-
blime, & que les autres étoient plats. La vérité fimple
eft que l’a&ion, le dialogue, le pathétique feront
toujours très-favorables à la forme du choeur, & que
le genre de notre opéra y donne lieu , toutes les fois
que la fituation eft paffionnée & qu’elle intéreffe
une multitude : c’ eft au poëte à faifir le moment,
c’eft au muficien à le féconder. Voy. Air , C hant ,
D u o , Lyrique , R é c it a t i f , Supplément. {M.
M A RM O N T EL. )
CH OQUAN T, te , adj. ( Beaux-Arts.) Ce terme
, dans l’ufage ordinaire, fert à défigner une
choie qui bleffe les notions morales. Nous l’emploierons
ici pour exprimer une idée très-importante dans
la théorie des beaux - arts ; c’eft qu’on apperçoit
quelquefois dans les ouvrages de l’art des défauts qui
bleffent les réglés fondamentales de l’art. Ces défauts
font choquans, parce qu’on ne peut pas ne les point
appercevoir, & qu’on ne devoit pas s’y attendre.
Ainli , par exemple, dans un bâtiment, une colonne
qui feroit hors de fon à-plomb, un plancher
qui ne feroit pas de niveau, nous choqueroient.
Donc auffi en général tout ce qui eft oppofé à la nature
d’une chofe, eft choquant lorfqu’on l’y apperçoit;
mais il arrive plus fouvent qu’on ne penfe,qu’un
artifte perde de vue la nature de fon objet, &c que
dans cette diftra&ion il y joigne hardiment des incongruités;
c’eft ce qu’on remarque fur-tout affez fréquemment
en architecture. Même d’habiles artiftes
oublient quelquefois la véritable nature ou la qualité
originaire de certaines parties ; de là vient que fouvent
ce qui dévroit être entier eft brifé, ce qui devroit
être droit eft courbe , ce qui devroit être fort eft
foible: on voit des frontons brifés , des entablemens
tronqués, des colonnes & des pilaftres qui ne fou-
tiennent rien, ou qui ne portent fur rien ; c’eft principalement
dans les ornemens d’architefture qu’on
trouve des défauts de ce genre ; on transforme fou-
vent l’architrave des cheminées en deux volutes op-
pofées qui ne fe réunifient au milieu que par une coquille
ouquelqu’autre colifichet ‘9 on appuie ainfi des
maffes entières fur des feftons.
Les archite&es ne font pas les feuls qui tombent
dans ce défaut : il y a du choquant dans tous les arts.
Les peintres raffemblent fouvent une foule de perfon-
nages dans un efpace où il eft évidemment impoffi-
ble qu’ils puiffent tenir ; ils placent des jours aux endroits
où aucune lumière ne fauroit pénétrer ; ils deffi-
nent des figures dans des attitudes qu’elles n’ont pu
prendre : toute faute contre la perfpe&ive eft choquante
y parce qu’elle viole des réglés néceffaires, &
immuables.
Les ouvrages dramatiques ne fourniffent que trop
d’exemples de défauts qui choquent. Plaute transporte
quelquefois le fpeftateur d’Athenes à Rome ,
ou plutôt le place dans ces deux villes à la fois ; fouvent
un aûeur eft en même tems le perfonnage qu’il
doit repréfenter, & le comédien qu’il eft en effet : il
eft choquant d’entendre publier à haute voix des fe-
crets qui ne doivent être révélés à perfonne , ou de
voir un afteur , dans un monologue où il eft cenfé
être feul, adreffer la parole à tous les fpe&ateurs.
Le choquant eft un des défauts les plus effentiels ,
en ce qu’il détruit totalement l’illufion ; cette illufion
qui pour l’ordinaire eft la principale fource du bon
effet qu’un ouvrage produit : il bleffe tellement l’imagination
, qu’on eft obligé de détourner la vue de
deffus l’objet qui choque, de même qu’une feule plai-
fanterie peut j etter du ridicule fur une fcene fériéu-
fe , un feul trait choquant peut détruire l’effet d’une
piece qui d’ailleurs feroit excellente.
Les habiles artiftes ne tombent jamais dans ce défaut
que parinadvertence ; ainfi ils peuvent aifément
l’éviter, en confultant la nature fur chaque partie
de leur ouvrage; mais fi l’on ne s’attache qu’à l’effet
du tout-enfemble, & qu’on néglige les parties de
détail, il eft facile de commettre des fautes qui choquent
les perfonnes attentives à la nature & aux
propriétés de ces parties. {Cet article eft tiré delà théorie
générale des beaux-arts de M. Su LZ ER. )
CHOREION, ( Muftq. des anç. ) nom d’un air de
danfe des anciens, fuivant Meurfius.( F. D . C. )
CHORI, f. m. ( Hift. nat. Botaniq. ) nom Brame
d’un arbre du Malabar affez bien gravé par Van-
Rheede,' dans fon H or tus Malabàricus, volume IV y
page 8j , pl. X L , fous.le nom de mallam toddali >,
qui fignifie toddali des montagnes. Les Brames l ’appellent
chéri & chéri beri ; les Malabares, dudhali,
félon Zanoni ; les Portugais, tarilla d’agoa , &c les-
Hollandois , narren pluymen , félon Zanoni.
Cet arbre s’élève à la hauteur de zo à 25 pieds ;
fon tronc eft cylindrique droit, haut de cinq à fix
pieds , fur un pied & demi à deux pieds de diame-
metre, couronné par une cime fphérique, com-
pofé de branches alternes menues, longues, difpo-
lées circuîairement, ouvertes fous un angle de 45
dégrés, à bois blanc folide, recouvert d’une écorce
d’abord verte & velue, enfuite brune-liffe.
Sa racine eft blanchâtre, recouverte d’une écorce
rougeâtre.
Les feuilles font alternes, difp'ofées parallèlement
fur un même plan , au nombre de fix à dix fur chaque
branche, fort ferrées à des diftances d’un pouce
environ, écartées, fous un angle ouvert de 60 à 70
dégrés ; elles font elliptiques, obtufes à leur bafe a
pointues à leur extrémité, longues de trois à cinq
pouces, une fois & demie moins larges, marquées
d’une centaine de petites dentelures fur chacun de
leurs bords, velues, rudes , verd-noires deffus, plus
claires deffous, relevées de trois à quatre côtes principales,
dont la plus groffe ne les coupe pas préci-
fément au milieu , la moitié fupérieure étant plus
large, & portées fur un pédicule cylindrique v e lu ,
fort court.
De l’aiflelle de chaque feuille fort un corymbe
trois à quatre fois plus court qu’elles, compofé de
dix à douze fleurs vertes, de deux lignes au plus dé
longueur, portées fur un pédicule cylindrique de
même longueur.
Chaque fleur eft hermaphrodite, & confifte en un
calice verd, fermé, ne produifant point, enveloppant
les étamines, & un ovaire fphéroïde, couronné
par deux ftyles coniques auffi longs que la fleur, for^
tant au-dehors,& épanouis horizontalement comme
deux cornes veloutées de points blancs.
L’ovaire en mûriffant devient une baie fphéroïde,
verdâtre, à chair fucculente, à une loge contenant
un offelet rougeâtre, liffe, à une amande blanche de
même forme.
Culture. L e chori croît au Malabar fur les montagnes
, au bord des rivières, für-tout auprès de Cam-
botto ; il porte des fruits pendant 60 ans, & ils
mûriffent communément en feptembre & oCtobre.
Qualités. Toutes fies parties & même fes fruits
ont une faveur âcre, amere, aftfingente , & une
odeur aromatique douce , affez agréable.
Ufages. Sa racine, fon é corce, fes feuilles & fes
fruits paffent dans l’Inde pour le fpécifique de l’épi—
lepfie, de la phrénéfie & femblables maladies du
cerveau.
Remarque. Le chori eft un genre particulier de
plante qui femble tenir le milieu entre le micacou-
lie r , celtisy & le bucephalen, dans la troifieme feâiori
de la famille des châtaigners. Voye^ nos Familles des
plantes , volume I L , pug. 3 J J . ( M. A d a n s o n . )
CHOR ION , ( Muftq. ) nom de la mufique grecque
qui fe chantoit en l’horineur de la mere des dieux,
& qui, dit-on, fut inventée par Olympe Phrygien.
■ H ,
§ CHORION. {Anatomie?) Ajoute* a fa defeription
trop abrégée'dans le Diction, raif. des Sciences: Les ana-
tomiftes appliquent différemment ce nom ; on s’en
fervoit,anciennement pour défigner la membrane la
plus extérieure de l’oeuf du quadrupède ; cette même
membrane qui s’attache à l’uterus, dont toute la
furface eft chevelue dans l’oeuf encore tendre, &
dont la partie fupérieure fe diftingue peu à-peu de
l’inférieure.La partie du chorion qui s’attache naturellement
entre les orifices des trompes, prend beaucoup
plus d’accroiffement dans la femme, & devient
une malle épaiffe qui prend le noih de placenta. Le
refte de la furface extérieure de la première enveloppe
du foetus, devient un tiffu fpongieux, mollet
y comme réticulaire, avec des enfoncemens :
cette membrane s’attache légèrement à toute la fur-
face intérieure de l’uterus : c’eft une véritable membrane,
elle a des vaiffeaux qui communiquent avec
ceux de l ’uterus ; macérée dans l’eau, elle fe réfout
en filets branchus qui communiquent par des filets
tranfverfaux ; la face intérieure du chorion eft unie
à la mçmbrane moyenne par une fine cellulofité ; elle
fe trouve dans tous les. quadrupèdes.
Un grand anatomifte moderne regarde la membrane
que nous venons de décrire comme la lame
extérieure du véritable chorion, & prend pour ce
chorion la membrane moyenne dont nous avons parlé
a l’occafion de l’amnios ; mais les anciens ont certainement
regardé le chorion comme la membrane,
dont une partie dégénéré en placenta, la même qui
■ s’attache à l’uterus : dans le cheval tout le chorion fe
change en placenta.
M. Hunter, excellent anatomifte Anglois, a fait
une découverte très-confidérable fur le chorion. La
membrane interne de l’ùterus fe gonfle dans les der^
niers mois de la groffeffe ; elle devient plus épaiffe
& plus vafculeufe ; elle s’attache au placenta, en
couvre la convexité & en forme une écorce vafeu-
laire qui communique avec le placenta d’un côté, Sc
avec i’uterus de l’autre ; elle s’attache de même à
toute la furface extérieure du chorion, & s’y unit
tres-èxaâément. Nous avons vu très - fouvent des
lambeaux attachés à l’utéru-s,dans le tems que le refte
de cette membrane eft forti avec le foetus, ( il. D . G .j
CHORIQUE, ( Muftq. inftr. des anc. ) nom d’une
forte dé flûte dont on accompagnoit les dithyrambes.
(F . D .C .)
CHORODIDASCALE, {Hift. artc. Muf. ) maître
du choeur, qui bat la mefure, qui conduit la danfe &
léchant ; les LatinsTappelloient^nece/ziror. C’ëft ainfi
qu’Horace eft le précenteur dans le poëme féculaire
qui devoit être chanté par de jeunes garçons & dé
jeunes filles,
Virginum primee , puérique clans
Patribüs orti
Lesbium fervate pedem , meique
Pollicis ictum. (-f>)
§ CHOROÏDE, ( Anatomie. Phyfiologit, ) Il eft
tout-à-fait hors d’ufage d’appeller choroïde la memr
brane intérieure qui couvre le cerveau.
Les plexus choroïdes font effentiels à la fon&ion
du cerveau ; les poiffons en font pourvus.
Une produ&ion de la pie-mere mérite d’être décrite
ici : c’eft un voile qui vient du lobe poftérieur
du cerveau ; il entre dans lés véntricuies antérieurs:,
fa figure eft triangulaire, il couvre les éminences que
l’on appelle nates 6c teftes, il pofe fur ia glande pi-
néale & fur les couches optiques ; il avance jufqu’à
l’endroit où fe féparent les piliers antérieurs de la
voûte ; fes bords fe continuent avec le paquet vaf-
culeux de la pie-mere, qu’on appelle plexus choroïde.
Ce voile que nous avons décrit eft d’une grande
beauté, quand il a été injeélé avec fuccès.
Additions a P article de la membrane CHOROÏDE.
Elle fe trolive dans toutes les claffes d’animaux,
& peut-être même dans ïes infeûes : la couleur noire
pàroît d’une néceffîté abfolue pour l’organe de la vi-
fion : dans l’hommé elle eft fimple j & ce feroit faire
violence à la nature d’en faire deux membranes, n’y
ayant aucune cellulofité entr’elles.
Dans les animaux elles font plus féparables, &
dans le poiffon ce font deux membranes entièrement
différentfes, & il y a un intervalle confidérable entre
la naiffance de la choroïde & celle de la membrane
noire, qui tient la place de la ruyfchienne.
Elle naît de la circonférence de la lame cribleufe,
qui couvre l’entrée du nerf optique; elle eft attachée
par une cellulofité fine à la laine brune interne delà
fdérotique.
Elle eft entièrement couverte d’un velouté très-
fin , qui augmente à mefure que la choroïde approche
de la cornée , & qui devient à la fin un anneau tout-
à-fait cellulaire, qui eft attaché à la fdérotique.
Cette cellulofité paroît plus diftin&ement dans
les vieillards, & la choroïde paroît alors plus pâle.
La furface antérieure delà choroïde fe continue avec
l’iris, & la poftérieure plus évidemment encore avec
la couronne ciliaire : on a douté de cette continuité,
mais elle eft évidente dans les poiffons ; comme l’iris
y a deux lames diftinde's, l’extérieure ,eft continue à
la choroïde argentée, & la membrane noire qui