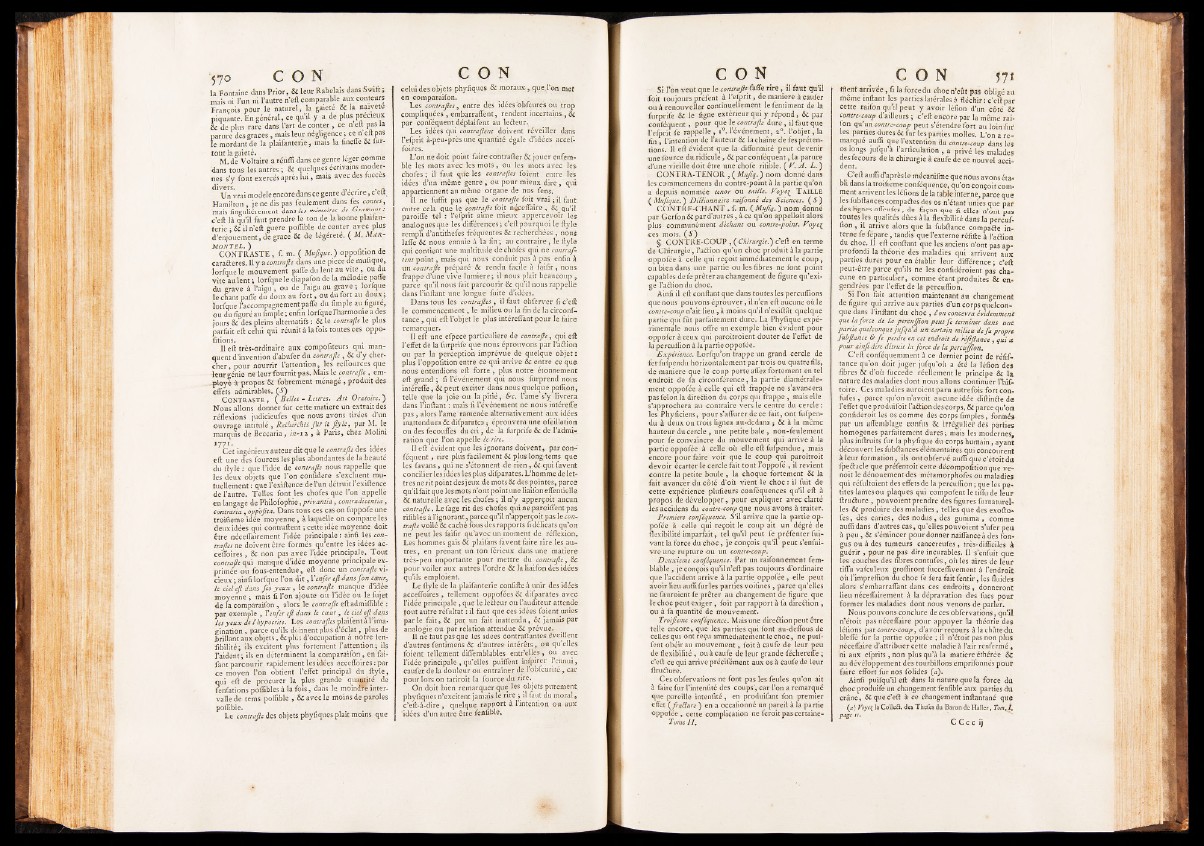
la Fontaine dans P rior, & leur Rabelais dans Swift ;
mais ni l’un ni l’autre n’eft comparable aux conteurs
François pour le naturel, la gaieté 8ç la naivete
piquante. En général, ce qu’il y a de plus précieux
& de plus rare dans l’art de conter , ce n eft pas la
parure des grâces, mais leur négligence; ce n’eftpas
le mordant de la plaifanterie, mais la finefle 8c lur-
toüt la gaieté.
M. de Voltaire a réuffi dans ce genre leger comme
dans tous les autrfes ; & quelques écrivains mo er-
nes s’y font exercés après lu i, mais avec des lucces
divers. „ , . , n
Un vrai modèle encore dans ce genre d écrire, c elts
Hamilton, je ne dis pas feulement dans fes conus,
mais lînguliérement dans les mémoires de Gramont :
c’eft là qu?il faut prendre le ton de la bonne plaifan-
terie ; 8c il n’eft guere poffible de conter avec plus
d’enjouement, de grâce 8c de légèreté. ( M. Mar-
MONTEL. )
CONTRASTE, f. m. ( Mufiquc.) oppofition de
carafteres. Il y a contrajle dans une piece de mufique,
lorfque le mouvement paffe du lent au vite , ou du
vite aillent ; lorfque le diapafon de la mélodie paffe
du grave à l’aigu , ou de l’aigu au grave ; lorfque
léchant paffe du doux au fo r t , ou du fort au doux;
lorfque l’accompagnement paffe du fimple au figure,
ou du figuré au fimple ; enfin lorfque l’harmonie a des
jours & des pleins alternatifs : & le contrajle le plus
parfait efl celui qui réunit à la fois toutes ces oppo-
fitions. . • ' •
Il eft très-ordinaire aux compouteurs qui manquent
d’invention d’abufer du contrajle , & d y chercher,
pour nourrir l’attention, les reffources que
leur génie ne leurfournit pas. Mais le contrajle , em-
à--propos-■ & Tobrement ménagé , produit des
effets admirables. (S)
C O N T R A S T E , ( Belles - Lettres. Art Oratoire. )
Nous allons donner fur cette matière un extrait des
réflexions judicieufes que nous avons tirées d’un
ouvrage intitulé , Recherches fur le fy le , par M. le
marquis de Beccaria, in - J i , à Paris, chez Molini
^Cet ingénieux auteur dit que le contrajle des idées
eft une des fources les plus abondantes de la beaute
du ftyle : que l’idée de contrajle nous rappelle que
les deux objets que l’on confidere s’excluent mutuellement
' que l’exiftence de l’un détruit 1 exiftence
de l’autre. Telles font les chofes que l’on appelle
en langage de Philofophie ,privantia, contradicentia,
contraria, opp'ojîta. Dans tous ces cas on fuppofe une
.troifieme idée moyenne, à laquelle on compare lçs
deux idées qui contraftent ; cette idée moyenne doit
être néceffairement l’idee principale : ainfi. les con-
trajles ne doivent être formés qu’entre les idées àc-
ceffoires, 8c non pas avec l’idée principale. Tout
contrajle qui manque d’idée moyenne principale exprimée
ou fous-entendue, eft donc un contrajle vicieux
; ainfi lorfque l’on d it , Venfer ejl dans Jon coeur,
le ciel ejl dans fes yeux , le contrajle manque d’idée
moyenne ; mais fi l’on ajoute ou l’idée ou le fujet
de la comparaifon , alors le contrafte eftadmiffible :
par exemple , Venfer ejl dans le coeur, le ciel ejl dans
les yeux de C hypocrite. Les contrajles plaifent a l’imagination
, parce qu’ils donnent plus d’éclat, plus de
brillant aux objets, 8c plüs d’occupation à notre fen-
fibilité; ils excitent plus fortement l’ attention; ils
l’aident; ils en déterminent la comparaifon, en fai-
fant parcourir rapidement les idées acceffoires : par
ce moyen l’on obtient l’effet principal du ftyle,
qui eft de procurer la plus grande qua lité de
lenfations poffibles à la fois, dans le moindre intervalle
de tems poflible , 8c avec le moins de paroles
poffible.
Le contrajle des objets pbyfiques plaît moins que
c e lu i d e s objets pbyfiques 8c moraux-, qùe.l’on met
en comparaifon.
Les contrajles, entre dés idées ‘bbfcure's ou trop
compliquées , embarraffent, rendent incertains., &
par conféquent déplaifent au lefteur.
Les idées qui contrajlent doivent réveiller dans
l’efprit à-peu-près une quantité égale d’idées açcef-
foires.
L’on ne doit point faire contrafter & jouer enfem-
ble les mots avec les mots, ou les mots avec les-
chofes; il faut qife les contrajles foient entre les
idées d’un même genre, ou pour mieux dire , qui
appartiennent au même organe de nos fens.
Il ne fuffit pas que le contrajle foit vrai ; il faut
outre cela que le contrajle foit ngceflaire, 8c qu’il
paroiffe tel : l’efprit aime mieux appercevoir les
analogues que les différences; c’eft pourquoi le ftyle
rempli d’antithefes fréquentes 8c recherchées , nous
laffe 8c nous ennuie à la fin ; au contraire , le ftyle
qui contient une multitude de chofes qui ne contraftent
point, mais qui nous conduit pas à pas enfin à
un contrajle préparé & rendu facile à faifir, nous
frappe d’une vive lumière; il nous plaît beaucoup ,
parce qu’il nous fait parcourir & qu’il nous rappelle
dans l’inftant une longue fuite d’idées.
Dans tous les contrajles , il faut obferver fi c’eft
le commencement, le milieu ou la fin de la circonf-
tance, qui eft l’objet le plus intéreffant pour le faire
remarquer.
Il eft une efpece particulière de contrajle, qui eft
l’effet de la furprife que nous éprouvons par Paftion
ou par la perception imprévue de quelque objet :
plus I’oppofition entre ce qui arrive & entre ce que
nous entendions eft forte, plus notre étonnement
eft grand ; fi l’événement qui nous furprend nous
intéreffe, & peut exciter dans nous quelque paffion,
telle que la joie ou la pitié,. &c. l’ame s’y livrera
dans l’inftant : mais fi l’événement ne nous intéreffe
pas, alors l’ame ramenée alternativement aux idées
inattendues 8c difparates, éprouvera une ofcillation
ou des feeouffes du cri, de la furprife & de l’admi-,
ration que l’on appelle le rire.
Il eft évident que les ignorans doivent, par conféquent
, rire plus facilement & plus long-tems que
les fa vans, qui ne s’étonnent de rien , 8c. qui faven,t
concilier les idées les plus difparates.L’hommedelet-
tresneritpoint des jeux de mots & des pointes, parce
qu’il fait que les mots n’ont point une liaifon effentielle
8c naturelle avec les chofes ; il n’y appèrçoit aucun
contrajle. Le fage rit des chofes qui ne paroiffent pas
rifibles à l’ignorant, parce qu’il n’apperçoit pas le contrajle
voilé ôc caché fous des rapports fi délicats qu’on
ne peut les faifir qu’avec un moment de réflexion.
Les hommes gais 8c plaifans favent faire rire les autres,
en prenant un ton férieux dans une matière
très-peu importante pour mettre du contrajle, 8c
pour voiler aux autres l’ordre 8c la liaifon des idées
qu’ils emploient.
Le ftyle de la plaifanterie confifte à unir des idées
acceffoires , tellement oppofées 8c difparates avec
l’idée principale, que le leéleur ou l’auditeur attende
tout autre réfultat : il faut que ces idées foient unies
par le fait, 8c pat; un fait inattendu, 8c jamais par
analogie ou par relation attendue 8c prévue.
Il ne faut pas que les idées contraftantes éveillent
d’autres fentimens & d’autres- intérêts, ou qu’elles
foient tellement diffemblables entr’elles -, ou avec
l’idée principale , qu’elles puiffent infpirer l’ennui,
caufer de la douleur ou entraîner dp l’obfcurite, car
pour lors on tariroit la fource du rire.
On doit bien remarquer que les objets purement,
phyfiques n’excitent jamais le rire ; il faut du moral,
c’eft-à-dire, quelque, rapport à l’intention ou aux
idées d’un autre être fenfible.
Si l’on veut que le co/itrajle fktte rire, il faut qu’il
Toit toujours préfent à l’elprit, de maniéré à caufer
ou à renouveller continuellement lefemiment de la
furprife 8c le figne extérieur qui y répond, 8c par
conféquent, pour que 11 contrajle dure , il faut que
l’efprit fe rappelle, î° . l’événement, i°. l’objet, la
fin , l’intention de l’auteur 8c la chaîne de fes prétentions.
Il eft évident que la difformité peut devènir
une fource du ridicule, & par conféquent, la parure
id’une vieille doit être une chofe rifible. ( V. A . L . )
CONTRA-TENOR , ( Mujîq. ) n o m d o n n é d a n s
l e s c o m m e n c em e n s d u c o n t r e - p o i n t à l a p a r t i e q u ’o n
a d e p u i s n o m m é e ténor o u taille. Voyeç T a i l l e
( Mufique. ) Dictionnaire raifonné des Sciences. ( S )
CONTRE-CHANT, f. m. (Mujîq. ) nom donné
par Gerfon 8c par d’autres, à ce qu’on appelloit alors
plus communément déchant ou contre-point. Voye£
■ ces mots. ^(«S)
§ CONTRE-COUP, ( Chirurgie.') c’eft en terme
de Chirurgie , l’a&ion qu’un choc produit à la partie
-oppofée à celle qui reçoit immédiatement le coup,
ou bien dans une partie ou les fibres ne font point
capables de fe prêter au changement de figure qu’exige
raétiondu choC.
‘ Ainfi il eft confiant que dans toutes les percuffions
que nous pouvons éprouver, il n’en eft aucune oii le
contre-coup n’ait lieu, à moins qu’il n’exiftât quelque
partie qui fût parfaitement dure. La Phyfique expérimentale
nous offre un exemple bien évident pour
oppofer à ceux qui paroîtroient douter de l’effet de
la percuflion à la partie oppofée.
Expérience. Lorfqu’on frappe un grand cercle de
fer fufpendu horizontalement par trois ou quatre fils,
de maniéré que le coup porte affez fortement en tel
endroit de la circonférence, la partie diamétralement
oppofée à celle qui eft frappée ne s’avancera
pas félon la direéfion du corps qui frappe , mais elle
s’approchera au contraire vers le centre du cercle :
les Phyficiens, pour s’affurer de ce fait, ont fufpendu
à deux ou trois lignes au-dedans , & à la même
hauteur du cercle , une petite baie, non-feulement
pour fe convaincre du mouvement qui arrive à la
partie oppofée à celle oh elle eft fufpendue, mais
encore pour faire voir que le coup qui paroîtroit
devoir écarter le cercle fait tout l’oppofé , il revient
contre la petite boule , la choque fortement & la
fait avancer du côté d’où vient le choc : il fuit de
cette expérience plufieurs conféquences qu’il eft à
propos de développer, pour expliquer avec clarté
lesaccidens du contre-coup que nous avons à traiter.
Première conféquence. S’il arrive que la partie oppofée
à celle qui reçoit le coup ait un dégré de
flexibilité imparfait, tel qu’il peut fe préfenter fui-
vant la force du choc, je conçois qu’il peut s’enfui-
vre une rupture ou un contre-coup.
Deuxieme conjéquence. Par un raifonnement fem-
blable, je conçois qu’il n’eft pas toujours d’ordinaire
que l’accident arrive à la partie oppofée, elle peut
avoir lieu auffi fur les parties voifines , parce qu’elles
ne fauroient fe prêter au changement de figure que
le choc peut exiger , foit par rapport à fa dire&ion ,
ou à fa quantité de mouvement.
Troifieme conféquence. Mais une direâion peut être
telle encore, que les parties qui font au-deffous de
celles qui ont reçu immédiatement le choc, ne puiffent
obéir au mouvement, foit à caufe de leur peu
de flexibilité , ou à caufe de leur grande féchereffe ;
c’eft ce qui arrive précifément aux os à caufe de leur
ftruélure.
Ces obfervations ne font pas les feules qu’on ait
à faire fur l’intenfité des coups', car l’on a remarqué
que pareille intenfité, en produifant fon premier
effet (jfracture ) en a occafionné un pareil à la partie
oppofée , cette complication ne feroit pas certaine-
Tome I I ,
nient arrivée, fi la forcedü choc n’eût pas obligé aü
ihême inftant les parties latérales à fléchir: c’eftpat
cette raifon qu’il peut y avoir léfion d’un côté St
contrecoup d’ailleurs 5 c'eft encore par la même ration
qu'un.contrecoup peut s’étendre fort au loin litf
■ les parties dures & fur les partiës molles. L’on a re»
marque auffi que l’extention du contrecoup dans les
os longs jufqu’à l’articulation , a privé lés malades
des fecours de la chirurgie 4 caufe de ce nouvel acci-
dent. .
C’eft auffi d’après le mécânifffle que nous avons éta*
blidans la troifieme conféquence, qu’on conçoit com*
ment arrivent les léfions de la table interne, parce que
les fubftancescompades des os n’étant unies que par
des Hgnes offeufes, de façon que fi elles n’ont pas
toutes les qualités dues à la flexibilité dans la percuf.
fion , il arrive alors que la fubftance compare interne
fe fépare, tandis que l’externe réfifte à l’a&ion
du choc. Il eft confiant qüe les anciens n’ont pas ap*
profondi la théorie des maladies qui arrivent aux
parties dures pour en établir leur différence ; c’eft
peut-être parce qu’ils ne les confidéroient pas chacune
en particulier, comme étant produites & engendrées
par l’effet de la percuflion.
Si l’on fait attention maintenant au changement
de figure qui arrive aux parties d’un corps quelconque
dans l’inftant du chod , l'on concevra évidemment
que la force de la percufjion peut f e terminer dans une
partie quelconque ju fq u à un certain milieu de fa proprt
fubftance & f e perdre en cet endroit de rèjîflance , qui a
pour ainfi dire détruit la force de la percufjion.
C’eft conféquemment à ce dernier point de téfiC»
tance qu’on doit juger jufqu’oîi a été la léfion des
fibres & d’où fuccede réellement le principe & la
nature des maladies dont nous allons continuer l’hif-
toire. Ces maladies auroient paru autrefois fort con-
fufes , parce qu’on n’avoit aucune idée diftin&e de
l’effet que produifoit l’attion des corps, & parce qu’on
confidéroit les os comme des corps Amples, formés
par un affembtage confus & irrégulier des parties
homogènes parfaitement dures ; mais les modernes,
plus inftruits fur la phyfique du corps humain, ayant
découvert les fubftances élémentaires qui concourent
à leur formation, ils ont obfervé auffi que c’étoit du
fpeétacle que préfentoit cette decompofition que ve-
noit le dénouement des métamorphofes ou maladies
qui réfultoient des effets de la percuflion ; que les petites
lames ou plaques qui compofent letiffude leur
ftrufture , pouvoient prendre des figures furnaturel-
les & produire des maladies , telles que des exofto-
fes, des caries, des nodus , des gumma , comme
auffi dans d’autres cas, qu’elles pouvoient s’ufer peu
à peu, & s’émincer pour donner naiflance à des fon-
gus ou à des tumeurs cancereufes , très-difficiles à
guérir , pour ne pas dire incurables. Il s’enfuit que
les couches des fibres contufes, où les aires de leur
tiffu vafculeux grofliront fucceflivement à l’endroit
où l’impreflion du choc fe fera fait fentir, les fluides
alors s’embarraffant dans ces endroits, donneront
lieu néceffairement à la dépravation des fucs pour
former les maladies dont nous venons de parler.
Nous pouvons conclure de ces obfervations, qu’il
n’étoit pas néceffaire pour appuyer la théorie des
léfions par contre-coup, d’avoir recours à la chute du
bleffé fur la partie oppofée ; il n’étoit pas non plus
péceflaire d’attribuer cette maladie à l’air renfermé ,
ni aux efprits , non plus qu’à la matière éthérée 8c
au dévéloppement des tourbillons emprifonnés pour
faire effort fur nos folides (à).
Ainfi puifqu’il eft dans la nature que la force dù
choc produife un changement fenfible aux parties du
crâne, 8c que c’eft à ce changement inftantané que
(a) Voye\_ la Colleft. des Thefes du Baron de Haller, Tom,J,