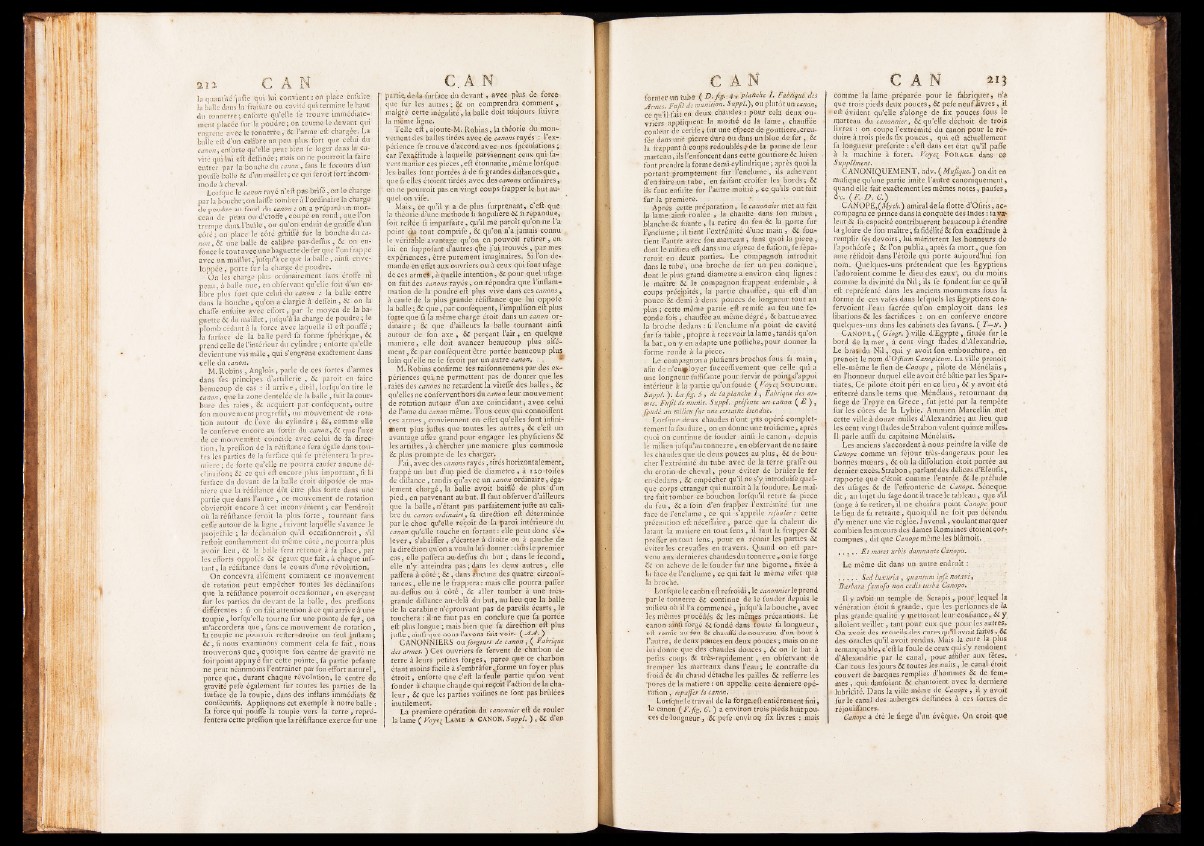
la quantité'jufte qui lui convient : on 'place enfuite
la balle dans la fraifure ou cavité qui termine le haut
du tonnerre ; enforte qu’elle le trouve immédiate-:
ment placée fur la poudre; on tourne le devant qui
engrene avec le tonnerre-, & l’arme eft chargée. La
bafle eft d’un calibre un peu plus' fort que celui du
canon, enfôrte qu’ elle peut- bien fe loger dans la- cavité
qui lui eft de'ftiné'e ; mais on ne pourroit la faire
entrer par la bouche du canon, fens le fecours d un
pouffe-balle & d’un maillet; ce qui feroit fort incommode
à cheval.’ t t , « /, -
Lorfque le canon rayé n’eft pas brife, On le charge
par la bouche ; on laiffe tombera l’ord'inairela charge
de poudre au fond du cation ; on a préparé u n mon- ,
ce au de peau ou'd’étoffe, coupé’en rond yqtie l’on
trempe dans. Hittite, ou1 qu’on-enduit de graillé d’un
côté; on place1 le côté gt’aiffé fur la bouche du canon
, & une balle de calibre par-deffus, & on en--
fonce le tout avec une baguette de- fer que l’on frappe
avec un mailletjü-fqu’à ce que la balle, ainfi enveloppée
, porté fur la charge de’ poudre. ^ ■
; On leS charoe plus ordinairement fans étoffe ni
peau, à balle nue, en obfervant qu’elle foit d’un calibre
plus fort que celui du canon : là balle entre
dans la bouche, qu’on a élargie à deffein, & on là
chaffe enfuite avec effort, par le moyen de la baguette
& du maillet, jufqu’à la charge de poudre ; le
plomb cédant à la force avec laquelle il eft pouffé ;
la furface dé la balle perd fa forme fphérique, &
prend celle de l’intérieur du cylindre ; enfôrte qu’elle
devient une vis mâle, qui s’engrene exactement dans
celle du canon.
M. Robins, Anglois, parle de ces fortes d’armes
dans les principes d’artillerie , & paroît en faire
beaucoup de cas : il arrive , dit-il ^ lorfqu’on tire le
cation j que la zone dentelée de la balle, luit la courbure
des raies, Sc acquiert pat conféquent, outre
fon mouvement progreffif, un mouvement de rotation
autour de l’axe du cylindre comme elle
le conferve encore au for tir du canon, & que l’axe
. de ce mouvèmfcnt coïncide avec celui de fa direction
, la preffion de la réfiftance fera égale dans toutes
les parties de la furface qui fe pVél'entera la première
; de forte qu’ellç ne pourra caufer aucune dé-
clinaifon; &: ce qui eft encore plus-important, li là
furface du devant de la balle étoit dilpoféè de maniéré
que la réfiftance dût être plus forte dans une
partie que dans l’autre , ce mouvement de rotation
obvieroit encore à cet inconvénient ; car l’endroit
oîi la réfiftance feroit la plus forte , tournant fans
ceffe autour de la ligne ,-fuivant laquelle s’avance le
projeûile ; la déclinaifon qu’il occafionneroit, s’il
reftoit conftamment du même cô té, ne pourra plus
avoir lieu, & la balle fera retenue,à fa place, par
lès efforts oppofés & . égaux que fait, à chaque inf-
tant, la réfiftance dans le cours d’une révolution.
On concevra aifément comment ce mouvement
de rotation peut empêcher foutes les déclinaifons
que la réfiftance pourroit occafionner, en exerçant
fur les parties du devant de là balle, des preflions
différentes : fi on fait attention à ce qui arrive à une
toupie, lorfqu’elle tourne fur une pointe de fer, on
m’accordera que, fans ce mouvement de rotation,
la toupie ne pourroit refter*droite un feul inftant;
& , fi nous examinons comment cela fe fa it, nous
trouverons que, quoique fon centre de gravité ne
foitpoint appuyé fur cette pointe, fa partie pefente
ne peut néanmoins l’entraîner par fon effort naturel,
parce que, durant chaque révolution, le centre dè
gravité pelé également fur toutes les parties de là
furface de la toupie, dans des inftans immédiats &
confécutifs. Appliquons cet exemple à notre balle :
la force qui pouffe la toupie vers la terre , repré-
fentera cette preffion que la réfiftance exerce fur une
partît de-la furfaèe du devant, avec plus de force
que fur les autres ; §C on comprendra comment,
malgré cette inégalité ,1a balle doit toujours fuivre
la même ligne.
Telle eft » ajoute-Mi Robins , la théorie du mou*-
vêment des-balles tirées avec de ca/ions rayés ^l’expérience
fe trouve d’accord avee-nôs fpééwlations ;
car l’exaélitude à laquelle parviennent ceux-qui fa-
vent manier ces pièces, eft étonnante, même lorfque
les balles font portées à dé fi grandes diftances que,
que fi elles étoient tirées, avec des canons ordinaires,
on ne pourroit pas en Vingt coupsfrappér le)but auquel
on vifie.
Mais,, ce qu’il y; a de plus furprenaftty c ’efh que
la théorie dhine méthode fi-fingufiere & fi répandue,
foit reftée fi imparfaite, qu’il me paroît qu’on ne l’a
point du tout comprife, & qu’on n’a .jamais connu A
le vérirable avantage qu’on en pouvoit retirer,.en:
lui en fuppofant d’autres que j’ai, trouvés , par mes-
expériences, être purement imaginaires. SiTonde-
mande en effet aux ouvriers ou à ceux qui font ufage
de ces armeS,/à quelle intention', & pour quel ufage
on fait des canons rayés , on répondra que ^inflammation
d e la’ poudre eft plus vive dans ces canons,
à caufe de la plus grande réfiftance que lui oppofe
la balle ; & que, par conféquent, l’impulfion eft plus,
fofte que fi la même charge étoit, dans vin. canon ordinaire
; & que d’ailleurs la balle tournant ainfi
autour de fon axe , & perçant l’a i r , en quelque
maniéré, elle doit avancer beaucoup plus aifément
, & par conféquent être portée beaucoup plus
loin qu’elle ne le feroit par un autre canon. . W
M. Robins confirme fes r-aifonnemens par des expériences
qui, ne permettent pas de douter que les
. raies des canons ne retardent-la vîteffe des balles, &
qu’elles ne cônferventhors du canon leur mouvement
de rotation autour d’un axe coïncidant, avec celui
de l’ame du canon même. Tous ceux qui connoiffent
ces armes, conviennent en - effet qu’elles font infiniment
plus juftes que toutes les autres, & c’eft un
avantage allez grand pour engager les phyficiens &£
les artiftes, à chercher une maniéré plus commode
& plus prompte de les charger.
J’a i, avec des canons rayés, tfrés horizontalement*
frappé un but d’un pied de diamètre, à izo'toifes
de diftance , tandis qu’avec un canon ordinaire, également
chargé, la balle avoit baiffé de plus'd’un
pied, en parvenant au-but. Il faut obferver d’ailleurs
que la balle, n’étant pas parfaitement jufte au calibre
du canon ordinaire, fa direâion eft déterminée
par le choc qu’ elle reçoit de la-paroi intérieure du
canon qu’elle touche en fortant : elle peut donc s’é-
lev er, s’abaiffer, s’écarter à droite ou à gauche de
la dire&ion qu’on a voulu-lui donner : dans le premier
cas, elle pafléra au-deffus du but ; dans le fécond,
elle n’y atteindra pas ; dans les deux autres, elle
paffera à côté ; & , dans mienne des quatre cireonf-
tances, elle ne le frappera: mais-elle pourra paffer
au-deffus ou à côté , & aller tomber à* une très-
grande diftance au-delà du but, au lieu que la balle
de la carabine n’éprouvant pas de pareils écarts, le
touchera : il ne faut pas en conclure que fa portée
eft plus longue ; mais bien que fa- dire&ion eft plus
jufte, ainfi que nous l’avons fait voir. ( A A . )
CANONNIERS ou forgeurs de canon, ( Fabrique
des armes. ) Ces ouvriers fe fervent de charbon de
terre à leurs petites forges , parce que ce charbon
étant moins facile à s’embrâfer.forme un foyer plus
étroit, enfôrte que c’eft la feule partie qu’on veut
fouder à chaque chaude qui reçoit l’a&ion de la chaleur
, & que les parties voifines ne font pas brûlées
inutilement.' ^ j
La première opération du canonnier eft de rouler
la lame ( Voye^ Lame a canon, Suppl. ) , & d en
ferner un tube ( D . f ig .A t ß « '“ 1'* t. Êàbtiju«.-âcs
Arms. F u ß de munition. Suppl.), OU plutôt mcapon;
ce qu’il fait en deux chaudes-: po.uf cela deux ouvriers
appliquent la moitié de la lame, chauffée
couleur de cerife 5 fur une efpece de-gouttière,creu-
féè dans'unc pierre dure ou dans un bloe de.fer , &
la frappant à coups redoublés ,* de la panne.de leur
marteau , ils l'enfoncent dans cette gouttière & lui en
font prendre la forme demi-cylindrique ; apres.quoi la
portant ;promptement fur l’enclume, ils achèvent
d’en faire un tube g enfeifent croifer les bords ; &
ils font enfuite fur l’autre moitié ,> ce qu ils . ont feit
fur la premierê. . *- - . . r
Après cettfe préparation, le canonnier met au feu
la lame âinfir fouléè , la chauffe dans fon milieu ,
b lan c h e fu an te , la retire du feu & la porte fur
l ’enclume ; .il tient l’extrémité d’une main , & fou-
tient l’autre avec fon marteau , fans quoi la pièce ,
dont le miireu eft--dans une efpeee de fufioiï, fe.fépa-
feroit en deux parties.- Le compagnon introduit
dans le tube , une broche de fer un.peu conique’;
dont le plus grand diamètre a environ cinq lignes :
le maître &c le compagnon frappent ensemble, à
coups précipités, la partie chauffée, qui eft d’un
pouce & demi k deux pouces de. longueur, tout au
plus ; cette même partie eft remife au feu une fécondé
.fois , chàuffée au même dégré, & battue-avec
la broche* dedans : fi l’enclume n’a point de cavité
fur fa tàble , propre .à recevoir la lame, tandis qu’on
la bat, on y en adapte une poftiche,pour donner la
forme ronde à la pièce.
. Le. compagnon a plufietirs broches fous : fe , main,
afin de n’employer fucceffivement que celle qui a
une longueur, fuffifante pour fervir de poin^d’appui
intérieur k la partie qu’on foude ( Voye^Soudure,
Suppl. ). La fig. 5 , de la planche 1 , Fabrique des armes.
Fufil de munit-. Suppl, préfente un canon ( E ) ,
fpadé au milieu fur une certaine étendue.
• Lorfque deux chaudes n’ont pas opéré complet-
tement la foudure, on en donne.une troifieme, après
quoi on continue de fouder, ainfi le canon,- depuis
le milieu jufqu’au tonnerre, en obfervant de ne faire
les chaudes que de deux pouces au plus, & de boucher
l’extrémité du tube avec de la terre graffe ou
du crotin -de cheval, pour éviter de brûler le fer
en-dedans , & empêcher qu’il ne s’y introduife quelque
corps étranger qui nuiroit à la foudure. Le maître
fait tomber ce bouchon lorfqu’il retire fa piece
du feu , & a foin d’en frapper l’extrémité fur une
face de l’enclume ,. ce qui -s’appelle refouler : cette
précaution eft néceffaire, parce que la chaleur di»
ïatant la matière en tout fens ,.il faut la frapper &
preffer en tout fens, pour en réunir les parties &
éviter les crevaffes entravers. Quand on eft parvenu
aux dernieres chaudes du tonnerre, on le forge
& on achevé de le fouder fur une bigorne, fixée à
la face cle l’enclumè, ce qui lait le même effet que
la broche.
• Lorfque le canbn eft refroidi, le canonnier le prend
par le tonnerre & continue de le fouder depuis le
milieu oh il l’a commencé, jufqu’à la bouche, avec
• les mêmes procédés & les-mêmes précautions. Le
canon aiftû forgé &foudé dans toute fa longueur,
eft remis au feu & chauffé de nouveau d’un bout à
l’autre, de-deux pouces en deux poncés ; mais on ne
iiii donne que des chaudes douces , & on le bat à
petits coups & très-rapidement, en obfervant de
tremper les marteaux dans l’eau; le contrafte du
•froid & du chaud détache les pailles & refferre les
'pores de la matière : on appelle cette dernière opération,
repaffer le canon. 1 ;
Lorfque le travail de la forge,eft entièrement fini,
le canon ( F.fig. 6". ) a environ trois pieds huit pou-
ces de-longueur , •& pefe -enviio® fix livres : mais
comme la îarfté préparée poui* lé fabriquer, ffâ
que trois pieds deux pouces, & pefe neuf liv res, il
-eft évident qu’elle s’alonge de fix pouces fous lô
marteau du canonnier, & qu’elle déchoit de trois
livres : on coupe l ’extrémité du canon pour le ré**
duire à trois pieds fix pouces, qui eft aâuellement
fa longueur preferite : c’eft dans Cet état qu’il paffe
à la machine à forer. Voye^ Forage dans cô
Supplément.
CANONIQUEMENT, adv. ( Mujique. ) on dit ert
mufique qu’une partie imite,l’autre canoniquement,
quand elle fait exactement les mêmes notes, paufes,
(F , D . C.)
GANOPE,(ïlfyrÀ.) amiral de là flotte d*Ofiris, ac*
compagna ce prince dans la conquête des Indes : fa va*
leur & fa: capacité contribuèrent beaucoup à étendrô
la gloire de fon maître ; fa fidélité & fon’ èxaâitude à
remplir fés devoirs, .lui méritèrent les honneurs de
l’apothéofe ; & l’on publia, après fa mort » que fon
ame réfidoit dans l’étoile qui porte aujourd’hui fon
nom. Quelques-uns prétendent que les Egyptiens
l’adoroient comme le dieu des eaux*, ou du moins
comme la divinité du Nil ; ils fe fpndent fur ce qu’il
eft repréfenté dans les anciens monumens fous là
forme de ces vafes dans lefquels les Egyptiens con-
fervoient l’eau facrée qu’On employoit dans les
libations & les facrifîces : on en conferve encore
quelques-uns dans les cabinets des favans. ( T— N. )
C a-nope , ( Géogr* ) ville d’Egypte , fituée fur le
bord de la mer, à cent vingt ftades d’Alexandrie»
Le brasedu N il, qui y avoit fon embouchure, en
prenoit le nom d'Oftiùm Canopicum. La ville prenoit
elle-même le fien de Canope, pilote de Ménélaiis ,
en l’honneur duquel elle avoit été bâtie par les Spartiates.
Ce pilote étoit péri en ce lieu, & y avoit été
enterré dans le tems que Ménélaiis, retournant du
fiege de Troye en G rè ce , fut jetté par la tempête
fur les côtes de la Lybie. Ammien Marcellin met
cette ville à douze milles d’Alexandrie; au lieu que
les cent vingt ftades de Strabon valent quinze milles*
Il parle auffi du capitaine Ménélaiis.
Les anciens s’accordent à nous peindre la ville de
Canope .comme un féjour très-dangereux pour les
bonnes: moeurs , & où la diffolution étoit portée âu
dernier excès. Strabon, parlant des délices d’Eleufis,
rapporte que e’étoit comme l’entrée & le prélude
des ufages & de l’effronterie de. Canope. Séneque
dit, au fujet du fage dont il trace Le tableau, que s’il
fongé à fe retirer-, il ne choifira point Cançpe pouf
le liqu de fa retraite, quoiqu’il ne foit pas défendu
d’y mener une vie réglée. JuvenaL, voulant marquer
combien les moeurs des dames Romaines étoient corrompues
, dit que Canope même les blâmoit. _
..........Et mores urbis damnante Canppo. -
Le même dit dans un autre endroit : ,
. . . . . Sed luxilria , quantum ipfè not.aui,
Barbara famofo non cedit turba Canopo.
Il y a Voit un temple de Serapis,. pour lequel la
vénération étoit fi grande, que les personnes de la
plus grande qualité, y giettoient leur, confiance, & y
allaient veiller, tant pour eux que pour les autres.
On avoit des recueils des cures qu’il avoit faites, &
des oracles qu’il avoit rendus. Mais la cure la plus
remarquable, c’eft la foule de ceux qui s’y rendqient
d’Alexandrie par le canal, pour amfter aux fetes.
Car tous les jours & toutes les. nuits, le canal etoit
couvert de barques remplies d’homme$ & de femmes
, qui; danfoient & chantoient avec la dernière
• lubricité.'Dans la ville même de Canope , il y avoit
fur le canaf des auberges deftinées à . ces fortes, dé
•réjouiffances.
Canope a été le fiege d’un évêque. On croit que