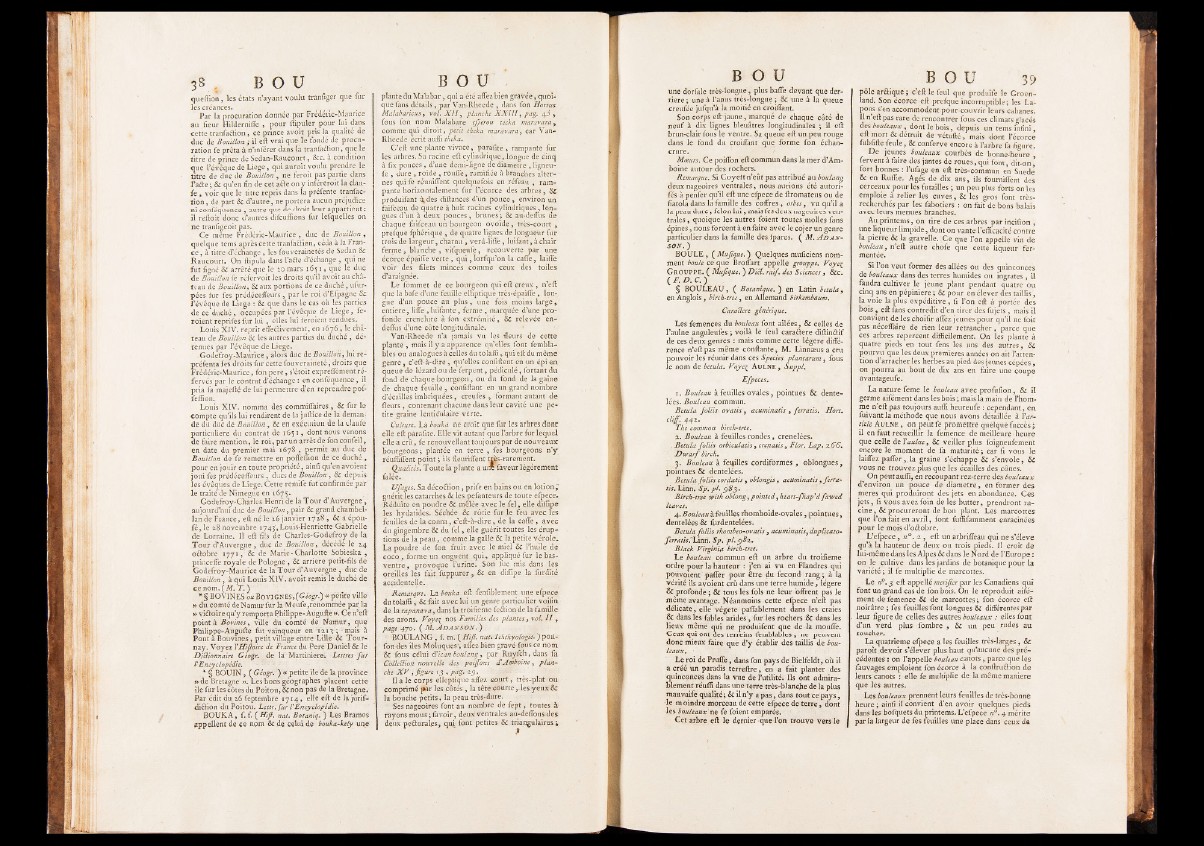
I i l
queftîon, les états n’ayant voulu tranfiger que fur
les créances. v .
Par la procuration donnée par Frederic-Maurice
au fieur Hilderniffe , pour ftipuler pour fui dans
cette tranfaéiion, ce prince avoit pris la qualité de
duc de Bouillon ,• il eft vrai que le fonde de procuration
fe prêta à n’inférer dans là tranfaélion, que le
titre de prince de Sedan-Raucourt, &c. à condition
que l’évêque de Liege, qui auroit voulu prendre le
titre de duc de Bouillon , ne feroit pas partie dans
l ’afle ; & qu’en fin de cet afte on y inféreroit la clau-
f e , voir que le titre repris dans la prefente tranfac-
tion, de part & d’autre, ne portera aucun préjudice
ni conféquence, autre que de droit leur appartient :
il reftoit donc d’autres difcuflions fur lefquelles on
ne tranfigeoit pas.
Ce même Frédéric-Maurice , duc'de Bouillon ,
quelque tems après cette tranfa&ion, céda à la France
, à titre d’échange , les fouverainetes de Sedan &c
Raucourt. On llipula dans Tafte d’échange , qui ne
fut figné & arrêté que le 2.0 mars 16 51 , que le duc
de Bouillon fe réfervoit les droits qu’il avoit au château
dé Bouillon, & aux portions de ce duché, ufur-
pées fur fes predpceffeurs , par le roi d’Efpagne &
l ’évêque de Liege : & que dans le cas où les parties
de ce duché , occupées par Févêque de Liege, fe-
roient reprifes fur lui , elles lui feroient rendues.
Louis XIV. reprit effeélivement, en 1676, le château
de Bouillon & les autres parties du duché , détenues
par l’évêque de Liege.
- Godefroy-Maurice, alors duc de Bouillon, lui re-
préfenta fes droits fur cette fouveraineté, droits que
Frédéric-Maurice, fon pere, s’étoit expreflement ré-
fervés par le contrat d’échange : en conféquence, il
pria fa majefté de lui permettre d’en reprendre pof-
ieflion.
Louis XIV. nomma des commiffaires, & fur le
compte qu’ils lui rendirent de la juflice de la demande
du duc de Bouillon, & en exécution de la claufe
particulière du contrat de i^ i , dont nous venons
de faire mention, le roi, par un arrêt de fon confeil,
en date du premier mai 1678 , permit au duc de
Bouillon de fe remettre en poffefîion de ce duché,
pour en jouir en toute propriété, ainfi qu’en avoient
joui fes prédéceffeurs , ducs de Bouillon, & depuis
les évêques de Liege. Cette remife fufconfirmée par
le traité de Nimegué en 1675.
Godefroy-Charles Henri de la Tour d’Auvergne,
aujourd’hui duc de Bouillon, pair & grand chambellan
de France, eft né le 16 janvier 1728 , & a épou-
fé , le 28 novembre 1743',Louis-Henriette Gabrielle
de Lorraine. 11 eft fils de Charles-Godefroy de la
Tour d’Auvergne , duc de Bouillon, décédé le 24
oftobre 1 7 7 1 & ; de Marie-Charlotte Sobieska ,
princeffe royale de Pologne, & arriéré petit-fils de
Godefroy-Maurice de la Tour d’Auvergne , duc de
Bouillon, à qui Louis X IV. avoit remis le duché de
ce nom. (M. T .)
* § BOVINES ou BoviGNES,(Geogr.) << petite ville
» du comté deNamur fur la Meufe,renommée par la
» viftoire qu’y remporta Philippe-Aügufte »'. Ce n’eft
point à Bovines, ville du comté de Namur, que
Philippe-Augufte fut vainqueur en 1213 ; -mais à
Pont à Bouvines, petit village entre Lille & Tour-
nay. Voyez 1’Hißoire de France du Pere Daniel & le
Dictionnaire Géogr. de la Martiniere* Lettres fur
F Encyclopédie.
* % BOUIN, ( Gèogr. ) « petite île de la province
» de Bretagne ». Lesbôhs géographes placent cette
île fur les côtes du Poitou, & non pas de la Bretagne.
Par édit du 26 feptembre 1 7 14 , elle eft de la jurif-
diftion du Poitou. Lettr. fur F Encyclopédie.
BO U K A , f. f. ( Hiß. nat. Botaniq. ) Les Brames
appellent de ce nom & de celui de bouka-kely une1
plante du Malabar, qui a été affez bien gravée, quoique
fans détails, par Van-Rheede , dans fon Hortus
Malabaricus, vol, X I I , planche X X I I I , pag. 46 ,
fous fon nom Malabare tfjérou tecka maravara,
comme qui diroit, petit theka maravara, car Van-
Rheede écrit aufli theka.
C ’eft une plante vivace, parafite » rampante fur
les arbres. Sa racine eft cylindrique,.longue de cinq
à fix pouces, d’une demi-ligne de diamètre , ligneu- .
fe , dure , roide , roufle, ramifiée à branches alter- -
nés qui fe réunifient quelquefois en réfeau , rampante
horizontalement lur l’écorce des arbres, Sc
produifant x^des diftances d’un pouce , environ un
faifceaù de quatre à huit racines cylindriques , longues
d’un à deux pouces, brunes ; & au-deflùs de
chaque faifceaù un bourgeon ovoïde, très-court ,
prefque fphérique , de quatre lignes de longueur fur
trois de largeur, charnu, verd-lifîe, luifant, à chair
ferme, blanche, vifqueufe, recouverte par une
écorce épaifie v e r te , q u i, lorfqu’on la caffe, laifle
voir des filets minces comme ceux des toiles
d’araignée.
Le fommet de ce bourgeon qui eft creux, n’eft
que la bafe d’une feuille elliptique très-épaiffe , longue
d’un pouce au plus, une fois moins large , 1
entière, lifte , luifante , ferme , marquée d’une profonde
crenelure à fon extrémité, ÔZ relevée en-
deffus d’une côte longitudinale.
Van-Rheede n’a jamais vu les fleurs de cette
plante , mais il y a apparence qu’elles font fembla-
bles ou analogues à celles du tolafli, qui eft du mênie
genre, c’eft-à-dire, qu’elles confident en un épi en
queue de lézard ou de ferpcnt, pédiculé, fortant du
fond de chaque bourgeon, ou du fond de la gaîne
de chaque feuille, confiftant en un grand nombre
d’écailles imbriquées,- creufes , formant autant de
fleurs, contenant chacune dans leur cavité une petite
graine lenticulaire vdrte.
Culture. La bouka ne cr'oît que fur les arbres donc
elle eft parafite. Elle vit autant que l’arbre fur lequel
elle a crû, fe renouvellant toujours par de nouveaux
bourgeons; plantée en terre , fes bourgeons n’y
réufliffent point ; ils fleuriffent très-rarement.
Qualités. Toute la plante a uire faveur légèrement
falée.
Ufages. Sa décoftion, prife en bains ou en lotion y
guérit les catarrhes & les pefanteurs de toute efpece.
Réduite en poudre & mêlée avec le fe l, elle diflipe
les hydatides. Séchée & rôtie fur le feu avec les
feuilles de la conna, c’eft-à-dire, de la cafte, avec
du gingembre & du fe l, elle guérit toutes les éruptions
de la peau, comme la galle & la petite vérole.
La poudre de fon fruit avec le miel & l’huile de
co c o , forme un ongueht qui, appliqué fur le bas-
ventre , provoque l’urine. Son lue mis dans les
oreilles les fait fuppurer, & en diflipe la furdité
accidentelle.
. Remarque. La bouka eft fenfiblement une efpece
du tolafli ; & fait avec lui un genre particulier voifin
de la iapanava, dans la troifieme feftion de la famille
des arons. Voye%_ nos Familles des plantes, vol. I I ,
page 4jo . ( M. A d a n s o n . ) •
BOULANG, f. m. ( Hiß. nat. Ichthyologie. ) poif-
fon des îles Moluques", aflèz bien gravé fous ce nom
& fous célui d’ican boulang, par Ruyfch, dans fa
Collection nouvelle des po 'iffons cCAmboine, plan-
che X V , figure ig , pag. 2$.
Il a le corps eileptique affez court, très-plat ou;
comprimé par les côtés , la tête courte ,.les yeux &
la bouche petits, la peau très-dure.
Ses nageoires font au nombre de fep t , toutes à
rayons mous ; favoir, deux ventrales au-deffous des
deux peftorales, quj font petites & triangulaires;
une dorfale très-longue, plus baffe devant que derrière
; une à l’anus très-longue ; & une à la queue
creufée jufqu’à la moitié en croiffant.
Son corps eft-jaune, marqué de chaque côté de
neuf à dix lignes bleuâtres longitudinales ; il eft
brun-clair fous le ventre. Sa queue eft un peu rouge
dans le fond du croiffant que forme fon échancrure.
Moeurs. Ce poiffon eft commun dans là mer d’Am-
boine autour dès rochers.
Remarque. Si Coyett n’eut pas attribué au boulang
deux nageoires ventrales, nous aurions été autori-
fés à penfer qu’il eft une efpece de ftromateus ou de
fiatola dans la famille des coffres, orbes, vu qu’il a
la peau dure, félon lui ; mais fes deux nageoires ventrales
, quoique les autres foient toutes molles fans
épines, nous forcent à en faire avec le cojer un genre
particulier dans la famille des, fpares. ( M. A d an -
s o n . )
BO UL E , ( Mujîquc. ) Quelques muficiens nomment
boule ce que Broffart appelle grouppe. Voye£
Grouppe. ( Mufique, ) Dici. raif. des Sciences , &c.
( F. D . C. ) x
§ BOULEAU, ( Botanique. ) en Latin betula,
en Anglois, birch-tree, en Allemand birkembaum.
Caractère générique.
Les femences du bouleau font ailées, & celles de
l’aulne anguleufes ; voilà le feul caraftere diftindif
de ces deux genres : mais comme cette légère différence
n’eft pas même confiante, M. Linnæus a cru
pouvoir les réunir dans ces Species plantarum, fous
le nom de betula. Voye£ Aulne, Suppl.
Efpeces.
1. Bouleau à feuilles ovales, pointues & dentelées.
Bouleau commun.
Betula foliiS' ovatis , acuminatis , ferratis. Hort.
cliff. 442.
The common birch-tree.
2. Bouleau à feuilles rondes, crenelées.
. Betula foliis orbiculatis, crcnatis, Flor, Lap. zÇC.
Dwar f birch.
3. Bouleau à feuilles cordiformes , oblongues,
pointues & dentelées.
Betula foliis cordatis , oblongis , acuminatis , ferratis.
Linn. S'p. pl. 98g.
Birch-tree withoblong,pointed,heart-fhap>dfawed
hâves.
4. Bouleau à feuilles rhomboïde-ovales, pointues,
dentelées & furdentelées.
Betula foliis rhombeo-ovatis » acuminatis, duplicato-
ferratis.'lAnn. Sp. p l.§82,
Black Virginia birch-tree.
Le bouleau commun eft un arbre du troifieme
ordre pour la hauteur : j’en ai vu en Flandres qui
poùvoient paffer pour être du fécond rang; à la
vérité ils avoient crû dans une terre humide , légère
& profonde ; & tous les fols ne leur offrent pas le
même avantage. Néanmoins cette efpece n’eft pas
délicate, elle végété paffablement dans les craies
& dans les fables arides, furie s rochers & dans les
lieux mêmë qui ne produifent que de la moufle.
Ceux qui ont des terreins femblables, ne peuvent
donc mieux faire que d’y établir des taillis de bouleaux.
■
Le roi de Pruffe, dans fon pays de Bielfeldt, où il
a créé un paradis terreftre, en a fait planter des
quinconces dans la vüe de l’utilité. Ils ont admirablement
réuffi dans une terre très-blanche de la plus
mauvaife qualité; & il n’y a pas, dans tout ce pays,
le moindre morceau dé cette efpece de terre, dont
les bouleaux ne fe foient emparés.
Cet arbre eft le dernier-que l’on trouve Vers le
pôlé arétiqué; c’eft le feul que produife le Groenland.
Son écorce eft prefque incorruptible; les Lapons
s’en accommodent pour couvrir leurs cabanes.
Il n’eft pas rare de rencontrer fous ces climats glacés
des bouleaux , dont le bois, depuis un tems infini,
eft mort & détruit de vétufté, mais dont l’écorce
fubfifte feule, & conferve encore à l’arbre fa figure.
De jeunes bouleaux courbés de bonne-heure
fervent à faire des jantes de roues, qui font, dit-on *
fort bonnes : l’ufage en eft très-commun en Suede
& en Ruflîe. Agés de dix ans, ils fourniffent des
cerceaux pour les futailles ; un peu plus forts on les
emploie à relier les cu ves, & les gros font très-
recherchés par les fabotiers : on fait de bons balais
avec leurs menues branches.
Au printems, on tire de ces arbres par incifion ,
une liqueur limpide, dont on vante l’eflkacité contre
la pierre & la gravelle. .Ce que l’on appelle vin de
bouleau, n’eft autre chofe que cette liqueur fermentée.
Si Ton veut former des allées ou des quinconces
de bouleaux dans des terres humides ou ingrates , il
faudra cultiver le jeune plant pendant quatre ou
cinq ans en pépinière ; & pour en élever des taillis,
la voie la plus expéditive , fi Ton eft à portée des
bois , eft fans contredit d’en tirer des fujets , mais il
convient de les choifir affez jeunes pour qu’il ne foit
pas néèeffaire de rien leur retrancher, parce que
ces arbres repercent difficilement. On les plante à
quatre pieds en tout fens les uns des autres, &
pourvu que les deux premières années on ait l’attention
d’arracher les herbes au pied des jeunes cépées ,
on pourra au bout de dix ans en faire une coupe
avantageufe.
La nature feme le bouleau avec profufion, & il
germe aifément dans les bois ; mais la main de l’homme
n’eft pas toujours aufli heureufe : cependant, en
fuivant la méthode que nous avons détaillée à Y article
Aulne , on peutfe promettre quëlque fuccès ;
il en faut recueillir la femence de meilleure heure
que celle de Y aulne , & veiller plus foigneufement
encore le moment de fa maturité ; car fi vous le
laiffez paffer, ,1a graine s’échappe & s’envole, &
vous ne trouvez plus que les écailles des cônes.
On peut aufli, en recoupant rez-terre des bouleaux
d’environ un pouce de diamètre, en former des
meres qui produiront des jets en abondance. Ces
je ts, fi vous avez foin de les butter, prendront racine
, & procureront de bon plant. Les marcottes
que l’on fait en avril, font fuffifamment enracinées
pour le mois d’oélobre.
L’efpece, n°. z , eft un arbriffeau qui ne s’élève
qu’à la hauteur de deux ou trois pieds. Il croît de
lui-même dans les Alpes & dans le Nord de l’Europe :
on le cultive dans les jardins de botanique pour la
variété ; il fe multiplie de marcottes.
Le n°. g eft appellé merifier par les Canadiens qui
font un grand cas de fon bois. On le reproduit aifément
de. femence & de marcottes ; fon écorce eft
noirâtre ; fes feuilles font longues & differentes par
leur figure de celles des autres bouleaux : elles font
d’un verd plus fombre , & un peu rudes au
toucher.
La quatrième efpece a les feuilles très-larges, &
paroît.devoir s’élever plus haut qu’aucune des précédentes
: on l’appelle bouhau canots, parce que les
fauvages emploient fon écorce à la conftruâion de
leurs canots : elle fe multiplie de la même maniéré
que lés autres.
Les bouleaux prennent leurs feuilles de très-bonne
heure ; -ainfi il convient d’en avoir quelques pieds
dans les bofquets du printems. L’efpece n°. 4 mérite
par la largeur de fes feuilles une place dans ceux d«