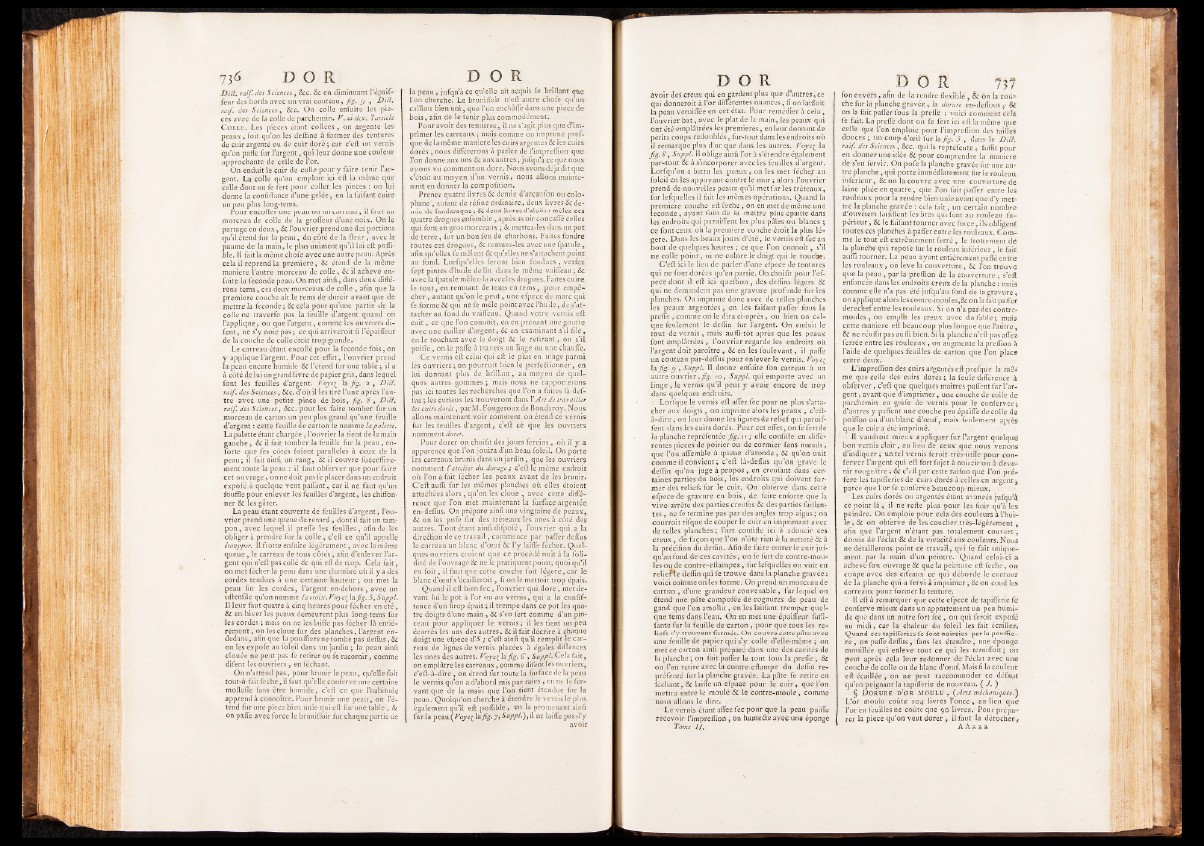
Dicl. raif- des Sciences, &c. & en diminuant l’épaif-
feur des bords avec un vrai couteau, fig. cj , Dicl.
raif. des Sciences, &c. On colle enfuite les pièces
avec de la colle de parchemin. V. ci-dev. l’article
C olle. Les pièces étant collées, on argente les
peaux, foit qu’on les deftine à former des tentures
de cuir argenté ou de cuir doré ; car c’eft un vernis
qu’on pafle fur l’argent, qui leur donne une couleur
approchante de celle dè l’or.
On enduit le cuir de colle pour y faire tenir l’argent.
La colle qu’on emploie ici eft la même que
celle dont on fe fert pour coller les pièces : on lui
donne la confiftance d’une gelée, en la faifant cuire
un peu plus long-tems.
Pour encoller une peau ou un carreau, il faut un
morceau de colle de la groffeur d’une noix. On le
partage en deux, & l’ouvrier prend une des portions
qu’il étend fur la peau, du côté de la fleur, avec la
paume de la main, le plus uniment qu’il lui eft poffi-
ble. Il fait la même chofe avec une autre peau. Après
cela il reprend la première, & étend de la même
maniéré l’autre morceau de colle, & il achevé en-
fuite'la fécondé peau. On met ainfi, dans deux difïé-
rens tems, ces deux morceaux de colle , afin que la
première couche ait le tems de durcir avant que de
mettre la fécondé ; & cela pour qu’une partie de la
colle ne traverfe pas la feuille d’argent quand on
l’applique, ou que l’argent, comme les ouvriers di-
fent, ne s’y noie pas ; ce qui arriveroit fi l’épaiffeur
de la couche de colle étoit trop grande.
Le carreau étant encollé pour la fécondé fois, on
y applique l’argent. Pour cet effet, l’ouvrier prend
la peau encore humide & l’étend fur une table ; il a
à côté de lui un grand livre de papier gris, dans lequel
font les feuilles d’argent. Voye£ la fig. 2 , Dicl.
raif. des Sciences, &c. d’où il les tire l’une après l’autre
avec une petite pince de bois, fig. 8 , Dicl.
raif. des Sciences, & c . pour les faire tomber fur un
morceau de carton un peu plus grand qu’une feuille
d’argent : cette feuille de carton fe nomme la palette.
La palette étant chargée, l’ouvrier la tient de la main
gauche, & il fait tomber la feuille fur la peau, en-
forte que fes côtés Toient parallèles à ceux de la
peau ; il fait ainfi, un rang, & il couvre fucceffive-
ment toute la peau : il faut obferver que pour faire
cet ouvrage, on ne doit pas fe placer dans un endroit
expofé à quelque vent paffant, car il ne faut qu’un
fouffle pour enlever les feuilles d’argent, les chiffonner
& les gâter.
La peau étant couverte de feuilles d’argent, l’ouvrier
prend une queue de renard, dont il fait un tampon,
avec lequel.il preffe les feuilles, afin de les
obliger à prendre fur la colle , c’eft ce qu’il appelle
étoupper. Il frotte enfuite légèrement, avec la même
queue, le carreau de tous côtés, afin d’enlever l’argent
qui n’eft pas collé & qui eft de trop. Cela fait,
on met fécher la peau dans une chambre où il y a des
cordes tendues à une certaine-hauteur ; on met la
peau fur les cordes, l’argent en-dehors, avec un
uftenfile qu’on nomme lacroix. Voye£ la fig. 3, Suppl.
Il leur faut quatre à cinq heures pour fécher en é té,
& en hiver les peaux demeurent plus long-tems fur
les cordes ; mais on ne les laiffe pas fécher là entièrement
, on les cloue fur des planches, l’argent en-
dedans, afin que la poufliere ne tombe pas deffus, &
on les expofe au foleil dans un jardin ; la peau ainfi
clouée ne peut pas fe retirer ou fe racornir, comme
difent les ouvriers, en féchant.
On n’attend pas, pour brunir la peau, qu’elle foit
tout:à-fak feche, il faut qu’elle conferve une certaine
molleffe fans être humide, c’eft ce que l’habitude
apprend à connoître. Pour brunir une peau, on’ l’étend
fur une piece bien unie qui eft fur une table , &
on paffe avec force le bruniffoir fur chaque partie de
la peau, jufqu’à ce qu’elle ait acquis le brillant que
l’on cherche. Le bruniffoir n’eft autre chofe qu’un
caillou bien uni, que l’on enchâffe dans une piece de
bois, afin de le tenir plus commodément.
Pour avoir des tentures, il ne s'agit plus que d’imprimer
les carreaux ; mais comme on imprime pref-
que de la même maniéré les cuirs argentés Scies cuirs •
dorés , nous différerons à parler de i’impreflîon que
l’on donne aux uns & aux autres, jufqu’à ce que nous
ayons vu comment on dore. Nous avons déja'dit que
c’étoit au moyen d’un vernis, nous allons maintenant
en donner là compofition.
Prenez quatre livres & demie d’arcanfon ou colophane
, autant de réfine ordinaire, deux livres & demie
de fandaraque, & deux livres d’aloës : mêlez ces
quatre drogues enfemble, après avoir concaffé. celles
qui font en gros morceaux ; & mettez-les dans un pot
de terre, fur un bon feu de charbons. Faites fondre
toutes Ces drogues , & remuez-les avec une fpatule ,
afin qu’elles fe mêlent & qu’elles ne s’attachent-point
au fond. Lorfqu’elle.s feront bien fondues , verfez
fept pintes d’huile de lin dans le même vaiffeau; &
avec la fpatule mêlez-la avec les drogues. Faites cuire
le tout, en remuant de tents en tems, pour empêcher
, autant qu’on le peut, une efpece de marc qui
fe forme.& qui ne fe mêle point avec l’huile, dé s’attacher
au fond du vaiffeau. Quand votre vernis eft
cu it, ce que l’on connoît, en en prenant une goutte
avec une cuiller d’argent, 8c en examinant s’il file,
en le touchant avec le doigt 8c le retirant, ou s’il
poiffe, on le paffe à travers un linge ou une chauffe.
Ce vernis eft celui qui eft le plus en ufage parmi
les ouvriers ; on pourroit bien le perfeélionner, en
lui donnant plus de brillant, au moyen de quelques
autres gommes ; mais nous ne rapporterons
'pas ici toutes les recherches que l’on a faites là-def-
lùs ; les curieux les trouveront dans Y Art de travailler
les aiirsdorés, parM. Fougeroux de Bondaroy. Nous
allons maintenant voir comment on étend ce vernis
fur les feuilles d’argent, c’eft ce que les ouvriers
nomment dorer.
Pour dorer on choifit des jours fereins , où il y a
apparence que l’on jouira d’un beau foleil. On porte
les carreaux brunis dans un jardin, que les ouvriers
nomment l'attelier du dorage ; c’eft le même endroit
où l’on a fait fécher les peaux avant de les brunir.
C’eft aufli fur les mêmes planches où elles étoient
attachées alors , qu’on les cloue , avec cette différence
que l’on met maintepant la furface argentée
en-deffus. On prépare ainfi une vingtaine de peaux,
& on les pofe fur des tréteaux les unes à côté des
autres. Tout étant ainfi difpofé, l’ouvrier qui a la
direction de ce travail, commence par paffer deffus
le carreau un blanc d’oeuf 8c l ’y laiffe fécher. Quelques
ouvriers croient que ce procédé nuit à la foli-
dité de l’ouvrage & ne le pratiquent point; quoi qu’il
en fo it , il faut que cette couche foit légère, car lé
blanc d’oeuf s ’écailleroit, fi on le mettoic trop épais.
Quand il eft bien fe c , l’ouvrier qui dore, met devant
lui le pot à l’or ou au vernis, qui a la confif-
tance d’un firop épais ; il trempe dans ce pot les quatre
doigts d’une main , 8c s’en fert comme d’un pinceau
pour appliquer le vernis ; il les tient un peu
écartés les uns des autres, 8c il fait décrire à chaque
doigt une efpece d’^ ; c’eft ainfi qu’il remplit le carreau
de lignes de vernis placées à égales diftances
les unes des autres. Voye{ la fig. 6 , S u p p l-^ la fait,
on emplâtre les carreaux, comme difent les ouvriers,
c’eft-à-dire , on étend fur toute la furface de la peau
le vernis qu’on a d’abord mis par raies , en ne fe fer-
vant que de la main que l’on tient etendué fur la
peau. Quoiqu’on cherche à étendre le vernisle plus
également qu’il eft pofîible , en la promenant ainfi
fur la peau (Voyei la fig. 7, il ne laiffe pas d’y
avoir
avoir des Creux qui en gardent plus que d’autrês iêê
qui donneroit à l’or différentes nuances, fi on laiffoit
la peau vêrniffée en cet état. Pour remédier à cela,
l’ouvrier bat, avec le plat de la main, les peaux qui
ont été emplâtrées les premières, en leur donnant de
petits coups redoublés , fur-tout dans les endroits où
il remarque plus d’or que dans les autres. Voyeç la
fig. 8 , Suppl. Il oblige ainfi l’or à s’étendre également
par-tout &t à s’incorporer avec les feuilles d’argent.
Lorfqu’on a battu les peaux, on les met fécheÿ au
foleil en les appuyant contre le mur ; alors l’ouvrier
prend de nouvelles peaux qu’il met fur les tréteaux,
fur lefquelles il fait les mêmes opérations. Quand la
première couche eft feche, on en met de même une
fécondé, ayant foin de la mettre plus épaiffe dans
les endroits qui paroiffent les plus pâles ou blancs ;
ce font ceux où la première couche étoit la plus légère.
Dans lès beaux jours d’été, le vernis eft fec au
bout de quelques heures ; ce que l’on connoît, s’il
ne colle point, ni ne colore le doigt qui le touclie.
C’eft ici le lieu de parler d’une efpece de tentures
qui ne font dorées qu’en partie. On choifit pour l’ef-
pece dont il eft ici queftion , des deflins légers- 8c
qui ne denjandent pas une gravure profonde fur les
planches» On imprime donc avec de telles planches
les peaux argentées, en les faifant paffer fous la
preffe , comme où le dira ci-après, ou bien on calque
feulement le deffin fur l’argent. On enduit le
tout de vernis, mais auffi-tôt après que les peaux
font emplâtrées , l’ouvrier regarde les endroits où
l’argent doit paroître , & en les,foulevant, il paffe
un couteau pàr-deffus pour enlever le vernis. Voye£
la fig-9 » Suppl. Il donne enfuite fon carreau à un
autre ouvrier f fig-' 10, Suppl, qui emporte avec un
linge, le vernis qu’il peut y avoir encore de trop
dans quelques endroits»
•- Lorfque le vernis eft affez fec pour ne plus s’attacher
aux doigts , on imprime alors les peatix , c’eft-1
à-dire, on leur donne les figures de relief qui.paroif-
fent dans les cuirs dorés. Pour cet effet, on fe fert de
la planche repréfentée fig. 11 ; elleeonfifte en différentes
pièces-de poirier ou de cormier fans noeuds,
que l’on affemble à queue d’aronde., & qii’on unit
comme il convient ; c’eft là-déffus qu’on grave le_
deffin qu’on juge à propos , en creufant dans cer^-
taines parties du bois, les endroits qui doivent former
des reliefs fur le Cuir, On obferve dans cette
efpece de gravure en bois , de faire enforte que la
vive-arrête des parties creufes 8c desparties faillan*
te s , ne fe termine pas par dés angles trop aigus ; ôrt
courroit rifque de couper le cuir en imprimant avec
de telles planches ; l’art confifte ici à adoucir ces
creux , de façon que l’on n’ôte rien à la netteté 8c à
la précifion du deflin. Afin de faire entrer le cuir juf-
qu’au fond dé ces cavités, on fe fert de contre-moules
ou de contre-eftampes, fur lefquelles on voit en
relie Me deffin qui le trouve dans la-planche gravée:
voici comme onles forme. On prendun morceau de
carton , d’une grandeur convenable , fur lequel on '
étend-une pâte compofée de rognures de peau de
gand que l’on amollit, en leslaitiant tremper que U
que tems dans l’eau. On en met une épâiffeur fuffi-
fante fur la feuille de carton , . pour que tous les reliefs
s’y trouvent formés. On couvre cette pâte avec
une feuille de papier qui s’y colle d’elle-même ; on
met ce carton ainfi préparé dans une des cayités de
la planche; on fait paflèr: le tout foiisla preffe:, 8c
o n l?en retire avec la'contre-eftampe du deffin re-
préfenté fur la planche, gravée. La pâte fe retire en
féchant, ÔC laiffe un ëfpace pour le Cuir, que l’on
mettra entre le moulé 8c le contre-moule, comme
nous allons le dire.
Lè vernis étant affez fec pour que la peau puiffe
recevoir l’impreffioh, pn humette avec une éponge /
Tome I I . 1
lôn envêfs, afin de ia rendre flexiblé , & ôn la tôii»
che fur la planche gravée, la dorure en-deffous ,• $£
on la fait paffer fous là preffe : voici comment cëîâ
fe fait. La preffe dont on fe fert ici eft la même que
celle quë l’on emploie poiir l’imprefiion des tailles
douces ; un coup d’oeil fur \a fig. 3 , dans le DicU
raif. des Sciences, &e. qui la repréfente , fuffit pour
en donner une idée & pour comprendre la maniéré
de s’en fervir. On pofe la planche gravée fur une autre
planche, qui porte immédiatement fur le rouleau
inférieur, & on là couvre avec une couverture dé
laine pliée en quatre, qtte l’on fait paffer entre les
rouleaux pour la rendre bien unie avant que d’y met-1
tre la planche gravée : cela fait, un certain nombré
d’olivriers faififfent les bras qui font au rouleau fu-
périeur, & le faifaiït tourner avec force, ils obligent
toutes ces planches, à paffer entre les rouleaux. Comme
le tout eft extrêmement ferré , le frottement dé
la planche qui repofê fur le rouleau inférieur, le fait
auffi tourner. La peau ayant entièrement pàffé entre
les rouleaux, ôn leVe la couverture, & l’on trouvé
que la peau, par la preflion de la couverture , s’eft
enfoncée dans les endroits creux de la planche : mais
comme elle n’a pas été jiifqu’au fond de la gravure,
on applique alors les contre-moùIes,& on la fait paffer
derechef entre les rouleaux. Si on n’a pas des contre-1
moules , on emplit les creux avec du fable ; mais
cette maniéré eft beaucoup plus longue que l’autre,
& ne réuffit pas auffi bien. Si la planche n’eift pas affez
ferrée entre les rouleaux , on augmente la preflion à
l’aide de quelques feuilles de carton que l’on placé
entre deux.;
L’impreffion descuirs argentés eft prefqiié la même
que celle des cuirs dorés; la feule différence à
obferver, c’eft que quelques maîtres paffent fur l ’argent,
avant que d’imprimer., une couche de colle dé
parchemin en guife de vernis pour le conferver;
d’autres y paffent une couche peu épaiffe de colle de
poiffon ou d’un blanc d’oeuf, mais feulement après
que le cuir a été imprimé»
Il vaudroit mieux appliquer fur Fargèrtt qiieiquë
bon vernis clair, au lieu de ceux que nous venons
d’indiquer ; un tel vernis feroif rrès-iitile pour conferver
l ’argent qui eft fort fujet à noircir ou à devenir
rougeâtre ; & c’eft par cette raifon que l’on pré*
fiere les tapifferies’de cuirs dorés à celles en argent,
parce que l’or fe conferve beaucoup mieux.
Les cuirs dorés' ou argentés étant avancés jufqu-à
ce point-là, il ne refte plus: pour les finir qu’à les
peindre. On emploie pour cela des couleurs à l ’hui^
le , ÔE ofl obferve de les Coucher très-légérement ,
afin que' l’argent n’étant pas totalement couvertr,
donne de l’éclat de la vivacité aux couleurs. Nous
ne détaillerons point ce-travail, qui fe fait uniquement
par la main d’un peintre. Quand celui-ci ai
achevé fon ouvrage 8c que la peinture eft feche, on
coupe avec des cife-aux ce qui déborde le contour
de la planche qui a fervi à imprimer, &c on coud les
carreaux pour former la tenture';
Il eft à remarquer quë cette efpece de tapifferze fë
Conferve mieux dans un appartement un peu humide
què- dans un autre fort fe c , ou qiti feroit expofé
au midi, car la chaleur du foleil les fait écaillen
Quand ces tapifferies fe font noircies par la pouffie-
re , on paffe deffus, Tans les étendre, une éponge
mouillée qui enleve- tout ce qui les terniffoit; ori
peut après cela leur redonner de l’éclat avec une
Couche de colle ou de blanc d’oeuf. Mais fi la couleur
eft écaillée, on ne peut raccommoder ce défaut
qu’en peignant la tapifferie de nouveau. ( /. )
§ Dorure d’or MOULU-, (Arts méchaniqiièsf)
L’or moulu coûte 104 livres l’once, au fieu que
l’or en feuilles ne coûte que tjô livres. Pour préparer
la piece qu’oiï veut dorer , il faut la dérocher ,
À A a a a