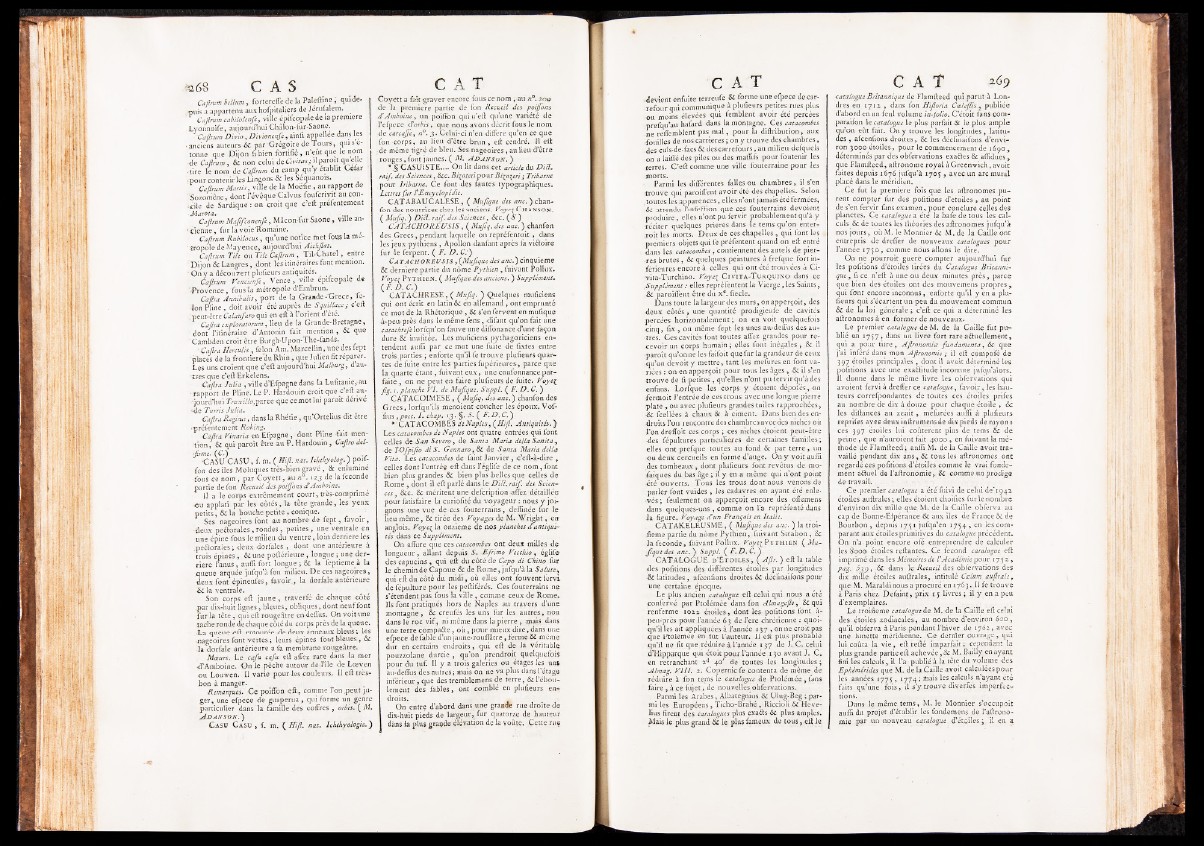
Caflrum bellum,- fortereflé de la Paleftine , qui depuis
a appartenu aux hofpitaliers de Jérulalem.
' Caflrum cabilolenfe, ville épifcopale de la première
• Lyonnoife, aujourd’hui Châ lo n - fur - S ao ne.
Caflrum D iv io , Divionenfe, ainii appellée dans les
• anciens auteurs & par Grégoire de Tours, quise-
tonne que Dijon fi bien fortifié , n’eut que le nom
de Caflrum, & non celui d eCmrai; il{>aroit quelle ;
'tire le nom de Caflrum du camp qu’y établit Ceiar '
• pour contenir les Lingons 6c les SequanOis.
Caflrum Marris, ville de la Moëfie , au rapport de
Sozomêne, dont l’évêque Calvus foufcrivit au conc
ile de Sardique : on -croit que c’eft préfentement
■ Marota. - 1
Caßrum Maßfconenfe, Mâcon-luï Saône, ville an-
'cieftne, fur îavôie"Romaine. ,
Caflrum Rubilocus, qu’une notice met fous la métropole
de Mayence, aujourd’hui Aichfiàt.
Caflrum Tile ou Tile Caflrum , Til-Chatel, entre
Dijon 6c Langres, .dont les itinéraires font mention.
' On y a découvert plufieurs antiquités.
Caflrum Vencienfe, Vence, ville epifcopäle d«
-Provence, fous'la métropole d’Embrun.
Cafira Annïbdlis, pott de la Grande-Grece,'félon
Pline , doit avoir été auprès de Squillace; c’eft
. peut-être Calaufaro qui en eft à l’orient d ete.
' Cafira exploratorum, lieu de la Grande-Bretagne,
dont l’itinéraire d’Antonin fait mention , 6c que
'Cambden croit être Burgh-Upon-The-fands.
Cafira Herculis , félon Am. Marcellin, une des fept
places de la frontière du Rhin, que Julien fit réparer.
Les uns croient que c’eft aujourd’hui Malburg, d autre
s que c’eft Erkelens.
Cafira Julia , ville d’Efpagne dans la Lufitame,-au
•rapport de Pline. Le P. Hardouin croit que c’eft aujourd'hui
Truxillo,parce que ce mot lui paroît dérive
'-de Turris Julia. . A
Cafira Regina, dans la Rhétie, qu’OrteliuS dit etr-e
^-préfentement Roking. - . .
Cafira Vinaria en Efpagne, dont Pline fait mention,
6c qui paroît être au P. Hardouin, Cafiro del-
firme. (:C>) . .
CASU C A SU , f. rn. ( Hift. nat. Icjithyolog. ) poil;
fon des îles Moluques très-bien gravé, & enluminé
-fous ce nom, par C o y e tt , au n°. 123 de la fécondé
partie de fon Recueil des poiffons <£Amboine. •
Il a le corps extrêmement court, très-comprime
-eu applati par les côtés, la tôte grande, lès yeux
petits, 6c la bouche petite , conique.
Ses nageoires font au nombre de fept, favoir,
-deux pettorales , rondes , petites , une ventrale en
une épine fous le milieu du ventre, loin derrière les
.pêéloraies; deux dorfales , dont une antérieure à
trois épines , & une poftérieure, longue ; une derrière
l’anus, aufli fort longue ; 6c la feptieme à la
queue arquée jufqu’à fon milieu. De ces nageoires,
deux font épineufes, favoir., la dorfale anterieure
■ 6c la ventrale. I t
Son corps eft jaune, traverfé de -chaque côte
.par dix-huit lignes, bleues, obliques, dont neuf font
fur la tête, qui eft rougeâtre en-deffus. On voit une
•tache ronde dechaque côté du corps près de la queue.
-La queue -eft entourée de deux anneaux bleus ; les
■ nageoires font vertes ; leurs épines font bleues, 6c
la dorfale antérieure a fa membrane rougeâtre.
Moeurs. L e cafu cqfu eft affez rare dans -la mer
•d’Amboine. On le pêche autour d e l’île de Lceven
ou Louwen. Il varie pour les couleuis. Il eft très-
bon à manger.
Remarques. C e poiffon -eft-, comme l’on .peut juger,
une efpece de guaperiia, qui forme un genre
particulier dans la -familie des coffres , orbis.fM.
A d a n so n .)
C ja.s u C a s u , f . m . \ K i f l . nat. Ichthyologie.)
Coyett a fait graver encore fous ce nom , au n°. 200
de la première partie de fon Recueil des poiffons
d'A/nboine, un poiffon qui n’eft qu’une variété de
l’efpece d'orbis, que nous avons décrit fous le nom
de carcaffe, n°. 3. Celui-ci n’en différé qu’ en ce que
fon-corps, au lieu d’être brun, eft cendré. Il eft
de même tigré de bleu. Ses nageoires, au lieu d’être
rouges , font jaunes. ( M. A d a n so n . )
*.§ CASÙiSTE.... On lit dans cet article du DicL
raif. des Sciences, 8cc. Bi{oteri pour Biço^eri ; Tribarne
pour Iribarne. Ce font des fautes typographiques.
Lettres fur ÜEncyclopédie.
CATABAUCALESE-, ( Mufique des anc. ) chanfon
des nourrices chez les anciens. Voye^ C hanson.
( Mufiq. ) Dicl. raif. des Sciences, &C. ( S )
CATACHOREUS1S ,.( Mufiq. des anc. ) chanfon
des Grecs, pendant laquelle on repréfentoit, dans
les jeux pythiens , Apollon danfant après fa viftoire
fur le ferpent. ( F. D . C. j
Ca TACHOREUSi s , (Mufique des anc. ) cinquième
& derniere partie du nôme Pythien, fuivant Pollux.
Voyt? PYTHIEN. ( Mufique des anciens. ) Supplément.
( F .D .C .)
CATACHRESE, ( Mufiq. ) Quelques muficiens
oui ont écrit en latin 6c en allemand, ont emprunté
ce mot de la Rhétorique, 6c s’en fervent en mufique
-à-peu-près dans le mêmefens, -difant qu’on fait une
catachrefe lorfqu’on fauve une diffonance d’une façon
dure 6c inufitée. Les muficiens pythagoriciens entendent
auffi par ce mot une fuite de fixtes entre
trois .parties ; enforte qu’il fe trouve plufieurs quartes
de fuite entre les parties fupérieures>, parce què
la quarte étant, fuivant eux, une confonnance parfaite
, on ne peut en faire plufieurs de fuite. A"oye^
fig. 1. planche VI. de Mufique. Suppl. ( F. D . C. )
CATACOIMESE, ( Mufiq. des anc J) chanfon des
Grecs, lorfqu’ils menoient coucher les époux. Vof-
fius,poet. I . chap. 13. § . i . ( F .D .C .)
* ’ CATACOMBES de Naples, ( Hifi. Antiquités. )
Les catacombes de Naples ont quatre entrées qui font
celles de San Severo, de Santa Maria délia Samt a.,
•de YOfpifio d iS. Gennaro, & de Santa Maria délia
Vita. Les catacombes de faint Janvier, c’éft-à-dire ,
celles dont l’entrée eft dans l’eglife de ce nom, font
bien plus grandes & bien plus belles que celles de
Rome , dont il eft parlé dans le Dicl. raif. des Sciences,
&c. & méritent une defeription affez détaillée
pour fatisfaire la curiolité du voyageur : nous y joignons
une vue de ces fouterrains, deïfinée fur le
lieu même, & tirée des Voyages dç M. Wright, en-
anglois. Voye^ la onzième àe nos planches dlantiquités
dans ce Supplément.
On affure que ces catacombes ont deux milles de
longueur, allant depuis S. Efrimo Vecchio, églife-
des capucins , qui eft du côté de Capo di Chino fur
le chemin de Capoue 6c de Rome, jufqu’à la Salute.
qui eft du côté du midi, où elles ont fouventfervi
de fépulture pour les peftiférés. Ces fouterrains ne
s’étendent pas fous la v ille, comme ceux de Rome.
Ils font pratiqués hors de Naples au travers d’une
montagne, 6c creufés les uns fur les autres, non
dans le roc v if, ni même dans la pierre , mais dans
une terre compare, o ù , pour mieux d ire, dans une
efpece de fable d’un jaune-rouffâtre, ferme & même
dur en certains endroits, qui eft de la véritable
pouzzolane durcie , qu’on prendroit quelquefois
pour du tuf. Il y a trois galeries ou étages les uns
au-deffus des autres; mais on ne va plus dans l’étage
inférieur, que des tremblemens de terre, 6c l’ébou-
lement des fables, ont comblé en plufieurs endroits.
..
On entre d’abord dans une grande rue droite de
dix-huit pieds de largeur, fur quatorze de hauteur
dans la plus grande élévation dç la Yoùte. Cette ru§
■ devient éhfuite terreufe & forme une efpecede-car-
■ xefour qui communique à plufieurs petitesses plus
rou moins élevées qui femMent avoir été percées
prefqu’au hafard dans la montagne. Ces catacombes
ne reffemblent pas mal, pour la diftribution, aux
•fouilles de nos carrières ; on y trouve des chambres,
-des culs-de-facs 6c des carrefours, au milieu defquels
on a laiffédes piles ou des maflifs pour foutenir les
terres. C ’eft comme une ville fouterraine pour les
morts.
Parmi les différentes faites ou chambres, il s’en
trouve qui paroiffent avoir ete des chapelles. Selon
toutes les apparences, elles n’ont jamais été fermées,
6c attendu l’infe&ion que ces fouterrains dévoient
produire, elles n’ont pu fervir probablement qu’à y
■ réciter quelques prières dans le tems qu’on enterr-
;roit les morts. Deux de ces chapelles , qui font les -
premiers objets qui fe préfentent quand on eft entré
■ dans les catacombes , contiennent.des autels de pier-
-rcs brutes, 6c quelques peintures à frefque fort inférieures
encore à celles qui ont été trouvées à Ci-
vita-Turchino. Voye{ C iv it a -Turquino dans ce
Supplément : elles repréfentent la Vierge, les Saints,
6c paroiflent être du x 8. fiecle.
Dans toute la largeur des murs , onapperçoit, des
deux côtés, urte quantité prodigieufe de cavités
.percées horizontalement ; on en Voit quelquefois
cinq, fix , ou même fept les unes au-deffus des autres.
Ces cavités font toutes affez grandes pour recevoir
un corps humain ; elles font inégalés, 6c il
paroît qu’on ne les faifoit que fur la grandeur de ceux
;qu’on devoit y mettre, tant les mefures en font variées
: on en apperçoit pour tous les âges, & il s-en
trouve de fi petites , qu’ elles n’ont pu fervir qu’à des
enfans. Lorfque les corps y étoient dépofés, on
fermoir l’entrée de ces trous avec une longue pierre
-plate , ou avec plufieurs grandes tuiles rapprochées ,
6c fcellées à chaux & à ciment. Dans bien des en-
-droits l’on rencontre des chambres avec des niches où
Ton dreffoit ces corps ; ces niches étoient peut-être
fies fépultures particulières de certaines familles;
elles ont prefque toutes au fond & par terre, un
ou deux cercueils en forme d’auge. On y voit aufiî
,des tombeaux, dont plufieurs font revêtus de. mp-
faïques du bas âge; il y en a même qui n’ont poin.t
été ouverts. Tous les trous dont nous venons de
parler font vuides , les cadavres en ayant été enle-
•vés ; feulement on apperçoit encore des oflemens
ffans quelques-uns , comme on l’a repréfenté dans
J a figure. Voyage d? un François en Italie.
CATAKLELEUSME, ( Mufique des anc. j la troi-
jfieme partie du nôme Pythien,.fuivant Strabon, 6c
:la fécondé, fuivant Pollux. Voye^ Py thien ( Mufique
des anc. ) Suppl. ( F. D. C. )
CATALOGUE d’Étoiles ; ( Aflr. ) eft la table
des pofitions des différentes étoiles par longitudes
& latitudes, afeenfions droites 6c déclinaifons pour
une certaine époque.
Le plus ancien catalogue eft celui qui. nous a été
confervé par Ptolémée dans fon Almagefle, 6c qui
renferme i o z z étoiles, dont les- pofitions font à-
peu-près pour l’année 63 de l’ere chrétienne : quoiqu’il
les ait appliquées à l’année 13 7 , on ne croit pas
jque Ptolémée en fut l’auteur. Il eft plus.probable
qu’il ne fit que,réduire à l’année 137 de J.,,C,. celui
d’Hipparque qui étoit pour l’année 130 avant J. C.
en retranchant 2d 40' de toutes les longitudes ;
Almag. V ll l. 2. Copernic fe contenta de même de
réduire à fon tems le catalogue de Ptolémée., fans
faire, à ce fujet, de nouvelles obfervations.,,
Parmi les Arabes, Albategnius 6ç Ulug-Beg ; parmi
les Européens, Ticho-Brahé., Rjccioli.ôc Heve-,
lius firent des catalogues plus exafts 6c plus amples.
Mais le plus grand ôi le plus fameux de tous, eft le
■ catalogue Britannique de Flamfteed qui parût à Londres
en 1712 , dans fon Hifioria Coelefiis., publiée
d’abord en un feul volume in-folio. C’étoit fans côm-
paraifon le catalogue le plus parfait & le plus ample
qu’on eût fait. On y trouve les longitudes , latitudes
, afeenfions droites, 6c les déclinaifons d’environ
3000 étoiles, pour le commencement de 1690,
déterminés par des obfervations exaêles 6c aflidues.,
que Flamfteed, aftronome royal à Greenwich, avoit
faites depuis 1676 jufqu’à 1705 , avec un arc mural
placé dans le méridien.
Ce fut la première fois que les aftronomes purent
compter fur des pofitions d’etoiles, au point
de s’en fervir fans examen, pouf conclure celles des
planètes. Ce catalogue a été la bafe de tous les calculs
6c de toutes les théories des aftronomes jufqu’à
nos jours, où M. le Monnier 6c M. de la Caille ont
entrepris de dreffer de nouveaux catalogues pour
l’année 175.O , comme nous allons le dire.
On ne pourrçit guerê compter aujourd’hui fur
les pofitions d’étoiles tirées du Catalogue Britannique
, fi ce n’eft à une ou deux minutes près, parce
que bien des étoiles ont des mouvemens propres ,
qui font encore inconnus, enforte qu’il y en a plufieurs
qui s’écartent un peu du mouvement commun
6c de la loi générale ; c’eft ce qui a déterminé les
aftronomes à en former de nouveaux.
Le premier catalogue de M. de la Caille fut publié
en 1757; dans un livre fort rare aéhiellement,
qui a pour titre, Aflronomice fundamenta, & que
j’ai inféré dans mon Afironomie ; il eft çompofé de
397 étoiles principales , dont il avoit déterminé les
pofitions avec une exa&itude inconnue jufqu’alors.
Il donne dans lê même livre les obfervations qui
avoient fervi à dreffer ce catalogue, favoir , les hauteurs
correfpondantes de toutes ces étoiles prifes
au nombre de dix à douze pour chaque étoile , 6c
les diftances au zenit , mefurées aufli à plufieurs
reprifes avec deux inftrumensde dix pieds de rayon :
ces 397 étoiles lui coûtèrent plus de tems 6c de
peine , que n’auroient fait 4000 , en fuivant la mé-
thode de Flamfteed; aufli M. de la Caille avoit travaillé
pendant dix ans, & tous les aftronomes ont
regardé ces pofitions.d’étoiles comme le vrai fondement
âéhiei de l’aflronômie, 6c comme un prodige
de-travaif. .
Ce premier catalogue a été fuivi de celui de"i942
étoiles auftrales; elles étoient choifies furie nombre
d’environ dix mille que M. de la Caille oblerva au
cap de Bonne-Efpérance 6c aux îles de France 6c de
Bourbon, depuis 1751 jufqu’en 1 75 4 , en les comparant
attx étoiles primitives du catalogue précédent.
On n’a point encore ofé entreprendre de calculer
les 8000 étoiles reliantes. Ce fécond catalogue eft
imprimé dans les Mémoires de l'Académie pour. 17 52 ,
pag. 63 c) , 6c dans le Recueil des obfervations des
dix mille étoiles auftrales,. intitulé Calurn aufiralef
queuM. Màraldi nous a procuré en 1763. Il ,fe trouve
à Paris chez Defaint, prix 15 livres ; il ÿ en a peu
d’exemplaires.
Le troifieme cataloguent M. de la Caille eft celui
des étoiles zodiacales, au nombre d’environ 600 ,
qu’il obferva à Paris pendant l ’hiver de 1762, avec
une lunette' méridienne. Ce dernier ouvrage , qui
lui coûta la v ie , eft relié imparfait; cependant la
plus grande partie eft. achevée, & M. Bailly en ayant
fini les calculs, il l’a publié à la tête du volume des
Ephémérides que M. de la Caille avoit calculées pour
les années 1775 , 1774 ; mais les calculs- n’ay.ant été
faits qu’une fois, il s’y.trouve diverfes imperfecr
tions. ..
Dans- le même tems, M. le Monnier s’occupoit
aufli du projet d’établir les fondemens de l’allrono-
mie par un nouveau catalogue, d’étoiles; il en a