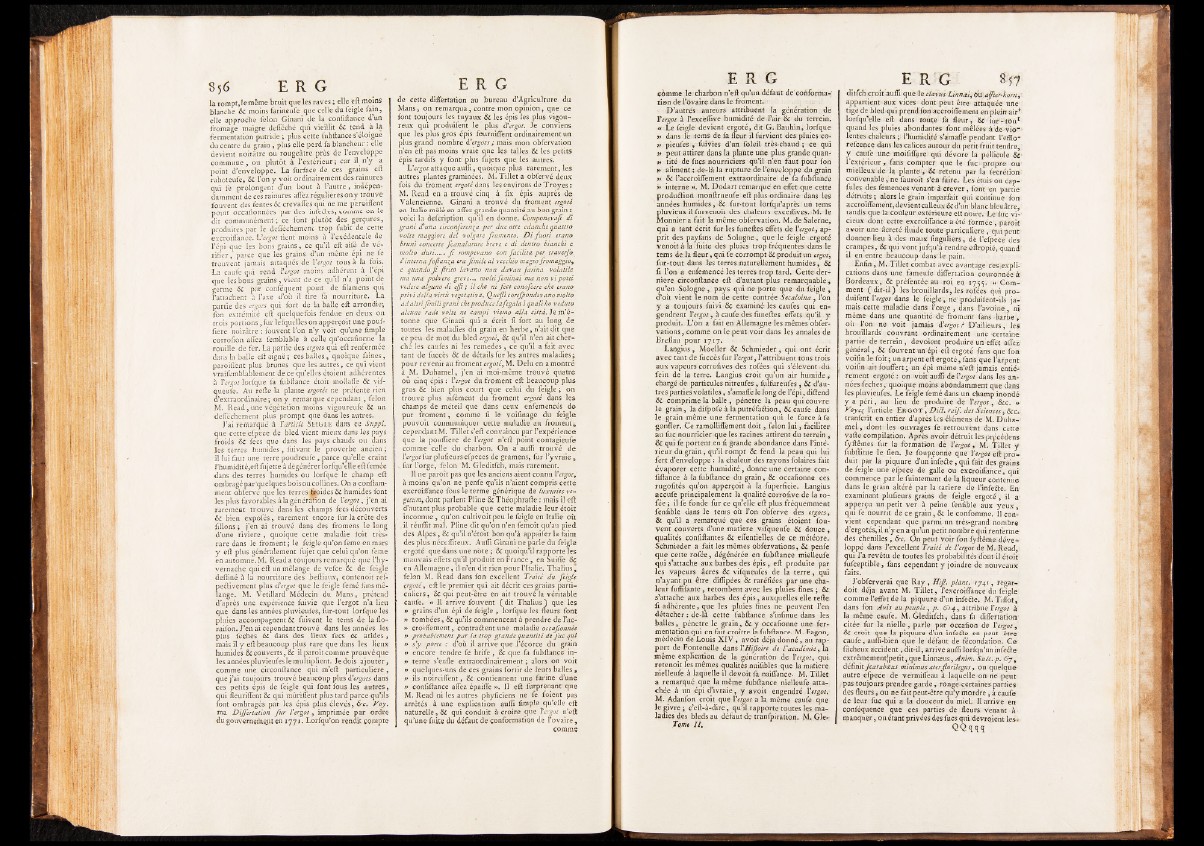
là rompt, le même bruit que les raves ; elle eft moins
blanche & moins farineufe que celle du feigle fain,
elle approche félon Ginani de la confiftance d un
fromage maigre defféché qui vieillit 6c tend à la
fermentation putride ; plus cette fubftance s éloigné
du centre du grain , plus elle perd fa blancheur : elle
devient noirâtre ou rougeâtre, près de l’enveloppe
commune, ou plutôt à l’extérieur; car il n’y a
point d’enveloppe. La furface de ces grains eft
raboteufe, 6c l’on y voit ordinairement des rainures
qui fe prolongent d’un bout a l’autre, indépendamment
de ces rainures affez régulières on y trouve
fouvent des fentes 6c crevaffei qui ne me paroiffent
point occafionnées par des infectes, comme on le
dit communément; ce font plutôt des gerçures,
produites par le defféchement trop fubit de cette
excroiffance. L'ergot tient moins à l’exédentele de
l’épi que les bons grains, ce qu’il eft aifé de vérifier
, parce que les grains d’un même épi ne fe
trouvent jamais attaqués de l 'ergot tous à la fois.
La caufe qui rend l’ergot moins adhérent à l’ épi
que les bons grains , vient de ce qu il n’a .point de
germe 6c par conséquent point de filamens qui
l’attachent à l’axe d’où il tire fâ nourriture. La
partie des ergots qui fort de la balle eft arrondie;
fon extrémité eft quelquefois fendue en deux ou
trois portions, fur lefquelles on apperçoit une pouf-
fiere noirâtre : fouvent l'on n’y voit qu’une fimplé
eorrofion affez femblable à celle qu’occafionne la
rouille de fer. La partie des ergots qui eft renfermée
dans la balle eft aiguë ; ces balles, quoique faines,
paroiflent plus brunes que les autres, ce qui vient
vraifemblablement de ce qu’elles étoient adhérentes
à Vergot lorfque fa fubftance étoit- mollaflè & vif-
queule. Au refte la plante ergotée ne préfente rien
d’extraordinaire ; on y remarque cependant, félon
M. Read, une végétation moins vigôureufe 6c un
defféchement plus prompt que dans les autres.
J’ai remarqué à Y article Seigle dans ce Suppl.
que cette efpece de bled vient mieux dans les pays
froids 6c fecs que dans les pays chauds ou dans
les terres humides, fuivant le proverbe ancien ;
il lui faut une terre poudreufe , parce qu’elle craint
l’humidité,eft fujette à dégénérer lorfqu’elle eft femée
dans des terres humides ou lorfque le champ eft
ombragé par’quelques bois ou collines. On a conftam-
ment obfervé que les terres &oides 6c humides font
les plus favorables à la génération de Yergot, j’en ai
rarement trouvé dans les champs fecs découverts
6c bien expofés, rarement encore fur la crête des
filions ; j’en ai trouvé dans des fromens le long
d’une riviere , quoique cette maladie loit très-
rare dans le froment ; le feigle qu’on feme en mars
y eft plus généralement fujet que celui qu’on feme
en automne. M. Read a toujours remarqué que l’hy-
vernache qui eft un mélange de vefce 6c de feigle
deftiné à la nourriture des beftiaux, contenoit ref-
peclivement plus d’ergot que le feigle femé fans mélange.
M. Vetillard Médecin du Mans, prétend
d’après une expérience fuivie que l’ergot n’a lieu
que dans les années pluvieufes, fur-tout lorfque les
pluies accompagnent 6c fuivent le tems de la flo-
raifon. J’en ai cependant trouvé dans les années les
plus feches 6c dans des lieux fecs 6c arides,
mais il y eft beaucoup plus rare que dans les lieux
humides & couverts, & il paroît comme prouvé que
les années pluvieufes le multiplient. Je dois ajouter,
comme une. circonftance qui m’eft particulière ,
que j’ai toujours trouvé beaucoup plus d’ergots dans
ces petits épis de feigle qui font fous les autres,
qui fleuriffent 6c qui mûrilîent plus tard parce qu’ils
font ombragés par les épis plus élevés, &c. Voy.
ma Differtation fur Vergpt, imprimée par ordre
du gouvernemçpt en 1771. Lorfqu’on rendit compte
de cette differtation au bureau d’Agriculture du
Mans, on remarqua, contre mon opinion, que ce
font toujours les tuyaux & les épis les plus vigoureux
qui produifent le plus d’ergot. Je conviens
que les plus gros épis fourniffent ordinairement un
plus grand nombre d’ergots ; mais mon obfervation
n’en eft pas moins vraie que les talles 6c les petits
épis tardifs y font? plus fujets que les autres.
Uergot attaque aufli, quoique plus rarement, les
autres plantes graminées. M. T illet a obfervé deux
fois du froment ergoté dans les environs de Troyes :
M. Read en a trouvé cinq à fix épis auprès de
Valencienne. Ginani a trouvé du froment ergoté
en Italie mêlé en affez grande quantité au bon grain :
voici la defcription qu'il en donne. Compontvaji di
grani d’un a circonferenqa per due otre edanche quattro
volte maggiore del volgare fntmento. D i fuori erano
bruni concerte fcanalature brève e di dentro bianchi e
inolto dun.....f i rompevano con facilita per traverfo
l’interna fojîan^a era fimile al vecchio niagro fromaggio,
e quando f i jlrito lavano non davan farina volatile
111a unà polvere greve... molli feminai ma nonvipotti
vcdere alguno di effi ; il che ni fece conofcere che erano
privi délia virtu vegetativa. Quefli corefpondtv ano molto
ad altrifimili grani che produce la[égala i quali ho veduto
alcune rade volte ne campi vietno alla citta. Je m’étonne
que Ginani qui a écrit fi fort au long de
toutes les maladies du grain en herbe, n’ait dit que
ce peu de mot du bled ergoté, & qu’il n’én ait cherché
les caufes ni les remedès, ce qu’il a fait avec
tant de fuccès 6c de détails fur les autres maladies;
pour revenir au froment ergoté, M. Delu en a montré
à M. Duhamel, j’en ai moi-même trouvé quatre
ou cinq épis : Yergot du froment eft beaucoup plus
gros 6c bien plus court que celui du feigle ; on
trouve plus aifément du froment ergoté dans les
champs de méteil que dans ceux enfemencés de
pur froment , comme fi le voifinage du feigle
pouvoit communiquer cette maladie au froment;
cependant M. Tillets’eft convaincu par l’expérience
que la pouflïere de Y ergot n’eft point contagieufe
comme celle du charbon. On a aufli trouvé de
Yergot fur plufieurs efpeces de gramens, fur l’y vraie ,
v fur l’orge, félon M. Gleditfch, mais rarement.
Il ne paroît pas que les.anciens aient connu Yergot,
à moins qu’on ne penfe qu’ils n’aient compris cette
excroiffance fous le terme générique de luxuries ve-
getum, dont parlent Pline &Théophrafte : mais il eft
d’autant plus probable que cette maladie leur étoit
. inconnue , qu’on cultivoit peu le feigle en Italie où
vil réuflit mal. Pline dit qu’on n’en femoit qu’au pied
des Alpes, & qu’il n’étoit bon qu’à appaifer la faim
des plus nécefliteux. Aufli Ginani ne parle du feigle
ergoté que dans une note ; 6c quoiqu’il rapporte les
mauvais effets qu’il produit en France , en Suiffe 6c
en Allemagne, il n’en dit rien pour l’Italie. Thalius ,
félon M. Read dans fon excellent Traité du feigle
çrgoté, eft le premier qui ait décrit ces grains particuliers,
6c qui peut-être en ait trouvé la véritable
’ caufe. « Il arrive fouvent ( dit Thalius ) que les
» grains d’un épi de feigle ; lorfque les fleurs font
» tombées, 6c qu’ils commencent à prendre de l’ac-
» croiffement, contractent une maladie occafonnée
» probablement par la trop grande quantité de fuc. qui
» s’y 'porte : d’où il arrive que J’écorce du grain
» encore tendre fe brife, 6c que fa fubftance in-
» terne s’enfle extraordinairement ; alors on voit
» quelques-uns de ces grains fortir de leurs balles ,
» ils noirciffent, & contiennent une farine d’une
» confiftance affez épaiffe ». Il eft furprenant- que
M. Read ni les .autres phyficiens ne fe foient pas
arrêtés à une explication aufli fimple qu’elle eft
naturelle, 6c qui conduit à croire que Yergot n’eft
qu’une fuite du défaut de conformation dè l’ovaire,
comme
càmme le charbon n’eft qu’un défaut de'conforma-'
tion de.l’Ôvaire dans le froment.
■ D ’autcës' . auteurs attribuent la génération i de
Y ergot à Üexéeifive humidité de d’air 6c du terrein.
«-Le feigle devient ergoté, dit G; Bauhin, lorfque
» dans lfe tems; de fa fleur il furvient des pluies rco*
» pieufeis , fui vies d’un foleil très-chaud ; ce qui
» peut attirer, dans la plante une plus grande quanf
» tité de fues nourriciers qu’il n’ën faut pour fon
» aliment : de-là la rupture de l’enveloppe du grain
» 6c l’accroiffement extraordinaire de fa fubftance
>> interne ». M. Dodart remarqué en effet que cetté
production monftrueufe eft plus ordinaire? dans les
années humides, & fur-tout.lorsqu’à près un tems
pluvieux il furvenoit des chaleurs exceflïves. M. le
Monniera fait la même obfervation. M. de Salerne,
qui a tant écrit fur les funeftes effets.de Y ergot, apprit
des payfans de Sologne-, que-le feigle ergoté
venoit à la i fuite des pluies trop fréquentes xlans le
tems de la fleur, qui fe corrompt 6c produit un ergot,
fur-tout dans les terres [naturellement humides, 6c
fi l’on a enfemencé les terrés trop tard. Cette dernière
circonftance eft d’aufant plus remarquable ,
qu’en Sologne, pays qui ne?porte que du feigle ,
d’où vient le nom de cette contrée Secaloina, l’on
y a toujours fuivi 6c examiné les caufes qui engendrent
l ’ergot, à caufe des funeftes .effets qu’il y
produit. L’on a fait en Allemagne les mêmes obfer-
vations , comme on le peut voir dans les annales de
Breflau pour 1717. -
Langius, Moeller 6C Schmiedei?, qui. ont écrit
avec tant de fuccès fur 1’ergot, l’ attribuent tous trois
aux vapeurs corr.ofives des rofées qui s’élèvent . du.
fein de la terre. Langius croit qu’un air humide ;
chargé de particules nitreufes , fulfureùfes , & d’autres
parties Volatiles, s’amaffe le long de l’épi, diftend
6c comprime la balle , pénétré la peau qui couvre
le grain, la difpofe à la putréfadion, & caufe dans
le grain même une fermentation qui le force à fe
gonfler. Ce raniofliffement do it, félon lu ifa c ilite r
au fuc nourricier que les racines attirent du terrein ,
& qui fe portent.en fi grande abondance dans l’intérieur
du grain, qu’il rompt 6c fend la peau qui lui
fert d’enveloppe : la chaleur des rayons folaires fait
évaporer cette humidité, donne une certaine con-
iiftance à la fubftance du grain, 6c occafionne ces
rugofités qu’on apperçoit à la fuperficie. Langius
accufe principalement la qualité corrofive de la ro-
fée ; il fe fonde fur ce qu’elle eft plus fréquemment
fenfible dans le tems où l’on obferve des ergots,
& qu’il a remarqué que ces grains étoient fouvent
couverts d’une matière vifqueufe 6c douce ,
qualités confiftantes 6c effentielles de ce météore.
Schmieder a fait les mêmes obfervations, 6c penfe
que cette rofée, dégénérée en fubftance mielleufe
qui s’attache aux barbes des épis, eft produite par
les vapeurs âcres 6c vifqueufes de la terre, qui
n’ayant pu être diflipées & raréfiées par une chaleur
fuffifimte, retombent avec les pluies fines ; &
s’attache aux barbes des épis, auxquelles elle refte
fi adhérente, que les pluies fines ne peuvent l’en
détacher : de-là cette fubftance s’infinue dans les
balles, pénétré le grain, 6c y occafionne une fermentation
qui en fait croître la fubftance. M. Fagon,
médecin de Louis X IV , avoit déjà donné, au rapport
de Fontenelle dans YHiJioire de l'académie, la
même explication de la génération de Yergot, qui
retenoit les mêmes qualités nuifibles que la matière
nielleufe.à laquelle il devoit fa naiffance. M. Tillet
a remarqué que la même fubftance nielleufe attar
chée à un épi d’ivraie, y avoit engendré Yergot.
M. Adanfon croit que Yergot a la même caufe que
le givre ; c’eft-à-dire, qu’il, rapporte toutes les maladies
des bleds au défaut de tranfpiratiQn. M. Gle-
Tqrne //.
ditfch croit aufli què 'le clavus Linnai,6if;affter-'korrl, '
appartient aux vices dont-peut être attaquée utïe
tige de bled qui prendToffaccroiffement en plein- air*
lorfqu’èlle eft dans toute fa fleur, 6c • lur-tôu^
quand les pluies abondantes font mêlées à dè'^vio"'
lentes chaleurs ;? rhumidfté s’amaffe pendant l’efflo"
refcence dàns les calices autour du petit- fruit tendre,
y caufe une moififfure: qui dévore la pellicule &•
l’extérieur, fans compter que le fuc? propre ou
mielleux.de là plante y :& retenu par la feèfétion ■
convenable, ne fauPoit s’en faire. Les étuis-ou cap-
fules des fémences venant^ à< crever, font en partie
détruits ; alors le grain? imparfait qui continue font
accroiffement, de vientcalleux & d’un blanc bleuâtre,
tandis que la.couleur extérieure eft noire. Le fuc v icieux
dont cette excroiffarice-a été formée , pâroîf
avoir uneâcreté fluide toute’particulière-, qui. peut
donner lieu à des maux finguliers, dè i ’efpece des
crampes, 6c qui vont jufqu’à fendre eftrppié,quand-
il ea entre -beaucoup dans;'le pain.
Enfin, M. Tillet combat avec avantagé cësiexpli-
cations dans une fameufe differtation couronnée à
Bordeaux , & préfentée au roi en 1755'. « Commentée
dit-il) les brouillards, les rofees qui produifent
Yergot dans lé feigle, ne prôdüilent-ils ja-!
mais cette maladie dans l’orge,.dans Favôiné, ni
même dans une quantité de froment fans -barbe ,
où l’on ne voit jamais d’ergot ? D’ailleurs, les
brouillards couvrant ordinairement unie -certaine
partie de terrein, dévoient produire ùô effét affez'
général, & fouvent un épi eft ergoté fans que fon
voîfinle. fôit; un arpent eft ergoté, fans que l’arpent
voifin ,ait fouffert ; un -épi même n’eft jamais entièrement
ergoté: on ‘voit aufli d'e l’^/gurdarts les années
fechesquoique moins abondamment que dans
les pluvieufes. Le feigle lemé dans un champ inondé
y a péri, au lieu de produire de Yergot,, 6cé. »
Poyei l’article E r g o t , Dicl. raif. des Sciences, &c*-
tranferit en entier d’après les élémens de M. Duha-'
m e l, dont les ouvrages fe-retrouvènt dans cette?
vafte compilation. Après avoir détruit lès'précédens
fyftêmes fur la formation dè Yergot, M. Tillet y
fubftitUe le fien. Je foupçonrie que Yergot eft pro*
duit par la piquure d’un infe&e, qui fait des grains
de feigle une efpece de galle ou excroiffance , qui
commençe par le fuintement de la liqueur contenue
dans le grain altéré par la tariere de Tihfeûe. En1
examinant plufieurs grains de feigle ergoté1, il a
apperçu un petit ver à peine fenfible aux y e u x ,
qui fe nourrit de ce grain, 6c le confomme. Il convient
cependant que parmi un très-grand nombre
d’ergotés,il n’y en a qu’un petit nombre qui renferme
des chenilles , &c. On peut voir fon fyftême.déve-
loppé dans l’excellent Traité de l'ergot de M. Read,
qui l’a revêtu de toutes les probabilités dont^'il étoit
fufceptible, fans cependant y joindre de nouveaux
faits.
J’obferverai que R a y , Hiß. plant. >741, regar-
doit déjà avant M. T ille t, l’excroiffancé du feigle
comme l’effet de la piquure d’un infefte. M. Tiffot,
dans fon Avis au.peuple ; p. S i4 , attribue Yergot à ’
la même caufe. M. Gleditfch, dans fa differtation
citée fur la nielle, parle par-occafion de Yergot,
6c croit que la piquure d’un infefte en peüt être
caufe, aufli-bien que le défaut de fécondation. Ce
fâcheux accident, dit-il, arrive aufli lorfqu’un infeéle
extrêmement|petit,que Linnæus, Ànint. Suéc.'p.: 6 7 ,
définit fcarabceus minimus aterflorilegas, ou'-quelque
autre efpece de vermiffeau à laquelle on ne peut
-pas toujours prendre garde, ronge certaines parties
des fleurs.; ou ne fait peut-être qu’y mordre , à caufe
de leur fuc qui a la douceur du miel. Il arrive en
çonlëquence que ces parties de fleurs venant à
manquer, ou étant privées des fucs qui :devro;ient les*
Q Q q q q