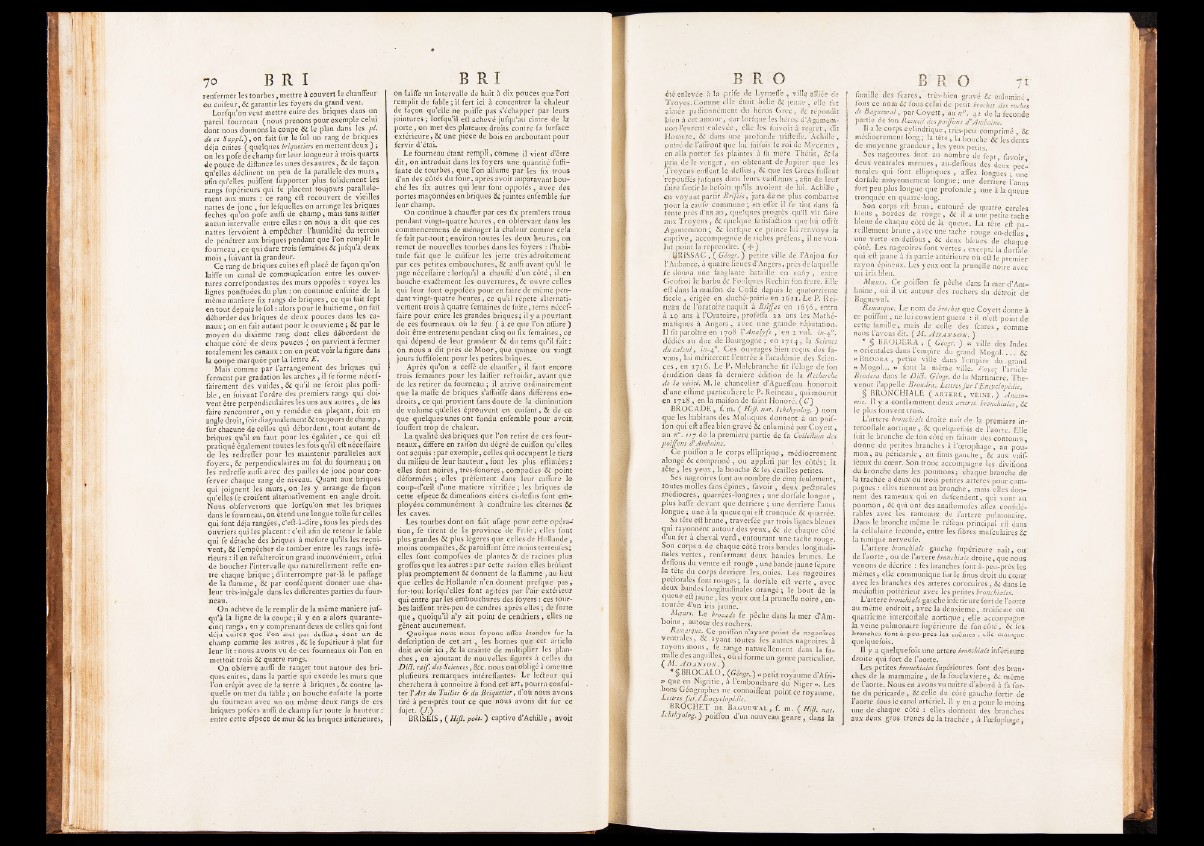
renfermer les tourbes, mettre à couvert le chauffeur
ou cuifeur, 8c garantir les foyers du grand vent.
Lorfqu’on veut mettre cuire des briques dans un
pareil fourneau (nous prenons pour exemple celui
dont nous donnons la coupe 8c le plan dans les pl.
de ce Suppl. ) , on fait fur le fol un rang de briques
déjà cuites ( quelques briquetiers en mettent deux ) ;
on les pofe de champ fur leur longueur à trois quarts
de pouce de diftance les unes des autres, 8c de façon
qu’elles déclinent ùn peu de la parallèle des murs,
afin qu’elles puiffent fupporter plus folidement les
rangs fupérieurs qui fe placent toujours parallèlement
aux murs : ce rang eft recouvert de vieilles
nattes de jonc , fur lefquelles on arrange les briques
feches qu’on pofe auflî de champ, mais fans laiffer
aucun intervalle entre elles : on nous a dit que ces
nattes fervoient à empêcher l’humidité du terrein
de pénétrer aux briques pendant que l’on remplit le
fourneau, ce qui dure trois femaines 8c jufqu’à deux
mois , fuivant fa grandeur. ^ ^
Ce rang de briques cuites eft placé de façon qu’on
laiffe un canal de communication entre les ouvertures
correfpondantes des murs oppofés : voyez les
lignes pon&uées du plan : on continue enfuite de la
même maniéré fix rangs de briques, ce qui fait fept
en tout depuis le fol : alors pour le huitième, on fait
déborder des briques de deux pouces dans les canaux;
on en fait autant pour le neuvième ; 8c par le
moyen du dixième rang dont elles débordent de
chaque côté de deux pouces | on parvient à fermer
totalement les canaux : on en peut voir la figure dans
la coupe marquée par la lettre E.
Mais comme par l’arrangement des briques qui
ferment par gradation les arches , il fe forme nécef-
fairement des vuides, 8c qu’il ne feroit plus pofli-
ble , en fuivant l’ordre des premiers rangs qui doivent
être perpendiculaires les uns aux autres , de les
faire rencontrer, on y remédie en plaçant, foit en
angle droit, foit diagonalement 8c toujours de champ,
fur chacune de celles qui débordent, tout autant de
briques qu’il en faut pour les égalifer, ce qui eft
pratiqué également toutes les fois qu’il eft néceffaire
de les redreffer pour les maintenir parallèles aux
foy ers , 8c perpendiculaires au fol du fourneau; on
les redreffe aufli avec des pailles de jonc pour con-
ferver chaque rang de niveau. Quant aux briques
qui joignent les murs, on les y arrange de façon
qu’elles fe croifent alternativement en ^ngle droit.
Nous obferverons que lorfqu’on met les briques
dans le fourneau,on étend une longue toile fur celles
qui font déjà rangées, c’eft-à-dire-, fous les pieds des
ouvriers qui les pfacent : c’eft afin de retenir le fable
qui fe détache des briques à mefure qu’ils les reçoivent,
8c l’empêcher de tomber entre les rangs inférieurs
: il en réfulteroitun grand inconvénient, celui
de boucher l’intervalle qui naturellement refte entre
chaque brique ; d’interrompre par-là le paffage
de la flamme, 8c par conféquent donner une chaleur
très-inégale dans les différentes parties du fourneau.
On achevé de le remplir de la même maniéré jufqu’à
la ligne de la coupe; il y en a alors quarante-
cinq rangs, en y comprenant deux de celles qui font
déjà cuites que l’on met par deflus, dont un de
champ comme les autres , 8c le fupérieur à plat fur
leur lit : nous-avons vu de ces fourneaux où l’on en
mettoit trois 8c quatre rangs.
On obferve aufli de ranger tout autour des briques
cùites, dans la partie qui excede les murs que
l’on crépit avec de la terre à briques, 8c contre.laquelle
on met du fable ; on bouche enfuite la porte
du fourneau avec un ou même deux rangs de ces
briques pofées aufli de champ fur toute la hauteur
entre cette efpece de mur 8c les briques intérieures,
on laiffe un intervalle de huit à dix pouces que Poii
remplit de fable ; il fert ici à concentrer la chaleur
de façon qu’elle ne puiffe pas s’échapper par leurs
jointures ; lorfqu’il eft achevé jufqu’au cintre de la
porte, on met des plateaux droits contre fa furface
extérieure, 8c une piece de bois en areboutant pour
fervir d’étai.
Le fourneau étant rempli, comme il vient d’être
dit, on introduit dans les foyers une quantité fuffi-
fante de tourbes, que l’on allume par les fix trous
d’un des côtés du four, après avoir auparavant bouché
les fix autres qui leur font oppofés, avec des
portes maçonnées en briques 8c jointes enfemble fur
leur champ.
On continue à chauffer par ces fix premiers trous
pendant vingt-quatre heures, en obfervant dans les
commencemens de ménager la chaleur comme cela
fe fait par-tout; environ toutes les deux heures, on
remet de nouvelles tourbes dans les foyers : l’habitude
fait que le cuifeur les jette très-adroitement
par ces petites embouchures, 8c aufli avant qu’il le
juge néceffaire : lorfqu’il a chauffé d’un cô té, il en
bouche exactement les ouvertures, 8c ouvre celles
qui leur font oppofées pour en faire de même pendant
vingt-quatre heures, ce qu’il répété alternatir
vement trois à quatre femaines de fuite, tems néceffaire
pour cuire les grandes briques; il y a pourtant
de ces fourneaux où le feu ( à ce que l’on affure )
doit être entretenu pendant cinq ou fix femaines, ce
qui dépend de leur grandeur 8c du tems qu’il fait :
on nous a dit près de Moor, que quinze ou vingt
jours fuffifoient pour les petites briques.
Après qu’on a ceffé de chauffer, il faut encore
trois femaines pour les laiffer refroidir, avant que
de les retirer du fourneau ; il arrive ordinairement
que la maffe de briques s’affaiffe dans différens endroits,
ce qui provient fans doute de la diminution'
de volume quielles éprouvent en cuifant, & de ce
que quelques-unes ont fondu enfemble pour avoir,
fouffert trop de chaleur.
La qualité des briques que l’on retire de ces fourneaux,
différé en raifon du dégré de cuiffon qu’elles,
ont acquis : par exemple, celles qui occupent le tiers
du milieu de leur hauteur, font les plus eftiméeài
elles font noires, trèsrfonores, compares 8c point
déformées ; elles préfentent dans leur caffure le
coup-d’oeil d’une matière vitrifiée ; les briques de
cette efpece 8c dimenfions citées ci-deffus font etù-;
ployées communément à conftruire les citernes 8c
les caves.
Les tourbes dont on fait ufage pour cette opération,
fe tirent de la province de Frife; elles font
plus grandes 8c plus légères que celles de Hollande ,
moins compares, 8c paroiffent être moins terreufes;
elles font compofées de plantes & de racines plus
groffes que les autres : par cette raifon eHes brûlent
plus promptement 8c donnent de la flamme , au lieu
que celles de Hollande n’en donnent prefque pas ,
fur-tout lorfqu’elles font agitées par l’air extérieur
qui entre par les embouchures des foyers : ces tourbes
laiffent très-peu de cendres après elles ; de forte
que, quoiqu’il n’y ait point de cendriers, elles ne
gênent aucunement.
Quoique nous nous foyons affez étendus fur la
defeription de cet.art , les bornes que cet article
doit avoir i c i , 8c la crainte de multiplier les planches
, en ajoutant de nouvelles figures à celles du
Hicl. raif. des Sciences, 8cc. nous ont obligé à omettre
plufieurs remarques intéreffantes. Le lefteur qui
cherchera à connoître à fond cet art, pourra conful-
ter l’Art du Tuilier 6* du Briquetier, d’où nous avons
tiré à peu-près tout ce que nous avons dit fur ce
fujet. (/.)
BRISÉIS, ( Hiß. poët. ) captive d’Achille, avoit
été enlevée à la prife de Lymeffe , ville alliée de
Troyes. Comme elle étoit belle 8c jeune ■, elle fut
aimée paflïonnément du hérds G re c , 8c répondit
bien à cet amour, carlorfque les héros d’Ag-amem-
non l’eurent enlevée, elle, les fuivoit à regret, dit
Homere, 8c dons une profonde trifteffe. Achille,
outré-de l’affront que lui faifoit le roi de Mÿcenes ,
en alla porter fes plaintes à fa mere Thétis, 8c-la
pria de le venger, en obtenant de Jupiter que les
Troyens enflent le deffus , 8c que les Grecs fuffent
repouffés jufques dans leurs vaiffeaux , afin de leur'
faire fentir le befoin qu’ils avoient de lui. Achille,
en voyant partir Briféis, jura de ne plus combattre
pour la caufe commune ; en effet il fe tint clans fa
tente près d’un an, quelques progrès qu’il, vît faire
aux Troyens, 8c quelque fatisfadion que lui offrit
Agamemnon ; 8c lorfque ce prince lui renvoya fa
captive, accompagnée de riches préfens, il ne voulut
point la reprendre. ( + )
13 R ISS AC , ( Géogr. ) petite ville de l’Anjou fur
l’Aubance, à quatre lieues d’Angers, près de laquelle
fe donna une fanglante bataille en 1067 , entre
Geofroi le barbu 8c Foulques Rechin fon frere. Elle
eft dans la maifon de Coffé depuis le quatorzième
■ fiecle , érigée en duché-pairie en i ö i i .L e P. Reineau
de l’oratoire naquit à Brißac en 1656, entra
à 20 ans à l’Oratoire, profeffa 22 ans les Mathématiques
à Angers, avec une grande réputation.
Il fit paroître en 1708 1 ' Analyfe , en 2 vol. i/2-40.
dédiés au duc de Bourgogne ; en 17 14 , la Science
du calcul, in-rf. Ces. ouvrages bien reçus des fa-
vans, lui méritèrent l’entrée à l’académie des Science
s , en 1716. Le P. Malebranche fit l’éloge de fon
érudition dans fa derniere édition de la Recherche
de la vérité. M. le chancelier d’Agueffeau honoroit
d’une eftime particulière le P. Reineau, qui mourut
en 1728 , en la maifon de faint Honoré. ( C )
BROCADE, f. m. ( Hiß. nat. Ichthÿolo g. ) nom
que les habitans des Moluques donnent à un poif-
fon qui eft affez bien-gravé 8c enluminé par C o y e tt ,
au. 72°. h.y de la première partie de fa Collection des
poißons £ Amboine.
Ce poiffon a le corps elliptique , médiocrement
alongé 8c comprimé ,. ou applati par le$;.qôtés; la
tête , les yeu x, la bouche 8c les écailles petites;.
Ses nageoires font au nombre de cinq feulement,,
toutes molles fans épines, favoir , deux peftorales
médiocres, quarrées-longues ; une dorfale longue ,
plus baffe devant que derrière ; une derrière l’anus
longue ; une à la queue qui eft tronquée 8c quarrée.
Sa tête eft brune, travërfée par trois lignes bleues
qui rayonnant autour des yeu x, 8c de chaque côté
d’un fer à cheval verd, entourant une tache rouge.
Son corps a de chaque côté trois bandes longitudinales
vertes, renfermant deux bandes brunes. Le
deffous du ventre eft rouge , unebande jaune fépare
la tête du corps derrière les^ouies. Les nageoires
.pe&orales font rouges ; la dorfale eft ver te , avec
deux bandes longitudinales orangé ; le bout de la
queue eft jaune, les yeux ont la prunelle noire ^entourée
d’un iris jaune.
Moeurs. Le brqcade fe pêche dans la mer d’Am-
bome , autour des rochers.
Remarque. Ce poiffon n’ayant point de nageoires
ventialçs,, 8c ayant toutes fes autres nageoires à
rayons mous, fe range naturellement dans la fa-
mille des anguilles, où il forme un genre particulier.
(M .A danson. )
S BROtCALO ’ (.^ogr.y« petit royaume d’Afri-
» que en Nigntie, à l’embouchure du Niger ». Les
bons Géographes, ne connoiffent point ce royaume.
Lettres fur. ÜEncy clopédie.
BROCHET de Baguewal, f. m. ( Hiß. nat.
Uhthyolog. J poiffon d’un nouveau genre, dans la
famille des foares, très-bien gravé 8c enluminé
fous ce nom 8c fous celui de petit brochet des roches
de Baguewa.1, par C o y e tt, au | É 42 de la fécondé
partie de fon Recueil despoifans d'Amboine.
lia le corps cylindrique, très-peu comprimé , 8e
médiocrement long; la tête, la bouche ÔC les dents
de moyenne grandeur, les yeux petits.
. :Ses nageoires font au nombre de fept, favoir ‘
deux ventrales menues, au-jleflous des deux pec-
' toraies qui font elliptiques , affez longues ; une
dorlale moyennement longue; une derrière l’anus
fort peu plus longue que profonde ; une à la queue
tronquée en quarré-long.
Son corps eft brun, entouré de quatre cercles
bleus , bordés de rouge, 8c il a une petite tache
bleue de chaque côté de la queue. La tête eft pareillement
brune , avec une tache rouge en-deffus
«ne verte en-deffous, 8c deux bleues de chaque
côté. Les nageoires font vértes , excepté la dorfale
qui eft jaune à fa partie antérieure où eft le premier
rayon épineux. Les yeux ont la prunelle noire avec
un iris bleu..
Moeurs. Ce poiffon fe pêche dans la mer d’Am-
boine, où il vit autour des rochers du détroit de
Baguerai.
Remarque. Le nom de brochet que C oyett donne à
ce poiffon, nelui convient guere : il n’eft point de
cette famille, mais de celle des feares,. comme
nous l’avons dit. ( M. A d a n s o n . )
* § BRODERA , ( Géogr. ) « ville des Indes-
» orientales dans l’empire du grand Mogol__ &
» Brqdra , petite ville dans l’empire -du. grand
» Mogol... ». font la meme ville. Voye£ l’article
Brodera dans le Dict. Géogr. de la Martiniere. The-
venot l’appelle Broudra.. Lettres J'ur C Encyclopédie.
§ BRONCHIALE (ARTERE, veine. ) Anatomie.
Il y a conftamment deux arteres. bronchiales, ôc
le plus fouvent trois.
L’artere bronchiale droite naît de la première in-
tercoftale aortique, 8c quelquefois de l’aorte. Elle
fuit le bronche de fon côté en failanr des contours,
donne de petites branches à l’oeiophage, air poumon,
au péricarde , au finus gauche , 8c aux vaif-
feaux du coeur. Son tronc, accompagne lçs-divifions
du.bronche dans les poumons; chaque branche de
la trachée a deux ou trois petites arteres pour compagnes
: elles tiennent au bronche, mais elles donnent
des rameaux qui en descendent, qui vont ail
poumon, & qui ont des.anaftomofes affez confidé-
rables;avec les rameaux: de l’artere pulmonaire.
Dans le bronche même le réfeau principal eft dans
la cellulaire fécondé, entre les fibres mufculaires 8c
la tunique nerveufe.
L’artere bronchiale gauche fupérieure naît, ou
de 1 aorte, ou de l’artere bronchiale droite, que nous
venons de décrire : fes branches font à-peu-près les
mêmes, elle communique fur ie finus droit du coeur
avec les branches des arteres coronaires, & dans le
médiaftin poltérieur avec les petites bronchiales.
L’artere bronchiale gauche inférieure fort de l’aorte
au même endroit,.avec la deuxieme, troifieme ou
quatrième intercoftale aortique ; elle accompagne
la veine pulmonaire fupérieure de fon côté, 8c fes
branches font à-peu-près les mêmes : elle manque
quelquefois.
Il y a quelquefois une artere bronchiale inférieure
droite qui fort de l’aorte.
Les petites bronchiales fupérieures font des branches
de la mammaire, de la fouclaviere, 8c même
de l’aorte. Nous en avons vu naître d’abord à Fa for-
tie du péricarde, 8c celle du côté gauche fortir de
l’aorte fous le canal artériel. Il y en a pour le moins
une de chaque côté : elles donnent des. branches
aux deux gros , troncs de la trachée , à l’oefophage,