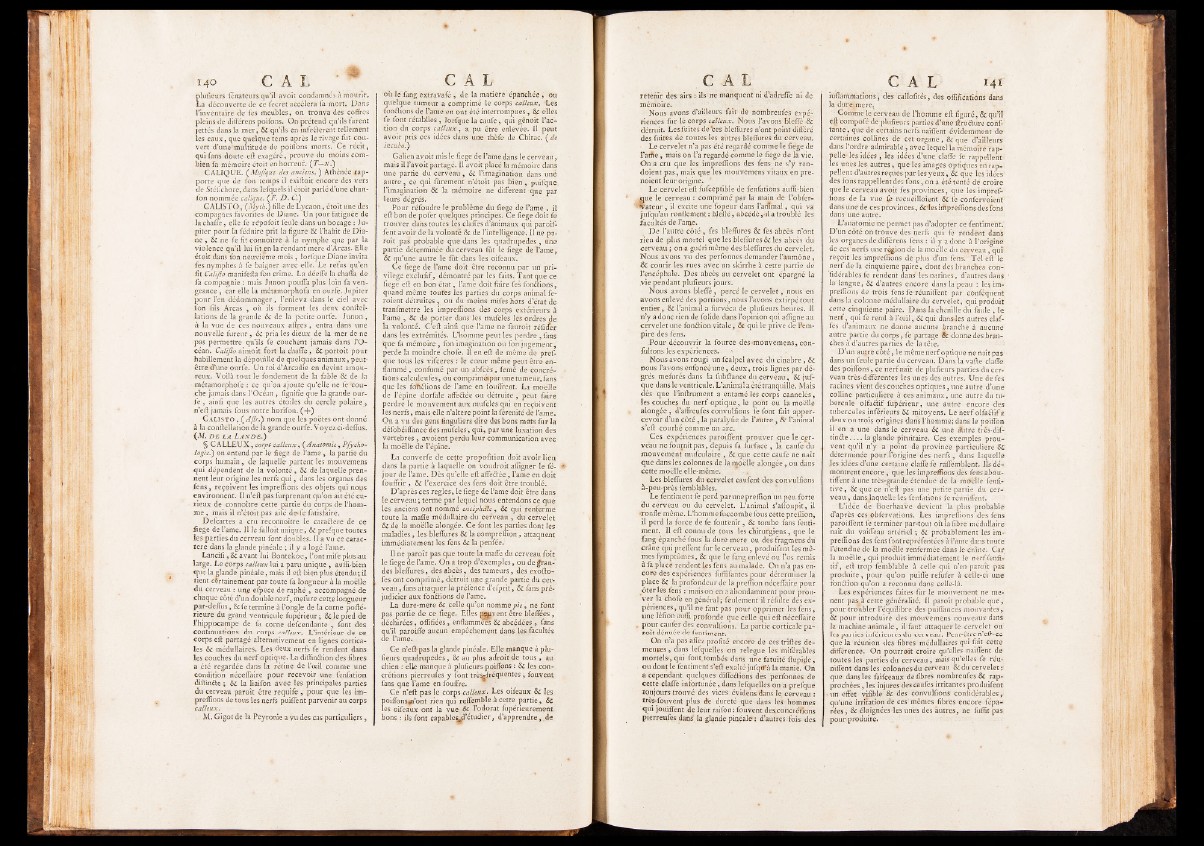
plufieurs fenateurs qu’il avoit condamnés.à mourir.
La découverte de ce fecret accéléra fa mort. Dans
^inventaire de fes meubles, on trouva des coffres
pleins de différées poifons. On prétend qu’ils furent
jettes dans la mer, & qu’ils en infe&erent tellement
les eaux, que quelque tems après le rivage fut couvert
d’une’multitude de poiffons morts. Ce récit,
qui fans doute, eft exagéré, prouve du moins combien
fa mémoire étoit en horreur. (T—N.)
CALIQUE. (Mujiqut des anciens. ) Athénée rapporte
que de fon temps il exiftoit encore des vers
de Stélichore, dans lefquels il étoit parlé d’une ehan-
fon nommée calique. (F. D. C.)
GALISTO , (.Myth.) fille de Lycaon, étoit une des
compagnes favorites de Diane. Un jour fatiguée de
la chaffe, elle fe répofoit feule dans un bocage : Jupiter
pour la féduire prit la figure 8c l’habit de Diane
, & ne fe fit connoître à la nymphe que par la
violence qu’il lui fit en la fendant mere d’Arcas. Elle
étoit dans fon neuvième mois , lorfque Diane invita
fes nymphes à fe baigner avec elle. Le refus qu’en
• fit Calijlo manifefta fon crime. La déefl'e la chaffa de
fa compagnie : mais Junon pouffa plus loin fa vengeance
, car elle la métamorphofa en ourfe. Jupiter
pour l’en dédommager, l’enleva dans le ciel avec
Ion fils Areas , oii ils forment les deux conftel-
lations de la grande 8c de la petite ourfe. Junon ,
à la Vue de ces nouveaux affres, entra dans vine
nouvelle fureur , 8c pria les dieux de la mer de ne
pas permettre qu’ils fe (Touchent jamais dans l’Océan.
Califio aimoit fort la chaffe, & portoit pour
habillement la dépouille de quelques animaux, peut-
être d’une ourfe. Un roi d’Arcadie en devint amoureux.
Voilà tout le fondement de la fable 8c de la
métamorphofe : ce qu’on ajoute qu’elle ne fe ‘couche
jamais dans l’Océan, fignifie que la grande our-
;f e , ainfi que les autres étoiles du cercle polaire,
n’efi jamais fous notre horifon. (+ )
C a l isto , (A(lr.) nom que les poètes ont donné
à la conffellation de la grande ourfe. V oyez ci-deffus.
(M. d e la La n d e .)
§ CALLEUX, corps calleux, ( Anatomie, PJycho-
logie.) on .entend par le fiege de l’ame , la partie du
corps humain, de laquelle partent les mouvemens
qui dépendent de la volonté , & de laquelle prennent
leur origine les nerfs q ui, dans les organes des
fens, reçoivent les impreffions des objets qui nous
environnent. Il n’eft pas furprenant qu’on ait été curieux
de connoître cette partie du corps de l’homme
, mais il n’étoit pas aifé de»fe fatisfaire.
Defcartes a cru reconnoître le caraftere de ce
fiege de Pâme. Il le falloit unique, & prefqne toutes
les parties-du cerveau font doubles. Il a vu ce caractère
dans la glande pinéale ; il y a logé Pâme.
Lancifi ,& avant lui Bontekoe^ Pont mife plus -au
large. Le corps calleux lui a paru unique , aufîi-bien
que la glande pinéale, mais il eft bien plus étendu; il
tient certainement par toute fa longueur à la moelle
du cerveau ; un£ efpece de raphé , accompagné de
chaque côté d’un double nerf, mefure cette longueur
par-deffus, ôtfe termine à l’ongle de la corne pofté-
rieure du grand ventricule fupérieur; & le pied de
l’hippocampe de fa corne defeendante , font des
continuations du corps calleux. L’intérieur de ce
corps eft partagé alternativement en lignes corticales
8c médullaires. Les deux nerfs fe rendent dans
les couches du nerf optique. La diftinefion des fibres
a été regardée dans la rétine de l’oeil comme une
condition néceffaire pour recevoir une fenfation
diftin&e ; 8c la liaifon avec les principales parties
du cerveau paroît être requife , pour que les impreffions
de tous les nerfs puiffent parvenir au corps
calleux.
M. G igot de la Peyronie a vu des cas particuliers,
oh le fang extravafé , de la matière épanchée, ou
quelque tumeur a comprimé le corps calleux. Les
fondions de l’ame en ont été interrompues, & elles
fe font rétablies, lorfque la caufe, qui gênoit l’action
du corps calleux, a pu être enlevée. Il peut
avoir pris ces idées dans une thèfe de Chirac. ( de
incubo.)
Galien avoit mis le fiege de l’ame dans le cerveau,
mais il l’avoit partagé. Il avoit placé la mémoire dans
une partie du cerveau, 8c l’imagination dans uné
autre, ce qui fûrement n’étoit pas bien, puifque.
l’imagination 8c la mémoire ne different que par
leurs degrés.
Pour réfoudre le problème du fiege de l’ame , il
eft bon de pofer quelques principes. Ce fiege doit fe
trouver dans toutes les claffes d’ânimaux qui paroifc
fent avoir de la volonté 8c de l’intelligence. Il ne paroît
pas probable que dans les quadrupèdes, fine
partie déterminée du cerveau fût le fiege de l ’ame,
8c qu’une autre le fut dans les oifeaux.
Ce fiege de l’ame doit être reconnu par un privilège
exclufif, démontré par les faits. Tant que ce
fiege eft en bon état, l’ame doit faire fes fondions,
quand même toutes les parties du corps animal fe-
roient détruites , ou du moins mifes hors d’état de
tranfmettre les impreffions des corps extérieurs à
l’ame , & de porter dans les mufcles les ordres de
la volonté. C.’eft ainfi que l’ame ne fauroit réfiaer
dans les extrémités. L’homme peut les perdre , fans
que fa mémoire , fon imagination ou fon jugement,
perde la moindre chofe. Il en eft de même de pref-
que tous les vifeeres : le coeur même peut être enflammé
, confumé par un abfcès, femé de concrétions
calculeufes, ou comprinïéipar une tumeur, fans
que les fonctions de l’ame en fouffrent. La moelle
de l’épine dorfale affeûée ou détruite , peut faire
perdre le mouvement aux mufcles qui en reçoivent
les nerfs, mais elle n’altere point la férenité de l’ame.
On a vu des gens finguliérs dire des bons mots fur la
défobéiffance des mufcles, qui, par une luxation des
vertebres , avoient perdu leur communication avec
la moëllé de l’épine.
La converfe de cette propofîtion doit avoir lieu
dans la partie à laquelle on voudroit affigner le fé-
jour de l’ame. Dès qu’elle eft affectée , l’ame en doit
fouffrir , 8c l’exercice des fens doit être trouble.
D ’après ces réglés, le fiege de l’ame doit être dans
le cerveau; terme par lequel nous entendons ce que
les anciens ont nommé encépkdle , & qui renferme
toute la maffe médullaire du cerveau , du cervelet
8c de la moelle alongée. Ce font les parties dont les
maladies, les bleffures & la compreffion, attaquent
immédiatement les féns 8c la penfée.1
Il ne paroît pas que toute la maffe du cerveau foit
le fiege de l’ame. On a trop d’exemples, ou de grandes
bleffures, des abcès, des tumeurs, des exofto-
fes ont comprimé, détruit une grande partie du cerveau
, fans attaquer la préfence d’efprit, 8c fans préjudicier
aux fondions de l’ame.
La dure-mere & celle qu’on nomme pie, ne font
pas partie de ce fiege. Elles najivent être bleffées ,
déchirées, offifiées, enflammées & abcédées , fans
qu’il paroiffe aucun empêchement dans les facultés
de l’ame.
Ce n’eft-pas la glande pinéale. Elle manque à plufieurs
quadrupèdes, 8c au plus adroit de tous , au
chien : elle manque à plufieurs poiffons : 8c les concrétions
pierreufes y font trè^réquentes ; fouvent,
fans que l’ame en fouffre.
Ce n’eft pas le corps calleux. Les oifeaux & les
poiffonsjip’ont rien qui reffemble à cette partie, 8c
les oifeaux ont la vue & l’odorat fupérieurement
bons : ils font capableyl’étudier, d’apprendre, de
retènîr des: airs : ils ne manquent ni d’adreffé ni de
mémoire.
Nous avons d’ailleurs fait de noinbreüfeS expé-,
riences fur lè corps calleux. Nous l’avons bleffé 8c
détruit. Le s fuites de'ceS bleffures n’ont point différé
des fuites de toutes les autres bleffures du cerveau.
Le cervelet n’a pas1 été regardé comme le fiège de
l’a die, mais on l’a regardé comme le fiege de la vie.
On a cru que les impreffions des fens- ne s?y ren-
cloient pas, mais que les mouvemens vitaux en pre-
noient leur origine. *
Le cervelet eft fufceptible de fenfations auffi-bien
.jgue le cerveau : comprimé par la main de l’obfer-
«vateur, il excite une fopeur dans l’ammal, qui va
gufqu’au ronflement : bjeffé, abcédé ,*il a troublé les
facultés de l’anie.
De l’autre côté , fes bleffures & fes abcès n’ont
rien de plus mortel que les bleffures & les abcès dû
cerveau ; on a guéri même des bleffures du cervelet.
Nous avons vu des perfonnes demander l’aumône,
8c courirdes rues avec un skirrhe à cette partie de
l’encéphale. Des abcès au cervelet ont épargné la
.vie pendant plufieurs jours.
Nous avons bleffé, percé le cervelët, nous en
avons enlevé des portions, nous l’avons extirpé tout
entier, & l’animal a furvécu de plufieurs heures. Il
n’y a donc rien de folide dans l’opinion qui affigne au
cervelet une fonéfion vitale 9 8c qui le prive de l*em-
pire des fens.
.Pour découvrir la fource des*mouvemens, con-
fultons les expériences. >
Nous avons rougi un fcalpel avec du cinabre, 8c
nous Pavons enfoncé une, deux, trois lignes par dé-
grés mefurés dans la fubffance ducerveau, 8c juf-
que dans le ventricule. L’animai a été tranquille. Mais
dès que l’inftrument a entamé les corps cannelés,
les couche? du nerf optique, le pont ou la moelle
alongée , d’affreufes convulfions fe font fait apper-
cevoir d’un cô té, la paralyfie de l’autre , & l’animal
s ’eft courbé comme un arc.; ’
Ces expériences paroiffent prouver que le cerveau
ne fournit pas, depuis fa furface , la caufe du
mouvement mufculaire , & que cette caufe ne naît
que dans les colonnes de la moelle alongée, ou dans
cette moelle elle-même. *
Les bleffures dit cervelet caufent des convulfions
à-peu-près femblables.
Le fentiment fe perd par unepreffio.n un peu forte
du cerveau ou du cervelet. L’animal s’affoupit, il
♦ ronfle même. L’homme fuccombe fous cette preffion,
il perd la force de fe foutënir, 8c tombe fans fentiment.
Il eft connu de tous les chirufgiens, que le
fang épanché fous’ la dure mere ou dés fragmens dif
crâne qui preffent fur le cerveau, produifent les mêmes
fymptômes, & que le fang enlevé ou l’os remis
à fa place rendent les fens au malade. On n’a pas encore
des expériences fuffifantes pour déterminer la
place 8c la profondeur de la preffion néceffaire pour
jôterles fens : maison en a abondamment pour prouver
la chofe en général ; feulement il réfulte dès expériences,
qu’il ne faut pas pour opprimer les fens,
une lefion auffi profonde que celle qui eft néceffaire
’ P°*ur ^au^fr ^es convulfions. La partie corticale paroît
dénuée de fentiment.
On n’a pas affez profité encore de ces triftes de-
meuses, dans lefquelles< on relegue les miférables
mortels’, qui font.tombés dans une fatuité ftupifle ,
ou dont le fentiment s’eft exalté jufqüFà la manié. On
a cependant quelques diffeôions des perfonnes de
cette claffe infortunée, dans lefquelles on a prefque
toujours trouvé des vices évidëns dans le cerveau :
très-fouvent plus de dureté que dans les hommes
qui jouiffent de leur raifôn : fouvent des.concré$ons
pierreufes dans’ la glande pinéale* : d’autres- fois des
iüflammations , des callofités, des offificafiôûs dans
la duresmere.
• Comme le cerveau de l’homme eft figuré, & qu’il
cf£ compofé dé-plufieurs parties d’une ffruéhire corif*
tante , que de certains nerfs naifiént évidemment de
certaines collines de cet organe , & que d’ailleurs
dans l’ordre admirable, avec lequel la mémoire rap*
pelle*lës idées , les idées d’une claffe fe rappellent
les unes les. autres, qué les images optiques en rappellent
d’autres reçues par les yeux, & que les idées’
des fons rappellent dés fons, on a été tenté de croire
que le cerveau avoit fes provinces, que les impreffions
de la vue fe recueilloient 8c fe confervôient
dans une de ces provinces, écoles irftpreffions des fons
dans une autre. '
L’anatomie ne permet pas d’adopter ce fentiment.
D’un côté on trouve des nerfs qui fe rendent dans
les- organes de dtfferens fens ! il y a donc à l ’origine
de ces'nerfs une région de la moelle du cerveau, qui
reçoit les impreffions de plus d’un fens. Tel eft le
nerf de la cinquième paire, dont des branches con-
fidérables fe rendent dans les narines, d’autres dans
la langue, 8c d’autres encore dans la peau : les impreffions
de trois fens fe-réuniffent par conféquent
dans la colonne médullaire du cervelet, qui produit
cette cinquième paire. Dans la chenille du faille , le
Herf, qui fe rend à l’oeil, & qui dansdes autres claffes
d’animaux ne donne aucune branche à aucune
autre partie du corps, fe partage !êc donne des branches
à d’autres parties de la tête.
D ’un autre côté, le même nerf optique ne naïf pas
dans un feule partie du cerveau. Dans la vafte claffe
des poiffons, ce nerf naît de plufieurs parties du cerveau
très:différentes les unes des autres. Une de fes
racines vient des couches optiques, une autre d’ une
colline particulière à ces animaux, une autre du tubercule
o lfaâ if fupérieur, une autre encore des
tubercules inférieurs & mitoyens. Le nerf olfaûifa
deux ou trois origines dans l’homnie; dans le poiffon
il en a une dans le cerveau 8c une filtre tr£s-dif-’
t in fte .... la glande pituitaire. Ces exemples prouvent
qu’il n’y a point de province particulière 8c
déterminée pour .l’origine des nerfs , dans laquelle
les idées d’une certaine claffe fe râffemblent. Ils démontrent
encore, que. les impreffions des fens abôu-
tiffent à une très-grande étendue de la moelle fenfi-
t ive , & que ce n’eft pas uné petite partie du cerveau
, dansjaquelle les fenfations fe réunifient.
L’idée de Boerhaave devient la plus probable
d’après ces çblervations. Les impreffions des fèns
paroiffent fe terminer par-tout oit la fibre médullaire
naît du vaille a u artériel ; & probablement lès impreffions
des fens fontrepréfentées à l’am'e dans toute
l’étendue de la moelle renfermée dans lè cYâne. Car;
la moelle , qui produit immédiatement le nerffenfi-
t if, eft trop femblable à celle qui n’en paroît pas
produite, pour qu’on puifl'e refufer à celle-ci une
fonéfion qu’on a reconnu dans celle-là. ' '-:
• Les expériences faites-fur le mouvement ne mènent
pas.à cette généralité. Il paroît'probable que,
pour troubler l’équilibre des puiffances mouvantes,
& pour introduire des mouvemens nouveaux dans
la machine animale, ilfaufi attaquer le cervelet ou
les parties inférieures du cerveau. Peut-être n’eft-ce
que la réunion des fibres médullaires qui fait cette
différence. On po!urra«it croire qu’elles naiffent de
toutes les parties du cerveau, mais qu’elles fe réunifient
dans les colonnes du cerveau & du cervelet:’
que dans les faifeeaux de fibres nornbreufes & rapprochées
, les injures des caufes irritantes produifent
• un effet vifible & des convulfions conficlérabjes,
qu’une irritation de ces mêmes fibres encore fépa-
rées, 8c éloignéesdes unes des autres, ne fuffit pas
pour produire.