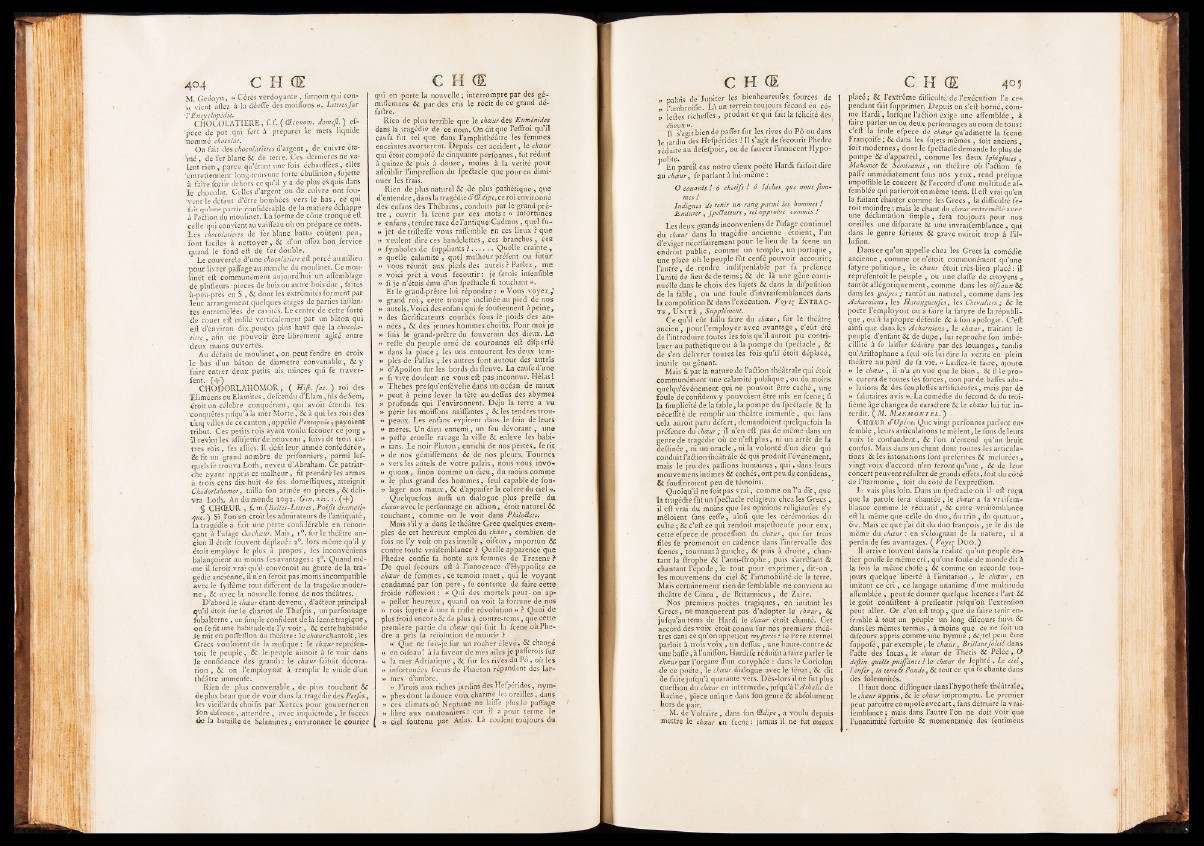
M. Gedoyn, « Cérès verdoyante , furnom qui con-
» vient allez à la déeffe'des moiffons ». Lettres, fur
‘VEncyclopédie. d \ r
CHOCOLATIERE ,‘ f .f. ( (Econom, domejt. ) et- ,
’pece de pot " qui fert à préparer le mets liquide ;
'nommé chotolat. .
On fait des chocolatières d’argent, de cuivre eta-
'■ mé , dé fer blanc & dë terre. Ces dernieres ne valent
rien , parce' qu’étant une fois echauffees, elles
‘entretiennent lông-tems une forte ébullition ,-fu jette
à faite’fcjrtir dehors ce qu’il y a de plus exquis dans
l e chocolat. Celles d’argent ou de cuivre ont fou-
*vent le défaut d’être bombées vers le bas, ce qui
'fait qu’une partie confidérable de la matière échappe
à l’aélion du moulinet. La forme de cône tronqué eft
celle qui convient au vaiffeau oit ôn prépare ce mets.
Les chocolatières de fer blanc battu coûtent peu,
'font faciles à nettoyer, 6c d’un âffez bon fervice
quand le fond eft de fer double.
Le couvercle d’une chocolatière eft percé au milieu
•pour livrer paffage au manche du moulinet. Ce moulinet
eft communément aujourd’hui un affemblage
de plufieurs pièces de buis ou autre bois dur , faites
;à-pè'u-près en S , & dont les extrémités forment par
leur arrangement quelques étages de parties Taillantes
entremêlées de cavités. Le centre de cette forte
de rouet eft enfilé verticalement par un bâton qui
éft d’environ dix pouces plus haut que la chocolatière
, afin 'de pouvoir être librement agité entre
deux mains ouvertes.
Au défaut de moulinet, "on peut fendre en croix
l e bâs d’un bâton de diamètre Convenable, & y
faire entrer deux.petits âis minces qui fe fraver-
fent. (-b)
CHODÔRLAHOMOR, ( U ifi.fa c ..) foi des
Tlimeeils ou Elamites, defcendu d’Elam, fils de Sem,
étoit un célébré Conquérant, qui avoit étendu fes
'conquêtes jûfqu’a la mer Morte, & à qui les rois des
Cinq villes de ce canton, appelle Pentapole ,.pa.yoient
tribut. Ces petits rois ayant voulu fecouer ce joug ,
i l revint les’ affujettir’de nouveau , fuivi de trois autres
rois, fes alliés. Il défit leur armée confédérée ,
& fit un grand nombre de prifonniers, parmi lef-
quelsfe trouva Loth, neveu d ’Abrâham. Cepatriar-
che ayant appris ce-malheur, fit prendre les armes
à trois cens dix-huit de fes domeftiques,-atteignit
■ Chodorlahomor, tailla fon afmée en pièces,6 c délivra
Loth. An du monde xOÿi.-Gen.-xiv.-i. (+ )
'§ CH (EU R , f. m.(B elles-Lettres, Poijie dramatique.
) Si l’on en croit les admirateurs de l’antiquité,
la tragédie a fait une perte confidérable en renon-
qaht -àTufàge'du'c/zte«/'. Mais, i° . fur ie théâtre ancien
il étoit fou vent déplacé: z°. lors même qu’il y
étoit employé le plus à propos, fes inconvéniens
balançoient au moins fes avantages : 30. Quand mê-
>me il feroit vrai qu’il convenoit au genre de la tra -1
•gédie ancienne, il n’en feroit pas moins incompatible
avec le fyftême tout différent de la tragédie moder-
•ne, &• avec la nouvelle forme dé nos théâtres.
D’abord le choeur étant devenu , d’afteur principal
qu’ il étoit-fur le Chariot de Thefpis, un perfonnage
fubalterne , un fimple confident de la fcene tragique,
'©n fe'fit-une habitude de l’y v o i r , 6c cette habitude
le mit en.poffeflion du théâtre: le c^oearchantoit, les
Grecs vouloient de la mufique : le choeur repréfen-
toit le peuple, & le.,peuple aimoit à fë voir dans
-la confidence des grands : le choeur faifoit décoration
, & on l’employoit à remplir le vuide d’un
théâtre immenfe.
qui xen -porte la nouvelle ; interrompre par des gé-
miffemens 6c par des cris le récit de ce grand dé-
faftre.
Rien de plus terrible que le choeur des Euménides
dans la tragédie »de ce nom. On dit que l’effroi qu’il
caufa fut tel que dans l’amphithéâtre les femmes
enceintes avortèrent. Depuis cet accident, le choeur
qui étoit compofé de cinquante perfonnes, fut réduit
à quinze & puis à douze, moins à la vérité pour
affaiblir l’impreflion du fpeflacle que pour en diminuer
Rien de plus convenable , de plus touchant &
déplus beau que de voir dans la tragédie des Perfes,
les vieillards choifis par Xercès pour gouverner en
fon abfence , attendre , avec inquiétude , le fuccès,
lie la bataille de Salamines ; environner le courier [
les frais.
Rien de plus naturel & de plus pathétique , que
d’entendre, dans la tragédie d’ (OEdipe, ce roi environné
des enfans des Thébains, conduits par le grand prêtre
, ouvrir la fcene par ces mots c « Infortunés
» enfans, tendre race de l’antique Cadmus, quel fu-
» jet de trifteffe vous raffemble en ces lieux ? que
» veulent dire ces bandelettes, ces branches , ces
» fymboles de fuppliants ? . .........Quelle crainte ,
» quelle calamité, quel malheur préfent ou futur.
» vous réunit aux pieds des autels ? Parlez, me
» voici prêt à vous fecourir: je ferois infenfible.
» fi je n’étois ému d’un fpeâacle fi touchant <».
Et le granârprêtre lui répondre : «Vous voyez J
v> grand r o i , cette troupe inclinée au pied de nos
» autels. Voici des enfans qui fe foutiennent à peine ,
» des facrificateurs courbés fous le poids des an-
» nées , 6c des jeunes hommes choifis. Pour moi je
» fuis le .grand-prêtre du fouverain des dieux. Le
» reftfe du peuple orné de couronnes eft difperfé
» d?ns la place ; les uns entourent les deux tem-
» pies de Pallas ; les autres font autour des autels
» d’Apollon fur les bords du fleuve. La caufe d’une
» fi vive douleur ne vous eft pas inconnue. Hélas l
- » Thebes prefqu’enféyelie dans un océan de maux
» peut à peine lever la tête au-deffus des abymes
» profonds qui l’environnent. Déjà la terre a vu
» périr les moiffons naiffantes , 6c les tendres trou-
» peaux. Les enfans expirent dans le fein de leurs
» meres. Un dieu ennemi, un feu dévorant, • une
» pefte cruelle ravage la ville & enleve les habi’-
» tans. Le noir Pluton, enrichi de nos pertes, ferit
» de nos gémiffemens & de nos pleurs. Tournés.
» vers les autels de votre palais, nous vous invo-*
» quons , finon comme un dieii,' du moins comirçe
« le plus grand des hommes, feul capable de fou-
» lager nos maux, 6c d’appaifer la colere du ciel ».
Quelquefois aufli un dialogue plus preffé du
choeur avec le perfonnage en action, étoit naturel 6c
touchant, comme on le voit dans Philoclete.
Mais s’il y a dans le théâtre Grec quelques exemples
de cet heureux emploi du choeur, combien de
fois ne l’y voit-on pas inutile , oifeux, importun 6c
contre toute vraifemblance ? Quelle apparence que
Phedre confie fa honte aux femmes de Trezene?
De quel fecours eft à l’innocence d’Hyppolite ce
thoeur de femmes, ce témoin muet, qui le voyant
condamné par fon pere -, fe contente de foire cette
froide réflexion: «Q u i des mortels peut -on ap*
» peller heureux, quand on voit la fortune de nos
» rois fujette à une fi trifte révolution « ? Quoi de
plus froid encore 6c de plus à contre-tems, que cette
première partie du choeur qui fuit la fcene oii Phedre
a pris la réfolution de mourir ?
« Que ne fuis-je fur un rocher élevé, & changé
» en oifeau'l à la faveur de mes ailes je pafferois fur
» la mer Adriatique fur lesrives du P ô , où les
» infortunées foeurs de Phaëton répandent des lar-
■ » mes d’ambre.
» J’irois aux riches jardins des Hefpériçles, nym-
» phes dont la douce voix charme les oreilles, dans
» ces Climats oii Neptune ne laiffe plus le paffage
» libre aux nautonniers : car il a pour 'terme le
» ciel foutenu par Atlas. Là coulent toujours di*
» palais de'Jupiter les bienheureufes fources de
» l’ambroifîe. Là un terrein toujours fécond en cé-
» leftes richeffes , produit cè qui fait la félicité des
Il s’agit bien de paffer fur les rives du Pô ou dans
le jardin des Hefpérides ! Il s’agit de fecourir Phedre
réduite au defefpoir, ou de fauver l’innocent Hypô-
polite.
En pareil cas notre vieux poete Hardi faifoit dire
au choeur, fe parlant à lui-même :
O couards ! ô chétifs ! 6 lâches qüe nous fom-
mes !
Indignes détenir un rang parmi les hommes!
■ Endurer, fpectateurs, tel opprobre commis ! - -
Les deux grands inconveniens de l’ufage continuel
'du choeur dans la tragédie ancienne étoient, l’un
d’exiger néceffairement pour le lieu de la fcene un
endroit public, comme^ un temple, un portique ,
Une place oîi le peuple fut cenfé pouvoir accourir;
l’autre, de rendre indifpenfable par fa préfence
l’unité de lieu & d e tems; & de là une gêne continuelle
dans le choix des fujets & dans la difpofition
de la fabïe, ou une foule d’irtvraifemblances dans
la compofition & dans l’exécution. Voye£ E n t r a c t
e , U n i t é , Supplément.
Ce qu’il eût fallu faire du choeur, fur le théâtre
ancien, pour l’employer avec avantage , c’eût été
de l’introduire toutes les fois qu’il auroit pu contribuer
au pathétique ou à la pompe du fpeétacle , &
de s’en délivrer toutes les fois qu’il étoit déplacé,
-inutile ou gênant.
Mais fi par la nature de l’a&ion théâtrale qui étoit
■ Communément une calamité publique, ou du moins
'quelqu’évënement qui ne pouvoit être caché, une
ffoule de confidens y pou voient être mis en fcene ; fi
la fimplicité de la fable, la pompe du fpe&acle & la
néceflité de remplir un théâtre immenfe, qui fans
cela auroit paru défert, demandoient quelquefois la
préfence du choeur; il n’en eft pas de même c^ans un
genre de tragédie où ce n’eft plus, ni un arrêt de la
deftinëe , ni un oracle-, ni la volonté d’un dieu qui
conduit I’a&ion théâtrale & qui produit l’événement,
mais le jeu des pallions humaines, q ui, dans leurs
mouvemens intimes & cachés, ont peu de confidens,
& fouffriroient peu dë témoins.
Quoiqu’il ne foitpas vrai, comme on l’a dit, que
la tragédie fut un fpettacle religieux chez les Grecs ,
il eft vrai du moins que les Opinions religieufes s’y
mêloient fans c'effe, ainfi que les cérémonies du
culte ; & c’eft ce qui rendçit majeftueufe pour eux,
cette efpeCe de proceflion du choeur, qui fur trois'
filés fe promenoit en cadence dans l’intervalle des
fcenes , tournant à gauche, & puis à droite, chantant
la ftrophe & l’anti-ftrophe, puis s’arrêtant &
chantant l’épode, le tout pour exprimer , dît-on ,
les mouvemens du ciel ScT’iminobilité de la terre.
Mais certainement rien de fèftiblable ne convient au
théâtre de Cinna, de Britannicus , de Zaïre.
Nos premiers poètes tragiques, en imitant les
Grecs, ne manquèrent pas d’adopter le choeur, &
jufqu’autems de Hardi le choeur étoit chanté. Cet
accord des voix étoit connu fur nos premiers théâtres
dans ce qu’on appelloit my'fieres: le Pere Éternel
parloit à trois V oix, un deffus , une haute-contre &
•une baffe, à l’uniffon. Hardi fe rédüifit à faire parler le
choeur par l’organe d’un coryphée : dans lë Coriolan
-de ce poète, 1 e choeur dialogue avec le fénat, & dit,
de fuite jufqu’à quarante vers. Dës-lors il ne fut plus
queftion du choeur en intermede, jufqu’à YAthdlie de
Racine, piece unique dans fön genre & abfolument
•hors de pair.
M. de Voltaire, dans fon OEdipe , a voulu depuis
mettre le choeur en fcene : jamais il né fut mieux
placé ; & l’extrême difficulté de l’exécution l’a ce*
pendant fait fupprimer. Depuis on s’eft borné, comme
Hardi, Iorfque l’aélion exige une affemblée , à
faire parler un ou deux perfonnages au nom de tous:
c eft la feule efpece de choeur qu’admette la fcene
Françoife ; & dans les fujets mêmes , foit anciens ,
foit modernes, dont le fpeâacle demande le plus de
pompe & d’appareil, comme les deux Iphigénies ,
Mahomet Sc Sémiramis , un théâtre oit l’aétion fe
paffe immédiatement fous nos yeu x , rend prefque
impoffible le concert & l’accord d’une multitude affemblée
quiparieroitenmême tems. Il eft vrai qu’en
la foifant chanter comme les Grecs , la difficulté fe-
roit moindre ; mais le chant du choeur entrémêlé avec
une déclamation fimple, fera toujours pour nos
oreilles une difparate & une invraifemblance , qui
dans le genre férieux & grave nuiroit trop à l’il-
lufion.
Dans ce qu’on appelle chez les Grecs la comédie
ancienne , comme ce n’étoit communément qu’une
fatyre politique, le choeur étoit très-bien placé,: il
repréfentoit le peuple , ou une claffe de citoyens ,
tantôt allégoriquement, comme dans les oifeaux&c
dans les guêpes.; tantôt au naturel, comme dans les
Acharniens, les Harangueufes, les Chevaliers.; & le
poète l’employoit ou à faire la fatyre de la république
, ou à fa propre défenfe & à fon apologie. C’efi:
ainfi que dans les Acharniens > le choeur, traitant le
peuple d’enfant & de dupe, lui reproche fon imbécillité
à fe laiffer féduire par des louanges , tandis
qu’Ariftophane a feul ofé lui dire la vérité en plein
théâtre au péril de fa vie. « Laiffez-le faire, ajoute
» le choeur, il n’a en vue que le bien ., & il le pro-
» Curera de toutes fes forces, non par de baffes adu-
» lations & des foupleffes artificieufes, mais par-de
» falutaires avis ». La comédie du fécond 6c du troisième
âge changea de cara&ere & le choeur lui fut interdit.
(M . Ma r m o n t e l . ) .
C hoeur <£Opéra. Que vingt perfonnes parlent en-'
femble , leurs articulations fe mêlent , le fons de leurs
voix fe confondent, 6c l’on n’entend qu’un bruit
confus. Mais dans un chant dont toutes les articula*
tions & les intonations font prefcrites 6c mefurées >
vingt voix d’ac'cord n’en feront qu’une, 6C de leur
concert peuvent réfulter de grands effets , foit du côté
de l’harmonie , foit du côté de l’expreffion.
Je vais plus loin. Dans un fpe&acle où il eft reçu
que la parole fera chantée, le choeur a fa vraifemblance
comme le récitatif, & cette vraifemblance
eft la même que celle du duo, du trio , du quatuor ,
&c. Mais ce que j’ai dit du duo françois , je le disvde
même du choeur :, en s’éloignant de la nature, il a
perdu de fes avantages. ( Voye{ D u o . )
Il arrive fouvent dans la réalité, qu’un peuple entier
pouffe le même c r i, qu’une foule de monde dit à
la rois la même chofe ; 6c comme on accorde toujours
quelque liberté à rimitation , le choeur, en
imitant ce c r i , ce langage unanime d’une multitude
affemblée •, peut fe donner quelque licence : l’art 6c
le goût confiftent à preffentir jufqu’où l’extenfion
peut aller. Or c’en eft trop, que de faire tenir en-
iemble à tout un .peuple un long dïfcours fuivi 6c
dans les mêmes termes, à moins que ce ne foit un
difçours appris comme une hymne ; 6ct tel peut être
fuppofé, par exemple, le choeur, Brillantfoleil dans
l’afte des Incas, le choeur de Thétis & Pelee, 0
de fin quelle puijfance ! le choeur de Jephte , Le ciel,
U enfer, la terre & Ponde, 6c tout ce qui fe chante dans
des folemnités.
Il faut donc dîftinguer dans l’hypothefe théâtrale,-
le choeur appris, & le choeur impromptu. Le premier
peut paroître compofé avec art, fans détruire la vrai-
femblan.ce ; mais dans l’autre l’on, ne- doit voir que
l ’unanimité fortuite 6c momentanée des fentimens