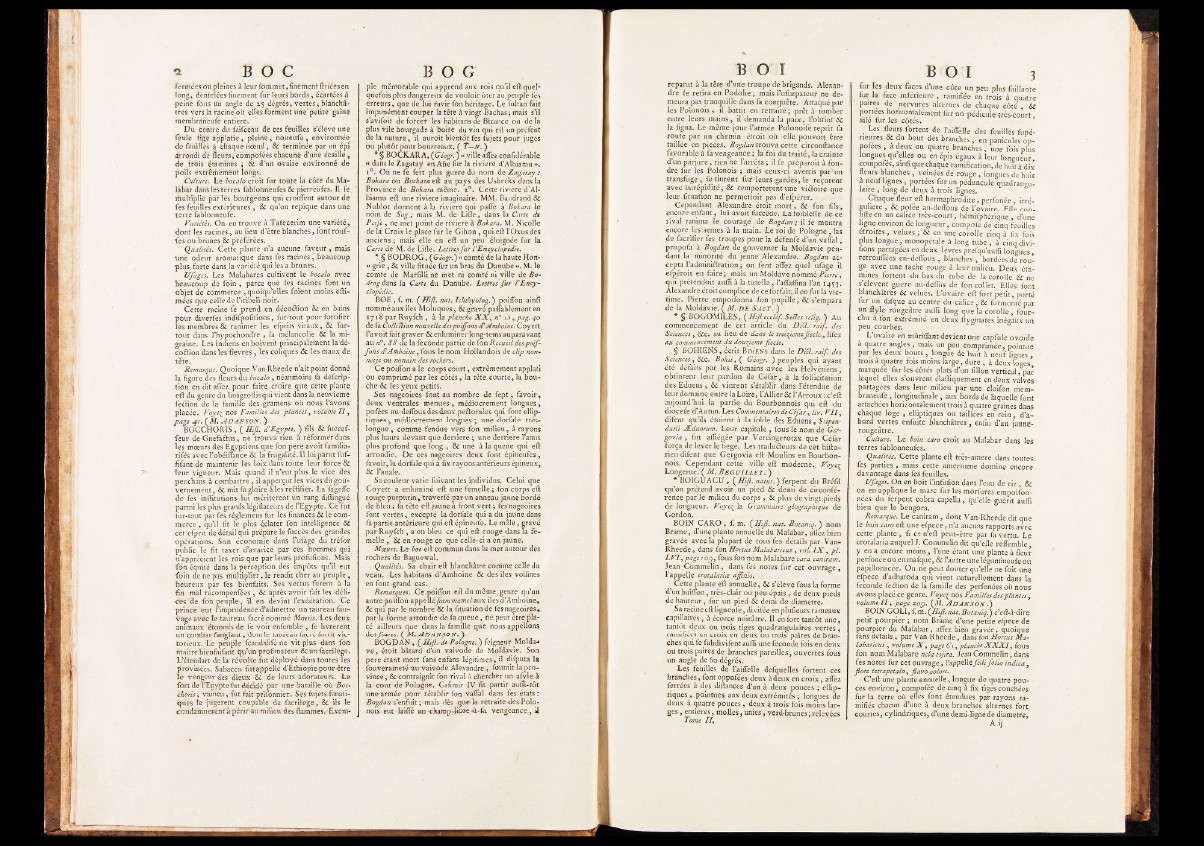
(
ü
P
Fermées trii pleines à leur fômmèt,fliié'ffienf ftriées en
long, dérîtélées finement fur leurS bbrds ; écàrtéës à
peiné fous un angle de 15 degrés, verteè; blanchâtres
Vers là râcine où ëliës forment line’ petite gaîrië
membrànëulë êntiere.
Du fcëritfë du failcëàu dê Ces feuilles s’élève une
ïpule tigé âpfplatie , pleinê ; nouëufe , èhvironhée
de feuilles à ëflâque htfeud ; & terniinéè par un épi
drroridi dé flètirs; compoféés chacunë d’uiïé éfcâille,
de trois ^tàrtiifiës , Si d’un Ovàite environné de
poils extrêmement lbng;s,
Cütiüri'. Le bo'càlo croît fur toiite là Côté du Ma-
lâbàr dans lès terrés fablorinëufes & pierretifes. Il fe
ïbultiplië pâr lës bourgeons qui croiflent autour de
fes feuilles extérieures , & qu’on repique dans une
terre fablonneufe. '
Variétés. On en trouve à Tatecerim une variété,
dont les racines, au lieu d’être blanches , font rouf-
les ou brunes & préférées.
Qualités. Cette plante n’a aucune faveur, mais
line odeur aromatique dans fes racines, beaucoup
plus forte dans la variété qui lés a brunes.
Ufages. Les Malabàrès cultivent lé boccClo âV'éc
beaucoup de foin , parce que les racines font un
objet de commerce , quoiqu’elles fôi'ént moins èfti-
mées que celle de l’iribeli noir.
Cette racine fe prend en déco&ion & en bains
pour divèrfes indifpofitions, fur-tout pour fortifier
lès membres & ranimer les efprits vitaux, & ïiir-
fout dans Thypochôrid’re , la mélancolie & la migraine.
Les Indiens enboivent principalement la'dé-
co&ion dans les 'fievrés, iës coliques & les thanx de
tête. H H H . . t >
Remarque. Quoique Van-Rh'eëdë n’ait point aoririé
la figure,des fleurs du bocalo , néanmoins fâ cléfcrip-
tiôn eh dit aflez pour faire croire qùe cëtfe plàrffe
éft du genre du linàgroflis qui Vient dans la nèùviëmé
fe&ion de là ’famille des grameris où nôiis l’àvoris
placée. Voyeç nos Familles des plantes, volübie / / ,
page 41. ( M. A d ÂNSON. )
BOCCrtORfS , ( Hijt. d'Egypte. ) fils & fù c c ë f - ,
feur de Gnëfa&us, ne trouva rien à réformer dans
les moeurs des Egyptiens que fon pere avoîtfamilià-
rifés avec l’obéiflance Bc la frugalité. Il ImpartitTûf-
fifant de maintenir les loixdans toute leur force Bc
leur vigueur. Mais quand il n’èùt plus le vice des
penchans à combattre , il apperçut les vicës'dù gouvernement
, & mît fà.gloire à les rëftifiër. La 'fàgélfe
de fes inftîtutîons lui méritèrent un rang diftingüé
parmi les plus grandsTégiflateurs de l’Egypte. 'Ce'fût
fur-tout par fës réglemens fur les finances & le commerce^
qu’il fit le plus éclater fon intelligence &
cet efprit de detail qui prépare le fuccès des grandes
opérations. Son économie dans l’üfage du tréfor
public le fit taxer d’avance par ces hommes qui
«’apprécient les rois que par leurs prôfiifioris. Mais
fôh éqüité dàns la péremption des iiripôts qu’il "eut
foin de ne pas multiplier ,1e fendit cher au peuple,
'heureux par fes bienfaits. Ses vértus fifrërit à la
■ fin m'ai récotnpenféés, & après'avoir fait les délires
rfle fdh peuple-, il en devint Tëxécrafion. Ce
prince "eut ^imprudence d’admettre un taurëaulàu-
vàge avéç Te taitfeau fâcré nommé Mneris. ’Les deux
âriimaitx étonnés de f e ’voir èhfemble, fe-livrèrent
un combat fànglant, -dontle taureaufàcré fortit -victorieux.
;Le peuple fcandalifé rie vitplus dans fdn
maîtrèbiénfaifàrit iju’iimpfofanateur & un’facrilege.
L’éfendart dé la féVolfe fut' déployé dans tôutes les
prbvincês. Sabacco futappeïlé d?Ethiopie.pour être
le vengeur dés dieux & de leurs adorateurs. ’Le
fôrt de TEgyptefut decidé par une bataille’o ù ‘Boc-
chôris, Vaincu, fut fait-prtfonnier. Ses fujets fanatiques
:îé ■ jugefent coupable de facrilege, & ils le
condamnèrent à périr au milieu' des flamntes. • Exemplë
mémofable qui apprend aux rois qu’il eft quel*
qnefôis plus dangereux de vouloir ôter au peuple fes
érrëürs, que de lui favir fon héritage. Le fultanfait
impunérfiëfitëoupët la tête à vingt Bachas ; niais s’il
s’aVifoit de fotcet les habitans de Bizanee ou de la
plus vile bbiirgade à boifê du vin qui eft un préfent
de là nature, il auroit biëritôt fes lujets pour juges
Ou plutôt pour bOtifreâuX, ( T—n . )
* § BOCKARA, (Géogn ) « ville aflèz confldérable
ti daKs le Zagatay en Afie fuf là riviere d’Albiamu ».
î . On në fe fert plus guere du nom de Zagàtay .*
B'okàra ou Bochâra eft au pays des Usbecks dans la
Province de Bokdra même» Cette riviere d’Albiamu
eft une riviere imaginaire. MM. Baudrand &c
Noblot donnent à la riviere qui pafle à Bokara le
nom de Sog; mais M. de Lifte, dans la Carte' de
Perfe , ne met point de riviere à Bokara. M. Nicolle
de la Croix le place fur le Gihon , qui eft TOxus des
anciens ; mais elle en eft un pêu éloignée fur la
Carte de M. de Lifté. Lettres fû t V Encyclopédie.
* § BODROG, QGéogr.) « comté de la haute Hon-
» g rie, & ville fitûée für Un bras du Danube ». M. le
comte de Marfilli né met ni Comté ni ville de Bo-
dïog dans fa Carte du Danube. Lettres fur VEncyclopédie.
B O E , f. m. ( Hijl. nat. Ichthyolàg. ) poiflbn ainiî
nommé aux îles Moltiques, & gravé paffablement en
1 7 1B par Ruyfch , à la planche X X y n° 16 -, pàg. 40
de fa Collection nouvelle despoifons d'Xmboine. Coyett
l’avoit fait graver & enluminer kmg-tems auparavant
au /2°. 88 de la fécondé partie de fon Recueil despoif-
fons dAmboïnt, fous le nom Hollandois de clip non-
net je ou nonain des rochers-,
Ce poiflbn a lé corps court, extrêmement applati
ou comprimé -par les côtés, la tête courte, la bouche
& les yeux petits.
Ses nageoires font au nombre de fep t , favoir,
deux vetftrales menues , médiocrement longues,
poféës au -deffous des deux ,péBorales qui font elliptiques^
médiocrement longues ; une dorfale très-
longue, comme fendue vèrs fon milieu, à rayons
plus hauts devant que derrière; une derrière l ’anus
plus profond que long , 'Bc une à la queue qui eft
arrondie. D e ces nageoires deux font épmeufes,
favoir,la doffale qui a fixTayons antérieurs épineux,
& l’anale.
Sà couleur varie ftiivant les individus. Celui que
Coyett a enluminé eft une femelle; fon corps eft
ronge purpurin, tra-verfé par un anneau.jaune bordé
de bleu; fa tête eft.jauiie à front vert ; fës'nagebires
font vertes, excepté -ladorfale qui a du jaune dans
fa-partie antérieure qui eft épineufe. Le mâle.,,gravé
par Ruyfch, -a en bleu c e iqui eft rouge dans la femelle,,
& en rouge ce qup celle-ci a en jaune.
Moeurs. Le boe ett commun dans la mer autour des
rochers de Baguewal.
Qualités. Sa chair eft blanchâtre comme celle du
veaii. -Les habitans d’Amboine & des îles voiiines
en font grand oas.
Remarqués. Ce poiflbn eft du même rgenre qu’un
autre,poiïfon-appeîléfîammatnel aux îles d’Amboine,
& qui par le nombre & la fituationde fesnageoires.,
par la forhie -arrondie de fa queue., ne.peut être placé
ailleurs que dans la:famille que nous appelions
des fcares.f M. A d an-son . )
BOGDAN, ( Hifl.-de-Pologne.^) feigneur Molda^
v e , étoit-bâtard d?un yaivode de Moldavie. Son
pere étant mort fansènfans légitimes, il dxfputa la
îouveraineté au vaivode Alexandre/-,, fournit la province
, & contraignit fon rival à chercher un afyle à
la eour de-Pologrie. -Gafimir IV fit-partir aum-tôt
une- armée pour rétablir fon yaflal dans fes "états :
■ Bogdan Venfuit ; :mais dès jque- la retraite-des* Polo-
nois eut ■ laifté un -eharpp• -libre -à-là vengeance,, ii
reparut à la tête d’une troupe dé brigands. Alexandre
fe retira en Podolie ; mais;lùifurpateur .ne demeura
pas, tranquille dans fa conquête. Attaqué par
les Polonois, il battit en retraite ; prêt à tomber
entrç leurs mains , il demanda ,1a paix , l’obtint &
la figna. Le même jour l’armée Polonoife reprit fa
route par un chemin étroit ;où elle pouvoit être
taillée en pièces. Bogdan trouva cette circonftance
favorable.à fa vengeance ; la fo i du traité, la crainte
d’un parjure, rien ne l’arrêta ; il fe préparoit à fondre
fur les Polonois ; triais ceux-ci avertis par: un
transfuge, fe tinrent fur'leurs gardes, le reçurent
avec intrépidité, & remportèrent une vi&oire que
leur fituation.ne permetloit pas d’efpérer.
Cependant Alexandre, étoit mort, & fon fils,
encore enfant, lui avoit fuceédé. La foibleflè de cë
rival ranima le courage de Bogdan; il fe montra
encore les armes à la main.rEe roi.de Pologne , las
de facrifler fes troupes pour la défenfe d’un vaflàl ;
propofa h Bogdan de gouverner la Moldavie pendant
la minorité du jeune Alexandre. Bogdan accepta
Tadminiftration ; on fent aflez quel ufage il
efpéroit en faire; mais un Moldave nommé Pierre y
qui prétendoit aufli à la tutelle , l’aflaflina l’an 1453.
Alexandre étoit complice de ce forfait; il en fut la victime.
Pierre empoifonna fon pupille, & s’empara
de la Moldavie. ( M. d e Sac y . ) ’. ■
* '$ BOGOMILES , ( Hiß eccléf. Sectes relig. ) Au
commencement de cet article, du Dict. raif. des
Sciences y &c. au lieu de dans le treizièmefiecle,yXiiez
au commencement du douzième fiecle.
§ BOHIENS, écrit Boïens dans le Dict. raif. des
Sciences, &c. Bohii, ( Géogr. ) peuples qui ayant
été défaits par les Romains avec les Helvétiens,
obtinrent leur pardon de Céfar, à la folliritation
des Eduens, & vinrent s’établir dans l’étendue de
leur domaine entre la Loire, l’Ailier & l’Arroux : c’eft
aujourd’hui la partie du Bourbonnois qui eft du
diocefe d’Autun. Les Commentaires de Céfar, liv. V i l ,
difent qu’ils étoient à la folde des Eduens, Sdptn-
darii Æduorum. Leur capitale , fous le nom de Ger-
govia , fut afliégee par Vercingerotax que Céfar
força de lever le fiegé. Les traduèleurs de cet hifto-
rien difent que Gergovia eft Moulins en Bourbonnois.
Cependant cette ville eft moderne. Voye1
Longerue. ( M. Be gu il let . )
* BOIGUACU, ( Hiß. natur. ) ferpent du Bréfil
qu’on prétend avoir un pied & demi de circonférence
par le milieu du corps, & plus de vingt pieds
de longueur. Vcyeç la Grammaire géographique de
Gordon.
BOIN CARO y f. m. ( Hiß. nat. Botaniq. ) nom
Brame, d’une plante annuelle du Malabar, aflez bien
gravée avec la plupart de tous fes détails par Van-
Rheede, dans fon Hortus Malabaricus, vol. I X , pi.
LV1 , page 1 oc», fous fon nom Malabare cara caniram.
Jean Commelin, dans fes notes fur cet ouvrage ,
l’appelle crotalarice affinis.
Cette plante eft annuelle, & s’élève fous la forme
d’unbuiflon, très-clair ou peu épais, de deux pieds
de hauteur, fur un pied & demi de diamètre.
^.a r?c*ne eft bgneufe, divifée en plufieurs rameaux
capillaires, à écorce noirâtre. Il en fort tantôt une,
tantôt deux ou trois tiges quadrangulaires vertes ,
ramifiées en croix en deux ou trois paires de branches
qui fe fubdivifent aufli une fécondé fois en deux
ou trois paires de branches pareilles, ouvertes fous
un angle de 60 dégrés.
Les feuilles de ,1’aiflelle defquelles fortent ces
branches, font oppofées deux à deux en c roix, aflez
ferrées à des diftances d’un à deux pouces ; elliptiques
, pointues aux deux-extrémités ; longues de
deux à quatre pouces, deux à trois fois moins larges
, entières, molles, unies, verd-brunes ; relevées
Tome II,
fur Tes deux Faces d’une cote un peu plus Taillante
fur la face inférieure , ramifiée en trois à quatre
' paires de nervures alternes de chaque côté &c
^or^zontalement fur tin pédicule très-court,
aile fur les côtés.
. Les fl0eur,s f° r£ent de l’aiflèlle des feuilles fupé*
-neitres & du bout des branches, en paniculés op-
polees , à-deux ou quatre branches, une fois plus
longues qu’elles ou en épis égaux à leur longueur,
compofés,-ainfi que chaque ramification, de huit à dix
fleurs blanches , veinées de <rouge , longues de huit
à neuf-lignes, portées fur un péduncule quadrangu*
laire , long de deux à trois lignes.
Chaque fleur eft hermaphrodite, perfonée, irrégulière
, & pofée au-deffous de l’ovaire. Elle con-
fifte en un calice très-court, hémifphérique , d’une
ligne environ de longueur, compofé de cinq feuilles
étroites, velues; & en.une corolle cinq à fix fois
plus longue, monopétale à long tube , à cinqdivi-
fions partagées en deux lèvres prefqu’aufli longues,
retrouflees en-deffous^ blanches, bordées de rouge
avec une tache rouge à leur milieu. Deux étamines
fortent du bas du tube de la corolle & ne
s’élèvent guere au-deflus de fon collet. Elles font
blanchâtres & velues. L’ovaire eft fort petit-, porté
fur un difque au centre du-calice, & furmonté par
un ftyle rougeâtre aufli long que la corolle, fourchu
à fon extrémité en deux ftygmates inégaux un
peu courbes.
L’ovaire en mûriflàrit devient une capfule ovoïde
à quatre angles, mais un peu comprimée, pointue
par les deux bouts , longue de huit à neuf lignes ,
trois à quatre fois moins large, dure , à deux Liges,
marquée fur les côtés plats d’un fillon vertical, par
lequel elles s’ouvrent élaftiquement en deux valves
partagées dans leur milieu par une cloifon mem-
braneufe, longitudinale, aux bords de laquelle font
attachées horizontalement trois à quatre graines dans
chaque loge , elliptiques ou taillées en rein, d’abord
vertes enfuite blanchâtres, enfin d’un jaune-
rougeâtre.
Culture. Le boin caro croît au Malabar dans les
terres fablonneufes.
Qualités. Cette plante eft très-amere dans toutes
fes parties , mais cette amertume domine encore
davantage dans fes feuilles.
Ufages. On en boit l’infufion dans l’eau de riz &
on en applique le marc fur les morfures empoifon-
nées du ferpent cobra capella, qu’elle guérit aufli
bien que le bengora.
Remarque. Le caniram, dont Van-Rheede dit que
le boin caro eft une éfpece, n’a aucuns rapports avec
cette plante , fi ce n’eft peut-être par fa vertu. Le
crotalaria auquel J. Commelin dit qu’elle reflemble,
y en a encore moins,, Tune étant une plante à fleur
perfonée ou en mafque, & l’autre unelégumineufeou
papillonacée. On ne peut douter qu’elle ne foit une
efpece d’adhatoda qui vient naturellement dans la
fécondé feûion de la famille des perfonées où nous
avons placé ce genre. Voye^ nos Familles des plantes,
volume 1 1 f page 2oy. (M. A d a n s o n -.')
BOIN GOLI, f.m. {Hijl.nat.Botaniq.) c’eft-à-dire
petit pourpier ; nom Brame d’une petite efpece de
pourpier du Malabar, aflez bièn gravée, quoique
fans détails, par Van-Rheede, dans fon Hortus Ma-
labaricus, volume X , page 6 1 , planche X X X I , fous
fon nom Malabare nela tsjira. Jean Commelin, dans
fes notes fur cet ouvrage, l’appelle fédi folio indica,
flore tetrapetalo, Jlavo colore.
C ’eft une plante annuelle, longue de quatre pouces
environ, compofée de cinq à fix tiges couchées
fur la terre où elles font étendues par rayons ramifiés
chacun d’une à deux branches alternes fort
courtes, cylindriques, d’une demi-ligne de diamètre,
A i j