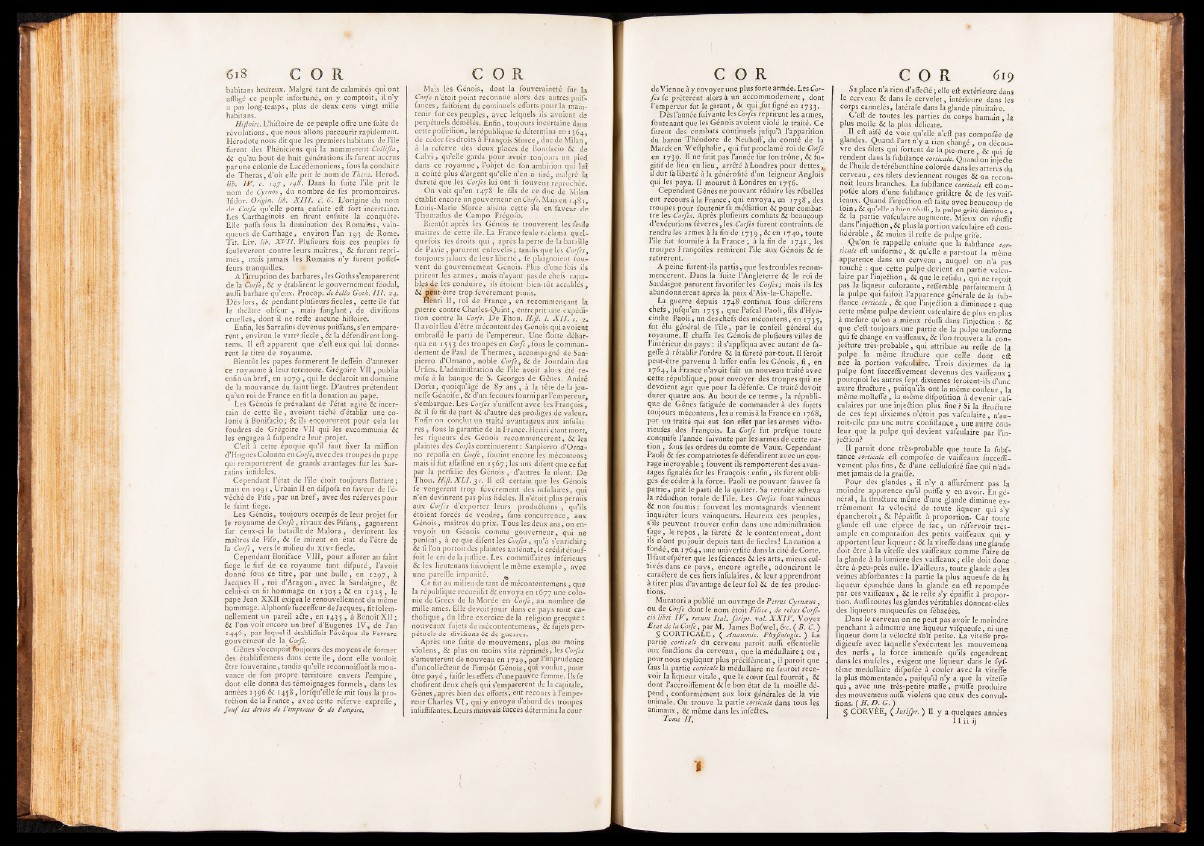
habitans heureux. Malgré tant de calamités qui ont
-affligé ce peuple infortuné, on y comptoit, il n’y
a pas long-temps, plus de deux cens vingt mille
-habitans.
Hifloite. L’hiftoire de ce peuple offre une fuite de
révolutions1, que nous allons parcourir rapidement.
Hérodote nous dit que les premiers habitans de Pile
furent des Phéniciens qui la nommèrent Collijla,
& qu’au bout de huit générations ils furent accrus
par une colonie de Lacédémoniens, fous la conduite
de Theras, d’oît elle prit le nom de Thera. Herod.
lib, IV. c. 147 i Dans la fuite l’xle prit le
nom de Cyrnos, du nombre de fes promontoires.
Ifidor. Origin. lib. X I I I . c. C. L ’origine du nom
de Corfa qu’elle porta enfuite eft fort incertaine.
Les Carthaginois en firent enfuite la conquête.
Elle paffa fous la domination des Romains, vainqueurs
de Carthage, environ l’an 193 de Rome.
Tit. Liv. lib. XVII. Plufieurs fois ces peuples fe
fouleverent contre leurs maîtres, & furent réprimés
, mais jamais les Romains n’y furent poffef-
feurs tranquilles.
A l’irruption des barbares, les Goths s’emparèrent
de la Corfe, & y établirent le gouvernement féodal,
auffi barbare qu’eux. Procop. debello Goth. III. 24.
Dès-lors, & pendant plufieurs fiecles, cette île fut
le théâtre obfcur , mais fanglant, de divifions
cruelles, dont il ne refte aucune hifloire.
Enfin, les Sarrafins devenus puiffans, s’en empare-
rent, environ le vm e fiecle, & la défendirent long-
tems. Il eft apparent que c’eft eux qui lui donnèrent
le titre de royaume.
Bientôt les papes formèrent le deffein d’annexer
ce royaume à leur territoire. Grégoire V I I , publia
enfin un b ref, en 1079 , qui le déclaroit un domaine
de la mouvance du faint fiege. D ’autres prétendent
qu’un roi de France en fit la donation au pape.
Les Génois fe prévalant de -l’état agité & incertain
de cette î l e , avoient tâché d’établir une colonie
à Bonifacio; & ils encoururent pour cela les
foudres de Grégoire VII qui les excommunia &
les engagea à fufpendre leur projet.
C ’eft à cette époque qu’il faut fixer la miffion
d’Hugues Colonna en Corfe, avec des troupes du pape
qui remportèrent de grands avantages fur les Sarrafins
infidèles.
Cependant l’état de I’île étoit toujours flottant ;
mais en 1091, Urbain II en difpofa en faveur de l’évêché
de Pife, par un bref, avec des réferves pour
le faint fiege.
Les Génois, toujours occupés de leur projet fur
le royaume de Corfe, rivaux des Pifans, gagnèrent
fur ceux-ci la bataille de Malora, devinrent les
maîtres de Pife, & fe mirent en état de l’être de
la Corfe, vers le milieu du x iv e fiecle.
Cependant Boniface VIII, pour affurer au faint
fiege le fief de ce royaume tant difputé, l’avoit
donné fous ce titre, par une bulle, en 1297, à
Jacques II , roi d’Aragon , avec la Sardaigne, &
celui-ci en fit hommage en 1305 ; & en 1325 , le
pape Jean XXII exigea le renouvellement du même
hommage. Alphonfe fucceffeur de Jacques, fitfolem-
nellement un pareil afte, en 1435 > à Benoît XII;
& l’on voit encore un bref d’Eugenes IV , de l’an
1446, par lequel il établiffoit l’évêque de Ferrare
gouverneur de la Corfe.
Gênes s’occupoit foujours des moyens de former
des établiffemens dans cette île , dont elle vouloit
être fouveraine, tandis qu’elle reconnoiffoit la mouvance
de fon propre territoire envers l’empire,
dont elle donna des témoignages formels, dans les
années 1396 & 1458, lorfqu’elle fe mit fous la protection
de la France, avec- cette réferve expreffe ,
fau f les droits de l'empereur & de üempire,
Mais lès Génois, dont la fouveraineté fur la
Corfe n’étoit point reconnue alors des autres puif-
fances, faifoient de continuels efforts pour la maintenir
fur ces peuples, avec lefquels ils- avoient de
perpétuels démêlés. Enfin, toujours incertaine dans
cette poffeflion, la république fe détermina en 1364,
de céder fes droits à François S force, duc de Milan,
à la réferve des deux places de Bonifacio & de
C a lv i, quelle garda pour avoir toujours un pied
dans ce royaume, l’objet de fon ambition qui lut
a coûté plus d’argent qu’elle n’en a tiré, malgré la
dureté que les Corfes lui ont fi fouvent reprochée.
On voit qu’en 1478 le fils de ce duc de Milan
établit encore un gouverneur en Corfe. Mais en 1481,
Louis-Marie Sforce aliéna cette île en faveur de
Thomafius de Campo Frégofo.
Bientôt après les Génois fe trouvèrent les feula
maîtres de cette île. La France feule réclama quelquefois
fes droits q u i , après la perte de la bataille
de Pavie , parurent enlevelis ; tandis que lès Corfes,
toujours jaloux de leur liberté , fe plaignoient fou-
vent du gouvernement Génois. Plus d’une fois ils
prirent les armes, mais n’ayant pas de chefs capa*
blés de les conduire, ils étoient bien-tôt accablés ,
& peut-être trop févérement punis.
Henri II, roi de France, en recommençant la
guerre contre Charles-Quint, entreprit une expédition
contre la Corfe. De Thom Hijl. I. X I I . c. 2.
Il avoit lieu d’être mécontent des Génois qui avoient
embraffé le parti de l’empereur. Une flotte débarqua
en 1553 des troupes en Corfe ,fous le commandement
de Paul de Thermes, accompagné de San-
pierro d’Ornano, noble Corfe^ & de Jourdain des
Urfins. L’adminiftration de l’île avoit alors été re-
mife à la banque de S. Georges de Gênes. André
Doria, quoiqu’âgé de 87 ans , à la tête de la jeu-
neffe Génoife, & d’un fecours fourni par l’empereur,
s’embarque. Les Corfes s’uniffent avec les François ,
& il fe fit de part & d’autre des prodiges de valeur.
Enfin on conclut un traité avantageux aux infulai-
res , fous la garantie de la France. Henri étant mort,
les rigueurs des Génois recommencèrent, & les
plaintes des Corfes continuèrent : Sanpierro d’Ornano
repaffa en Corfe, foutint encore les mécontens;
mais il fut affaffiné en 1567; les uns difent que ce fut
par la perfidie des Génois , - d’autres le nient. De
Thou. HiJl.XLI.31. Il eft certain que les Génois
fe vengerent trop févérement des infulaires, qui
n’en devinrent pas plus fideles. Il n’étoit plus permis
aux Corfes d’exporter leurs produ&ions , qu’ils
étoient forcés de vendre, fans concurrence, aux
Génois, maîtres du prix. Tous les deux ans, on en-
voyoit un Génois comme gouverneur, qui ne
penfoit, à ce que difent les Corfes, qu’à s’enrichir;
& fi l’on portoitdes plaintes aufénat, le crédit étouf-
foit le cri delà juftice. Les commiffaires inférieurs
Sc les lieutenans< fui voient le même exemple , avec
une pareille impunité. Q
Ce fut au milieu de tant de mécontentemens, que
la république recueillit & envoya en 1677 une colonie
de Grecs de la Morée en Corfe, au.nombre de
mille âmes. Elle devoit jouir dans ce pays tout catholique
, du libre exercice de la religion grecque :
nouveaux fujets de mécontentemens, & fujets perpétuels
de divifions & de guerres.
Après une fuite de mouvemens, plus ou moins
violens, & plus ou moins vîte réprimés, les Corfes
s’ameuterent de nouveau en 1729, par l’imprudence
d’uncolle&eur de l’impôt Génois, qui voulut, pour
être payé, faifir les effets d’une pauvre femme. Ils fe
chofirent deux chefs qui s’emparèrent de la capitale.
Gênes, après bien des efforts, eut recours à l’empereur
Charles V I , qui y envoya d’abord des troupes
infuffifantes. Leurs mauvais fuccès détermina la cour
de Vienne à y envoyer une plus forte armée. Les Corfes
fe prêtèrent alors à un accommodement, dont
l’empereur fut le garant, & qui £ut ligné en 1733.
Dès l’année fuivante les Corfes reprirent les armes,
foutenant que les Génois avoient violé le traité. Ce
furent des , combats continuels jufqu’à l’apparition
du baron Théodore de Neuhoff, du comté de la
Marck en Wëftphalie, qui fut proclamé roi de Corfe
en 1739* Il ne finit pas l’année fur fon trône, & fugitif
de lieu en lieu, arrêté à Londres pour dettes.
il dut fa liberté à la générofité d’un feigneur Anglois
qui les paya. Il mourut à Londres en 1756.
Cependant Gênes ne pouvant réduire les rébelles
eut recours à la France, qui envoya, en 1738 , des
troupes pour foutenir fa médiation & pour combattre
les Côrfes. Après plufieurs combats & beaucoup
d ’exécutions féverés, les Corfes furent contraints de
rendre les armes à la fin de 1739, & en 1740, toute
l’île fut foumife à la France ; à la fin de 174 1 , les
troupes Françoifes remirent l’île aux Génois & fe
retirèrent.
A peine furent-ils partis,que lestroublësrecom-
mencerent. Dans la fuite l’Angleterre & le roi de
Sardaigne parurent favorifer les Corfes; mais ils les
abandonnèrent après la paix d’Aix-la-Chapelle.
La guerre depuis 1748' continua fous différens
chefs, jufqu’en 1755 , que Pafcal Paoli,fils d’Hyacinthe
Paoli, un des chefs des mécontens, en 173 s,
fut élu général de l’île , par le confeil général du ■
royaume. Il chaffa les Génois de plufieurs villes de
l ’intérieur du pays : il s’appliqua avec autant de fa-
geffe à rétablir l’ordre & la fureté par-tout. Il feroit
peut-être parvenu à Iaffer enfin les Génois, f i , en
1764, la France n’avoit fait un nouveau traité avec
cette république, pour envoyer des troupes qui ne
dévoient agir que pour la défenfe. Ce traité devoit
durer quatre ans. Au bout de ce terme , la république
de Gênes fatiguée de commander à des fujets
toujours mécontens, les a remis à la France en 1768,
par un traité qui eut fon effet par les armes viélo-
rieufes des François. La Corfe fut prefque toute
conquife l’année fuivante par les armes de cette nation
, fous les ordres du comte de Vaux. Cependant
Paoli & fes compatriotes fe défendirent avec un cou-
ïage incroyable ; fouvent ils remportèrent des avantages
fignalés fur les François : enfin, ils furent obligés
de céder à la force. Paoli ne pouvant fauver fa
patrie, prit le parti de la quitter. Sa retraite acheva
la réduction totale de l’île. Les Corfes font vaincus
& non fournis: fouvent les montagnards viennent
inquiéter leurs vainqueurs. Heureux ces peuples,
s’ils peuvent trouver enfin dans une adminiftration
fage, le repos , la fureté & le contentement, dont
ils n’ont pu jouir depuis tant de fiecles! La nation a
fondé, eh 1764, une univerfité dans la cité deCorte.
Il faut efpérer que lesfciences & les arts, mieux cultivés
dans ce pays, encore agrefte, adouciront le
caraftere de ces fiers infulaires, & leur apprendront
à tirer plus d’avantage de leur fol & de fes productions.
Muratori a publié un ouvrage de Petrus Cyrnceus,
ou de Corfe dont le nom étoit Filice , de rebus Corjî-
cis libri I V , rerum Ital. fcript. vol. X X IV . Voyez
Etat de la Corfe, par M. James B ofwel, &c. ( B. C.)
§ CO RTICALE , ( Anatomie. Phyfiologie. ) La
partie corticale du cerveau paroît auffi effentielle
aux fondions du cerveau, que la médullaire ; ou ,
pour nous expliquer plus précifément, il paroît que
fans la partie corticale la médullaire ne fauroit recevoir
la liqueur vitale, que le coeur feul fournit, &
dont l’accroiffement & le bon état de la moelle dépend
, conformément aux loix générales de la vie
animale. On trouve la partie corticale dans tous les
animaux, & même dans les infeâes.
Tome II,
Sa place n’a rien d’affefté ; elle eft extérieure dans
le cerveau & dans le cervelet, intérieure dans les
corps cannelés, latérale dans la glande pituitaire.
C’eft de toutes les parties du corps humain, la
plus molle & la plus délicate.
Il eft aifé de voir qu’elle n’eft pas compofée de
glandes. Quand l’art n’y a rien changé , on découvre
des filets qui fortent de la pie-mere , & qui fe
rendent dans la fubftance corticale. Quand on injeôe
de l’huile de térébenthine colorée dans les arteres du
cerveau, ces filets deviennent rouges & on recon-
noît leurs branches. La fubftance corticale eft com-
pofee alors d’une fubftance grifâtre & de fes vaif-
feaux. Quand l’injeaion eft faite avec beaucoup de
foin, & qu’elle a bien réufîi, la pulpe grilè diminue ,
& la partie vafculaire augmente. Mieux on réuffit
dans l’injedion, & plus la portion vafculaire eft con-
fidérable , & moins il refte de pulpe grife.
Qu’on fe rappelle enfuite que la fubftance corticale
eft uniforme , & qu’elle a par-tout la même
apparence dans un cerveau , auquel on n’a pas
touché : que cette pulpe devient en partie vafculaire
par l’inje&ion,, & que le refidu , qui ne reçoit
pas la liqueur colorante, reffemble parfaitement à
la pulpe qui faifoit l’apparence générale de la fubftance
corticale, & que l’injedion a diminuée : que
cette même pulpe devient vafculaire de plus en plus
à mefure qu’on a mieux réuffi dans Pinjeôion : ôc
que c’eft toujours, une partie de la pulpe uniforme
qui fe change envaiffeaux, & l’on trouvera la conjecture
très-probable, qui attribue au refte de la
pulpe la même ftruCture que celle dont eft
née la portion vafculaire. Trois dixièmes de la
pulpe font fucceffivement devenus des vaiffeaux ;
pourquoi les autres fept dixièmes feroient-ils d’une
autre ftruCture, puifqu’ils ont la même couleur la
même molleffe, la même difpofition à devenir vaf-
culaires par une injeCtion plus fine ? Si la ftrudure
de ces fept dixièmes n’étoit pas vafculaire \ nfau-
roit-elle pas une autre confiftance, une autre couleur
que la pulpe qui devient vafculaire par l’in-
jeétion? ,
Il paroît donc très-probable que toute la fubftance
corticale eft compofée de vaiffeaux fucceffivement
plus fins, & d’une cellulofité fine qui n’admet
jamais de la graiffe.
Pour des glandes , il n’y a affurément pas U
moindre apparence qu’il puiffe y en avoir. En général
, la ftrufture même d’une glande diminue extrêmement
la vélocité de toute liqueur qui s’y
épancheroit, & l’épaiffit à proportion. Car toute
glande eft une efpece de fa c , un réfervoir très-
ample en comparaifon des petits vaiffeaux qui y
apportent leur liqueur : & la vîceffe dans une glande
doit être à la vîteffe des vaiffeaux comme l’aire de
la glande à la lumière des vaiffeaux; elle doit donc
être à-peu-près nulle. D’ailleurs, toute glande a des
veines abforbantes : la partie la plus aqueufe de là
liqueur épanchée dans la glande en eft repompée
par ces vaiffeaux , & le refte s’y épaiffit à proportion.
Auffi toutes les glandes véritables donnent-elles
des liqueurs muqueufes ou fébacées.
Dans le cerveau on ne peut pas avoir le moindre
penchant à admettre une liqueur vifqueufe, ni une
liqueur dont la vélocité foit petite. La vîteffe pro-
digieufe avec laquelle s’exécutent les mouvemens
des nerfs , la force immenfe qu’ils engendrent
dans les mufcles , exigent une liqueur dans Je fyf-
tême médullaire difpofée à couler avec la vîteffe
la plus momentanée, puifqu’il n’y a que la vîteffe
q u i, avec une très-petite maffe, puiffe produire
des mouvemens auffi violens que ceux des convul-
fions. ( H. D. G. )
§ CORVÉE, ( Jurifpr. ) Il y a quelques années
I I ii ij