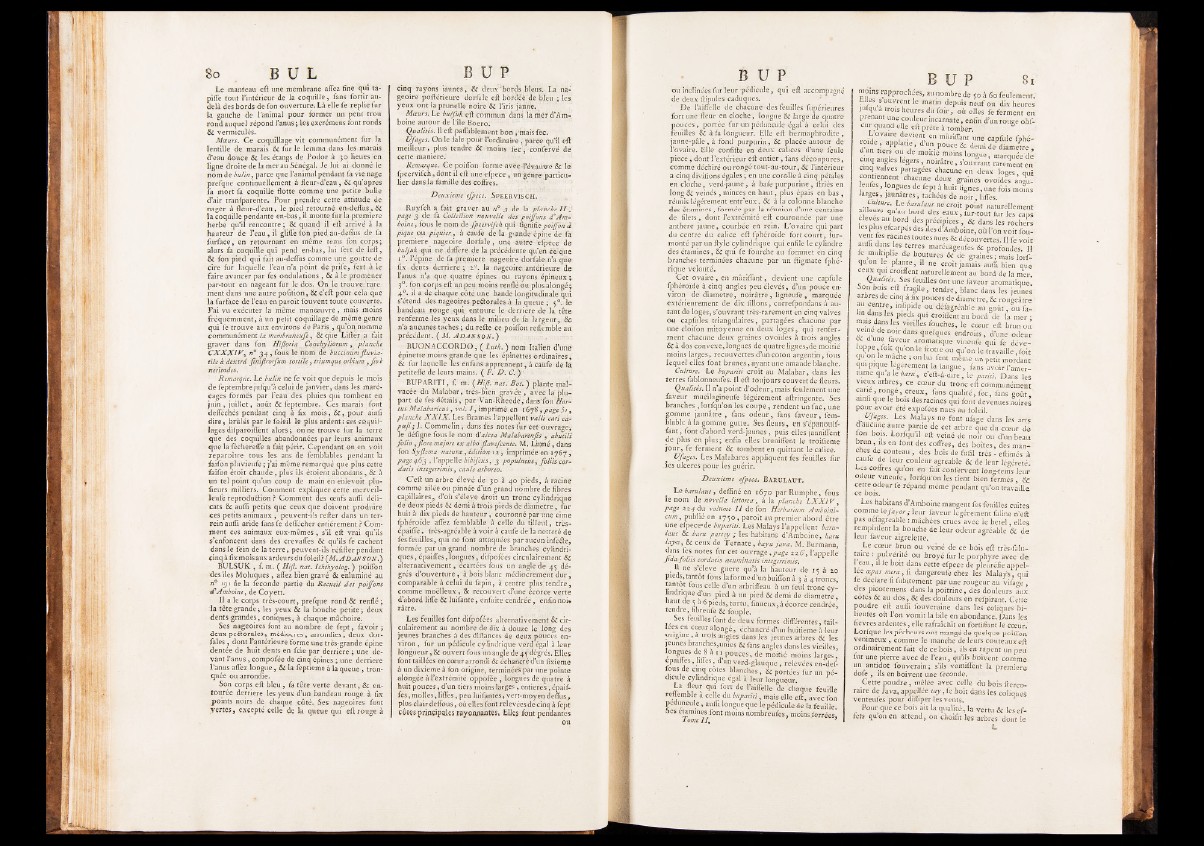
Le manteau eft une membrane aflez fine qui ta-
piffe tout l’intérieur de la coquille, fans fortir au-
delà des bords de fon ouverture. Là elle fe replie fur
la gauche de l’animal pour former un petit trou
rond auquel répond l’anus; les excrémens font ronds
& vermiculés.
Moeurs. Ce coquillage vit communément fur la
lentille de marais & fur le lemma dans les marais
d’eau douce & les étangs de Podor à 30 lieues en
ligne droite de la mer au Sénégal. Je lui ai donné le
nom de butin, parce que l’animal pendant fa vie nage
prefque continuellement, à fleur-d’eau , & qu’après
fa mort fa coquille flotte comme Une petite bulle
d’air tranfparente. Pour prendre cette attitude de
nager à fleur-d’eau, le pied retourné en-deffus,&
la coquille pendante en-bas, il monte fur la-première
herbe qu’il rencontre ; & quand il eft arrivé à la
hauteur de l’eau, il glifle fon pied au-deflus de fa
furface, en retournant en même tems fou corps;
alors fa coquille qui pend en-bas, lui lèrt .de left,
& fon pied qui fait au-deflus comme une goutte de
cire fur laquelle l’eau n’a point de prife., fert à le
faire avancer par fes ondulations , & à le prpméner
par-tout en nageant fur le dos. On le trouve, rarement
dans une autre poûtion, & c’eft pour.cela que
la furface de l’eau en paroît fouvent toute couverte.
J’ai vu exécuter la même manoeuvre, mais moins
fréquemment,, à un petit coquillage de même genre
qui fe trouve aux environs dè Paris , qu’ôq, nomme
communément la membraneufe, & que Lifter a Fait
graver dans fon Hifloria Çonchyliorum, planche
C X X X IV , n° 3 4 , fous le nom dë buccinumfiuvia-
tile à dextrd jinijlrorfum tortïle , triumque orbium
neritodes.
Remarque. Le butin ne fe voit que depuis le mois
de feptembre jufqu’à celui de janvier, dans lés marécages
formés par Peau des pluies qui tombent en
juin , juillet, août & feptembre. Ces marais font
deflechés pendant cinq à fix mois, & , pour ainli
dire, brûlés par le foleil le plus ardent : cës coquillages
difparoiflënt alors ; on ne trouve fur la terre
que des coquilles abandonnées par leurs animaux
que la féchereffe a fait périr. Cependant on en voit
reparoître tous les ans de femblables pendant la
faifon pluvieufe ; j’ai même remarqué que plus cette
faifon étoit chaude, plus ils étoient abondans, & à
un tel point qu’un coup de main èn e'nlevoit plu-
fieurs milliers. Comment expliquer cetté merveil-
leufê reproduction ? Comment des oeufs aufli délicats
& aufli petits que ceux que doivent produire
ces petits animaux , peuvent-ils refter dans un ter-
rein aufli aride fans fe deflecher entièrement ? Comment
ces animaux eux-mêmes , s’il eft vrai qu’ils
s’enfoncent dans des crevaffes & qu’ils fe cachent
dans le fein de la terre, peuvent-ils réfifter pendant
cinq à fix mois aux ardeurs du foleil? (M. A d a n s o n .)
BULSUK , f. m. ( Hijl. nat. Ichthyolog. ) poiflon
des îles Moluques , aflez bien gravé & enluminé au
n° ic)i de la fécondé partie du Recueil des poiffons
d’Amboine, de Coyètt.
Il a le corps très-court, prefque rond & renflé ;
la tête grande; les yeux & la bouche petite; deux
dents grandes, coniques, à chaque mâchoire.
Ses nageoires font au nombre de fept, favoir ;
deux pe&orales, médiocres, arrondies; deux dor-
fales , dont l’anterieure forme une très-grande épine
dentée de huit dents en fcie par derrière ; une devant
l’anus, compofée de cinq épines ; une derrière
l ’anus aflez longue, & la feptieme à la queue , tronquée
ou arrondie.
Son corps eft bleu, fa tête verte devant, & entourée
derrière les yeux d’un bandeau rouge à fix
points noirs dé chaque côté. Ses nageoires font
vertes, excepté celle de la queue qui eft rouge à
cinq rayons jaunes, & deux'bords bleus. La nageoire
poftérieure dorfalë eft bbrdeè de Bleu •; les
yeux ont la prunelle noire & l’iris jà,ùn;e.
Moeurs. Le bu/fuk eû commun dans la mér d’Am-
boine autour de l’île Boero;
Qualités. Il eft paflablement bonymais fec.
V f âges. On le falepour l’ordinaire y pàrcè qu’il eft
meilleur, plus tendre .& moins fec j confervé de
cette maniéré.
Rema/que. Ce poiflon forme avëè-l’-évailwe & le-
fpèervifch, dont il eft une efpece , un genre {particulier
dans la famille des coffres.
Deuxieme‘ efpece. SPEERVISGH. f,
Ruyfch a fait graver au n° j de. la planche I I ;
page 3 de fa Collection nouvelle des poijfons à'Am-
boine, fous le nom de fpeervifch qui -fîgnifie poijfon à
pique ou piquier., à càufe de la gnande épine de fa
première nageoire dorfale, une-autre efpece de
kuljp.K -qui ne fdiffere-.de la précédente qu’en cè’que
i° . l’épine de fa première nageoire dorfale.n’a que
fix dents derrière ; 20. la nageoire, antérieure de
l’anus n’a que quatre épines ou rayons épineux;
30. fon corps eft un pveu;moins renflé ou plus alongé;
4°. il a de, chaque nôt£ une bandé longitudinale qui
s’étend des nageoires pectorales, à. là queue ; 50. le
bandeau rouge,qui entoure le; derrière de Ja tête
renferme, les ..yeux dans le milieu de fa largeur,. ôc
n’a aucunes taches ; du refte ce poiflon reffemble au
précédent. ( M. Ad an so n . )
BUONACCORDO, ( Luth. ) nom Italien d’une
épinerte moins grande que les épinëttes ordinaires,
& fur laquelle les enfans apprennent, à calife de la
petiteffe de leurs mains. ( F. D . '■
BUPARITI, f. va. (Hijl. nat:Èot.) plante màl-
vacée du Malabar, très-bien graVée'. avec la plupart
de fes-détails,-par jVan-Rheéde,;dans fon ATor-
tus Malabaricus, vol. / , imprimé en ïGfô-, page 51,
planche X X IX . Les Bramès l’appellent vàllicari cd-
poeji; J. Commelin; dans lès notes fur cet-ouvrage-,-
le défignefousle nom d’alcea Malabarenjîs , abutilc
folio ,fiore-majore ex ulbô flavefçenie. M. Linné , dans
fon Syflema naturoe, édition 12, imprimée en -1767
page 4.63 ,1 ’appelle hibifcus, 3 populneus, foliis côr-
datis integerrimis, eau le arboreo.
C’eft un arbre élevé de 30 à 40 pieds, à racine
comme ailée ou pinnée d’un grand nombre de fibres
capillaires, d’où s’élève droit un tronc cylindrique
de deux pièds & demi à trois pièds de diamètre, fur
huit à dix pieds de hauteur , couronné parune cime
fjphéroïde aflez femblable à celle du tilleul, très-
epaiffe, très-agréable à voir à caufe de la netteté de
fes feuilles, qui ne font attaquées^par aucun infeôe,
formée par un grand nombre de branches cylindriques
, épaiffes, longues, difpofées circulairement &
alternativement, écartées fous un angle de 45 degrés
d’ouverture , à bois blanc médiocrement dur ^
comparable à celui du fapin, à centre plus.tendre,
comme moelleux, & recouvert d’une écorce verte
d’abord liffe & luifante, enfuite cendrée, enfin noi*
râtre.
Les feuilles font difpoféés alternativement & cir-
culairément au nombre de dix à douze le. long des
jeunes branches à des diftances de deux pouces environ
, fur un pédicule cylindrique verd égal à leur
longueur, & ouvert fous un angle de 45 degrés. Elles
font taillées en coeur arrondi & échançré d’un fixieme
à un dixième à fon origine, terminées par une pointe
alongée à l’extrémité oppofée , longües de quatre à
huit pouces, d’un tiers moins larges., entières, épaiffes,
molles, liffes , peu luifantes, vert-moyen deffus,
plus clair deffous, où elles font relevées de cinq à fept
côtçs principales rayonnantes. Elles font pendantes
ou
bu inclinées fur leur pédicule, qui eft accompagné
de deux ftipules caduques.
De l’aiffelle de chacune des feuilles fupérieures
fort une fleur en cloche, longue & large de quatre
pouces, portée fur un péduncuie égal à celui dès;
feuilles & à fa longueur. Elle eft hermaphrodite ,
jaune-pâle , à fond .purpurin, &c placée autour de
l’ovaire. Elle confifte en deux calices d’une feule
piece, dont l ’extérieur èft entier, fans découpures,
comme déchiré ou rongé tout-au-tour, &c l’intérieur
a cinq divifions égales ; en une corolle à cinq pétales
en cloche, verdjauné; à bafe purpurine, ftriés en
long & veinés , minces en haut, plus épais en bas ,
réunis légèrement entr’eux, & à la colonne blanche
des étamines, formée par la réunion d’une centaine
de filets, dont l’extrémité eft couronnée par une
anthere jaune, courbée en rein. L’ovaire qui part
du centre du calice eft fphéroïde fort court-, fur-,
monté par un ftyle cylindrique qui enfile le cylindre
des étamines, & qui fe fourche au fommet en cinq
branches terminées chacune par un ftigmate fphé-
rique velouté.
, Cet ovaire, en mûriffant, devient une capfule
fphéroïde à cinq angles peu élevés, d’un pouce environ
de diamètre, noirâtre, ligneufe , marquée
extérieurement de dix filions, correfpondans à autant
de loges, s’ouvrant très-rarement en cinq valves
0« capfules triangulaires, partagées chacune par :
une cloifon mitoyenne en deux loges, qui renferment
.chacune deux graines ovoïdes à trois angles
& à dos convexe, longues de quatre lignes,de moitié
moins larges, recouvertes d’un coton argentin, fous
lequel elles font brunes, ayant une amande blanche.
Culture. Le bupariti croît au Malabar, dans les
terres fablonneufes. Il eft toujours couvert de fleurs.
Qualités. Il n’a point d’odeur, mais feulement une
faveur mucilagineufe légèrement aftringente. Ses
branches, lorfqu’on les coupe, rendent un fuc, une
gomme jaunâtre , fans odeur, fans faveur, femblable
à la gomme gutte. Ses fleurs, en s’épanouif-
fant, font d’abord verd-jaunes , puis elles jauniffent
de plus en plus; enfin elles bruniflènt le troifieme
jour, fe ferment & tombent en quittant le calice.
Ufages. Les Malabares appliquent fes feuilles fur
ie s ulcérés pour les guérir.
Deuxieme efpece. BARULAUT.
Le barulaut, deffiné en 1670 par Rumphe, fous
le nom de novella littorea, à la planche L X X 1V
page 224 du volume I I de fon Herbarium Amboini-
cum, publié en 1750, paroît au premier abord être
une efpece*de bupariti. Les Malays l ’appellent barulaut
& baru partey ; les habitans d’Amboine, haru
layn, & ceux de Ternate, bayujava. M. Burmann,
dans fes notes fur cet ouvrage ,page 22C, l’appelle
Jida*foliis cordatis acuminatis integerrimis.
Il ne s’élève guere qu’à la hauteur de K B 20
pieds,tantôt fous la forme d’un buiffon à 3 à 4troncs,
tantôt fous celle d’un arbriffeau à un feul tronc cylindrique
d’un pied à un pied & demi de diamètre,
haut de 5 à 6 pieds, tortu, finueux, à écorce cendrée,
tendre, fibreufe & fouple.
^ Ses feuilles font de deux formes différentes, taillées
en coeur alongé, échancré d’un huitième à leur
origine , a trois angles dans les jeunes arbres & les
jeunes branches,unies &fans angles dans les vieilles,
longues de 8 à u pouces; de moitié moins larges,
epaiffes, liffes, d’un verd-glauque, relevées en-def
fous de cinq cotes blanches, & portées fur un pédicule
cylindrique égal à leur longueur.
La fleur qui fort de l’aiffelle de chaque feuille
reffemble à celle du bupariti, mais elle eft, avec fon
peduncule, aufli longue que le pédicule de la feuille.
5es etamines font moins nombreufes, moinsierrées.
Tome I I , 7
moins rapprochées, atmombre de 50 à 60 feulement.
■ '“» . f ouvrent le matm depuis neuf ou dix heures
julquà.trois heures du foir, oh elles fe ferment en
prenant une couleur incarnate , enfin d’un rouse obf-
. eur (juand elle eft ptêfe à tomber.
I Hm M H m I en mhtiffant une! capfule fphé-
d’un riersP? ' . n ' i 'ï*. P °oce & d e dûunMre ,
cinS anales £ cinq angles légersm On,,o1i%râmtr0el", Ss ’lo6unvSruanet’ BrarBemMent Hen
‘ clIJq valves partagées Chacune en dëux loges qui
! c° ntlen“ ent chacune deux graines ovoïdes a’nguM
1 , !! cs * .°ngueS de fept à huit lignes, une fois moins
larges, jaunâtres, tachéesde noir, ÜiTe^
Culture. h^'bamlàM- ne'erOît point natur-dllement
ailleurs des eaux, tur-fout fur les Caps
eleves au bord des précipices i & dans les rochers-
i les plus efearpés des îles d’Ambôine, où l’on voit fou- •
vent fes racines toutes nues & découvertes. Il fe voit
I au& dans les terres màrécageufes & profondes. II
; ieunuhiphe de boutures & de grainesÿmais f e f - '
qu on le plante, il'n e croît jamais^auffi bien que
ceux qui croiffent naturellement au bord-de la mer.
Qualités Ses feuilles ont une favétir aromatique.
| H b o i s eft fragile, tendre, blanc dans les jeunes'
arbres de cinq à fix pouces de diamètre, & rougeâtre •
au cenfre, InfipidésciSdéfagréable au goût, ou fa-
1m dans lqs. pieds qui Croîffent au bord dé la mer ;
mais dans les vieilles fouches, le coeur eft brun ou
I ^e“ f d? noir dans, quelques endroits, d’une odeur
, “ un* *aveur aromatique vineufe qui fe développe
fou qu’on le frotte ou qu’on le travaille, foit
qu on le mâche ; on lui fent même un petit mordant*'-
qui pique legerenjent la langue, fans avoir l’amertume
q u a le baru, c’eft-à-dire, lé pariti. Dans les
vieux arbres*, ce coeur du tronc eft Communément
ca rie,ronge , çreiix, fans qualité, fée,"fans goût,'
amti que le bois des racines qui font devenues noires '
pour avoir été expofées nues au loleil.
’ ^ fa g e s . Les Malays ne font ufage dans les arts
d aucune autre partie de cet arbre que du coeur de
Ion bois. Lorfqu'il eft veiné de noir ou d’un beau
brun ils en font des coffres, des boîtes, des manches
de couteau , des bois de fufil très - eftimés à
caufe de leur couleur agréable & de leur légéretér
Les coffres qu’on en fait confervent Jong-tems leur
odeur vmeufe, lorfqii'on les tient bien fermés , &
cette odeur fe répand même pendant qu’on travaille
• ce bois.
Les habitans d’Amboine mangent fes feuilles cuites
comme 1 ejdyor; leur faveur légèrement faline n’eft
pas aefagréable : mâchées crues avec le betel, elles
rempliflent la bouche de leur odeur agréable & de
leur faveur aigrelette.
Le coeur brun ou veiné de ce bois eft très-falii-
taire : pulvérife ou broyé fur le porphyre avec de
I eau, il-fe boit dans cette efpece de pleuréfie appei-
lee oepas mera, fi dangereufe chez les MalayS, qui
fe déclare fi fubitement par une rougeur au vifage ,
pfootemens dans la poitrine, des douleurs aux.
côtés &c au dos, & des douleurs eh refpifant. Cette
poudre eft aufli fouveraine dans les coliques bi-
lieufès où l’on vomit la bile en abondance. Dans les
fîevres ardentes, elle rafraîchit en fortifiant le coeur.
Lorfque les pêcheurs ont mangé de quelque poiflon
venimeux , comme le manche de leurs couteaux eft
ordinairement fait de ce bois, ils en râpent un peu
fur une pierre avec de l’eau, qu’ils boivent comme
un antidot fouverain ; s’ils vomiffent la première
dofe , ils en boivent une fécondé.
Cette poudre, mêlée avec celle dubois fterco-
raire de Java, appellée tay,fe boit dans les coliques
venteufes pour diflîper les vents.
Pour que ce bois ait la qualité , la vertu & les ef-
fets qu’on en «tend, .on choifit les arbres dont le
L