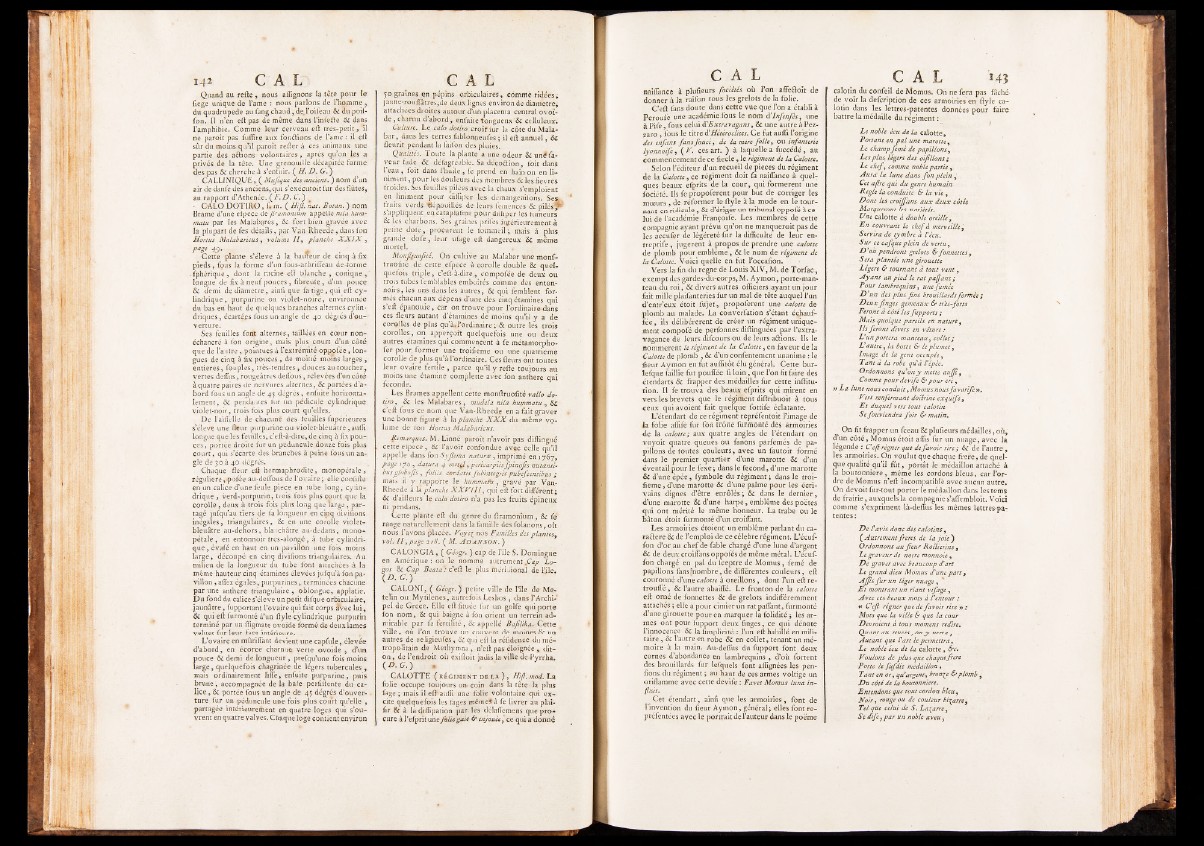
Quand au relie , nous alignons la tête pour le
fiege unique de l’ame : nous parlons de l’homme,
du quadrupède au fang chaud, de.l’oifeau 6c dupoif-
fon. Il n’en eft pas de même dans l’inle&e 6c dans
l’amphibie. Comme leur cerveau ëft très-perit, il
ne paroît pas fuffire aux fondions de Pâme : il eft
sûr du moins qu’il paroît relier à ces animaux une
partie des a étions volontaires, après qu’on les a
privés de la tête. Une grenouille décapitée forme
des pas & cherche à s’enfuir. ( H, D . G.')
CALLINIQUjE, ( Mujîque des anciens. ) nom d’un
air de danfe des anciens, qui s’exécutoit lur des flûtes,
au rapport d’Athenée. ( F .D . C.)
- CALO D O T IR O , f* m. ( Hifi. nat. Bot an. ) nom
Brame d’une efpece de Jlramonium appelle nïla hum-
matu par les Malabares, 6c fort bien gravée avec
îa plupart de fes détails, par Van-Rhee.de, dans l'on
Hortus Malabaricus, volume I I , planche X X I X ,
Page * 9- , . ’ x r
Cette plante s’eleve à la hauteur de cinq a lix
pieds, fous la forme d’un fous-arbriffeau de-forme
. iphérique, dont la racine eîl blanche , conique ,
longue de lix à neuf pouces , fibreule, d’un pouce
&c demi de diamètre, ainli que fa tige, qui eft cy lindrique,
purpurine ou violet-noirë, environnée
du bas en haut de quelques branches alternes cylindriques,
écartées lous un angle de 40 dégres d 'o u verture.
Ses feuilles fort! alternes, taillées en coeur non-
échancré à fon origine, mais plus court d’un côté
que de l’autre , pointues à l’extrémité oppofée, longues
de cinq à lix pouces , de moitié moins lar-ges,
entières, fouples, très-tendres, douces au toucher,
vertes deffus, rougeâtres delfous, relevées d’un côté
à quatre paires de nervures alternes, & portées d’a bord
fous un angle de 45 degrés, enfuite horizontalement,
6c pendantes fur un pédicule cylindrique
violet-noir, trois fois plus court qu’elles.
De l’ailî'elle de chacune des feuilles fupérieures
s’élève une fleur purpurine ou violet-bleuâtre , auffi
longue que les feuilles, c’eft-à-dire, de cinq à fix pou-,
ces, portée droite fur un péduncule douze fois plus
court, qui s’écarte des branches à peine fous un angle
de 30 à 40 dégrés.
Chaque fleur eû hermaphrodite, monopéfale,-
régulière,pelée au-delfous de l’ovaire ; elle confifte
en un calice d’une feule piece en tube long, cylindrique
, verd-purpurin, trois fois plus court que la
corolle , deux à trois fois plus long que large, partagé
jufqu’au tiers de fa longueur en cipq divilions
inégales, triangulaires, 6c en une corolle violets
bleuâtre au-dehors, blanchâtre au-dedans, mono*
pétale , en entonnoir très-alongé, à tube cylindrique,
évafé en haut en un pavillon une fois moins
large, découpé en cinq divifions triangulaires. Au
milieu de la longueur du tube font attachées à la
même hauteur cinq étamines élevées jufqu’à fon pavillon
, affez égales, purpurines, terminées chacune
par une anthere triangulaire , oblongue, applatje.
Du fond du calice s’élève un petit difque orbiculaire,
jaunâtre, fupportant l’ovaire qui fait corps avec lui,
& qui eft furmonté d’un ftyle cylindrique purpurin
terminé par un ftigmate ovoïde formé de deux lames
velues fur leur face intérieure. - ■
L’ovaire en mûriffant devient une capfule, élevée
d’abord, en écorce charnu^ verte ovoïde, , d’un
pouce 6c demi de longueur , prefqu’une fois moins
large, quelquefois chagrinée de légers tubercules ,
mais ordinairement lifle, enfuite purpurine, puis
brune, accompagnée delà baie perfiftente du calice
, 6c portée fous un angle de 45 dégrés d’ouverture,
fur un péduncule une fois plus court qu’elle ,
partagée intérieurement en quatre loges qui s’ou-
vrent en quatre valves. Chaque loge contient environ
50 graines en pépins - ojbiculaires, cômmè ridées,
jaune-rouffârres,de deux lignes environ de diamètre,
attachées droites autour, d’un placenta central ovoïde
, charnu d’abord, enfuite fongueux'& celluleux.
Culture. Le calo dotiro croîf fur la côte du Malabar,
dans les terres fablonueufes ; il eft annuel, &
fleurit pendant la faifon des pluies.
Qualités. Toute la plante a une odeur & u n é fa -
yeur fade 6c delagréable. Sa decoélion, foit dans
1 eau , foit dans 1 huile , fe prend en bain ou en li—
niment, pour les douleurs des membres âkles fievres
froides. Ses feuilles pilces avec la chaux s’emploient
en Uniment pour diffip'er les démangeaisons. Ses»,
fruits verds dépouillés de leurs lèmences 6c pilés
s appliquent eij cataplafme pour dilliper les tumeurs
6c les charbons. Ses graines priles intérieurement à
petite dofe;, procurent le fommeil ; mais à plus
grande dofe, leur ufage eft dangereux 6c même
mortel.
MonJfcuoßtL On cultive au Malabar une monf-
mrolité de. cette efpéce -à corolle double 6c quelquefois
triple, c’eft-à-dire., compoféè de deux ou
trois tubes femblables emboîtés comme des entonnoirs,
les uns dans les autres, 6c qui femblent formés
chacun aux dépens d’une des cinq étamines qui
, s eft épanouie, car on trouve pour l’ordinaire-dans
ces fleurs autant d’étamines de moins qu’il y a de
corolles de plus qu’à*l’ordioaire ;• & outre les trois
corolles, on apperçoit quelquefois une ou deux
autres étamines qui commencent à fe métamorpho-
fer pour, former une trqifieme où une quatrième
corolle de plus qu’à l’ordinaire. Ces fleurs ont toutes
leur ovaire fertile , parce qu’il y relie toujours au
moins une étamine complette avec fon anthere qui
féconde.
Les Brames appellent cette monftfuofité vallo dotiro,
6c les Malabares, mudela nila hupimatu, 6c
c eft fous ce nom que Van-,Rheedg en a fait graver
une bonne figure à la planche X X X du même vo lume
de Ion Hortus Malabaricus.
Remarques. M. Linné paroît n’avoir pas diftingué
cette elpece, 6c l’avoir confondue avec celle qu’il
appelle dans fon Syfiema natureè, imprimé en 1767,
page tyo , datura 4 mstçL, periearplisfpinofis nutanti-
biis globofis , foliis cordatis Jubintegris pubefeentibus ;
mais il y rapporte le hummalit , gravé par Van-
Rheede à là planche X X V I I I , qui eft fort différent;
6c d’ailleurs le calo dotiro n’a pas les fruits épineux
ni pendans.
Cette plante eft du genre du ftramonium, 6c fe
range naturellement dans la famille des folanons, où
nous l’avons placée. Voye^ nos Familles des plantes,
v o l.I I , page 218. ( M. A d AN SON. )
CALONGIA, ( Géogr. ) cap de Fîle S. Domingue
en Arrférique : on le nomme autrement fiap Lo-f
gos 6c Cap Beat a*: c’eft le plus méridional de l’ile.
{D . G .)
CALONI, ( Géogr. j petite ville de 111e de Me-
telin ou Mytilenes, autrefois Lesbos , dans l’Archipel
de Grece. Elle eft fituée fur un golfe qui porte
fon nom, & qui baigne à fon orient un terrein admirable
par fa fertilité, & appelle Bafilika. Cette .
v ille , où l’on trouve un couvent de moines 6c un *
autres de religieufes, & qui eft la réfidence du métropolitain
de Methymna n’eft pas éloignée , dit-
on , de l’endroit où exiftoit jadis la ville de Pyrrha.
C OG-) .
CALOTTE ( régiment de la ) , Hift. mod. La
folie occupe toujours un. coin dans la tête>la plus
fage ; mais il eft‘auffi une folie volontaire qui excite
quelquefois les fages même? à fe livrer au plai-
fir & à la diflipation par les délaffemens que procure
à l’efprit une folie gaie & enjouéece qui a donné
naiffance à plufieurs fociétés où l’oit affeélolt de
donner à la raifon tous les grelots de la folie.
C’eft laps doute dans cette vue que l’on a établi à
Peroufe une académieious le nom d’Infenfés, une
à Pife, fous celui d'Extravagans, 6c une autre à Pez-
zaro , fous le titre d’Hétéroclites. C e fut auffi l’origine
des enfans fans fouci, de lamere folle, ou infanterie
lyonnoife, ( V. çes art. ) à laquelle a fuccédé, au
commencement de ce fiecle, le régiment de La Calotte.
Selon l’éditeur d’un recueil de pièces du régiment
de la Calotte, ce régiment doit fa naiffance à que^
ques beaux efprits de la cour, qui formèrent une
Société. Ils fe propoferent pour but de corriger les
moeurs, de réformer le ftyle à la mode en le tournant
en ridicule, & d’ériger un tribunal oppofé à celui
de l’académie Françoife. Les membres de cette
compagnie ayant prévu qu’on ne manqueroit pas de
les accufer de légéreté fur la difficulté de leur entreprise
, jugèrent à propos de prendre une calotte
de plomb pour emblème, 6c le nom de régiment de
la Calotte. Voici quelle en fut l’occafion.
Vers la fin du régné de Louis XIV, M. de Torfac,
exempt des gardes-du-corps, M. A ymon, porte-manteau
du ro i, 6c divers autres officiers ayant un jour
fait mille plaifanteries fur un mal de tête auquel l’un
d’entr’eux étoit fu'jet, propoferent une calotte de
plomb au malade. La converfation s’étant échauffé
e , ils délibérèrent de créer un régiment uniquement
compofé de perfonnes diftinguées par l’extravagance
de leurs difeours ou de leurs aftions. Ils le
nommèrent le régiment de la Calotte, en faveur de la
Calotte de plomb , & d’un confentemcnt unanime : le
fleur Aymon en fut auffitôt élu général. Cette bur-
lefque faillie fut pouffée fl loin, que l’on fit faire des
étendarts 6c frapper des.médailles fur cette inftitu-
tion. Il fe trouva des beaux efprits qui mirent en
vers les brevets que le régiment diftribuoit à tous
ceux qui avoient fait quelque fottife éclatante.
L’étendart de ce régiment repréfentoit limage de
la folie afîife fur fon trône furmonté des armoiries
de la calotte; aux quatre angles de l’étendart on
voyoit quatre, queues ou fanons parfemés de papillons
de toutes couleurs, avec un fautoir formé
dans le premier quartier d’une marotte 6c d’un
éventail pour le fexe; dans le fécond, d’une marotte
& d’une épée, fymbole du régiment ; dans le troi-
fieme, d’une marotte & d’une palme pour les écrivains
dignes d’être enrôlés; 6c dans le dernier,
d’une marotte & d’une harpe, emblème des poètes
qui ont mérité le même honneur. La trabe ou le
bâton étoit furmonté d’un croiffaiit.
Les armoiries étoient un emblème parlant du ca-
raélere 6c de l’emploi de ce célébré régiment. L’écuf-
fon d’or au chef de fable chargé d’une lune d’argent
& de deux croiffans oppofés de même métal. L’écuf-
fon chargé en pal du lceptre de Momus, femé de
papillons fans^nombre, de différentes couleurs, eft
couronné d’une calotte à oreillons, dont l’un eft re-
trouffé, 6c l’autre abaiffé. Le fronton de la calotte
eft orné de fonnettes & de grelots indifféremment
attachés ; elle a pour cimier un rat paffant, furmonté
d une girouette pour en marquer la folidité ; les armes
ont pour fupport deux linges, ce qui dénote
l’innocence & la fimplicité : l’un eft habillé en militaire
, & l’autre en robe & en collet, tenant un mémoire
à la main. Au-deffus du fupport font deux
cornes d’aboridance e,n lambrequins , d’où fortent
des brouillards fur lefquels font aflignées les pen-
fions du régiment ; au haut de ces armes voltige un
oriflamme avec cette devife : Favet Momus luna in-
fuit.
Cet étendart, ainfi que les armoiries , font de
l’invention du fleur Aymon, général; elles font re-
préfentées ayec le portrait de l’auteur dans le poème
calo tin du confeil de Momus. On ne fera pas fâché-
de voir la defeription de ces armoiries en ftyle ca-
lotin dans les lettres-patentes données pour faire
battre la médaillé du régiment :
Le noble écu de la calotte,
Portant en pal une marotte ,
Le champ femé de papillons,
Les plus, légers des olfillons ;
Le chef, comme noble partie ,
Aura La lune dans fon plein ,'
Cet aflre qui du genre humain
Réglé lit conduite & la vie ,
Dont les croiffans aux deux côtés
Marqueront les variétés.
Une calotte à double oreille,
E n couvrant le chef à merveille,
Servira de tymbre d Vécu.
Sur ce cafque plein de vertu ,
D ou pendront grelots & fonnettes ,
Sera plantée une girouette
Légère & tournant d tout vent,
Ayant au pied h rat paffant ;
Pour Lambrequins, une fumée
D'un des plus fins brouillards formée ;
Deux finges gemeaux & très-forts
Feront d côté les fupports ;
Mais quoique pareils en nature ,
Ils feront divers en vêture :
L'un portera manteau, collet ;
D autre, la botte & le plumet,
Image de la gent occupée,
Tant d la robe qu'à l'épée.
Ordonnons qu'on y mette auffi , .
Comme pour devife & pour cri,
» La lune nous conduit, Momus nous favorife ».
V ’.rs renfermant doctrine exquife ,
Et duquel vers tout calotin
Sefouviendra foir & matin.
On fit frapper un fceau & plufieurs médailles, où,
d’un côté, Momus étoit aflis fur un nuage, avec la
légende : C'eff régner que de favoir rire ; & dé l’autre ,
les armoiries. On voulut que chaque frere,de quelque
qualité qu’il fû t, portât le médaillon attaché à
la boutonnière, même les cordons bleus, car l’ordre
de Momus n’eft incompatiblè avec aucun autre.
On devoit fur-tout porter le médaillon dans les tems
de frairie, auxquels la compagnie s’affembloit. Voici
comme s’expriment là-deflùs les mêmes lettres-pa-;
tentes :
De tavis donc des calo tins,
(Autrement frères de la jo ie )
Ordonnons aufieur RocHerins ,
Le graveur de notre monnoie ,
De graver avec beaucoup d.'art
Le grand dieu Momus d'une part,
AJJÎS fur un léger nuage ,
E t montrant un riant vifage,
Avec ces beaux mots d Ventour :
« C eft régner que de f avoir rire » .*
Mots que la ville & que la cour
Devroient, d tous momens redire.
Quant aw revers, on y verra,
Autant que Vart le permettra,
Le noble écu de la calotte, &c.
Voulons de plus que chaque frere
Porte le fufdit médaillon,
Tant en or, qu'argent, bronze & plomb ,
Du côté de la boutonnière.
Entendons que tout cordon bleu,
Noir, rouge ou de couleur bigarre.
Tel que celui de S. Lamarre ,
Se dife j par un noble aveu,