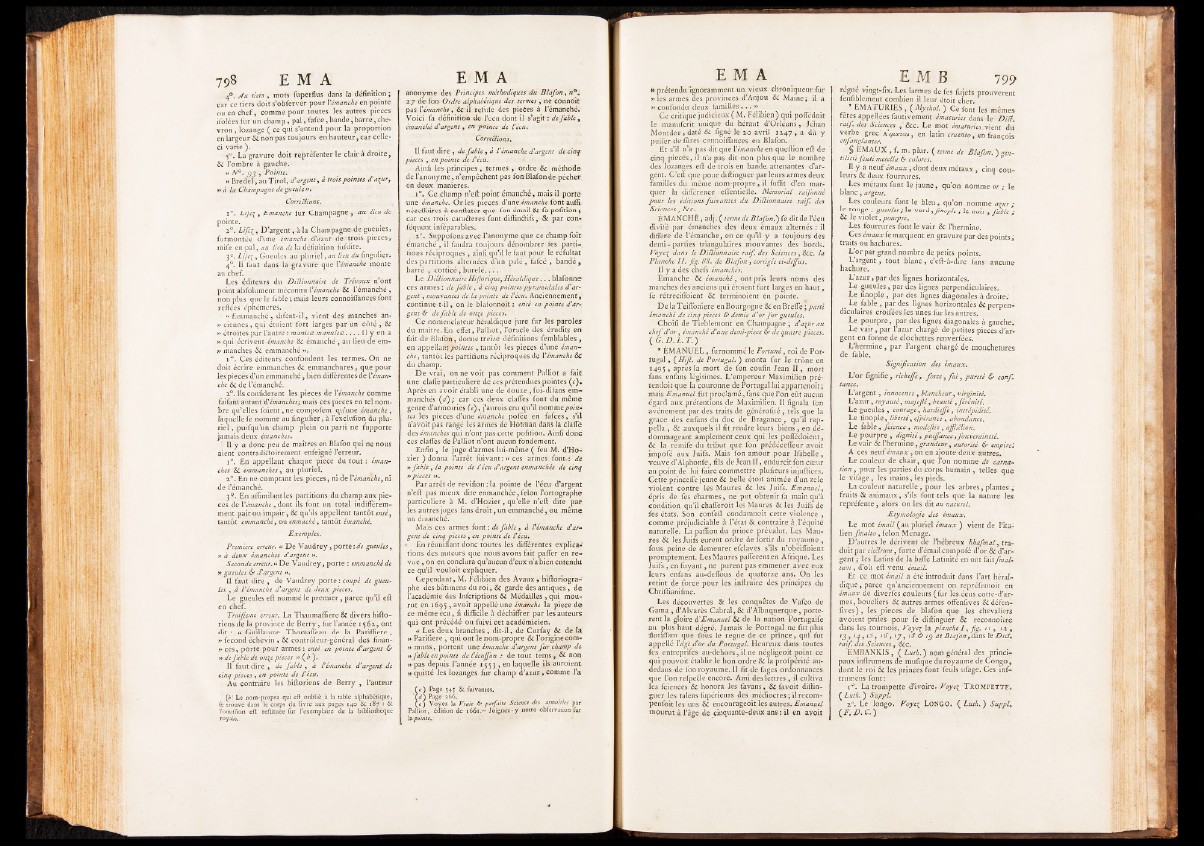
4°. Au tiers , mots fuperflus dans la définition ;
car ce tiers doit s’obferver pour Yèmanche en pointe
ou en ch ef, comme pour toutes les autres pièces
ifolées fur un champ, pal ,'fafce, bande, barre, che*-
vron , lozange ( ce qui s’entend pour la proportion
en largeur 6c non pas toujours en hauteur, car celle;
ci varie). v ' "i' " : ;
5°. La gravure doit repréfenter le clair a droite,
6c l’ombre à gauche.
« N°. _93 , Pointe.
» Bredel, au T irol, d’argent, à trois pointes d'a\ur,
» à la Chàrnpagne de gueule »,
Corrections.
i° . Life[ , Èmanche fur Champagne , au. lieu de
pointe.
2°. Life{ , D ’argent ,-à la Champagne, de gueules,
furmontée d’une èmanche d’azur de'trois pièces,
mife en pal, au lieu dp la' définition fufdite.
3°. Lije^ , Gueules aupluriel, au lieu du fingulier.
4°. Il faut dans la gravure que Yèmanche monte
au chef.
Les éditeurs du Dictionnaire de Trévoux n’ont
point abfolumCnt méconnu Y èmanche 6c l’émanche ,
non plus que le fable ; mais leurs connoiffances font
refiées éphémères.
« Emmanché, difènt-il,, vient des manches an-
» ciennes, qui étoient -fort larges par un côté , &
» étroites par l’autre : manicoe manulece. . . . Il y en a
» qui-.écrivent èmanche- 6c émanché , au lieu de em-
» manches 6c emmanché ». '
i ° . Ces éditeurs cQnfondent les termes. On ne
doit écrire emmanches 6c emmanchures, que pour
lëspieces d’un emmanché, bien différentes de Yéman-
che 6c de l’émanché.
2°. Ils confiderent les pièces de Y èmanche comme
faifant autant d’émanc/iei; mais ces pièces en tel nombre
qu’ elles foient,ne compofeni qu’une èmanche,
laquelle Te nomme au fingulier, à l’exclufion du pluriel
, puifqu’un champ plein ou parti ne fupporte
jamais deux émanches.
Il y a donc peu de maîtres en Blafon qui ne nous
aient contradiâoirement enfeigné l’erreur.
i°. En appellant chaque pièce du tout : émanches
6c emmanches , au pluriel.
2°. En ne comptant les, pièces, ni de l’èmanche, ni
de l’émanché.
39. En affimilant les partitions du champ aux pièces
de Y èmanche , dont ils font un total indifféremment
pair ou impair, 6c qu’ils appellent tantôt enté,
tantôt emmanché, ou enmaché, tantôt émanché.
Exemples.
Première erreur. « De Vaudrey, porte '.de gueules,
» a deux emanches a argent ».
Seconde erreur.« De Vaudrey, porte : emmanché de
» gueules & £ argent ».
Il faut dire , de Vaudrey porte : coupé de gueules
, à Vèmanche £ argent de deux pièces.
Le gueules eft nommé le premier, parce qu’il eft
en chef.
Troijieme erreur. La Thaumafliere 6c divers hifto-
riens de la province de Berry, fur l’année 1562, ont
dit : « Guillaume Thomaffeau de la Pariffiere ,
» fécond échevin , 6c contrôleur-général des finan-
» ces, porte pour armes : enté en pointe £ argent &
» de fable de on^e pièces » (£.).
Il faut dire , de fable , à P èmanche d'argent de
cinq pièces , en pointe de l'ecu.
Au contraire les hiftoriens de Berry , l’auteur
(b) Le nom-propre qui eft oublié, à la table alphabétique, fe trouve dans le corps du livre aux pages 140 & 187 : &
l’omillion eft reftituée fur l’exemplaire de la bibliothèque
royale.
anonyme des Principes méthodiques du Blafon, n°.
a y deTon Ordre alphabétique des termes , ne connoît
pas Y èmanche, & il refufe des pieées à l ’émanché.
Voici fâ définition de l’écu dont il s’agit : de fable ,
émanché d'argent, en pointe de l’écu. -
Corrections,
Il faut dire , de fable, a l'èmanche d'argent de cinq
pièces y en pointe de Vécu.
Ainfi les principes, termes , ordre 6c méthode-
de l’anonyme, n’empêchent pas fon Blafon de péche^
en deux 'maniérés.
i° . Ce champ n’eft point émanché, mais il porte
une èmanche. Or les pièces d’une èmanche font aufii
néceffaires à conftater que fon émail 6c fa pofition ;
car ces trois caraâeres font diftinftifs, & par con-
féquent inféparables.
. . Suppofons avec l’anonyme que ce champ foifr
émanché , il faudra toujours dénombrer Tes parti-,
tions réciproques , ainfi qu’il le faut pou:r le réfultat
des partitions alternées d’un palé , fafcé , bandé,
barré. ; ' cotticé, bure lé.
Le Dictionnaire Hiforique, Héraldique. . . blafonne
ces armes: defable , à cinq pointes pyramidales d'argent
, mouvantes de la pointe de Vécu. Anciennement,
continue-t-il, on le blafonnoit : enté en pointe d'argent
& de fable de on\e pièces.
Ce oonienclateur héraldique jure fur les paroles
du maître. En effet, Palliot, l’oracle des érudits en
fait de Blafon, donne treize définitions femblables,
en appellao.Cpointes , tantôt les pièces d’une èmanche
, tantôt les partitions réciproques de Yèmanche 6c
du champ.
De vrai , on ne voit pas comment Palliot a fait
une claffe particulière de ces prétendues pointes (c ).
Après en avoir établi une de douze , foi-difans emmanchés
(<aQ ; car ces deux claffes font du même
genre d’armoiries (e), j’aurois cru qu’il nomme pointes
les pièces d’une èmanche pofée en fafces, s’il
n’avoit pas rangé les armes de Hotman dans la claffe
des émanches qui n’ont pas cette pofition. Ainfi donc
ces claffes de Palliot n’ont aucun fondement.
Enfin , le juge d’armes lui-même ( feu M. d’Ho-
zier ) donna l’arrêt fuivant:«ces armes font»: de
» fable, la pointe de l’ècu £ argent enmanchèe de cinq
» pièces ».
Par arrêt de revifion:Ia pointe de l’écu d’argent
n’eft pas mieux dite enmanchèe,félon l’ortographe
particulière à M. d’Hozier, qu’elle n’eft dite par
les autres juges fans droit, un emmanché, ou même
un émanché.
Mais ces armes font: de fable, à P èmanche £ argent
de cinq pièces, en pointe de Pécu.
• En réunifiant donc toutes les différentes explications
des auteurs que nous avons fait paffer en revue
, on en conclura qu’aucun d’eux n’a bien entendu
ce qu’il vouloit expliquer.
Cependant, M. Félibien des Avaux, hiftoriogra-
phe, des bâtimens du roi, 6c garde des antiques, de
l’académie des Infcriptions 6c Médailles , qui mourut
en 1695 , avoit appellé une èmanche la pièce de
ce même écu, fi difficile à déchiffrer par les auteurs
qui ont précédé ou fuivi cet académicien.
« Les deux branches, dit-il, de Curfay & de la
» Parifiere , qui ont le nom-propre & l’origine com-
» muns, portent une èmanche d'argent fur champ de
» fable en pointe de Pécuffon : de tout tems, oc non.
» pas depuis l ’année 1553 , en laquelle ils auroient
» quitté les lozanges fur champ d’azur, comme l’a
(c) Page.545 & fuivantes.
Xi) Page' 266.’ ' 1 \ ' J T. 7
(e) Voyez la Vraie & parfaite Science des armoiries par"
Palliot, édition de 1661.- Joignez-y notre obfervation fur
lapointe.
» prétendu ignoramment un vieux chroniqueur fui*
» les armes des provinces d’Anjou 6c Maine ; il a
» confondu deux familles . . . »
Ce critique judicieux ( M. Félibien) qui pofledoit
le manufcrit unique du héraut d’Orléans, . Jéhan
Montdor,daté & ligné le 20 avril 12 4 7 ,.a du y
puifer de fûres connoiffances en Blafon.
Et s’il n’a pas dit que Yèmanche en queftion eft de
cinq piecés, il n’a pas dit non plus que le nombre
des lozanges eft de trois en bande, attenantes d’argent.
C ’eft que pour diftinguer par leurs armes deux
familles du même nom-propre, il fuffit d’en marquer
la différence effentielle. Mémorial raifonnè
pour les éditions fuivantes du Dictionnaire raif. des
Sciences, &c.
ÉMANCHÉ, adj. ( terme de Blafon.') fe dit de l’écu
divifé par émanches des deux émaux alternés : il
différé de l’émariche, en ce qu’il y a toujours des
demi-parties triangulaires mouvantes des bords.
Voye[ dans le Dictionnaire raif. des Sciences, &c. la
Planche II. fig. 88. de Blafon , corrigée ci-deffus.
11 y a des chefs émanches. .
Èmanche 6c émanché, ont pris leurs noms des
manches des anciens qui étotent fort larges en haut,
fe rétreciffoient 6c terminoient en pointe.
De la Teiffoniere en Bourgogne & en Bre'ffe ; parti
émanché de cinq pièces & demie d'or fur gueules.
Choifi de Tieblemont en Champagne; £a{urau
chef d’or, émanché d'une demi-piece & de quatre pièces.
( G. D . L. T . )
* ÉMANUEL, furnommé le Fortuné, roi de Portugal
, ( Hijl. de Portugal. ) monta fur le trône en
1495, aptes la mort de fon coufin Jean I I , mort
fans enfans légitimes. L’empereur Maximilien pré-
tendoitque la couronne de Portugal lui appartenoit;
mais Emanuel fut proclamé, fans que l’on eut aucun
égard aux prétentions de Maximilien. Il fignala fon
avènement par des traits de générofité , tels que la
grâce des enfans du duc de Bragance, qu’il rap-
pella , &: auxquels il fit rendre leurs biens, en dédommageant
amplement ceux qui les poffédoient,
& la remife du tribut que fon prédéceffeur avoit
impofé aux Juifs. Mais fon amour pour Ifabelle,
veuve d’Alphonfe, fils de Jean II, endurcit fon coeur
au point de lui faire commettre plufieurs injuftices.
Cette princeffe jeune & belle étoit animée d’un zele
violent contre les Maures & les Juifs. Emanuel,
épris de fes charmes, ne put obtenir fa main qu’à
condition qu’il chafferoit les Maures & les Juifs de
fes états. Son confeil condamnoit cette violence ,
comme préjudiciable à l’état & contraire à l’équité
naturelle. La paffion du prince prévalut. Les Maures
& les Juifs eurent ordre de fortir du royaume ,
fous peine de demeurer efclaves s’ils n’obéiffoient
promptement. Les Maures pafferenten Afrique. Les
Juifs, en fuyant, ne purent pas emmener avec eux
leurs enfans au-deffous de quatorze ans. On les
retint de force pour les inftruire des principes du
Chriftianifme. ,
Les découvertes & les conquêtes de Vafco de
Gama , d’Alvarès Cabrai, 6c d’Albuquerque, portèrent
la gloire à’Emanuel 6c de la nation Portugaife
au plus haut dégré. Jamais le Portugal ne fut plus
floriflant que fous le régné de ce prince, qui fut
appellé Ydgè d'or du Portugal. Heureux dans toutes
fes entreprifes au-dehors, il ne négligeoit point ce
qui pouvoit établir le bon ordre 6c la profpérité au-
dedans de fon royaume. 11 fit de fages ordonnances
que l’on refpefte encore. Ami des lettres, il cultiva
les fçiences 6c honora les favans, & favoit diftinguer
les talens fupérieurs des médiocres ; il recom-
penfoit les uns 6c encourageoit les autres. Emanuel
mpurut à l’âge de çinquante-deux ans : il en avoit
régné vingt-fix. Les larmes de fes fujets prouvèrent
fenfiblement combien il leur étoit cher.
EMATURIES , ( Mythol. ) Ce font les mêmes
tetes appellées fautivement èmacuries dans'le D i ci.
raif .des Sciences , &c . Le mot èmaturies.v ient dû
verbe grec' a iparoa, en latin cruento, en françois
enfanglanter.
§ EMAUX , f. m. pluf, Ÿ “ r>n( de Blafon. ) m .
tilicii feuti metella & colores.
Il y a neuf émaux, dont deux métaux, cinq couleurs'&
deux fourrures.
Les métaux font le jaune, qu’on nomme o r ; le
blanc, argent.
Les couleurs font le bleu, qu’on nomme a^ur ;
le rouge , gueules; le verd yjinople ; le noir, fable ;
6c le violet, pourpre.
Les fourrures font le vair 6c l’hermine.
Ces émaux fe marquent en gravure par des points;
traits ou hachures.
L’or par grand nombre de petits points.
L’argent, tout blanc, c’eft-à-dire fans aucune
hachure.
L’azur, par des lignes horizontales.
Le gueules, par des lignes perpendiculaires.
Le finople , par des lignes diagonales à droite.’
Le fable , par des lignes horizontales 6c perpendiculaires
croifées les unes fur les autres.
Le pourpre, par des lignes diagonales à gauche.
Le v a ir , par l’azur chargé de petites pièces d’argent
en forme de clochettes renverfées.
L’hermine, par l’argent chargé de mouchetures
de fable.
Signification des émaux.
L’or lignifie, richeffe, force, f o i , pureté & conf.
tance.
L ’argent, innocence , blancheur, virginité.
L’azur, royauté, majefiè , beauté , férénité.
Le gueules , courage, hardieffe, intrépidité.
Le finople, liberté, efpèrance , abondance.
Le fable , fcience , modefiie , affliction.
Le pourpre , dignité, puiffance , fouverainetè.
Le vair 6c l’hermine, grandeur, autorité & empire2
A ces neuf émaux, on en ajoute deux autres.
Le couleur de chair, que l’on nomme de carnation
, pour les parties du corps humain , telles que
le vifage , les mains, les pieds.
La couleur naturelle , pour les arbres, plantes ;
fruits & animaux, s’ils font tels que la nature les
repréfente, alors on les dit au naturel.
Etymologie des émaux.
Le mot émail (au pluriel émaux) vient de l’italien
fmalto, félon Ménagé.
D ’autres le dérivent de l’hébreux hhafmal, traduit
par eleclrum, forte d’émail compofé d’or 6c d’argent
; les Latins de la baffe Latinité en ont fait final•
ium, d’oîi eft venu émail'. '
Et ce mot émail a été introduit dans l’art héraldique
, parce qu’anciennement on repréfentoit en
émaux de diverfes couleurs (fur les éçus.cotte-d’ar-
mes, boucliers 6c autres armes offenfives 6c défen-
five s) , les pièces de blafon que les chevaliers
avoient prifes pour fe diftinguer 6c reconnoître
dans les tournois. Voye[ la planche I , fig. 1 1 , t z 9
13, 14, i5 , i f , / y , 18 & ig de Blafon, dans le Dicl.
raif. des Sciences, 6cc.
EMBANKIS , ( Luth. ) nom général des principaux
inftrumens de mufique du royaume de Congo,
dont le roi 6c les princes font feuls ufage. Ces inftrumens
font:
i° . La trompette d’ivoire. Voye{ T rompette.
( Luth. ) Suppl.
2°. Le longo. Voye£ LONG O. (£«//;.) Suppl»
( F .D .C . )
i