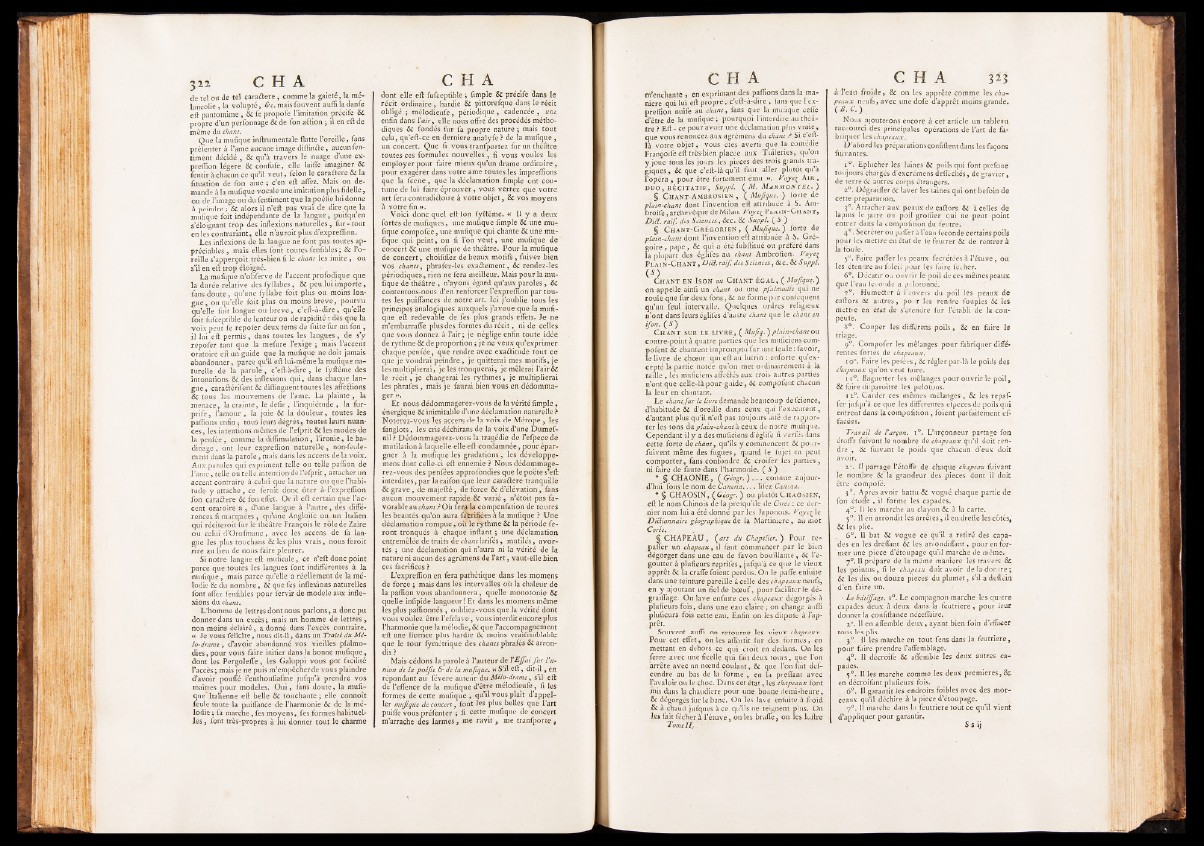
de tel ou de tel earaftere , comme la gaieté, la mélancolie
, la volupté, &c. mais fouvent aufli la danfe
eft pantomime , & fe propofe l’imitation précife &
propre d’un perfonnage & de fon a&ion ; il en eft de
même du chant.
Que la mufique inftrumentale flatte l’oreille, fans
préfenter à l’ame aucune image diftin&e, aucun fen-
timent décidé , & qu’à travers le nuage d’une ex-
prelîion légère & confufe, elle laifle imaginer &
fentir à chacun ce qu’il veut, félon le caraétere & la
fitùation de fon ame ; c’ en eft affez. Mais on demande
à la mufique vocale une imitation plus fidelle,
ou de l’image ou du fentiment que la poéfie lui donne
à peindre ; & alors il n’eft pas vrai de dire que la
mufique foit indépendante de la langue, puifqu’en
s’éloignant trop des inflexions naturelles, fur - tout
en les contrariant, elle n’auroit plus d’expreflion.
Les inflexions de la langue ne font pas toutes appréciables
, mais elles font toutes fenfibles ; & l’oreille
s’apperçoit très-bien fi le chant les imite , ou
s’il en eft trop éloigné.
La mufique n’obferve de l’accent profodique que
la durée relative de.s fy Uabes , & peu lui importe,
fans doute, qu’une fyllabe foit plus ou moins longu
e , ou qu’elle fojt plus ou moins breve, pourvu
qu’elle foit longue ou breve, c’eft-à-dire, qu’elle
foit fufceptible de lenteur ou de rapidité : dès que la
voix peut fe repofer deux tems de fuite fur un fon ,
il lui eft permis, dans toutes les langues, de s’y
repofer tant que la mefure l’exige ; mais l’accent
oratoire eft un guide que la mufique ne doit jamais
abandonner, parce qu’il eft lui-même la mufique naturelle
de la parole, c’eft-à-dire, le fyftême des
intonations & des inflexions qui, dans chaque langue
, cara&érifent & diftinguenttoutes les affeftions
& tous le s mouvemens de l’ame. La plainte , la
menace, la crainte, le defir , l’inquiétude, la fur-
prife, l’amour, la joie & la douleur, toutes les
pallions enfin , tous leurs dégrés, toutes leurs nuances,
les intentions mêmes de l’efprit & les modes de
la penfée, comme la diflimulation, l’ironie, le badinage
, ont leur expreflion naturelle, non-feulement
dans la parole, mais dans les accens de la voix.
Aux paroles qui expriment telle ou telle pafîion de
l ’ame, telle ou telle intention de l’efprit, attacher un
accent contraire à celui que la nature ou que l’habitude
y attache, ce feroit donc ôter à- l’exprefîion
fon cara&ere & fon effet. Or il eft certain que l’accent
oratoire a , d’une langue à l’autre, des différences
fi marquées , qu’une Angloife ou .un Italien
qui réciteroit fur le théâtre François le rôle de Zaïre
ou celui d’Orofmane, avec les accens de fa langue
les plus touchans & les plus vrais, nous feroit
rire au lieu de nous faire pleurer.
Si notre langue eft muficale, ce n’eft donc point
parce que toutes les langues font indifférentes à la
mufique, mais parce qu’elle a réellement de la mélodie
& du nombre, & que fes inflexions naturelles
font affez fenfibles pour fervir de modèle aux inflexions
du chant.
L ’homme de lettres dont nous parlons, a donc pu
donner dans un excès ; mais un homme de lettres,
non moins éclairé, a donné dans l’excès contraire.
« Je vous félicite, nous dit-il, dans un Traite du Mélo
drame , d’avoir abandonné vos vieilles pfalmo-
dies, pour vous faire initier dans la bonne mufique,
dont les Pergoleffe, les Galuppi vous pnt facilité
l’accès; mais je ne puis m’empêçherde vous plaindre
d’avoir pouffé l’enthoufiafme jufqu’à prendre vos
maîtres pour modèles. O u i, fans doute, la mufique'Italienne
eft belle & touchante; elle connoît
feule toute la puiffance de l’harmonie & de la mélodie
; fa marche, fes moyens, fes formes habituelles
, font très-propres à lui donner tout le charme
dont elle eft fufceptible ; fimple & précife dans le
récit ordinaire , hardie & pittorefque dans le récit
obligé ; mélodieufe, périodique , cadencée , une
enfin dans l’air, elle nous offre des procédés méthodiques
& fondés fur fa propre nature ; mais tout
cela, qu’eft-ce en derniere analyfe ? de la mufique,
un concert. Que fi vous tranfportez fur un théâtre
toutes ces formules nouvelles, fi vous voulez les
employer pour faire mieux qu’un drame ordinaire,
pour exagérer dans votre ame toutes les impreflions
que la feene, que la déclamation fimple ont coutume
de lui faire éprouver, vous verrez que votre
art fera contradi&oire à votre objet, & vos moyens
à votre fin ».
Voici donc quel eft fon fyftême. « Il y a deux
fortes de mufiques, une mufique fimple & une mufique
compofée, une mufique qui chante & une mufique
qui peint, ou fi l’on v eu t , une mufique de
concert & une mufique de théâtre. Pour la mufique
de concert, choififfez de beaux motifs , fuivez bien
vos chants, phrafez-les exaélément, & rendez-les
périodiques, rien ne fera meilleur. Mais pour la mufique
de théâtre , n’ayons égard qu’aux paroles, &
contentons-nous d’en renforcer l’expreflîon par toutes
les puiffances de notre art. Ici j’oublie tous les
principes analogiques auxquels j’avoue que la mufique
eft redevable de fes plus grands effets. Je ne
m’embarraffe plus des formes du récit, ni de celles
que vo.us donnez à l’air ; je néglige enfin toute idée
de rythme & de proportion ; je ne veux qu’exprimer
chaque penfée, que rendre avec exaélitude tout ce
que je voudrai peindre , je quitterai mes motifs, je
les multiplierai, je les tronquerai, je mêlerai l’air &
le réc it, je changerai les rythmes, je multiplierai
les phrafes , mais je faurai bien vous en dédomma- gS 9 I • . m Et nous dédommagerez-vous de la vérité fimple,
énergique & inimitable d’une déclamation naturelle ?
Noterez-vous les accens de la voix de Mérope, les
fanglots, les cris déchirans de la voix d’une Dumef-
nil ? Dédommagerez-vous la tragédie de l’efpece de
mutilation à laquelle elle eft condamnée, pour épargner
à la mufique les gradations, les développe-
mens dont celle-ci eft ennemie ? Nous dédommagerez
vous des penfées approfondies que le poète s’eft
interdites, par laraifôn que leur caraétere tranquille
& g rave, de majefté, de force & d’élévation, fans
aucun mouvement rapide & varié , n’étoit pas favorable
au chant ? Oh fera la compenfation de toutes
les beautés qu’on aura fafcrifiées à la mufique ? Une
déclamation rompue, où le rythme & la période feront
tronqués à chaque inftant ; une déclamation
entremêlée de traits de chant brifés, mutilés, avortés
; une déclamation qui n’aura ni la vérité de la
nature ni aucun des agrémens de l’a r t, vaut-elle bien
ces facrifices ?
L’expreflion en fera pathétique dans les momens
de force ; mais dans les intervalles où la chaleur de
la paflion vous abandonnera, quelle monotonie &
quelle infipide langueur ! Et dans les momens même
les plus paflionnés , oubliez-vous que la vérité dont
vous voulez être l’efclave, vous interdit encore plus
l’harmonie que la mélodie, & que l’accompagnement
eft une licence plus hardie & moins vraifemblable
que le tour fymétrique des chants phrafés & arrondis
?M
ais cédons la parole à l’auteur de YEJfai fur l ’union
de la poéjîe & de la mufique. « S’il eft, dit-il, en
répondant au févere auteur du Mélo-drame, s’il eft
de l’effence de la mufique d’être melodieufe, fi les
formes de cette mufique , qu’il vous plaît d’appel-
ler mufique de concert, font les plus belles que l’art
puiffe vous préfenter ; fi cette mufique de concert
m’arrache des larmes, me ra v it> me tranfporte ,
m’enchante « en exprimant des pallions dans la maniéré
qui lui eft propre ,vc?eft-à-dire , fans que l'ex-
preflîon nuife au chant, fans que la mufique ceffe
d’être de la mufique ; pourquoi l’interdire au théâtre
? Eft - ce pour avoir une déclamation plus vraie,
que vous renoncez aux agrémens du chant / Si c’eft-
là votre objet, vous êtes averti que la comédie
Françoife eft très-bien placée aux Tuileries, qu’on
y joue tous les jours les pièces des trois grands tragiques,
& que c’ eft-là qu’il faut aller plutôt qu’à
l ’opéra , pour être fortement ému ». Voye[ Ai r ,
DUO, RÉCITATIF, Suppl. ( M. MaRMONTEL. )
§ C hant-Ambrosien , ( Mufique. ) lorte de
plain-chant dont l'invention eft attribuée à S. Am-
broife,archevêque deMilan. Voye{ Plain-C hant,
Dict. raif. des Sciences, Scc. ÔC Suppl, (S )
§ C hant-Grégorien , ( Mufique. ) forte de
plain-chant dont l’invention eft attribuée à S. Grégoire
, pape, & qui a été fubftitué ou préféré dans
la plupart des églifes au chant Ambrofien. Voye^
Plain-Ch a n t , Dicl.raif. des Sciences, &c. & S uppl.
( S)C
hant en Ison o u C hant é g a l , ( Mufique.')
on appelle ainfi un chant ou une pfalmodie qui ne
roule que fur deux fons, & ne forme p-ir conléquent
qu’un feul intervalle. Quelques ordres religieux
n’ont dans leurs églifes d’autre chant que le chant en
ifon. ('S1)
C han t SUR LE LIVRE, ( Mufiq.) plain-chant ou
contre-point à quatre parties que les muficiens com-
pofent & chantent impromptu fur une leule : favoir,
le livre de choeur qui eft au lutrin : enforte qu’excepté
la partie notée qu’on met ordinairement à la,
taille, les muficiens affectés aux trois autres parties
n’ont que celle-là pour guide, 6c compofent chacun
la leur en chantant.
Le chant fur le livre demande beaucoup de fcience,
d’habitude & d’oreille dans ceux qui l’exécutent,
d’autant plus qu’il n’eft pas toujours ailé de rapporter
les tons du plain-chant é ceux de notre mufique.
Cependant il y a des muficiens d’églife fi verfés dans
cette forte de chant, qu’ils y commencent 6c po.ir-
fuivent même des fugues, quand le fujet en peut
comporter, fans confondre 6c croifer les parties,
ni faire de faute dans l’harmonie. ( S )
* § CHAONIE, (Géogr.) . . . connue aujourd’hui
fous le nom de Caneria.. . . liiez Canina.
* § CHAOSIN, ( Géogr. ) ou plutôt C haosien,
eft le nom Chinois de la prelqu’île de Corée : ce dernier
nom lui a été donné par les Japonois. Poye{ le
Dictionnaire géographique de la Martiniere, au mot
Corée.
§ CHAPEAU, (art du Chapelier. ) Pour re-
paffer un chapeau, il faut commencer par le bien
dégorger dans une eau de favon bouillante, 6c l’égoutter
à plufieurs reprifes, jufqu’à ce que le vieux
apprêt 6c la craffe foient perdus. On le paffe enfuite
dans une teinture pareille â celle des chapeaux neufs,
en y ajoutant un fiel de boeuf, pour faciliter le dé-
graiffage. On lave enfuite ces chapeaux dégorgés à
plufieurs fois, dans une eau claire ; on change aufli
plufieurs fois cette eau. Enfin on les dilpoie à l’apprêt.
Souvent aufli on retourne les vieux chapeaux.
Pour cet effet, on les affortit lur des formes, en
mettant en dehors ce qui étoit en dedans. On les
ferre avec une ficelle qui fait deux tours, que l’on
arrête avec un noeud coulant, 6c que l’on fait del-
cendre au bas de la forme , en la preffant avec
ljavaloir ou le choc. Dans cet état, les chapeaux font
mis dans la chaudière pour une bonne demi-heure,
& dégorges fur le banc. On les lave enfuite à froid
& à chaud jufques à ce qu’ils ne teignent plus. On
les fait fécher à l’étuve , on les braffe, on les luftre
Tome I f •
à l’eau froide, & on les apprête comme les chapeaux
neufs, avec une dofe d’apprêt moins grande.
CB.C.)
Nous ajouterons encore à cet article un tableau
raccourci des principales opérations de l’art de fabriquer
les chapeaux.
D ’abord les préparations çonfiftent dans les façons
fiiivantes.
i ° . Eplucher les laines & poils qui font prefaue
toujours chargés d’excrémens defféchés, de gravier,
de terre 6c autres corps étrangers.
2°. Dégraiffer & laver les laines qui ont befoin de
cette préparation.
3°. Arracher aux peaux de caftors & à celles de
lapins le jarre ou poil groilier qui ne peut point
entrer dans la compolition du feutre.
4°. Secréter ou paffer à l’eau fécondé certains poils
pour les mettre en état de fe feutrer & de rentrer à
la foule.
5". Faire paffer les peaux fecrétées à l’étuve, ou
les étendre au foleil pour les faire fécher.
6°. Décatir ou ouvrir le poil de ces mêmes peaux
que l’eau le coude a pelotonné.
7°. Humedter à l'envers du poil les peaux de
caftors 6c autres, pour les rendre fôuples & les
mettre en état de s’étendre fur l’établi de la cou-
peulè.
8°. Couper les différens poils, & en faire le
triage.
9°. Compofer les mélanges pour fabriquer différentes
fortes de chapeaux.
iO°. Faire les pefées, & régler par-là le poids des
chapeaux qu’on veut faire.
11°. Baguetter les mélanges pour ouvrir le poil,
& faire diiparoître les pelotons. •
12°. Carder ces mêmes mélanges , & les repafi-
fer jufqu’à ce que les différentes elpeces de poils qui
entrent dans la cômpofition, foient parfaitement effacées.
Travail de Varçon. i° . L’arçonneur partage fon
étoffe fuivant le nombre de chapeaux qu’il doit rendre
, 6c fuivant le poids que chacun d’eux doit
avoir.
2-’. Il partage l’étoffe de chaque chapeau fuivant
le nombre & la grandeur des pièces dont il doit
être Compofé.
3°. Après avoir battu & vogué chaque partie de
fon étoffe , il forme les capades.
4°. Il les marche au clayon & à la carte.
5°. Il en arrondit les arrêtes, il en dreffe les côtés,'
& les plie.
, 6°. Il bat & vogue ce qu’il a retiré des capades
en les dreffant 6c les arrondiffant, pour en former
une piece d’étoupage qu’il marche de même..
7°. Il prépare de la même maniéré les travers Sc
les pointus, fi le chapeau doit avoir de la dorure ;
& les dix ou douze pièces du plumet, s’il a deffein
d’en faire un.
* Le bdtijfage. i°. Le compagnon marche les quatre
capades deux à deux dans la feutriere, pour leur
donner la confiftance néceffaire.
2°. Il en affemble deux, ayant bien foin d’effàcer
tous les plis.
3°. 11 les marche en tout fens dans la feutriere,
pour faire prendre l’ affemblage.
4°. Il décroife & affemble les deux autres capades.
^°. Il les marche comme les deux premières, & .
en décroifant plufieurs fois.
6°. Il garantit les endroits foibles avec des morceaux
qu’il déchire à la piece d’étoupage.
7°. 11 marche dans la feutriere tout ce qu’il vient
d’appliquer pour garantir,
S s ij