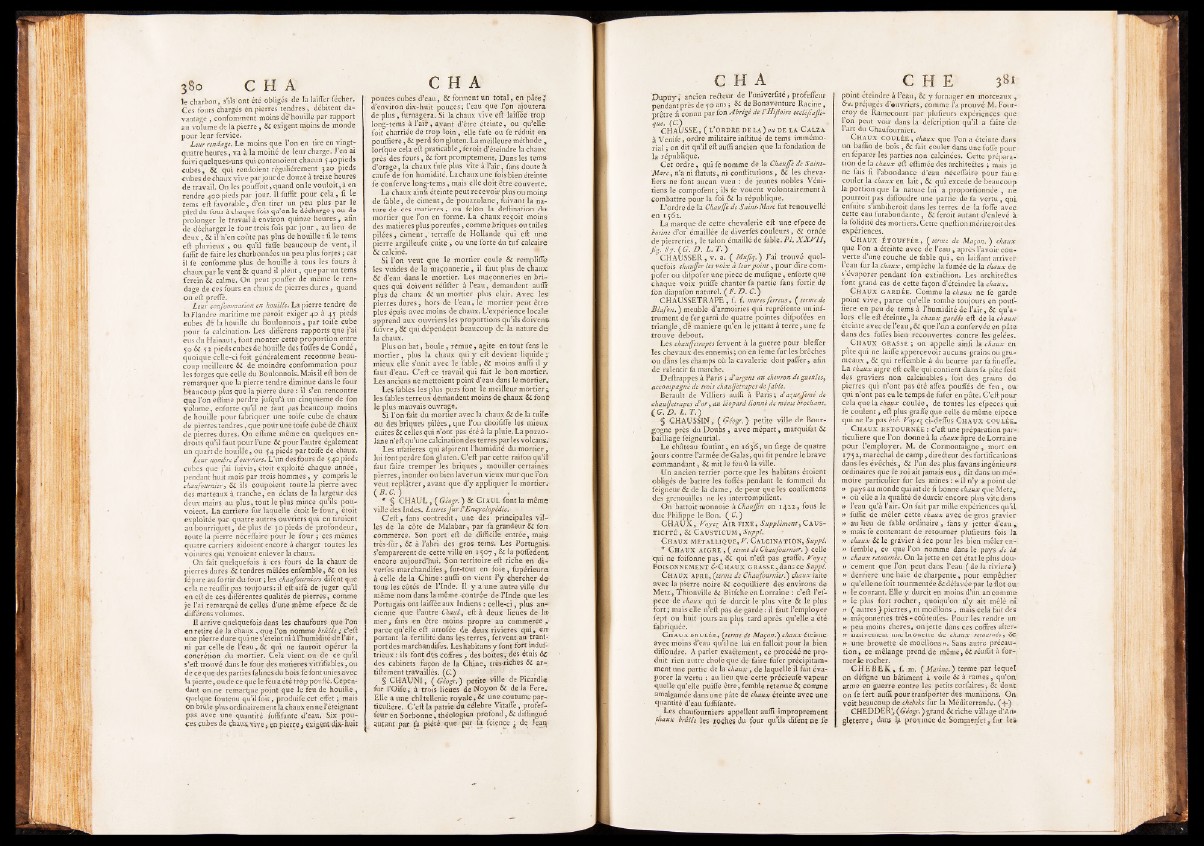
le charbon, s’ils ont été obligés de la laiffer fécher.
Ces fours chargés eapierres tendres, débitent davantage
, consomment moins d<?houille par rapport
au volume de la pierre, & exigent moins de monde
pour leur Service.
Leur rend âge. Le moins que l’on en tire en vingt-
quatre heures, va à la moitié de leur charge. J en ai
Suivi quelques-uns qui contenoient chacun 540 pieds
cubes, & qui rentloient régulièrement 3 zo pieds
cubes de chaux vive par jour de douze à treize heures
de travail. On les pouffoit, quand on le vouloit,à en
rendre 400 pieds par jour. Il Suffit pour ce la , fi le
tems eft favorable, d’en tirer un peu plus par le
pied du four à chaque fois qu’on le décharge ; ou de
prolonger le travail à environ quinze heures , afin
de décharger le four trois fois par jou r , au lieu de
d eux, & ilh ’en coûte pas plus de houille : fi le tems
eft pluvieux , ou qu’il faffe beaucoup de vent, il
Suffit de faire les charbonnées un peu plus fortes ; car
il fe confomme plus de houille à tous les fours à
chaux par le vent & quand il pleut, que par un tems
Serein & calme. On peut pouffer de même le ren-
dage de ces fours en chaux de pierres dures, quand
on eft preffé.
Leur confommadon en houille. La pierre tendre de
la Flandre maritime me paroît exiger 40 à 45 pieds
cubes d£ la houille du Boulonnois, par toife cube
pour fa calcination. Les différens rapports que j’ai
eus du Hainaut, font monter cette proportion entre
50 & 5 z pieds cubes de houille des foffes de Condé,
quoique celle-ci Soit généralement reconnue beaucoup
meilleure & de moindre confommation pour
les forges que celle du Boulonnois. Mais il eft bon de
remarquer que la pierre tendre diminue dans le four
beaucoup plus que la pierre dure : il s’en rencontre
que l’on eftime perdre jufqu’à un cinquième de Son
volume, enforte qu’il ne faut pas beaucoup moins
de houille pour fabriquer une toife cube de chaux
de pierres tendres, que pour une toife cube de chaux
de pierres dures. On eftime même en quelques endroits
qu’il faut pour l’une & pour l’autre également
un quart de houille, ou 54 pieds par toife de chaux.
Leur nombre etouvriers. L ’un des fours de 540 pieds
cubes que j’ai Suivis, étoit exploité chaque année,
pendant huit mois par trois hommes, y compris le
chaufournier, ôc ils coupoient toute la pierre avec
des marteaux à tranche, en éclats de la largeur des
deux mains au plus, tout le plus mince qu’ils pou-
voient. La carrière fur laquelle étoit le four, étoit
exploitée par- quatre autres ouvriers qui en tiroient
au bourriquet, de plus de 30 pieds de profondeur,
toute la pierre néceffaire pour le four ; ces mêmes
quatre carriers aidoient encore à charger toutes les
voitures qui venoient enlever la chaux.
On fait quelquefois à ces fours de la chaux de
pierres dures & tendres mêlées enfémble, & on les
fépare au fortir du four ; les chaufourniers difent que
cela ne réuffit pas toujours: il eft aifé de juger qu’il
en eft de ces différéntes qualités de pierres, comme
je l’ai remarqué de celles d’une même efpece & de
différens volumes.
Il arrive quelquefois dans les chaufours que l’on
en retire de la chaux, que l’on nomme brûlée c’eft
une pierre dure qui ne s’éteint ni à l’humidité de l’air,
ni par celle de l’eau, & qui ne fauroit opérer la
concrétion du mortier. Cela vient ou de ce qu’il
s’eft trouvé dans le four des matières vitrifiables, ou
de ce que des parties falines du bois fe font unies.avec
la pierre, ou de ce que le feu a été trop pouffé. Cependant
on ne remarque point que le feu de houille ,
quelque foutenu qu’il foit, produife cet effet ; mais
On brûle plus ordinairement la chaux en ne.l’éteignant
pas avec une quantité fuffifante d’eau. Six pouces
cubes de chaux v iv e , en pierre, exigent dix-huit
pouces cubes d’eau, & forment un total, en pâte J
d’environ dix-huit pouces; l’eau que l’çn ajoutera
de plus , furnagera. Si la chaux vive eft laifféè trop
long-tems à l’ail-, avant d’être éteinte, ou qu’elle
foit charriée de trop loin, elle fufe ou fe réduit en
pouffiere, & perd fon gluten. La meilleure méthode ,
lorfque cela eft praticable, feroit d’éteindre la chaux
près des fours, & fort promptement. Dans les tems
d’orage, la chaux fufe plus vite à l’air, fans doute à
çaufe de fon humidité. La chaux une fois bien éteinte
fe conferve long-tems, mais elle doit être couverte.
La chaux ainfi éteinte peut recevoir plusou moiqp
de fable, de ciment, de pouzzolane,fuivant la nature
de ces matières, ou félon la deftination du
mortier que l’on en forme. La chaux reçoit moins
des matières plus poreufes, comme briques ou tuiles
pilées, ciment,' terraffe de Hollande qui eft une
pierre argilleufe cuite , ou une forte du tuf calcaire
& calciné.
Si l’on veut que le mortier coule & remplifle
les vuides de la maçonnerie , il faut plus de chaux:
& d’eau dans le mortier. Les maçonneries en briques
qui doivent réfifter à l’eau, demandent auflr
plus de chaux & un mortier plus clair. Avec les
pierres dures, hors de l’eau, le mortier peut êtr©
plus épais avec moins de chaux. L’expérience localer
apprend aux ouvriers les proportions qu’ils doivent»
fuivre, & qui dépendent beaucoup de la nature de
la chaux.
Plus on bat, boule, remue, agite en tout fens le
mortier, plus la chaux qui y eft devient liquide
mieux elle s’unit avec le fable, & moins auffi il y
faut d’eau. C’ eft ce travail qui fait le bon mortier.
Les anciens ne mettaient point d’eau dans le mortier.
Les fables les plus purs font le meilleur mortier j
les fables terreux demandent moins de chaux & fonc-
le plus mauvais ouvrage.
Si l’on fait du mortier avec la chaux & de la tuile
ou des briques pilées, que l’on choififfe les mieux
cuites & celles qui n’ont pas été à la pluie. La pozzo-
lane n’eft.qu’une calcination des terres par les volcans.'
Les nfatieres qui afpirent l’humidité du mortier ,
lui font perdre fon gluten. C’eft par cette raifon qu’il
faut faire tremper les briques , mouiller certaines
pierres, inonder ou bien laver un vieux mur que l’on
veut replâtrer, avant que d’y appliquer le mortier^
( B .C . )
* § CH AUL, (Géogr.) & C iaul font la même
ville des Indes. Lettres fur C Encyclopédie.
C ’ eft , fans contredit, une des principales villes
de la côte de Malabar , par fa grandeur & fon.
commerce. Son port eft de difficile entrée, mais
très-fur, & à l’abri des gros tems. Les Portugais,
s’emparèrent de cette ville en 1 507, & la poffedent
encore aujourd’hui. Son territoire eft riche en di*
verfes marchandifes, fur-tout en foie , fupérieure
à celle de la Chine : auffi on vient l’y chercher d©
tous les côtés de l’Inde. Il y a une autre ville du
même nom dans la même contrée de l’Inde que les
Portugais ont laiffée aux Indiens : celle-ci, plus ancienne
que l’autre Chaul, eft à deux lieues de I»
mer, fans en être moins propre au commerce ,
parce qu’elle eft arrofée de deux rivières qui, en
portant la fertilité dans les terres, fervent au tranfc
port des marchandifes. Leshabitansy font fort industrieux
: ils font d ts coffres , des boîtes ; des étuis &c
des cabinets façon de la Chine, très-riches & ar-
tiftement travaillés. (C )
§ CHAUNI, ( Géogr. ) petite ville de Picardie
fur l’O ife ; à trois lieues deNoyon & delà Fere.
Elle a une châtellenie royale, & unexoutume particulière..
G’eft la patrie du célébré Vitaffe, profef-
feur en Sorbonne, théologien profond, & diftingu©
autant par fa piété- que par fa fçience j de Jeaq
Dupuy ; ancien refleur de l’univerfité, profefleUr
pendantprès de 50 ans; & deBonaventure Racine,
prêtre fi connu par fon Abrc%i üe l'II'jhire KcUfiajti-
que. (C.)
CHAUSSE, ( L’ordre delà) ou de la Calza
à Venife, ordre militaire inftitué de. tems immémorial
; on dit qu’il eft auffi ancien que la fondation de
la république. ' :v
Cet ordre, qui fe nomme de la Chauffe de Saint-
1Marc, n’a ni ftatuts, ni conftitutions, & les chevaliers
ne font aucun voeu : de jeunes nobles Vénitiens
le compofent ; ils fe vouent volontairement à
combattre pour la foi & la république.
L’ordre de la Chauffe de Saint-Marc fut renouvelle
en 156Z.
La marque de cette chevalerie eft une efpece de
botine d’or émaillée de diverfes couleurs, & ornée
de pierreries, le talon émaillé de fable. PI. X X F I I9
fig. 87. (G . D . L. T. )
CHAUSSER, v. a. ( Mufîq. ) J’ai trouvé quelquefois
chauffer les voix à leur point, pour dire com-
pofer ou difpofer une piece de mufique, enforte que
chaque voix puiffe chanter fa partie fans fortir de
fon diapafon naturel. (.F. D . C.)
CHAÜSSETRAPE , f. f. muresferreus, (termede
Blafon. ) meuble d’armoiries qui repréfente un inf-
trument de fer garni de quatre pointes difpofées en
triangle, de maniéré qu’en le jettant à terre, une fe
trouve debout.
Les chaujfetrapes fervent à la guerre pour bleffer
les chevaux des ennemis ; on en femè fur les brèches
ou dSns les champs où la cavalerie doit paffer, afin
de ralentir fa marche.
Deftrappes à Paris ; d?argent au chevron de gueules,
accompagné de trois chaujf etrapes de fable.
Berault de Villiers auffi à Paris; d!a*iirçfeml de
tfiauffetrapes d’or ,àu léopard lionnè de même brochant.
( G .D . L. T .)
§ GHAUSSIN, ( Géogr. ) petite ville de Bourgogne
près du Doubs, avec mépart, marquifat &
bailliage feigneurial.
Le château foutint, en 1636, un fiege de quatre
jours contre l’armée de Galas, qui fit pendre le brave
commandant, & mit le feu*à la ville.
Un ancien terrièr porte que les habitans étaient
obligés de battre les foffés- pendant le fommeil du
feigneur & de la dame, de peur que les coaffemens
des grenouilles ne les interrompiffent»
On battait naonnoie à Chauffin en 14ZZ, fous le
duc Philippe le Bon. ( C. )
CH AU X , Foye{ Air f ix e , Supplément,C aus-
t ic it é , & Causticum , Suppl.
Chaux métallique, V. Calcination, Suppl.
* Chaux AIGRE , ( terme de Chaufournier.') celle
qui ne foifonne pas, & qui n’eft pas grade. Voye^
Foisonnement 6*Chaux grasse, dans ce Suppl.
Chaux Apre, (terme de Chaufournier.') chaux faite
avec la pierre noire & coquilliere des environs de
Metz , Thionville & Bitfche en Lorraine : c’eft l’ef-
pece de chaux qui fe durcit le plus vite & le plus
fort ; mais elle n’eft pas de garde : il faut l’employer
fept ou huit jours au plus tard après qu’elle a été
fabriquée.
CHAUX BRÛLÉE, ( terme de Maçon.)-chaux éteinte
avec moins d’eau qu’il ne lui en falloit pour la bien
diffoudre. A parler exa&ement, ce procédé ne pro*
duit rien autre chofe que de faire fufer précipitamment
une partie de la chaux, de laquelle il fait évaporer
la vertu : au lieu que cette précieufe vapeur
quelle qu’elle puiffe être, femble retenue comme
amalgamée dans une pâte de chaux éteinte avec une
quantité d’eau fuffifante.
Les chaufourniers appellent auffi improprement
chaux brûlée les roches du four qu’ils difent ne fe
point éteindre à l’eau, & y furnager en morceaux ,
&e. préjugés d’#uvriers, comme l’a prouvé M. Four-
croy de Ramecourt par plufieurs expériences que
l’on peut voir dans la defcription qu’il a faite de
l’art du Chaufournier.
C h a u x c o u l é e -, chaux que l’on a éteinte dans
un baffin de bois , & fait couler dans une foffe pour
en féparer les parties non calcinées. Cette préparation
de la chaux eft eftimée des archite&es ; mais je
ne fais fi l’abondance d’eau néceffaire pour faire
couler la chaux en lait, & qui excede de beaucoup
la portion que la nature lui a proportionnée , ne
pourroit pas diffoudre une partie de fa v ertu , qui
enfuite s’imbiberoit dans les terres de la foffe avec
cette eau furabondante, & feroit autant d’enlevé à
la folidite des mortiers. Cette queftionmériteroit des
expériences.
C h a u x é t o u f f é e , ( terme de Maçon-.) chaux.
que l’on a éteinte avec de l’eau , après l’avoir couverte
d’une couche de fable q ui, en laiffant arriver
l’eau fur la chaux, empêche la fumée de la chaux de
s’évaporer pendant fon extin&iom Les architeûes
font grand cas de cette façon d’éteindre la chaux.
C h a u x g a r d é e . Comme la chaux ne fe garde
point v iv e , parce qu’elle tombé toujours en poufr
ftere en peu de tems à l’humidité de l’air, & qu’a-
lors elle eft éteinte, la chaux gardée eft de la chaux'
éteinte avec de l’eau, & que l’on a confervée en pâte
dans des foffes bien recouvertes contre les gelées.
C h a u x g r a s s e ; on appelle ainfi la chaux en
pâte qui ne laiffe appercevoir aucuns grains ou grumeaux
, & qui reffemble à du beurre par fa fineffe.
La chaux aigre eft celle qui contient dans fà pâte foit
des graviers non calcinables, foit des grains de
pierres qui n’ont pas été affez pouffes de fe u , ou
qui n’ont pas eu le temps de fufer en pâte. C ’eft pour
cela que la chtifix coulée, de toutes les efpeces qui
fe coulent, eft plus graffe que celle de même .efpece
qui ne l’a pas été. Voye^ ci-deffus C h a u x c o u l é e .
C h a u x r e t o u r n é e : c’eft une préparation particulière
que l’on donne à la chaux âpre de Lorraine
pour l’employer. M. de Cormontaigne, mort en
175z, maréchal de camp, direûeur des fortifications
dans les évêchés, ôc l’un des plus favansingénieurs
ordinaires que le roi ait jamais eus, dit dans un mé•*.
moire particulier fur les mines : « il n’y a point de
» pays au monde qui ait de fi bonne chaux que Metz,*
» où elle a la qualité de durcir encore plus vite dans
» l’eau qu’à l’air. On fait par mille expériences qu’il
» fuffit de mêler cette chaux avec de gros gravier
» au lieu de fable ordinaire, fans y jetter d’eau „
» mais fe contentant de retourner plufieurs fois la
» chaux & le gravier à fec pour les bien mêler ens-C
» femble, ce que l’on nomme dans le pays de la-
» chaux retournée. On la jette en cet état le plus dou-
» cernent que l’on peut dans l’eau (d e là riviere)
» derrière une haie de charpente, pour empêcher
» qu’elle ne foit tourmentée & délavée par le flot ou-
» le courant. Elle y durcit en moins d’un an comme
» le plus fort rocher, quoiqu’on d’y ait mêlé ni
» ( autres ) pierres, ni moellons , mais cela fait des
» mâçonneries très * coûteufes. Pour les rendre un
»;peu moins cheres, on jette dans ces coffres alter-
» nativement une brouette de chaux. retournée, &
» une brouette de moellons ». Sans autre précaution
, ce mélange prend de même, réuffit à for-, '
mer le rocher.
CH E B E K , f. m. (Marine.) terme par lequel
on défigne un bâtiment à voile & à rames, qu’on:
arme en guerre contre les petits corfairés , & dont
on fe fert auffi pour tranlporter des munitions. Ort
voit beaucoup de chebeks lur la Méditerranée. (-4-)
CHEDDERJ, (Géogr. ) grand & riche village d’Âit*
gletçrre, dans I4 province de Sonunerfet , fur 1g*