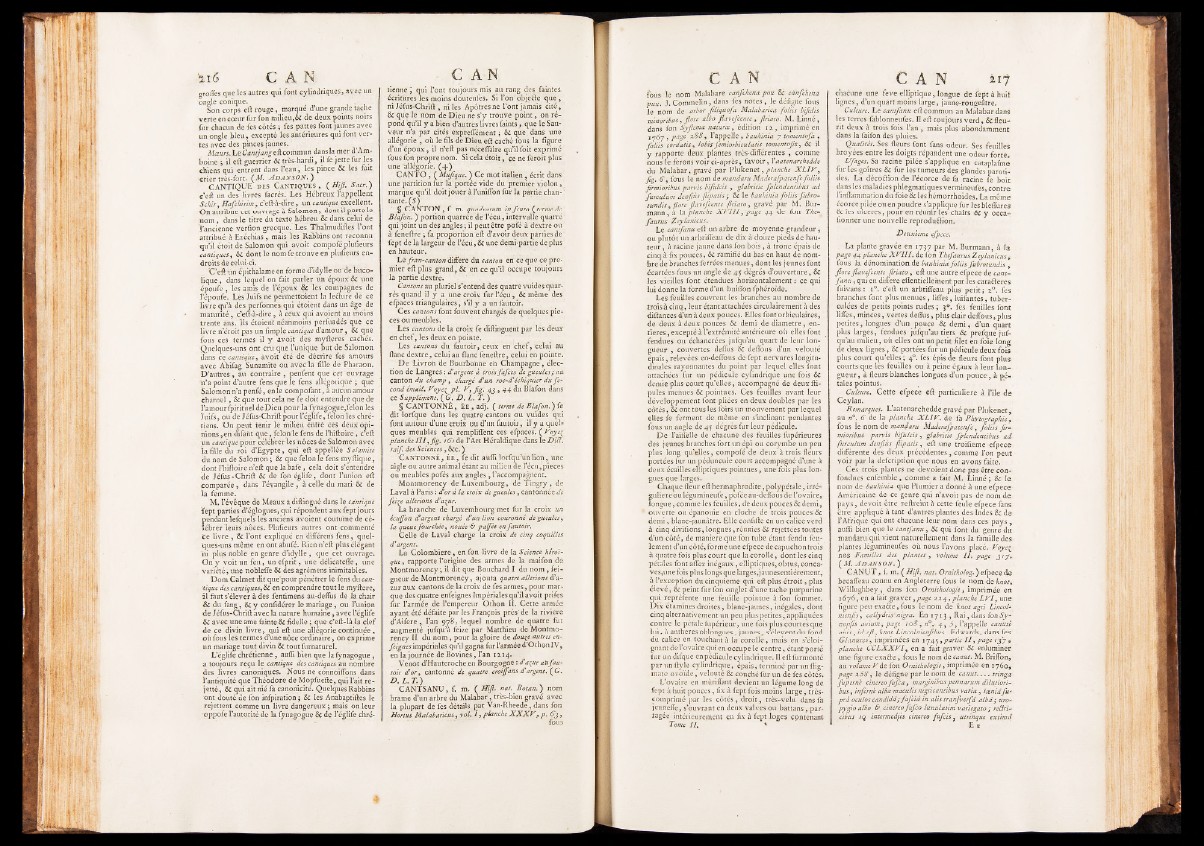
grofles que les autres qui font cylindriques,, avec un
ongle conique. .
Son corps eft ïouge, marqué d’une grande tache
verte en coeur fur fon milieu,& de deux points noirs
fur chacun de fes côtés ; fes pattes font jaunes avec
un ongle bleu, excepté les antérieures qui font vertes
avec des pinces; jaunes. '
Moeurs. Le CantjangeA commun dans la mer d’Am-
boine ; il eft guerrier & très-hardi, il fe jette fur les
chiens qui entrent dans l’eau , les .pince & les fait
crier très-fort. (M. A d a n so n . )
C A N T I Q U E d e s C a n t i q u e s , ( Hijî. Sacr.)
c’ett un des livrés facrés. Les Hébreux l’appellent
Schir, Hafchirim, c’eft-à-dire, un cantique excellent.
On attribue cet ouvrage à Salomon., dont il porte le
nom, dans le titre du texte hébreu & dans celui de
l ’ancienne verfion grecque. Les Thalmudiftés l’ont
attribué à Ezéchias, mais les Rabbins ont reconnu
qu’il étoit de Salomon qui avoit compofé plufieurs
cantiques, & dont le nom fe trouve en plufieurs endroits
de celui-ci.,
'C’eft fin épith'alame en formé d’idylle Oit de bucoliq
u e , dans lequel on fait parler ûn époux & une
époufe, les amis de l’époux & les compagnes de
fépoufe. Les Juifs ne permettoierit la le&ure de ce
livre qu’à des per fonnes qui étoient dans un â'gè de
maturité , c’eft-à-dire , à ceux qui avoient au moins
trente ans. Ils étoient néanmoins perfuadés que ce
livre n’étoit pas un fi m pie cantique d’amour, & que
fous ces termes il y avoit dès myfteres cachés.
Quelques-uns ont cru que l’unique but de Salomon
dans ce cantique, avoit été de décrire fes àmôurs
avec Abïfag Sunamite ou avëc lâ fille de Pharaon.
D ’autres , ait contraire , penfent que cet ouvrage
rn’ a point d’autre fens que le fens allégorique ; que
Salomon n’a penfé, en le compofant, à aifcun amour
charnfel, & que tout cela ne fe doit entendre que de
î’amour fpirituel de Dieu pour la fynagogue,félon les
Juifs, ou de Jéfus-Chrift pour l’églife, félonies chrétiens.
"On .peut tenir le milieu entré ces deux opinions
,en difant que, félon le fens de l’hiftoire, c’ eft
lin cantique pour célébrer les noces de Salomon avec
la fille du roi d’Egypte, qui eft àppellée Sal'amite
du nom de Salomon ; & que félon le fens myftique,
dont l’hiftoire n’eft que la bafe, cela doit s’entendre
de Jéfus-Chrift & de fon églife, dont l’union eft
comparée, dans l’évangile, à celle du mari & de
la femme.
M. l’évêque de Meaux a diftingué dans le cantique
fept parties d’églogues, qui répondent aux fept jours
pendant lefquels les anciens avoient coutume de célébrer
leurs n.ôcés. ïflufieurs autres ont commenté
ce livre , & l’ont expliqué en différeris fens, quelques
uns même en ont abufé. Rien n’eft plus élégant
ni plus noble en genre d’idylle, que cet ouvrage.
On y voit un feu , un efprit, une délicateffe, une
variété, ttne nobleffe & des.agrémens inimitables.
Dom Calmet dit que'pour pénétrer le fens du cantique
des cantiques,& en comprendre tout le myftere,
i l faut s’élever à des fentimens au-deffus de la chair
& du fang, & y confidérer le mariage, ou l’union
de Jéfus-Chrift avec là nature humaine, avec l’églife
& avec une ame fainte & fidelle ; que c’eft-là la clef
de ce divin livre, qui eft une allégorie continuée,
oiifous les termes d’une nôce ordinaire, on exprime
lin mariage tout divin & tout furnaturel.
L’églife chrétienne, aufli bien que la fynagogue,
a toujours reçu le cantique des cantiques au nombre
des livres canoniques. Nous ne connoiffons dans
l’antiquité que Théodore de Mopfuefte, qui Tait re-
jetté, & qui ait nié fa canonicité. Quelques Rabbins
ont douté de fon infpiration ; & les Anabaptiftes le
rejettent comme un livre dangereux ; mais on leur
oppofe l’autorité de la fynagogue &C de l’églife chrétienne
^ qui l’ont toujours mis au rang des faintes.
écritures les moins douteufes. Si Ton objeûe que ,
ni Jéfus-Chrift , ni les Apôtres ne l’ont jamais cité,
& que le nom de Dieu ne s’y trouve point, on répond
qu’il y a bien d’autres livres faints , que le Sauveur
n’a par cités expreffément ; & que dans une
allégorie , où le fils de Dieu eft caché fous la figure
d’ùn époux, il n’eft pas néceffàire qu’il foit exprimé
fous fon propre nom. Si cela é toit, ce ne feroit plus
une ‘allégorie. (-J-)
C A N T O , ( Mujique. ) Ce mot italien, écrit dans
une partition fur la portée vide du premier violon,
marque qu’il doit jouer à l’uniffon fur la partie chantante.
(5)
§ CANTON , f. m. quadràtufn in fcuto ( terme de
Blafon. ) portion quafrée de l’écu, intervalle quarré
qui joint un des angles ; il peut être p'ofé à dextre ou
à feneftre ; fa proportion eft d’avoir deux parties de
fept de la largeur de l’écii, & une demi-partie de plus
en hauteur.
Le fràn-canton différé du canton eri ce que ce premier
eft plus grand, & en ce qu’il Occupe toujours
la partie dextre.
Cantons au pluriel s’entend des quatre vuidesqüar-
rés quand il y a une croix fur l’ecu, & même des
efpàces triangulaires, s’il y a un fautoir.
Ces cantons font fouvent chargés de quelques pie*-
ces ou meubles.
Les c'antons de la croix fe diftinguênt par lés deux
en chef, les deux en pointe.
Les cantons du fautoir, ceux en chef, celui au
flanc dextre, celui au flanc feneftre, celui en pointe.
De Livron de Bourbonne en Champagne, élection
de Langres : d'argent à tfois fafces de gueules; ait
canton du champ , chargé d'un roc-d'échiquier du fé cond
émail. Voye^ pl. V, flg’. 4 3 ,4 4 du Blafon dans
ce Supplément. ( G. D . L. T. )
§ CANTONNÉ, Èe , ad). ( terme de Blafon.') fe
dit lorfque dans les quatre cantons ou vuides qui
fontautour d’une croix ou d’un fautoir, il y a quelques
meubles qui rempliffent ces éfpaces. QVoye{
planche I II 9fig. rCi de l’Art Héraldique dans le Dicl.
tdif. des Sciences, & C . )
C an to n n é , é e , fe dit aufli lorfqu’unlion, une
aigle' ou autre animal étant au milieu de, l’écu, pièces
ou meubles pofés aux angles ', l’acCompagnent.
Montmorency • de Luxembourg, de T in g ry, de
Laval à Paris : d’or à la croix de gueules, cantonnée de
feiçe aliénons d’azur.
La branche de Luxembourg met fur la croix ufi
écuffon <Pargent chargé dun lion couronné de. gueules,
la queue fourchée, nouée & pajfée en fautoir.
Celle de Laval charge la croix de cinq coquilles
d’argent.
La Colombiere, en fon -livre de la Science héroïque
, rapporte l’origine des armes de la maifon dé
Montmorency ; il dit que Bouchard I du nom, fei-
gneur de Montmorency, ajouta quatre aliénons d’azur
aux cantons de la croix de fes armes, pour marque
des quatre ènfeignes Impériales qu’il avoit prifes
fur l’armée dé l’empereur Othon II. Cette armée
ayant été défaite par les François près' de la rivière
d’Aifere , Tan 978, lequel nombre de quatre fut
augmenté jufqu’à feize par Matthieu de Montmorency
II du nom, pour la gloire de dou^e autres en-
feignes impériales qu’il gagna fur l’armée d’Othon IV,
en la journée de Bovines, Tan 1114.
Venot d’Hauteroche.en Bourgogne : d’azur aitfautoir
d’or, cantonné de .quatre, croiffans d'argent.\G.
D . L. T .)
CANTSANU, f. m. ( U fl- nçtt. Botan.)^ nom
brame d\in arbre du Malabar, très-bien gravé avec
la plupart de fes détails , par Van-Rheede , dans fon
Honus Malabaricus , vol. I , planche X X X K ) p. Cj ,
fous
fous lè nom Malabare canfchena pou & cànfc 'kenâ
puu. J. Commelin, dans fes notes , le défigne fous
le nom de arbor Jiliquofa Malabarica foins bifidis
uùnoribus, flore albo fiavefeente , flriato. M. Linné,
dans fon Syjlema natures, édition 1 2 , imprimé en
j j 6 7 , puge 2-88, l’appelle, bauhinia y tomentofa ,
foliis côrdatis, lobis femiorbiculatis tomentofis, & il
y rapporte deux plantes très-différentes , comme
nous le ferons voir ci-après, favoir, Vaatenarchedde
du Malabar, gravé par Plukenet, planche X L IV ,
jfig. <f, fous le nom de mandant Maderafpatenfe foliis
frmioribus parvis bifulcis , glabritie fplendentibus ad
furculum denfiùs fiipads j & le bauhinia foliis fubro-
tundis, flore fiavefeenté flriato., gravé par M. Bur-
mann, à la planche X V I I I , page 44 de fon The-^
faurus Zeylanicus.
Le cantfanu eft un arbre de moyenne grandeur j
ou plutôt un arbriffeau de dix à douze pieds de hauteur
, à racine jaune dans fon bois, à tronc épais de
cinq à fix pouces, & ramifié du bas en haut de nombre
de branches ferrées menues, dont les jeunes font
écartées fous un angle de 45 dégrés d’ouverture, &
les vieilles font étendues horizontalement : ce qui
lui donne la forme d’un buiflon fphéroïde.
Les feuilles couvrent les branches au nombre de
trois à cinq, leur étant attachées circulairement à des
diftanees <i’un à deux pouces. Elles font orbiculaires *
de deux à deux pouces & demi de diamètre, entières,
excepté à l’extrémité antérieure où elles font
fendues ou éehancrées jufqu’au quart de leur longu
eu r , couvertes deffus & deffous d’un velouté
épais, relevées en-deffous de fept nervures longitudinales;
rayonnantes du point par lequel elles font
attachées fur un pédicule cylindrique une fois &
demie plus court qu’elles, accompagné de deux fti-
pules menues & pointues. Ces feuilles avant leur
développement font pliées en deux doubles par les
côtés, & ont tous les foirs un mouvement par lequel
elles fe ferment de même en s’inclinant pendantes
fous un angle de 45 dégrés fur leur pédicule.
De Taiflèlle de chacune des feuilles fupérieures
des jeunes branches fort,un épi ou corymbe un peu
plus long qu’elles, compofé de deux à trois fleurs
portées fur un péduncule court accompagné d’une à
deux écailles elliptiques pointues, une fois plus longues
que larges.
Chaque fleur eft hermaphrodite, polypétale, irrégulière
ou légumineufe, pofée au-deffous de l’ovaire,
longue , comme les feuilles, de deux pouces & demi,
ouverte ou épanouie en cloche de trois pouces &
demi, blanc-jaunâtre. Elle confifte en un calice verd
à cinq divifions, longues,réunies & rejettées toutes
d’un côté, de maniéré que fon tube étant fendu feulement
d’un côté, forme une efpece de capuchon trois
à quatre fois plus court que la corolle, dont les cinq
pétales font aflez inégaux, elliptiques, obtus, concaves,
urte fois plus longs que larges,jaunesentiérement,
a l’exception du cinquième qui eft plus étroit, plus
elevé, & peint fur fon onglet d’une tache purpurine
qui repréfente une feuille pointue à fon fommet.
Dix étamines droites, blanc-jaunes, inégales, dont
cinq alternativement un peu plus petites, appliquées
contre le pétale fupérieur, une fois plus courtes que
lui, à anthères oblongues, jaunes^ s’élèvent du fond
du calice en touchant à la corolle, mais en s’éloignant
de l’ovaire qui en occupe le centre, étant porté
iur un difque en pédicule cylindrique. Il eft furmonté
par un ftyle cylindrique, épais, terminé' par un ftig-
mate ovoïde, velouté & couché fur un de fes côtés*
L’ovaire en muriflant devient un légume long de
fept à huit pouces, fix à fept fois moins large, très-
comprimé par les côtés, droit, très-velu dans fa
jeunefle, s’ouvrant en deux valves ou battans, partagée
intérieurement en fix à fept doges contenant
Tome I I . '
chacune une feve elliptique, longue de fept à huit
lignes, d’un quart moins large, jaune-rougeatre.
. Culture. Le cantfanu eft commun au Malabar dani
les terres fablonneufes. Il eft toujours verd, & fleurit
deux à trois fois l’an , mais plus abondamment
dans la faifon des pluies;
Qualités. Ses fleurs font fans odeur; Ses feuilles
broyées entre les doigts répandent une odeur forte*
Ufages. Sa racine pilée s’applique en cataplafmé
fur les goitres & fur les tumeurs des, glandes parotides;
La décôôion de Tée.orce de fa racine fe boit
dans les maladies phlegmatiques vermineufes, contre
l’inflammation du foie & les hémorrhoïdes. La même
écorce pilée ou en poudre s’applique fur les bleflùres
& les ülceres, pour en réunir les chairs & y oscar
fionner une nouvelle reproduction.
Deuxieme efpece;
La plante gravée en 1737 par M. Burmann, à la
page 44 planche X VIII. de fon Thefauras Zeylanicus,
fous la dénomination de bauhinia foliis fubrotundis ,
flore jlavefcents flriato, eft une autre efpece de cantfanu
, qui en différé eflentiellement par les caraéteres
fuivans : i°; c’eft un arbriffeau plus petit; 20. fes
branches font plus menues, liffes, luifantes -, tuber-
eulées de petits points rudes ; 3®. fes feuilles font
liffes, minces, vertes deffus j plus clair deffous ; plus
petites, longues d’un pouce & demi j d’un quart
plus larges, fendues jufqu’au tiers & prefque jufqu’au
milieu, où elles ont un petit filet en foie long
de deux lignes, & portées fur un pédicule deux fois
plus court qu’elles ; 40. fes épis de fleurs font plus
courts que lés feuilles ou à peine égaux à leur longueur
, à fleurs blanches longues d’un pouce, à pétales
pointus. ,
Culture. Cette efpece eft particulière à l’île de
Ceylan.
Remarques. L’aatenarchedde gravé par Plukenet y
au n°. C de la planche X L IV . de fa Photographie y
fous le nom de mandaru Maderafpatenfe, foliis fir-
mioribus parvis bifulcis, glabritie fplendentibus ad
furculum denfliis flïpatis, eft une troifieme efpece
différente des deux précédentes, comme l’on peut
voir par la defeription que nous en avons faite.
Ces trois plantes ne dévoient donc pas être confondues
enfemble, comme a fait M. Linné ; & le
nom de bauhinia que Plumier a donné à une efpece
Américaine de- ce genre qui n’avoit pas de nom de
pays, devoit être reftreint à cette feule efpece fans
être appliqué à tant d’autres plantes des Indes &: de
l’Afrique qui ont chacune leur nom dans ces pays *
àufli bien que le cantfanu, & qui font du genre du
mandaru qui vient naturellement dans la famille des
plantes légumineufes où nous l’avons placé. Voyeç
nos Familles des plantes, volume IL page 3 t j i
( M. A d a n s o n . )
CANUT > f. m. ( Hifl. nat. Omitholog. ) efpece de
becaffeau connu en Angleterre fous le nom de knon
Willughbey, dans fon Ornithologie, imprimée en
i6 ] f lf en a fait graver, page 2.24, planche L V I , une
figure peu e x a â e , fous le noim de knot agri Lincol-
nienfls, callydris*nigra. En 1713 , R a i, dans fon Sy-
nop/ïs avitini'y page I08 j n®.- 4 , 5 , l’appelle canuti
avis 9id eflt knot Lincolnienflbus. Edwards, dans fes
GlanûreSj imprimées en 1745, partie I I , page i fy ,
planche CCLXXVI, en a fait graver* & enluminer
une figure exatte, fous le nom de canut. M. Briffon,
au volume Vde fon Ornithologie , imprimée en 1760*
page 268, le défigne par le nom dé canut. . . . tringa
fuperne cinereo fufca, marginibus pennarum dilutionJ
bus, infernï alba maculis nigricantibus varia, icenidfuj
prà oculos çandidd;fafcia in alis tranfverfâ albâ ; uro-
pygio albo & cinereo fufco lunulatim variegato ; reclri-
cibus iq intermediis cinereo fufeis} utrinque extimd
E e