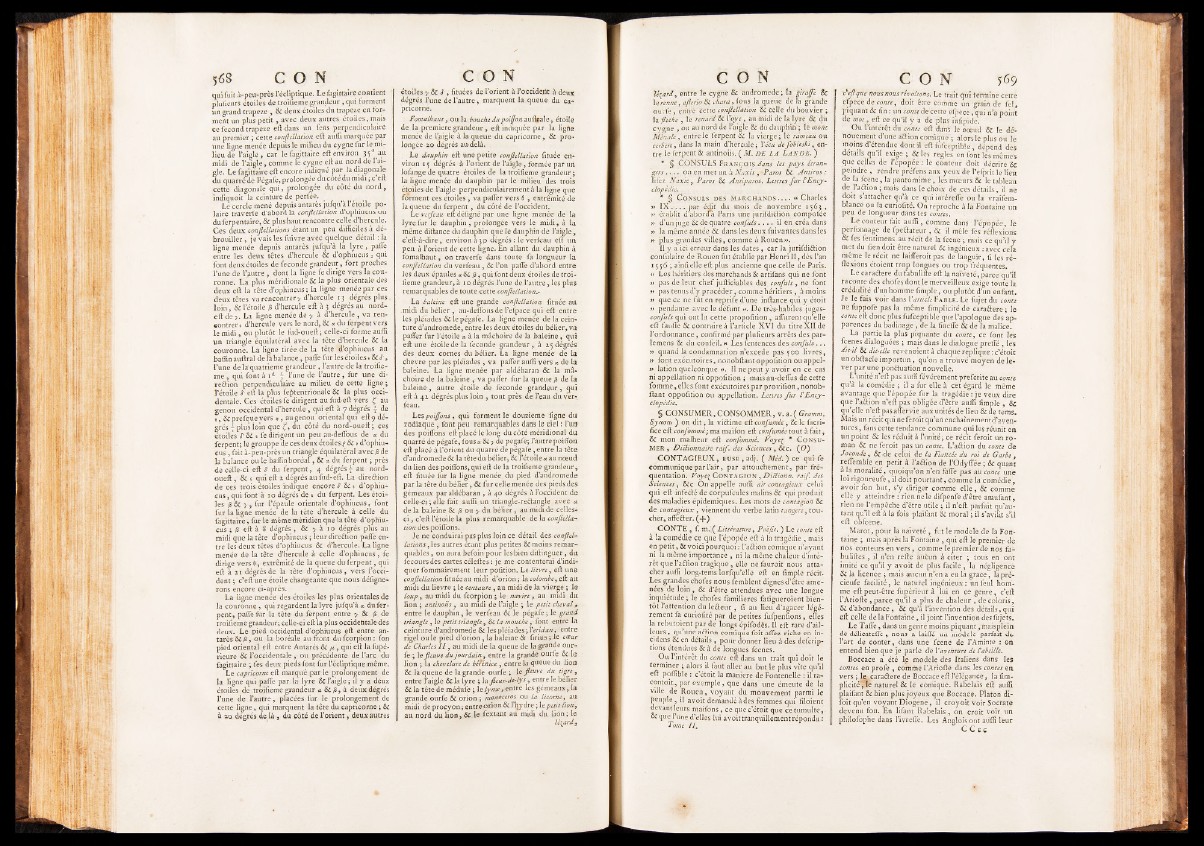
568 C O N
qui fuit à-peu-près l’écliptique. Lefagittaire contient
plusieurs étoiles de troifieme grandeur , qui forment
un grand trapeze , Sc deux étoiles du trapeze en forment
un plus petit , avec deux autres étoiles,mais
ce fécond trapeze eft dans un fens perpendiculaire
au premier ; cette confldlation eft auffi marquée par
une ligne menée depuis le milieu du cygne fur le milieu
de l’aigle, car lefagittaire eft environ 3 5°>a,u
midi de l’aigle, comme le cygne eft au nord de 1 aigle.
Le fagittaire eft encore indique par la diagonale
du quatré dé Pégafe, prolongée du côté du midi ; c’eft
cette diagonale qui, prolongée du côté du nord,
ïndiquoit la ceinture de perfée.
Le cercle mené depuis antarès jufqû à l’étoile polaire
traverfe d’abord la confldlation d’ophiucus ou
duferpentaire, & plus haut rencontre celle d’hercule.
Ces deux conciliations étant un peu difficiles à débrouiller
, je vais les fuivre avéc quelque détail : la
ligne menée depuis antarès jufqu’à la ly re , paffe
entre les deux têtes d’hercule Sc d’ophiucus , qui
font deux étoiles de fécondé grandeur, fort proches
l’une dé l’autre , dont la ligne fe dirige vers la couronne.
La plus méridionale & la plus orientale des
deux eft la tête d’ophiucus; la ligne menée par ces
deux têtes va rencontrer y d’hercule 13 dégrés plus .
lo in , Sc l’étoile /3 d’hercule eft à 3 dégrés au nord-
eft de y. La ligne menée de y à d’hercule , va rencontrer
ê d’hercule vers le nord, Sc « du ferpent vers
le m idi, ou plutôt le fud-oueft; celle-ci forme auffi
un triangle équilatéral avec la tête d’hercule Sc la
couronne. La ligne tirée de la tête d’ophiucus au
baffin auftral de lâ balance, paffe fur les étoiles tScS',
l’une de la'quatrième grandeur , l’autre de la troifie-
me , qui font à i d | l’une de l’autre , fur une direction
perpendiculaire au milieu de cette ligne ;
l’étoile <T eft la plus feptentrionale Sc la plus occ identale.
Ces étoiles fe dirigent au fud-eft vers £ au
genou occidental d’hercule, qui eft à 7 dégrés 7 de
*, &prefquevers w , au genou oriental qui eft 9 dégrés
7 plus loin que Ç, du côté du nord-oueft ; ces
étoiles S' Sc e fe dirigent un peu au-deffous de a du
ferpent; le grouppe de ces deux étoiles^ Sc t d’ophiucus
, fait à-peu-près un triangle équilatéral avec 0 de
la balance ou le baffin boréal, & a du ferpent ; près
de celle-ci eft S' du ferpent, 4 dégrés ~ au nord-
oueft § Sc e qui eft 2 dégrés au fud-eft. La direôion
de ces trois étoiles indique encore <T Sc e d’ophiucus
, qui font à 10 dégrés de t du ferpent. Les étoiles
j8 Sc y y fur l’épaule orientale d’ophiucus, font
fur la ligne menée de la tête d’hercule à celle du
fagittaire, fur le même méridien que la tête d’ophiucus
; /3 eft à 8 dégrés , Sc y à 10 dégrés plus au
midi que la tête d’ophiucus ; leur dire&ion paffe entre
les deux têtes d’ophiucus Sc d’hercule. La ligne
menée de la tête d’hercule à celle d’ophiuciis, fe
dirige vers 0, extrémité de la queue du ferpent, qui
eft à 21 dégrés de la tête d’ophiucus, vers l’occident
; c’eft une étoile changeante que nous défigne*
rons encore ci-après.
La ligne menée des étoiles les plus orientales de
la couronne , qui regardent la lyre jufqu’à a du ferpent,
paffe fiir la tête du ferpent entre y & /3.de
troifieme grandeur; celle-ci eft la plus occidehtale des
deux. Le pied occidental d’ophiucus eft entre antarès
& £ , ou la boréale au front dufcorpion: fon
pied oriental eft entre Antarès Sc p , qui eft la fupé-
rieure & l’occidentale, ou précédente de l’arc du
fagittaire ; fes deux pieds font fur l’écliptique même.
Le capricorne eft marqué :par le prolongement de
la ligne qui paffe par la lyre Sc l’aigle ; il y a deux
étoiles de troifieme grandeur a & /3, à deux dégrés
l’une de l’autre, placées fur le prolongement de
cette ligne, qui marquent la tête du capricorne ; Sc
à 2Q. dégrés de là , du côté de l’orient, deux autres
C O N
étoiles y Sc «f, fituées de l’orient à l’occidejit à deu*
dégrés l’une de l’autre, marquent la. queue du ca*
pricorne.
■ Fotnalhaüt, Ou la bouche dupoiffon auftrale, étoile
de la première grandeur, eft indiquée par la ligfte
menée de l’aigle à la queue du capricorne, Sc pro*
longée 20 dégrés au-delà. .
Le dauphin eft Une petite confldlation fituée en*
viron 15 dégrés à l’orient de l’aigle, formée par uii
lofange de quatre étoiles de la troifieme grandeur ;
la ligne menée du dauphin par le milieu des trois
étoiles de l’aigle perpendiculairement à la ligne que
forment ces étoiles , va paffer vers ô , extrémité de
la queue du ferpent , du côté de l’occident.
L& verfeau eftdéfignépar une ligne menée de’ la
lyre.fur le dauphin, prolongée vers le midi, à la
même diftance du dauphin que le dauphin de l’aigle,
c’eft-à-dire, environ à 39 dégrés : le verfeau eft un
peu à l’orient de cette ligne. En allant du dauphin à
fomalhaut, on traverfe dans toute fa longueur la
confldlation du verfeau, Sc l’on paffe d’abord entre
les deux épaules «Sc 13, qui font deux étoiles de troifieme
grandeur, à 1 o dégrés l’une de l’autre, les plus
remarquables de toute cette confldlation..
La baleine eft une grande confldlation fituée au
.midi du bélier , au-deffous de l’eipace qui eft entre
les pléiades Sc le pégafe. La ligne menée de la ceinture
d’andromede, entre les deux étoiles du bélier, va
paffer fur l’étoile a à la mâchoire de la baleine, qui
eft une étoile de la fécondé grandeur, à 25 dégrés
des deux cornes du bélier. La ligne menée de la
chevre par les pléiades , va paffer auffi vers a de la
baleine. La ligne menée par aldébaran & la mâchoire
de la baleine , va paffer fur la queue £ de la
baleine, autre étoile de fécondé grandeur, qui
eft à 42 dégrés plus loin , tout près de l!eau du verfeau.
Lespoiffôns, qui forment le douzième figne du
zodiaque , font peu remarquables dans le ciel : l’uri
des poiffons eft placé le long du côté méridional du
quarré de pégafe, fous a&iyde pegafe; l’autre poiffon
eft placé à l’orient du quarré de pégafe, entre la tête
d’andromede & la tête du bélier, Sc l’étoile a au noeud
du.lien des poiffons, qui eft de la troifieme grandeur ,
eft fituée fur la ligne menée, du pied d’andromede
par la tête du bélier, Sc fur celle menée des pieds des
gémeaux par aldébaran , à 40 dégrés à l’occidënt de
celle-ci ; elle fait auffi un triangle-reftângle avec a
de la baleine Sc /3 ou y du bélier, aumidi de celles-
ci , c’eft l’étoile la plus remarquable de la confldla-
tion des poiffons.
Je ne conduirai pas plus loin ce détail des conflel-
lations, les autres étant plus petites & moins remarquables
, on aura befoin pour lesbien diftinguer, dit
fecoursdes cartes céleftes : je me contenterai d’indi*
quer fommairement leur pofition. Le lievre, eft une
conJldlation (\t\xêQ2,u midi d’orion; la colombe, eft au
midi du lievre ; le centaure , au midi de la vierge ; le
loup, au midi du feorpion ; le navire , au midi du
lion ; antinoiis , au midi de l’aigle ; le petit cheval 9
entre le dauphin, le verfeau Sc le pégafe ; le grand
~ triangle , le petit triangle, Sc la mouche , font entre la
ceinture d’andromede Sc les pléiades ; Veridan, entre
rigel ouïe pied d’orion, la baleine & firius ; le coeur
de Charles I I , au midi de la queue de la grande our-
fe ; le fleuve du jourdain, entre la grande ourfe Sc le
lion ; la chevelure de b.éténice , entre la queue du lion
& là queue de la grande ourfe ; le fleuve du tigre ,
entre l’aigle & la lyre ; la jleur-de-lys, entre le bélier
& la tête de médufe; le lynx» entre les gémeaux, la
grande ourfe & orion ; monoceros ou la licorne, au
midi de procyon; entre orion & l’hydre ; 11 petit lion,
au nord du U on ,& ;le fextant au midi du. lion; le
lézard 3
C O N
îlrard, entre le cygne & àndrômede ; la giraffe &
le renne, aflerio & chara, fous la queue dé la grând’è
ourfe , entré cètte confldlation & celle du bouvier ;
ia flèche , le 'rénard & l’o y e , au midi dé là lyre & dit
cygne , ou au nord de I’âigle & du dauphin ^ le mont
Menale, entré le ferpent 6c la vierge ; lè rdmèaü ou
cerbère, dans la main d’hèrculè ; Vécu dé fobieski, entre
le ferpent & antinoiis, ( M , d e l a L a n d e . )
* § CONSULS François dans les pays étrangers
..,... on en met un à N axis , 'Paros & Antiros :
liiez N a x ie , Paras &C Andparos. Lettres fu r t Encyclopédie,,,
,
* § C onsuls des m a r ch an d s . . . . «Charles
» I X . . . . par édit du mois d‘e .novembre 1563 ,
» établit d’aborcHi Paris une jurifdi&km compofée
» d’un juge & de quatre confuls. . . . il en.créa dans
» la même année & dans les deux fuivantes dans les
» plus grandes villes, comme à Rouen».
11 y a ici erreur dans les dates , car la jurifdiftion
confiilaire de Rouen fut établie par Henri II, dès l’an
1556 ; ainfi elle eft plus ancienne que celle de Paris.
« Les héritiers des marchands & artifans qui ne font
» pas dé leur chef jufticiables des. confuls , ne font
» pas tenus d’y procéder, comme héritiers , à moins
» que ce ne fut en reprife d’une inftance qui y étoit
» pendante avec le défunt ». De très-habiles juges-
confuls qui ont lu cette propofition, affurent qu’elle
eft faufle & contraire à l’article XVI du titre XII de
l ’ordonnance, confirmé par plufieurs arrêts des par-
lemens & du confeil. « Les lentencês des confuls. . .
» quand la condamnation n’excede pas 500 livres,
» font exécutoires, nonobftantoppofition ou appel-
» lation quelconque ». Il ne peut y avoir en ce cas
ni appellation ni oppofition ; mais au-deffus de cette
fomme, elles font exécutoires par provifion, nonob-
ftant oppofition ou appellation. Lettres fur VEncyclopédie,
§ CONSUMER, CONSOMMER, v. a .( Gramm.
Synon. ) on d it , la viélime eft confumée, & le facri-
fice eft confommé; ma maifon eft confumée tout à fait,
& mon malheur eft confôtnmé. Voye{ * CONSUMER
, Dictionnaire raif. des Sciences, &c. (O)
CONTAG IEUX, euse , adj. ( Méd. ) ee qui fe
communique par l’air, par attouchement, par fréquentation.
Voyez_ C o ntagio n , Dicliohn. raif. dés
Sciences, & c On appelle auffi air contagieux Celui
qui eft infeélé de corpufcules malins & qui produit
des maladies épidémiques. Les mots de contagion Sc
de contagieux, viennent du verbe latin tangere, toucher,
affe&er. (+ )
C O N T E , f. m..( Littérature, Poèfie. ) Le conte eft
à la comédie ce que l’épopée eft à la tragédie , mais
en petit, & voici pourquoi: Fa&ion comique xi’aÿant
ni la même importance , ni la même chaleur d’intérêt
que l’aéfion tragique, elle ne fauroit nous attacher
auffi Iong-tems lôrfqu’ellé eft en fimple récit.
Les grandes chofes nous lemblent dignes d’être ame-
nees^de loin, & d’être attendues avec une longue
inquiétude ; le chofes familières fatigueroient bientôt
l’attention du leûeur , fi au lieu d’agacer légèrement
fa curiofité par de petites fufpenfions, elles
la rebutoient par de longs épifodës. Il eft rare d’ailleurs
, qu’une aftion comique foit affez riche en in-
cidens^ & en details , pour donner lieu à des deferip-
tions étendues & à de longues feenes.
Ou l’intérêt du conte eft dans un trait qui doit le
terminer ; alors il faut aller au but le plus vite qu’il
eft poffible : c’etoit la maniéré de Fontenelle : il racontait,
par exemple, que dans une émeute de la
ville de Rouen, voyant du mouvement parmi le
peuple, il avoit demandé à des femmes qui filoient
devant leurs maifons, ce que c’était que ce tumulte,
&que l’une d’elles lui avoittranquillement répondu :
Tome II,
C O N 569
’c eft que ûous nous révoltons. Le trait qui termine cette
efpece de conte, doit être comme tin grain de fel,
piquant 6c fin : un conte de cetre efpece, qui n’a point
f e mot , e ft ce qu’il y a de plus infipide. '
Ou l’intérêt da conte eft difn's lé noeud & le dénouement
d’uné aârion comic/ûé ; alors le plus ou le
ritains d’étendue dont il eft fufceptible, dépend des
details qu’ü exige ; & le s réglés en font les mêmes
qùè celles de l’épopée : le conteur doit décrire &c
peindre , rendre préfens aux yeux de l’efprit le lieu
de la feene, la pantômime, lés moeurs & le tableau
de l’attion ; mais dans le choix de tces détails , il né
doit s’attacher qu’à ce qui intéreffe ou la vraifem-
blance ou la curiofité. On reproche à là Fontaine un
peu de longueur dans fes contés.
Lé conteur fait àüffi , comme dans l ’ép'ôpée, lé
pérfoiinage de fpeaateur , & il mêle fes réflexions
&C fes feritimens.aù récit de la feene ; mais ce qu’il y
met du fien doit être naturel &c ingénieux : avec cela
même le récit ne laifferoit pas de languir, fi les réflexions
étaient trop longues ou trop fréquentes.
Le càra&ere dufabulifte eft la naïveté, parce qu’il
raconte des chôfesdontle merveilleux exige toute la
crédulité d’un homme fimple, ou plutôt d’un enfant.
Je Te fais voir dans l’article F a b l e . Le fujet du conte
ne fuppofe pas la même fimplicité de cara&ere ; le
conte eft donc plus fufceptible que l’apologue des apparences
du badinage, de la fîneffe & de la malice.
La partie la plus piquante du conte, ce font les
feenes dialoguées ; mais dans le dialogue preffé , les
dit-il Sc dit-elle revenoient à chaque répliqué : c’était
un obftacle importun, qu’on a trolivé moyen de lever
par une pon&uation nouvelle.
L’unité n’eft pas auffi févérement preferite au conte
qu’à la comédie ; il a fur elle à cet égard le même
avantage que l’épopée fur la tragédie : je veux dire
que l’aftion n’ eft pas obligée d’être auffi fimple , &
qu’elle n’eft pas aue'rvië aux unités de lieu & de tems.
Mais un récit qui ne ferôit qu’urt enchaînement d’aventures
, fans cette tèhdàncë commune qui lés réunit en
un point Sc les réduit à l’Unité; ce récit feroit un roman
& ne feroit pas un conte. L’aétion du conte de
Jocohde, &,de celui de la Fiancée du roi de Garbe ,
réffemble en petit à I’a&ion de l’Odyffée ; & quant
à la moralité, quoiqu’on h’en faffe pas aii conte une
loi rigoureufe, il doit pourtant, comme la comédie ,
avoir fon but, s’y diriger comme elle , & comme
elle y atteindre : rien ne le diipènfe d’être amufant,
rien ne l’empêche d’être utile ; il n’eft parfait qu’au-
tant qu’il eft à là fois plàifânt Sc moral ; il s’avilit s’il
eft obfcene.
Màrot, pour là naïveté, fut le modèle de la Fontaine
; mais après la Fontaine , qui eft le premier de
nos conteurs en vers, comme le premier de nos fâ-
buliftes , il n’ën refté aucun à citer ; tous en ont
imité ce qu’il y avoit de plus facile , la négligence
& la licence ; mais aucun h’en a eu là grâce, lapré-
cieufe facilité, le naturel ingénieux : un feul hom-
mè eft peut-être fupériéur à lui en ce genre, c’eft
I’Ariofte , parce qu’il a plus dé chaleur , de coloris,
Sc d’abondance, & qù’â l’invention des détails, qui
eft celle de la Fontaine, il joint l’invention des fujets.
Le Taffe, dans un genre moins piquant , maisplein
de délicateffe, nous a laiffé un modelé parfait de
l’art de conter, dans une fcéné de l’Aminte : on
entend bien que je parle de l'aventuré de C abeille.
Boccace a été le modèle des Italiens dans les
contes en profe , comme I’Afiofté dans les contes en
vers ; le cara&ere de Boccace ëft J’élegance, la fimplicité
,Te naturel & lé cômiqiiè. Rabelais eft auffi
plaifant &bien plus joyeux que Boccace. Platon di-
foit qu’en voyant D iogene, il crôÿoit voir Socrate
devenu fou. En lifant Rabelais, on croit voir un
plfilofophe dans l’ivreflè. Les Anglôis ont auffi leur
C C c c