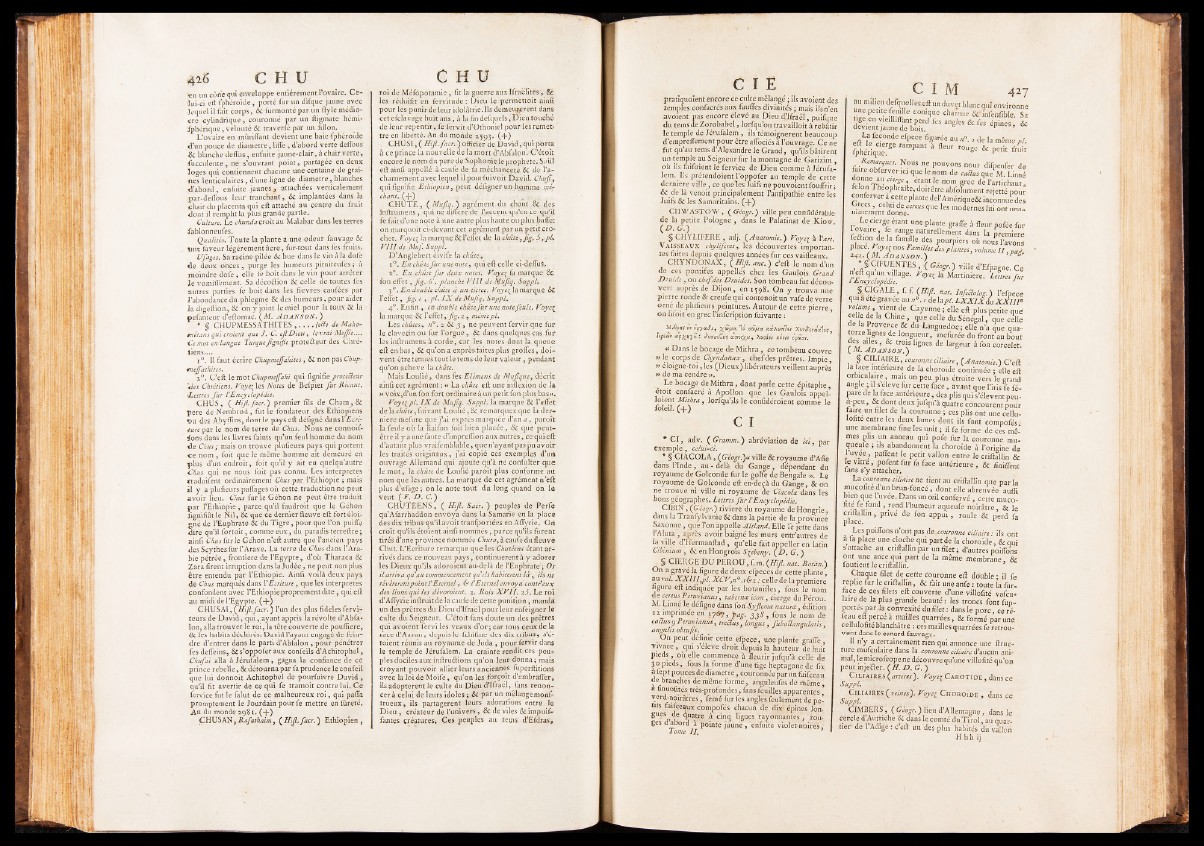
«n un cône qui enveloppe entièrement l’ovaire. Ce -
-lui-ci ell fphéroïde, porté fur un difque jaune ayéc
•lequel il fait corps, ôc furmonté par un flyle médiocre
cylindrique , couronné par un ftigmate hemi-
Jphérique, velouté & traverfé par un lillon.
L’ovaire en muriffant devient une baie -fphéroïde
<l’un pouce de diamètre, liffe-, d’abord verte deffous
& blanche deffus, enfuite jaune-clair, à chair verte,
fucculente, ne s’ouvrant point, partagée en deux
loges qui contiennent chacune une centaine de graines
lenticulaires , d’une ligne de diamètre, blanches
d ’abord, enfuite jaunes > attachées verticalement
par-deffous leur tranchant, & implantées dans la
chair du placenta qui eft attaché au centre du fruit
dont il remplit la plus grande partie.
Culture Le chunda croît au Malabar dans les terres
fablonneufes.
Qualités. Toute la plante a une odeur fauvage &
une faveur légèrement âcre, fur-tout dansfes fruits.
Ufagts. Sa racine pilée & bue dans le vin a la dofe
de deux onces, purge les humeurs pituiteufes ; à
moindre dofe , elle le boit dans le vin pour arrêter
le vomilfement. Sa décoûion & celle de toutes fes
autres parties fe boit dans les fievrescaufées par
l ’abondance du phlegme & des humeurs, pour aider
la dioeftion, & on y joint le miel pour la toux & la
pefanteur d’eltomac. ( M. A d a n s o n . )
* § CHUPMESSATHITES , . . . .fecle de Maho-
tn écarts qui croient que J. C. ejl Dieu, livrai Mcjfit.-...
Ce mot en langue Turque fignifie protecteur des Chrétiens....
i° . Il faut écrire Chupmejjahites, & non pas Chup-
meffathites.
x°. C’eft le mot Chupmejfahi qui fignifie protecle.ùr
'■ des Chrétiens. Voye\ les Notes de Befpier fur Rie au t.
•Lettres fur ü Encyclopédie-.
CHUS, ( Hi.fi.facr.) premier fils de C h am ,&
pere de Nembrod, fut le fondateur des Ethiopiens
ou des Abylïins, dont le pays eft défigné dans YEcrfi
iture par le nom de terre de Chus. Nous ne connoif-
fons dans les livres faints qu’un feul homme du nom
de Chus ; mais on trouve plufieurs pays qui portent
ce nom , foit que le même homme ait demeuré en
plus d’un endroit, foit qu’il y ait eu quelqu’autre
Chus qui ne nous foit pas connu. L'es interprètes
ti-aduifent ordinairement Chus par l’Ethiopie ; mais
i l y a plufieurs paffages où cette tradudion,ne peut
avoir lieu. Chus fur le Géhon ne peut être traduit
par l’Ethiopie, parce qu’il faudroit que le Géhon
lignifiât le N il, & que ce dernier fleuve eft fort éloigné
de l’Euphrate & du T ig re, pour que l’on puiffe
dire qu’il fortoit, comme eux, du paradis terreftre ;
ainfi Chus fur le Géhon n’eft autre que l’ancien pays
des Scythes fur l’Araxe. La terre de Chus dans l’Arabie
pétrée, frontière de l’Egypte, d’où Tharaca &
Zara firent irruption dans la Judée, ne peut non plus
être entendu par l’Ethiopie. Ainfi voilà deux pays
de Chus marqués dans Y Ecriture, que les interprètes
confondent avec l’Ethiopie proprement dite, qui eft
au midi de l’Egypte. (+ )
CHUSAl, ( Hijl.facr. ) l’un des plus fideles fervi-
teurs de David, qui, ayant appris la révolte d’Abfa*
Ion, alla trouver le roi, la tête couverte de poufliere,
& les habits déchirés. David l’ayant engagé de feindre
d’entrer dans le parti d’Abfalon , pour pénétrer
fes deffeins, & s ’oppofer aux confeils d’Achitophel,
Chufaï alla à Jérufalem, gagna la confiance de ce
prince rebelle ,& détourna par fa prudence le confeil
que lui donnoit Achitophel de pourfuivre David ,
qu’il fit avertir de ce qui fe tramoit contre lui. Ce
fervice fut le falut de ce malheureux ro i, qui paffa
promptement le Jourdain pour fe mettre en fureté.
An du monde 1981. (+ )
CHUSAN, Rafathaim, ( H i j l . f a c r Ethiopien,
roi de Méfôpotamie, fit la guerre aux Ifraëlïté's’, Sè
les réduifit en fervitude : Dieu le permettoit ainfi
pour les punir de leur idolâtrie. Ils demeui/srent dans
cet efclavage huit ans, à la fin defquels,’ Dieu touché
de leur repentir, fe fervit d’Othoniel pour les remet*
tre en liberté. An du monde 2593. (+ )
CHU SI, ( Hijl.facr. ) officier de David, qui porta
à ce prince la nouvelle de la mort d’Abfalpn.'C’étoit
encore le nom-du pere de'Sophonieie prçphete; §aül
eft ainfi appellé à caufe de fa méchanceté & de l’acharnement
avec lequel il pourfuivoit Dayid;. Chufi,
qui fignifie Ethiopien, peut défigner un hojnmô: r\ié-
chant. (+.) . ,-i j i ' • r ,
CH U T E , ( Mufîq. ) agrément du chant Sc des
inftrumens, qui ne différé de l’accent qu’en ce qu'il
fe fait d’une note à une autre plus haute ou plus baffe:
on marquoit ci-devant cet agrément par un peti.t crochet.
Voyez la marque & l’effet de la chute-, fig, S ,p L
F 1I I de Muf Suppl. ï
D ’Anglebert divife la chute,
i° . En chiite fur une,note, qui eft celle ci-defluà.
2°. En chiite fur deux notes. Voyez fa marque ÔC
fon effet, fig. G. planche VIII de ty.ufiq, Suppl:
30, En double ckûte à un-tierce. Voyez la marque $£
l’effet, fig. 1 , pl. I X de M uf q. Suppl.
. 40. Enfin , en double chuteJ'ur une note feule. Voyez
la marque 6c l’effet, fig. z , même p l.
Les chûtes, n°. 2 & 3 ne peuvent fervir que fur
le clavecin ou fur l’orgue , & dans quelques cas fur
les inftrumens à corde, car les notes dont la queue
eft en bas, & qu’on a exprès-faites plus groffes, doivent
être tenues tout le tems de leur valeur, pendant
qu’on achevé la chute.
Mais Loulié, dansfes Elémens de M u f que, décrit
ainfi cet agrément : « La chute eft une inflexion de la
>> voix,d’un fon fort ordinaire à un petit fon plus bas».
Foye^pl. IX de Mufq. Suppl, la marque & l’effet
de la chute, fuivant Loulié, &. remarquez que la der-^
niere mefure que j’ai exprès marquée d’un a , paroît
la feule où la liailon foit bien placée, & que peut-
être il y a une faute d’imprefîion aux autres, ce qui eft
d’autant plus vraifemblable, que n’ayant pas pu avoir
les traités originaux, j’ai copié cés exemples d’un
ouvrage Allemand qui ajoute qu’à ne confulter que
le mot, la chute de Loulié paroît plus conforme ait
nom que les autres. La marque de cet agrément n’eft
plus d’ufage ; on le note tout du long quand on le
veut (F . D . C.y
CHUTÉENS, ( Hifi. Sacr. ) peuples de Perfe
qu’Afarrhaddon envoya dans -la Samarie en la place
des dix tribus qu’il avoit transportées en Aflyrie. On
croit qu’ils étôient ainfi nommés, parce qu’ils1 furent
tirés d’une province nommée Chuta, à caufe du fleuve
Chut. L’Ecriture remarque que les Chutéens étant ar*
rivés dans ce nouveau pays, continuèrent à y adorer
les Dieux qu’ils adoroient au-delà de l’Euphrate ; Of
il arriva qui au commencement qu’ils habitèrent la-, ils rte
révérèrent point l'Eternel, & L'Eternel envoya contreux
des lions qui les dévoraient. 2. Rois X V I I . z 5. Le roi
d’Affyrieinftruitde la caufe de cette punition, mandà
un des prêtres du Dieu d’Ifraël pour leur enfeigner le
culte du Seigneur. C’étoit fans doute un des prêtres
qui avoient fervi les veaux d’or; car tous ceux de la
raced’Aaron, depuis lé fchifme des dix tribus, . s’é?
toient réunis au royaume de Juda , pour fervir dans
le temple de Jérufalem. La crainte rendit ces peu*
pies dociles aux inftruéfions qu’on leur donna; mais
croyant pouvoir allier leurs anciennes fuperftitions
avec la loi de Moïfe, qu’on les forçoit d’embraffer,
ils adoptèrent le culte du Dieu d’Ifraël, fans renoncer
à celui de leurs idoles ; & par un mélange monf-
trueux, ils partagèrent leurs adorations entre le
Dieu , créateur de l’univers, & de viles & impuif-
famés créatures, Ces peuples au tems d’Efdras,
pratïquûient encore ce culte mélangé ; ils avoient des
temples confacrés aux fauffes divinités ; mais ils n’en
avoient pas encore élevé au Dieu d’Ifraël, puifque
du tems de Zorobabel, lorfqu’on travailloit à rebâtir
le temple de Jérufalem , ils témoignèrent beaucoup
d’empreffement pour être affociés à l’ouvrage. Ce ne
fut qu’au tems d’Alexandre le Grand, qu’ils bâtirent
un temple au Seigneur fur la montagne dé Garizim ,
où ils faifoient le fervice de Dieu comme à Jérufalem.
Ils prétendoient l’oppofer au temple de cette
derniere v ille , ce queles Juifs ne pouvoientfouffrir;
& de là venoit principalement l’antipathie entre les
Juifs & les Samaritains. (+ )
CHWASTOW, ( Géogr.") ville peu confidérable
de la petite Pologne , dans le Palatinat de Kiow
Ü
§ CHYLIFERE , adj. ( Anatomie. ) Voye^k Y art.
V aisseaux chylifères, les découvertes importantes
faites depuis quelques années fur ces vaiffeaux.
CHYNDONAX, ( Hifi. anc. ) c'eft le nom d’un :
de ces pontifes appelles chez les Gaulois Grand ,
Druide ,011 chef des Druides. Son tombeau fut découvert
auprès de Dijon, en 1598. On y trouva une
pierre ronde & creufe qui contenoit un vafe de verre 1
orné de plufieurs peintures. Autour de cette pierre
on lifoit en grec l’infeription fuivante :
M/ôpi? t y opya.S'i, % truffa zciXvtHu XvvS'ovditJoç,
itfiuv ap^uyts : JWotCjfç ami%u, Aunoi v.ôviv cpSa-i.
« Dans le bocage de Mithra, ce tombeau couvre
» le corps de Chyndonax, chef des prêtres. Impie,
» éloigne-toi, les (Dieux) libérateurs veillent auprès
» de ma cendre ».
Le bocage de Mithrà, dont parle cette épitaphe,
étoit confacré à Apollon que les Gaulois appel-
loient Mithra, lorfqu’ils le confidéroient comme le
foleil. (+ )
C I
* C I , adv. ( Gramm. ) abréviation de ici, par
exemple, celui-ci.
* § C IA CO LA , (Géogr.}« ville & royaume d’Afie
dans l’Inde , au - delà du Gange, dépendant du
royaume de Golconde fur le golfe de Bengale ». Le
royaume de^ Golconde eft en-deçà du Gange, & on j
ne trouve ni ville ni royaume de Ciacola dans les
bons géographes. Lettres fur VEncyclopédie.
CIBIN, (Geogr.) riviere du royaume de Hongrie, !
dans la Tranfylvanie & dans la pàrtie de la province :
Saxonne, que l’on appelle Altland. Elle ïè jette dans •
l’Aluta , après avoir baigné les murs entr’autres de
la ville d’Hermanftad, qu’elle fait appeller en latin j
Cibiniïim, & en Hortgrùis S^ebeny. (D . G .)
§ CIERGE DU PEROU, f.m. (Hifi. nat. Botdn.)
On a gravé la figure de deux efpeces de cette plante,
vol. XXIII,p l. XCV,n°.i&2 : celle de la première
figure eft indiquée par les botaniftes, fous le nom
de cereus Peruvianus, tabernee icon, cierge du Pérou.
M. Linné le defigne dans fon/Syfiema naturte, édition
12 imprimée en 1767, fiag. 3 3 8 , fous le nom de I
cactus9 P eruvianus, erectus , longus, fuboclangularis,
angulis obtufis.
_ On peut définir cette efpeçe, une plante gràffe,
vivace , qui s’élève droit depuis la hauteur de huit
pieds, où elle .commence à fleurir jufqu’à celle de
30 pieds, .fous la forme d’une tige heptagone de fix
à fept pouces de diamètre _, couronnée par un faifeeau
de branches de même forme, anguleufes de même,
à finuofités très-profondes; fansjfeuillesapparentes,
yerd-noirâtres, femé fur fes angles feulement de petits
faifeeaux dompofés chacun de dix- épines lon-
gues_ de quatre à cinq lignes rayonnantes , .rouges
d abord à pointe jaune, 'enfuite violét-nbifés,-
Tome II.
au milieu defquelles.eft un duvet blanc qui environne
une petite femlle'conique charnue & ' infenfible. Sa
d e ^ iem iL : tntb | ï d ^ & f “ éP” eS > &
eftL? / e-°nde efPece % lréu au n?. 2 de la même PU
fphirique ® ramPant 4 fle“ r f ° “ 8e & Petit
Nous ne pouvons nous difpenfer de
rair.e.obferver ici que le nom de caiïus qae M. Linné
ej antJenom grec de l’artichaut.
félon Theophrafle, doit être abfolument rejette pour
conferver à ce tte plante del’Amérique& inconnue des
ecs ’ cel“ ‘ de cereus que les modernes lui ont unanimement
donné.
B D étant unê plante graffe j fleur pofée fur
W S S m ™ g e naturellement dans là première
i f lf c f f a famp e 1 P °urPiers 0« nous l'avons
place, royei nos Familles des plantes, volume I I , H
242. (M, A d anson.} S*
WB| B | | B 1 W Ê ) Ville d’Efpagne. Ce
n eft qu im village, la Martiniere. Leceres fur
L Jtncyclopedte. . J
^ C IG A L E , f. f. (Hifi. nat. IhfectoLog. ) l’efpece
qui a ete gravée au n°. 1 de la pl. LXXlXàw X X H P 5
vient de Cayenne ; elle eft plus petite quë
celle de la Chine, que celle du Sénégal / q u e celle
de la Provence & du Languedoc; eïle n^a que quatorze
lignes de longueur, mefurée du front au bout
? e.s, a“ es » & ljgnes de largeur à fon corcelet.
(M . A d a n so n .}
§ CILIAIRE, epuronne ciliaire, (Anatomie.) C ’eft
la face inteneure||êvlg choroïde continuée ; elle eft
orbiculaire, mais un peu plus étroite vers le grand
angle ; il s’eleve fur cette face, avant que l’iris fe fé-
pare de la face intérieure, des plis qui s’élèvent peu-
a-peu, & dont deux jufqu’à quatre concourent pour
faire un filet de la couronne ; c es plis ont une cellu-
lofite entre les deux lames dont ils font compofés^
une membrane fine les unit ; il fe forme de ces mêmes
phs un anneau qui pofe fur la couronne mu-
queufe ; ils abandonnent la choroïde à l’origine de
1 «vye , paffent le petit vallon entre le criftallin &
le vitre, pofent fur fà face antérieure, & finiffenr
fans s y attacher.
la couronne ciliaire rie tient au criftallin que parla
mucofited’un brun-foncé, dont elle abreuvée auffi
bien que 1 uvee. Dans un oeil confqryé, cette muco.
fité fe fond , rend l’humeur aqueufe noirâtre & le
criftallin , privé de fon appui, roule & perd fa
placé. r
Les poiflons n’ont pas de,coqmnnc ciliaire ■ ils ont
à fa place une cloche qui part de la choroïde, & qui :
s attache au criftallin par un filet ; dfautres poiflons
ont une ance qui part de la même membrane, &
fouttent le criftallin.
Chaque filet de cette Couronne efï double ; il fe
replie fur le eriftallïn, & fait une anfe : toute la fur-
face .de ces filets eft couverte d’une villofité vafeu.
latre de là plus grande beauté : les troncs foht fup-
portes p a fjà cCnvexité du filet : dans le porc, ce ré-
feaueftpetcéà mailles quarrées, & formé parunê
cellulofite blanchâtre : ées mailles quatre es fe retrouvent
dans le canard fauvage.
Il n y a certainement rien qui annonce une ftruc-
ture mufculaire dans la couronne ciliaire d’aucun animal,
le microfcope ne découvre qu’une villofité qu’oa
peyt inje'ftef. (H. D . G. )
C iliaires (arteres}. Voyez Carot id e , dans ce
Suppiç . t
C iliaires (veines). Voyez C horoïde , dans ce
Suppl.
CIMBERS, ( Geogr. ) lieu d’Allemagne, dans le
cercle ^’Autriche & daps le comté du Tirol, au quartier
de TAdige : c’èft un dés plus habités dit vallon
H hh ij