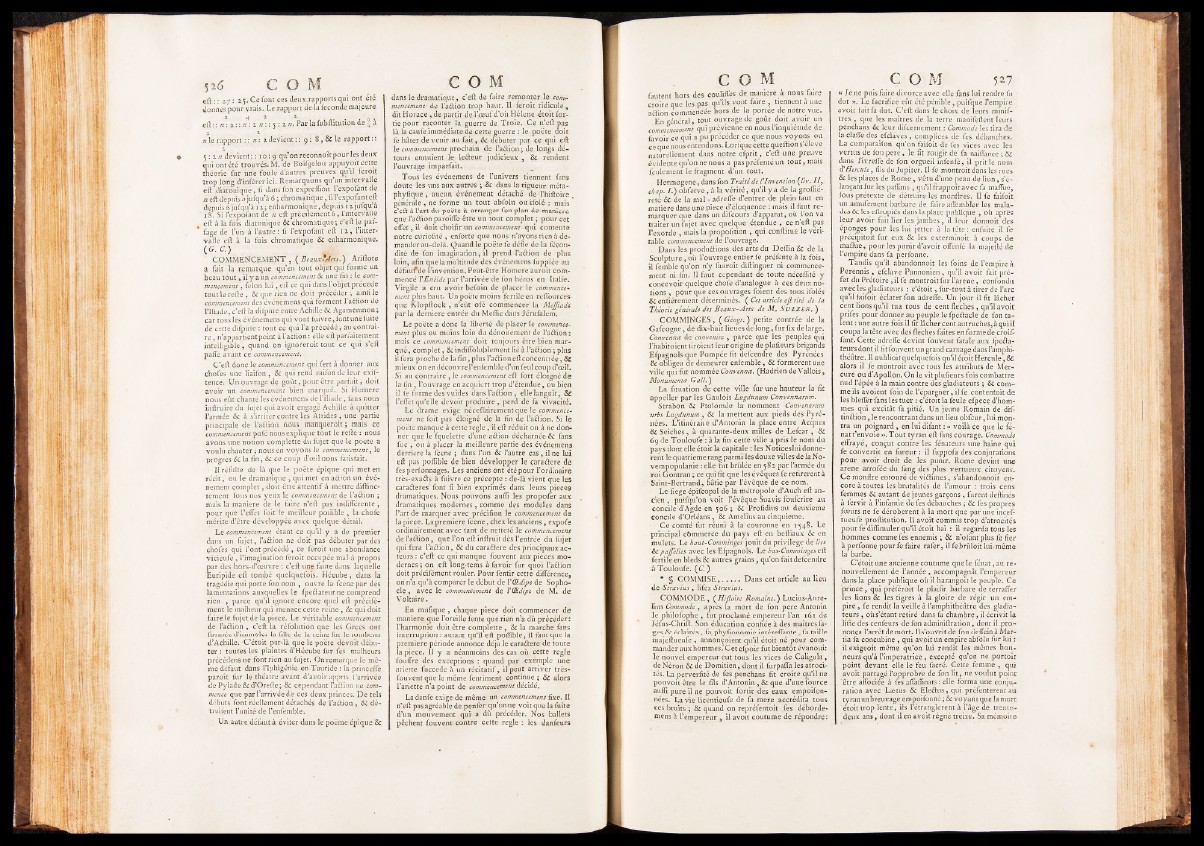
eft : : 27: 25. Ce font ces deux/apports qui ont été
donné? pour vrais. Le rapport de la fécondé majeure
2 4 a 2 t '
eft : : n : 2 : : n : 2 « : : 5 : 2 «. Par la fubftitution de J a
».le rapport : : n : 2 devient : : 9 : 8 , & lé rapport : ;
O 5 : 2 n devient : : 16 : ç> qu’on reconnoît pour les deux
qui ont été trouvés. M. dé Boifgelou appuyoit cette
théorie fur une foule d’autres preuves.qu’il feroit
trop long d’inférer ici. Remarquons qu’un intervalle
eft .diatonique, fi dans fon expreffion l’expofant de
n eft d'epuis ojuiqu’à 6 ; chromatique, fi l’expofanteft
depuis ô.julqu’à 12; enharmonique, depuis 12 jirfqu’à
18. Si l’expofant de n eft préeifémentô, l’intervalle
eft à la fois diatonique Si chromatique ; c’eft le pat-
* fage de l’un à l’autre: fi l’expofant eft 12 , l’inter-
vâilé eft à la fois chromatique Si enharmonique.
c e . m
COMMENCEMENT , ( Beaux-Arts.) Ariftote
a fait la remarque qu’en tout objet qui forme un
beau .tout, il y a un commencement & une fin : le commencement
félon lu i, elï ce qui dans l’objet précédé
tout le refte , & ‘que rien ne doit précéder; ainfile
commencement des ëvénèmens qui forment l ’attion de
l’Iliade, c’eft la dilpute entre Achille Si Agamemnqn ;
car tous les événemens qui vont fuivre, font une fuite
de cette difpute : tout ce qui l’a précédé, au contraire
, n’appàrtientpoint à l ’aâion: elle eft parfaitement
intelligible , quand on ignoreroit tout ce qui s’eft
paffé avant ce commencement,
C ’eft donc le commencement qui fert à donner aux
chofes une liaifon , & qui rend raifon de leur existence.
Un ouvrage de goût, pour être parfait, doit
avoir un commencement bien marqué. Si Homere
nous eût chanté les événemens de l’Iliade, fans nous
inftruire du fujet qui avoit engagé Achille à quitter
l’armée Si à s’irriter contre les Atrides , une partie
principale de TattiQn nous manqueroit ; mais ce
commencement pofé nous explique tout le refte : nous
avons une notion complette du fujet que le poète a
voulu chanter ; nous en voyons le commencement, le
progrès Si la fin, Si ce coup d’oeil nous fatisfait.
Il réfulte de là que le poète épique qui met en
récit, ou le dramatique , qui met en aclion un événement
complet, doit être attentif à mettre diftinc-
tement fous nos yeux le commencement de l’action ;
mais la maniéré de le faire n’eft pas indifférente,
pour que l’ effet foit le meilleur pofiible , la chofe
mérite d’être développée avec quelque détail.
Le commencement étant ce qu’il y a de premier
dans un fujet, l’aftion ne doit pas débuter par des
chofes qui l’ont précédé, ce feroit une abondance
vicieufe , l’imagination feroit occupée mal-à-propos
par des hors-d’oeuvre : c’eft une faute dans laquelle
Euripide eft tombé quelquefois. Hécube, dans la
tragédie qui porte fon nom , ouvre la fcene par des
lamentations auxquelles le fpeâateur ne comprend
r-ien , parce qu’il ignore encore quel eft précifé-
ment le malheur qui menace cette reine, Si qui doit
faire le fujet de la piece. Le véritable commencement
de l’adion , c’eft la réfolution que les Grecs ont
formée d’immoler la fille de la reine fur le tombeau
d’Achille. C ’étoit par-là que le poète devoit débuter
: toutes les plaintes d’Hécube fur fes malheurs
précédens ne font rien au fujet. On remarque le même
défaut dans l’Iphigénie en Tauride : la princeffe
paroît fur le théâtre avant d’ayoir appris l’arrivée
de Pylade Scd’Orefte; & cependant l’adion ne commence
que par l’arrivée de ces deux princes. De tels
débuts font réellement détachés de l’adion , Si dé-
truilent l’unité de l’enfemble.
Un autre défaut à éviter dans le poème épique Si
dans le dramatique , .c’eft de faire remonter, le corn*
mencement de l’aéfion trop haut. Il feroit ridicule ,
dit Horace , de partir .ded’oeuf d’où Hélène étoit for-
tie pour' raconter la guerre de Troie. Ce n’eft pas
là la caufe immédia,te-dg'cette guerre : le poète doit
fe hâter devenir au fa it,:Si débuter îpar,-ce qui eft
le commencement prochain de l’aftion ; de. longs détours
ennuient le; le&eur judicieux , Si- rendent
l’ouvrage imparfait.;
Tous les événemens de l’univers tiennent fans
douté les uns aux autres ; Si dans la rigueur méta-
phyfiqué, aucun événement détaché de Thiftoire .
générale, ne forme un tout abfolu ouâfolé : mais
c’eft à l’art du poète à arranger fon plan de-maniéré
que l’aéfion paroiffe être un tout complet ; pour cet
effet, il doit choifir un commencement qui contenté
notre curiofité , enforte que nous n’ayons rien à demander
au-delà. Quand le poète fe défie de la fécondité
de fon imagination, il prend l’aéfion de plus
loin, afin que la multitude des événemens fupplée au
défaufde l’invention. Peut-être Homere auroit commencé
¥ Enéide par l’arrivée de fon héros en Italie.
Virgile a cru avoir befoin de placer le commencement
plus haut. Un poète moins fertile en reffources
que Klopftock , n’eût ofé commencer la MeJJîade
parla derniere entrée du Meflie dans Jérufalem.
Le poète a donc la liberté de placer le commencement
plus ou moins loin du dénouement de l’attioti:
mais ce commencement doit toujours être bien marqué,
complet, Si indiffolublement lié à l’aftion ; plus
il fera proche de la fin, plus l’âftion eft concentrée, Sc
mieux on en découvre l’enfemble d’un feul coup d’oeil.
n Si au contraire , le commencement eft fort éloigné de
la fin , l’ouvrage en acquiert trop d’étendue, ou bien
il ie forme des vuides dansl’aftion , elle languit, SC
l’effet qu’elle devoit produire , perd de fa vivacité.
Le drame exige néceffairementque le commencement
ne foit pas éloigné de la fin de l’aélion. Si le
poète manque à cette réglé, ‘il eft réduit ou à ne donner
que le fquelette d’une<a&ion décharnée Si fans
fuc , ou à placer la meilleure partie des événemens
derrière la fcene ; dans l’un & l’autre cas, il ne lui
eft pas poflible de bien développer le cara&ere de
fes perfonnages. Les anciens ont été pour l’ordinaire
très-exa&s à fuivre ce précepte : de-là vient que les
cara&eres' font fi bien exprimés dans leurs pièces
dramatiques. Nous pouvons aufli les propofer aux
dramatiques modernes, comme dçs modèles dans
l’art de marquer avec précifion le commencement de
la piece. La première fcene, chez les anciens, expofè
ordinairement avec tant de netteté le commencement
de l’aâ ion, que l’on eft inftruit dès l’entrée du fujet
qui fera l’aclion, Si du caraftere des principaux acteurs
: c’eft ce qui manque fou vent aux pièces modernes
; on eft long-tems à favoir fur quoi l’a&ion
doit précifément rouler. Pour fentir cette différence,
on n’a qu’à comparer le début de VOEdipe de Sophocle
, avec le commencement de YOEdip'e de M. de
Voltaire.
En miifique , chaque piece doit commencer dé
maniéré que l’oreille fente que rien n’a dû précéder:
l’harmonie doit être complette , Si la marche fans
interruption : autant qu’il eft poflible, il faut que la
première période annonce déjà le cara&ere de toute
la piece. Il y a néanmoins des cas où cette réglé
fouffre des exceptions : quand par exémple une
ariette fuccede à un récitatif, il peut arriver très-
fouvent que le même fentiment continue ; Si alors
l’ariette n’a point de commencement A icidé.
La danfe exige de même un commencement fixe. Il
n’eft pas agréable de penfer qu’on ne voit que la fuite
d’un mouvement qui a dû précéder. Nos ballets
pêchent fouvent contre cette réglé : les danfeurs
fautent hors des couliffes de maniéré à nous faire
croire que les pas qu’ils vont faire. ^ tiennent à une
aàion commencée hors de la portée de notre vue.
En général, tout ouvrage de goût doit avoir un
commencement qui prévienne en nous l’inquiétude de
favoir ce qui a pu précéder ce que nous voyons ou
ce que nous entendons. Lorfque cette queftion s’élève
naturellement dans notre efprit, c’eft une preuve
évidente qu’on ne nous a pas préfenté un tout, mais
feulement le fragment d’un tout.
Hermogene, dans fon Traité de L'Invention \liv. //,
chap. /.) obferve, à la v érité, qu’il y a de la groffié-
reté Si de la mal - adreffe d’entrer de plein làut en
matière dans une piece d’éloquence : mais il faut remarquer
que dans un difeours d’apparat, où l’on va
traiter un fujet avec quelque étendue , ce n’eft ças
l ’exorde , mais la propofition , qui conftitue le véritable
commencement de l’ouvrage.
. Dans les produ&ions des arts du Deflin & de la
Sculpture ,011 l’ouvrage entier fe préfente à la fois,
il femble qu’on n’y fauroit diftinguer ni commencement
ni fin. Il faut cependant de toute néceflité y
concevoir quelque chofe d’analogue à ces deux notions
, pôur que ces ouvrages foient des tous ifolés,
& entièrement déterminés. ( Cet article ejl tiré de La
Théorie générale des Beaux-Arts de M. SüLZER. )
COMMINGES , ( Géogr. ) petite contrée de la
Gafcogne, de dix-huit lieues de long, fur fix de large.
Convennce de convenire , parce que les peuples qui
l’habitoienttiroient leur origine de plufieurs brigands
Efpagnols que Pompée fit defeendre des Pyrénées
& obligea de demeurer enfemble, Si formèrent une
ville qui fut nommée Convennce. (Hadrien de Vallois,
Monùmenta G ail. )
• La fituation de cette ville fur une hauteur la fit
appeller par les Gaulois Lugdunum Convennarum.
Strabon Si Ptolomée la nomment Convenarùm
iirbs Lugdunum , Si la mettent aux pieds des Pyrénées.
L’itinéraire d’Antonin la place entre Acques
& Seiches, à quarante-deux milles de Lefcar , &
6 a de Touloufe : à la fin cette ville a pris le nom du
pays dont elle étoit la capitale : les Notices lui donnèrent
le quatrième rang parmi les douze villes de la No-
vempopulanie : elle fut brûlée en 582 par l’armée du
-roi Gontran ; ce qui fit que les évêques fe retirèrent à
Saint-Bertrand, bâtie par l’évêque de ce nom.
Le fiege épifcopal de la métropole d’Auch eft ancien
, puifqu’on voit l’évêque Suavis fouferire au
concile d’Agde en 506 ; & Profidius au deuxieme
concile d’Orléans, Si Amelius au cinquième.
■ Ce comté fut réuni à la-couronne en 1548. Le
principal commerce du pays eft en beftiaux & en
mulets. Le haut-Comminges jouit du privilège de lies
Si pa(felies avec lès Efpagnols. Le bas-Comminges eft
fertile en bleds & autres grains, qu’on fait defeendre
•à Touloufe. (C. )
* § COMMISE,.........Dans cet article au lieu
de Stravius, lifez Struvius.
COMMODE, ( Hijloire Romaine.) Lucius-Aure-
lius Commode , après la mort de fon pere Antonin
’le philofophe , fut proclamé empereur l’an 161 de
Jéfus-Chrift. Son éducation confiée à des maîtres fa-
.ges & éclairés, farphyfionomie intéreffante, fa taille
.majeftuCufe , annonçoient qu’il étoit né pour commander
auxhommes.'Cetefpoir fut bientôt évanoui:
le nouvel empereur eut tous les vices de Caligula,
de Néron & de Domitien, dont il furpaffa les atrocités.
La perverfité de fes pençhans fit croire qu’il ne
pouvoit être le fils d’Antonin , & que d’une fource
aufli pure il ne pouvoit fortir des eaux empoifon-
nées. La vie licentieufe de fa mere accrédita tous
ces bruits ; St quand on repréfentoit fes déborde-
mens à l’ empereur , il avoit coutume de répondre:
« Je ne puis faire divorce avec elle fans lui rendre fa
dot ». Le facrifice eût été pénible, puifque l’empire
avoit fait fa dot. C ’eft dans le choix de leurs minif*
très , que les maîtres de la terre manifeftent leurs
pénehans & leur difeernement : Commode les tira de
la claffe des efclaves , complices de fes débauches.
La comparaifon qu’on faifoit de fes vices avec les
vertus de fon pere, le fit rougir de fa naiffance ; &
dans l’ivreffe de fon orgueil infenfé, il prit le nom
à!Hercule, fils du Jupiter. Il fe montroit dans les rues
& les places de Rome, vêtu d’une peau de lion, s’é- .
lançantfur les paffans , qu’il frappoitavec fa maffue,
fous prétexte de détruire les monftres. Il fe faifoit
un amufement barbare de faire affembler les malades
&c les eftropiës dans la place publique , où après
leur avoir fait lier les jambes , il leur donnoit des
éponges pour les lui jetter à la tête : enfuite il fe
précipitoit fur eux & les exterminoit à coups de
maffue, pour les punir d’avoir offenfé la majefté de
l’empire dans fa perfonné.
Tandis qu’il abandonnoit les foins de l’empire à
Perennis , efclave Pannonien, qu’il avoit fait préfet
du Prétoire, il fe montroit fur l’arene, confondu
avec les gladiateurs : c’étoit, fur-tout à tirer de l’arc
qu’il faifoit éclater fon adreffe. Un jour il fit lâcher
cent lions qu’il tua tous de cent fléchés , qu’il avoit
prifes pour donner au peuple le fpeâacle de fon talent
: une autre fois il fit lâcher cent autruches, à qui il
coupa la tête avec des fléchés faites en forme de c ro if
fant. Cette adreffe devint fouvent fatale aux fpe£la-
teursdont il fit fouvent un grand carnage dans l’amphithéâtre.
Il oublioif quelquefois qu’il étoit Hercule, &
alors il fe montroit avec tous les attributs de Mercure
ou d’Apollon. On le vit plufieurs fois combattre
nud l’épée à la main contre des gladiateurs ; Si comme
ils avoient foin de l’épargner, il fe contentoit de
les bleffer fans les tuer : c’étoit la feule efpece d’hommes
qui excitât fa pitié. Un jeune Romain de difi-
tinûion, le rencontrant dans un lieu obfcur, lui montra
un poignard, en lui difant : « voilà ce que le fé-
natt’envoie ».Tout tyran eft fans courage. Commode
effrayé, conçut contre les fénateurs une haine qui
fe convertit en fureur : il fuppofa des conjurations
pour avoir droit de les punir. Rome devint une
àrene arrofée du fang des plus vertueux, citoyens.
Ce monftre entouré de viûimes, s’abandonnoit encore
à toutes les brutalités de l’amour : trois cens
femmes & autant de jeunes garçons , furent deftinés
à fervir à l’infamie de fes débauches ; & fes propres
foeurs ne fe dérobèrent à la mort que par une incef-
tïieufe proftitution. Il avoit commis trop d’atrocités
pour fe diflimuler qu’il étoit haï : il regarda tous les
hommes comme fes ennemis ; & n’ofant plus fe fier
à perfonne pour fe faire rafer, il febrûloitlui-même
la barbe.
C’étoit une ancienne coutume que le fénat, au renouvellement
de l’année , accompagnât l’empereur
dans la place publique où il harangoit le peuple. Ce
prince, qui préféroit le plaifir barbare de terraffer
les lions & les tigres à la gloire de régir un empire
, fe rendit la veille à l’amphithéâtre des gladiateurs
, où s’étant retiré dans fa chambre, il écrivit la
lifte des cenfeurs de fon adminiftration, dont il prononça
l’arrêt de mort. Il s’ouvrit de fon deffein à Maffia
fa concubine , qui avoit un empire abfolu fur lui :
il exigeoit même qu’on lui rendît les mêmes honneurs
qu’à l’imperatrice , excepté qu’on ne portoit
point devant elle le feu facré. Cette femme , qui
avoit partagé l’opprobre de fon lit, ne voulut point
être affociée à fes affaflinats : elle forma une conjuration
avec Lætus & Eleéhis, qu’l préfenterent au
tyran un breuvage empoifonné ; & voyant que la mort
étoit trop lente, ils l’étranglerent à l’âge de trente-
deux ans, dont il en avoit régné treize. Sa mémoire