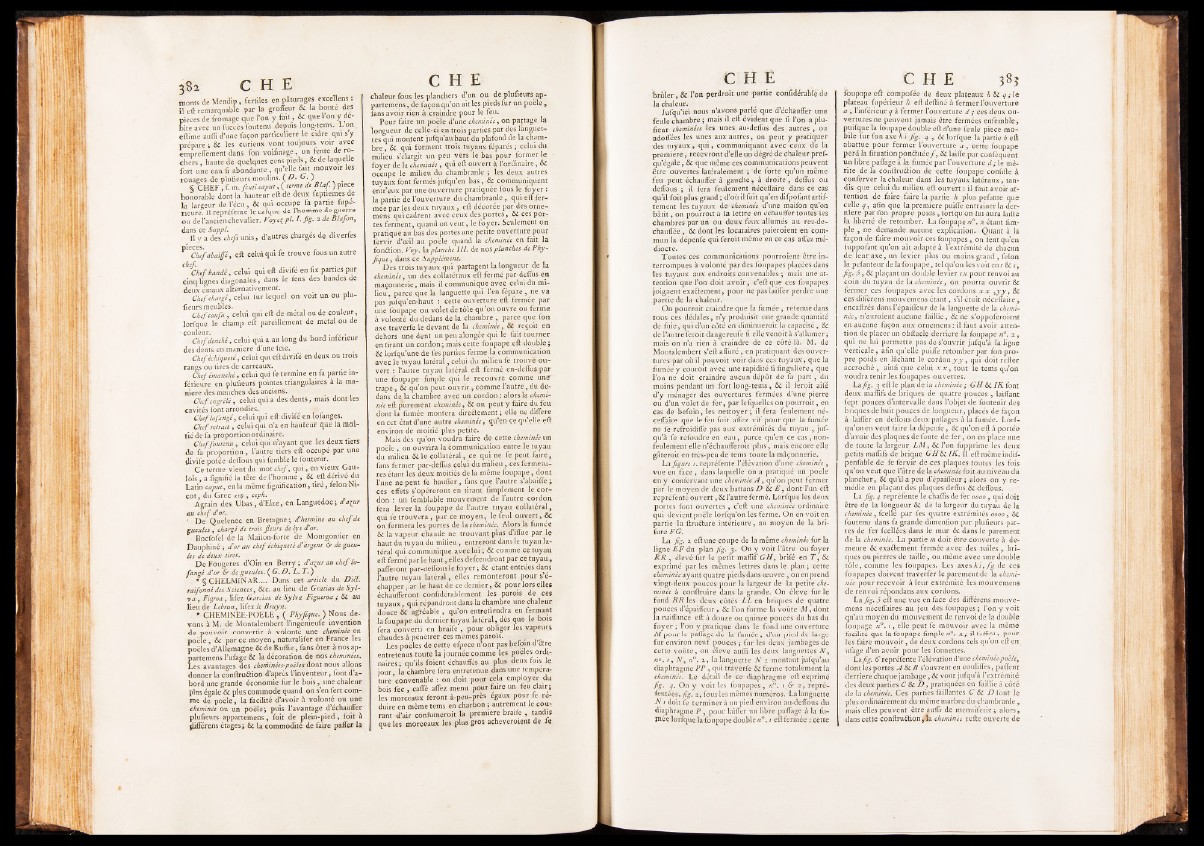
monts de Mend'ip, fertiles en pâturages exceUens I
il eft remarquable par la groffeur 6c la bonté des
pièces de fromage que l’on y fait, & que 1 on y débité
avec un fuccès foutenu depuis long-tems, L o n ,
eftime aufli d’une façon particulière le cidre qui s y
prépare ; 6c les curieux vont toujours voir avec
empreffement dans fon voifinage, un fente de rochers
, haute de quelques cens pieds, & d e laquelle
fort une eau fi abondante , qu’elle fait mouvoir les
rouages de plufieurs moulins. (D . G .) .
S CHEF , f. m. fcuti caput, ( terme de Blaf. ) piece
honorable dont la hauteur eft de deux feptiemes de
la largeur de l’écu, 6c qui occupe fa partie fupé- ■
Heure. Il repréfente le cafque de l’homme de guerre
ou de l’ancien chevalier. Voye^pl. I.fig. z de B Laf on,
dans ce Suppl. , , .
Il y a des chefs unis, d’autres charges de diveries
pièces. I HR
Chef abaiffé, eft celui qui fe trouve fous un autre
Ch Chef bandé, celui qui eft divifé en fix parties par
cinq lignes diagonales, dans le fens des bandes de
deux émaux alternativement. _
Chef chargé, celui fur lequel on voit un ou plufieurs
meubles. , .
Chef coufu, celui qui eft de métal ou de couleur,
lorfque le champ eft pareillement de métal ou de
• couleur. . , , . r , .
Chef denché, celui qui a au long du bord intérieur
des dents en maniéré d’une teie.
Chef échiqueté, celui qui eft divifé en deux ou trois
rangs ou tires de carreaux. .
Chef émanché, celui qui fe termine en fa partie inférieure
en plufieurs pointes triangulaires à la maniéré
des manches des anciens.
Chefengrêlé, celui qui a des dents, mais dont les
cavités font arrondies. 7 «t
Chef Lofante, celui qui eft divifé en lofanges.
Chef retrait, celui qui n’a en hauteur que la moitié
de fa proportion ordinaire.
Chef foutenu, celui qui n’ayant que les deux tiers
de fa proportion, l’autre tiers eft occupé par une
divifé pofée deffous qui femble le foutenir.
Ce terme vient du mot chef, qui, en vieux Gaulois
, a fignifié ia tête de l’homme , 6c eft dérivé du
Latin caput, en la même fignification, tiré, félon Ni-
c o t , du Grec kkp, ceph.
Agrain des Ubas, d’Elze, en Languedoc; déaiur
au chef d'or.
' De Quelenec en Bretagne; cühermine au chef de
gueules , chargé de trois fleurs de lys d?or.
Bocfofel de la Maifon-forte de Montgontier en
Dauphiné ; et or au chef échiqueté <fargent & de gueules
de deux tires.
D e Fougères d’Oin en Berry ; cta^ur au chef lo-
fangé d'or & de gueules. ( G .D . L .T .)
* § CHELMINAR.... Dans cet article du Dicl.
raifonné des Sciences, 6cc. au lieu de Gratias de Sylva
, Figroa, lifez Gardas de Sylva Figueroa ; 6c au
lieu de Lebrun,, lifez le Bruyn.
* CHEMINÊE-POELE, ( Phyfique. ) Nous devons
à M. de Montalembert l’mgénieufe invention
de pouvoir convertir à volonté une cheminée en
p o êle, 6c par ce moyen, naturalifer en France les
poêles d’Allemagne 6c de Ruffie, fans ôter à nos ap-
partemens l’ufage 6c la décoration de nos cheminées.
Les avantages des cheminées-poêles dont nous allons
donner la conftruâion d’apres l’inventeur, font d a-
bord une grande économie fur le bois, une chaleur
plus égale & plus commode quand on s’en fert comme
de poêle, la facilité d’avoir à volonté ou une
cheminée ou un poêle; puis l’avantage d’echaùffer
plufieurs appartemens, foit de plein-pied, foit à
jlifférens étages ; ôc la commodité de faire paffer la
chaleur fous les planchers d’un ou de plufieurs appartemens
, de façon qu’on ait les pieds fur un poêle ,
fans avoir rien à craindre pour le feu.
Pour faire un poêle d’une cheminée, on partage la
longueur de celle-ci en trois parties par des languet-»
tes qui montent jufqu’au haut du plafond de la chambre
, 6c qui forment trois tuyaux féparés ; celui du
milieu s’élargit un peu vers lebas^ppur former le
foyer de la cheminée , qui eft ouvert à l’ordinaire, 6c
occupe le milieu du chambranle ; les deux autres
tuyaux font fermés jufqu’en bas, 6c communiquent
entr’eux par une ouverture pratiquée fous le foyer :
la partie de l’ouverture du chambranle, qui eft fermée
par les deux tuyaux, eft décorée par des orne-
mens qui cadrent avec ceux des portes, & ces portes
ferment, quand on v eut, le foyer. Seulement on
pratique au bas des portes une petite ouverture pour
fervir d’oeil au poêle quand la cheminée en fait la
fonction. Foy. la planche 111. de nos planches de Phy-
Jîque, dans ce Supplément.
Des trois tuyaux qui partagent la longueur de la
cheminée, un des collatéraux eft fermé par-deffus en
maçonnerie, mais il communique avec celui du milieu
, parce que la languette qui l’en fépare , ne va
pas jufqu’en-haut : cette ouverture eft fermée par
une foupape ou volet de tôle qu ’on ouvre ou ferme
à volonté du dedans de la chambre , parce que fon
axe traverfe le devant de la cheminée, & reçoit en
dehors une dent un peu alongée qui le fait tourner
en tirant un cordon; mais cette foupape eft double ;
6c lorfqu’une de fes parties ferme la communication
avec le tuyau latéral, celui du milieu fe trouve ouvert
: l’autre tuyau latéral eft fermé en-deffus par
une foupape fimple qui le recouvre comme une-1
trape, ôc qu’on peut ouvrir, comme l’autre, du dedans
de„la chambre avec un cordon : alors la cheminée
eft purement cheminée, 6c on peut y faire du feu
dont la fumée montera dire&ement ; elle ne différé
en cet état d’une autre cheminée, qu’en ce qu’elle eft
environ de moitié plus petite.
Mais dès qu’on voudra faire de cette cheminée un
poêle , on ouvrira la êommunication entre le tuyau
du milieu & le collatéral, ce qui ne fe peut faire,
fans fermer par-deffus celui du milieu, ces fermetures
étant les deux moitiés de la même foupape, dont
l’une ne peut fe hauffer, fans que l’autre s’abaiffe;
ces effets s’opéreront en tirant Amplement le cordon
: un femblable mouvement de l’autre cordon
fera lever la foupape de l’autre tuyau collatéral,
qui ie trouvera , par ce moyen, le feul ouvert, 6c
on fermera les portes de Acheminée. Alors la fumee
6c la vapeur chaude ne trouvant plus d’i'ffue par le
haut du tuyau du milieu, entreront dans le tuyau latéral
qui communique avec lui ; 6c comme ce tuyau
eft fermé par le haut, elles defeendjont par ce tuyau,
pafferont par-deffous le foy er; 6c étant entrées dans
l’autre tuyau latéral, elles remonteront pour s’échapper
,jar le haut de ce dernier, 6c pour lors elles
échaufferont confidérablement les parois de ces
tuyaux, qui répandront dans la chambre une chaleur
douce 6c agréable , qu’on entretiendra en fermant
la foupape du dernier tuyau latéral, dès que le bois
fera converti en braife , pour obliger les vapeurs
chaudes à pénétrer ces mêmes parois.
Les poêles de cette efpeçe n’ont pas befoin d être
entretenus toute la journée comme les poêles ordinaires
; qu’ils foient échauffés au plus deux fois le
jour la chambre fera entretenue dans une température’
convenable : on doit pour cela employer du
bois fec , caffé affez menu pour faire un feu clair;
les morceaux feront à-peu-près égaux pour fe réduire
en même tems en charbon ; autrement le courant
d’air confumeroit la première braife , tandis
que les morceaux les plus gros a chèveront de le
Wàler, èc l’on perdroit une partie confidérable de
la chaleur.
Jufqu’ici nous n’avôns parle que d’échauffer une
feule chambre ; mais il eft évident que li l’on a plu-
fieur cheminées les unes au-deffus des autres , ou
adoffées les unes aux autres-, on peut y pratiquer
des tuyaux, qui, communiquant avec ceux de la
première, recevront d’elle un dégré de chaleur pref-
qu’égale, 6c que même ces communications peuvent
être ouvertes latéralement ; de forte qu’un même
feu peut échauffer à gauche , à droite, deffus ou
deffous ; il fera feulement héeeffàire dans ce cas
qu’il foit plus grand ; d’oii il fuit qu’en difpofantartif-
tement les tuyaux ùe cheminée d’une maifon qu’on
b âtit, on pourroit à la lettre en échauffer toutes les
chambres par un ou deux feux allumés au rez-de-
chauffée, 6c dont les locataires paieroient en commun
la dépenfe qui feroit même en ce cas affez médiocre*
Toutes ces communications pourroient être interrompues
à volonté par des foupapes placées dans
les tuyaux aux endroits convenables ; mais une attention
que l’on doit avo ir, c’éftque ces foupapes
joignent exactement, pour ne pas laiffer perdre une
partie de;la chaleur.
On pourroit craindre que la fumée, retenue dans
tous ces dédales, n’y produisît une grande quantité
de fuie, qui d’un côté en diminueroit la capacité, 6c
de l’autre feroit dangereufe fi elle venoità s’allumer;
mais on n’a rien à craindre de ce côté-là-. M. de
Montalembert s’eft affuré, en pratiquant dés ouver-
tures’par oit il pou voit voir dans ces tuyaux, que la
fumée y couroit avec une rapidité fi finguliefe, que
l ’on ne doit craindre aucun dépôt de fa part , du
moins pendant un fort long-tems, 6c il feroit aifé
d’y ménager des ouvertures fermées d’une pierre
ou d’un volet de fer, par lefquelles on pourroit, en
cas de befoin, les nettoyer ; il fera feulement né-
ceffaire que le feu foit affez v if pour que la fumée
ne fe refroidiffe pas aux extrémités du tuyau , juf-
qu’à' fe réfoudre en eau, parce qu’en ce cas, non-
feulement elle n’échaufferoit plus, mais encore elle
gâteroit en très-peu de tems toute la mâçonnerie.
La figure /. repréfente l’élévation d’une cheminée ,
vue en face, dans laquelle on a pratiqué un poêle
«en y confervant une cheminée A , qu’on peut fermer
par le moyen de deux battans D 6c E , dont l’un eft
ïepréfenté ouvert ,6 c l’autre fermé. Lorfque les deux
portes font.ouvertes , c’eft un e cheminée ordinaire
qui devient poêle lorfqu’on les ferme. On en voit en
partie;la ftru&ure intérieure, au moyen de la bri-
fure F G.
La fig. z eft une coupe de la même cheminée fur la
ligne E F du plan fig. 3. On y voit l’âtre ou foyer
R R , élevé fur le petit maflif GH, brifé en T , &
exprimé par les mêmes lettres dans le plan ; cette
cheminée ayant quatre pieds dans oe uvre, on en prend
vingt-deux pouces pour la largeur de la petite cheminée
à conftruire dans la grande. On éleve fur le
fond RR les deux côtés LL en briques de quatre
pouces d’épaiffeur , 6c l’on forme la voûte M , dont
la naiffance eft à douze ou quinze pouces du bas du
foyer ; l’on y pratique dans le fond une ouverture
M pour le paffage de la fumée, d’un pied de large
fur environ neuf pouces ; fur les deux jambages de
cette voûte, on éleve aufii les deux languettes N ,
no. 1 , N , n°. z , la languette N z montant jufqu’au
diaphragme PP , qui traverfe 6c ferme totalement la
cheminée. Le détail de ce diaphragme eft exprimé
fig. 4. On y voit les foupapes, n r .j ,& Zj représentées,
fig. z , fous les mêmes numéros. La languette
■ H 1 doit fe terminer à un pied environ au-deffous du
diaphragme P , pour laiffer un libre paffage à la fu-
jnée lorfque la foupape double n°. 1 eft fermée ; cètte
foupape èft cômpofée de deux plateaux h 6c q; lé
plateau fupérieur h eftdeftiné à fermer l’ouverture
a , l’inférieur q à fermer l’ouverture d ; c es deux ouvertures
ne peuvent jamais être fermées enfemble*
puifque la foupape double eft d’une feule piece mobile
fur fon axe k i fig. 4 , & lorfque la partie h eft
•abattue pour fermer l’ouverture a , cette foupape
perd la fituation ponttuée ƒ , 6c laiffe par conféquent
un libre paffage à la fumée par l’ouverture d; le mérite
de la conftruttion de cette foupape confifte à
conferver la chaleur dans les tuyaux latéraux, tandis
que celui du milieu eft ouvert : il faut avoir attention
de faire faire 1a partie h plus pefante que
celle q, afin que la première puiffe entraîner la dernière
par fon propre poids , lorfqu’on lui aura laiffé
la liberté de retomber. La foupape«0. z étant Ample
, ne demande aucune explication. Quant à la
façon de faire mouvoir ces foupapes, on fent qu’en
fuppofant qu’on ait adapté à l’extrémité de chacun
de leur axe, un levier plus ou moins grand, félon
la pefanteur de la foupape, tel qu’on les voit en r 6c s*
fig. 5 , 6c plaçant un double levier tu pour renvoi au
coin du tuyau de la cheminée, on pourra ouvrir 6c
fermer ces foupapes avec les cordons x x ^yy, 6c
ces différens mouvemens étant, s’il étoit néceffaire,
encaftrés dans l’épaiffeur de la languette de la cheminée,
n’auroient aucune faillie, & ne s’oppoferoient
en aucune façon aux ornemens : il faut avoir attention
de placer un obftacle derrière la foupape n°. z ,
qui ne lui permette pas de s’ouvrir jufqu’à la ligne
verticale, afin qu’elle puiffe retomber par fon propre
poids en lâchant le cordon y y , qui doit refter
accroché , ainfi que celui x x , tout le tem's qu’on
voudra tenir les foupapes ouvertes.
La fig. 3 eft le plan de la cheminée ; GH & IK font
deux maffifs de briques de quatre pouces , laiffant
fept pouces d’intervalle dans l’objet de foutenir des
briques de huit pouces de longueur, placés de façon
à laiffer en deffous deux pafiàges à la fumée. Lorfqu’on
en veut faire la dépenfe, 6c qu’on eft à portée
d’avoir des plaques de fonte de fe r , on en place une
de toute la largeur LM , 6c l’on fupprime les deux
petits maffifs de brique GH6c IK. 11 eft même indif-
penfable de fe fervir de ces plaques toutes les fois
qu’on veut que l’âtre delà cheminée foit au niveau du
plancher, 6c qu’il a peu d’épaiffeur ; alors on y remédie
en plaçant des plaques deffus 6c deffous.
La fig. 4 repréfente le chaffis de fer 0000, qui doit
être de la longueur 6c de la largeur du tuyau de la
cheminée , fcellé par fes quatre extrémités 0000,' 6c
foutenu dans fa grande dimenfion par plufieurs pattes
de fer fcellées dans le mur 6c dans le parement
de la cheminée. La partie m doit être couverte à demeure
6c exactement fermée avec des tuiles , briques
ou pierres'de taille, ou même avec une double
tôle, comme les foupapes. Les a\ e s k i , fg de ces
folipapes doivent traverfer le parement de la cheminée
pour recevoir à leur extrémité les mouvemens
de renvoi répondans aux cordons.
La fig. S eft une vue en face des différens mouvemens
néceffaires au jeu des foupapes ; l’on y voit
qu’au moyen du mouvement de renvoi de la double
foupage n°. 1, elle peut fe mouvoir avec la même
facilité que là foupape fimple n°. z ; il iuffira, pour
les faire mouvoir, de deux cordons tels qu’on eft en
ufage d’en avoir pour les fonnettes.
La fig. G repréfente l’élévation d’une cheminée-poêle,
dont les portes A 6c B s’ouvrent en couliffes, paffent
derrière chaque jambage, 6c vont jufqu’à l’ extrémité
des deux parties C 6c D , pratiquées en faillie à côté
de la cheminée. Ces parties faillantes C 6c D font le
plus ordinairement du même marbre du chambranle,
mais elles peuvent être aufli de menuiferie ; alors,
dans cette conftru&ion j«à cheminée refte ouverte de