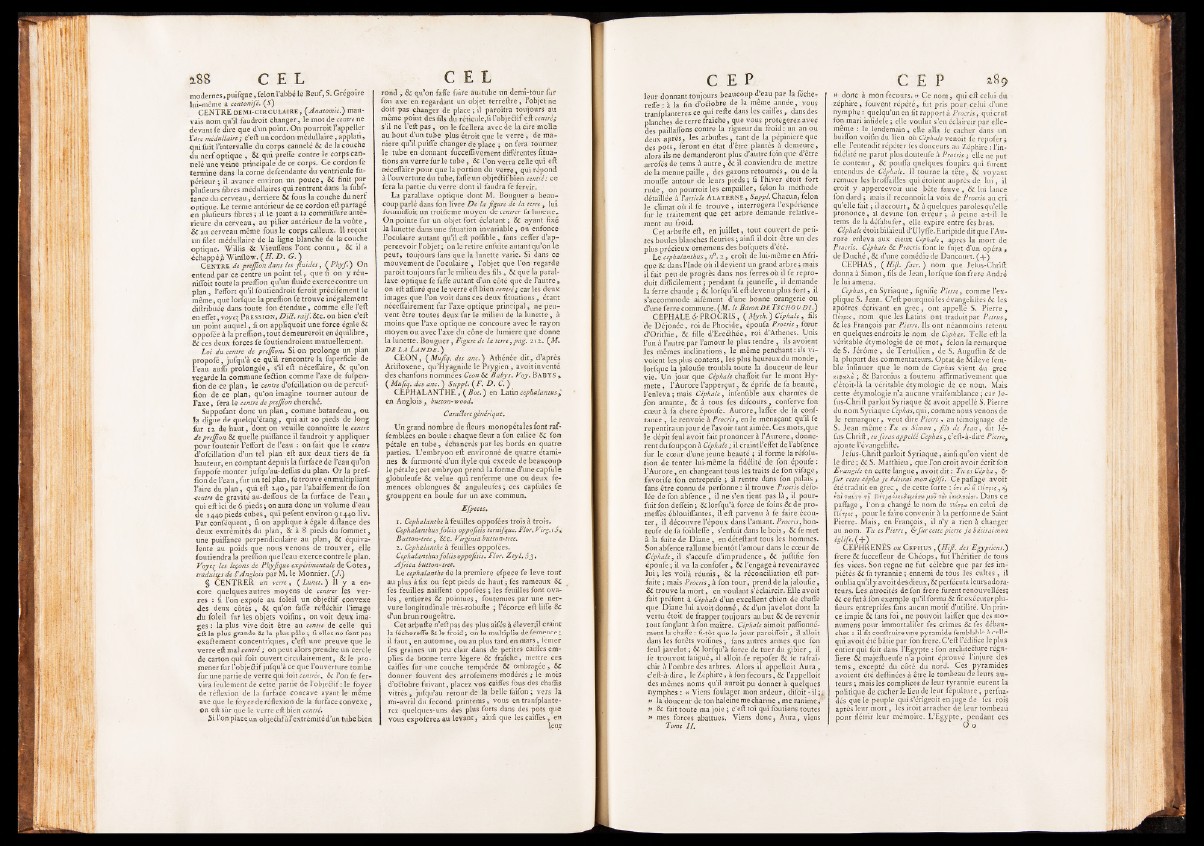
modernes, puifque, félon l’abbé le Beuf, S. Grégoire
lui-même a centonifé. {S)
CENTRE D EM I-C IR C U LA IR E , {Anatomie.) mauvais
nom qu’il’ faudroit changer, le mot de centre ne
devant fe dire que d’un point. On pourroit l’appeller
l’arc médullaire; c’eft un cordon médullaire, applati,
qui fuit l’intervalle du corps cannelé & de la couche
du nerf optique , &. qui preffe contre le corps cannelé
une veine principale de ce corps. Ce cordon fe
termine dans la corne defcendante du ventricule fu-
périeur ; il avance environ un pouce, & finit par
plufieurs fibres médullaires qui rentrent dans la fubf-
tance du cerveau, derrière & fous la couche du nerf
optique. Le terme antérieur de ce cordon eft partagé
en plufieurs fibres; il fe joint à la commiffure antérieure
du cerveau, au pilier antérieur de la voûte,
& au cerveau même fous le corps calleux. 11 reçoit
un filet médullaire de la ligne blanche de la couche
optique. Willis & Vieuffens l’ont connu, ÔC il a
échappé^"Wrnflow. {H. D . G. )
CENTRE de prejjion dans les fluides, ( Phyf. ) On
entend par ce centre un point tel, que fi on y reu-
niffoit toute la preflion qu’un fluide exerce contre un
plan, l’effort qu’il foutiendroit feroit précifément le
même, que lorfque la preflion fe trouve inégalement
diftribuée dans toute Ion étendue, comme elle l’eft
en effet, voye^ Pression, Dict. raif. &c. ou bien c eft
un point auquel, fi on appliquoit une force égale &
oppofée à la preflion, tout demeureroit en équilibre,
& ces deux forces fe foutiendroient mutuellement.
Loi du centre de preflion. Si on prolonge un plan
propofé, jufqu’à ce qu’il rencontre la fuperficie de
l ’eau aufli prolongée, s’il eft néceffaire, & qu’on
regarde la commune fe&ion comme l’axe de fufpen-
fion de ce plan, le centre d’ofcillation ou de percuf-
fion de ce plan, qu’on imagine tourner autour de
l’ax e, fera le centre de preflion cherché.
Supposant donc un plan, comme batardeau, ou
la digue de quelqu’étang, qui ait 20 pieds de long
fur i z de haut, dont on veuille connoître le centre
de preflion & quelle puiflance il faudroit y appliquer
pour foutenir l’effort de l’eau : on fait que le centre
d’ofcillation d’un tel plan eft aux deux tiers de fa
hauteur, en comptant depuis la furface de l’eau qu’on
fuppofe monter jufqu’au-defliis du plan. Or la pref-
iion de l’eau, fur un tel plan, fe trouve en multipliant
l’aire du plan, qui eft 240, par l ’abaiffement de fon
centre de gravite au-deffous de la furface de l’eau,
qui eft ici de 6 pieds ; on aura donc un volume d’eau
de 1440pieds cubes, quipefent environ 91440 liv.
Par conféquent, fi on applique à égale diftance des
deux extrémités du plan, & à 8 pieds du fommet,
une puiflance perpendiculaire au plan, & équivalente
au poids que nous venons de trouver, elle
Soutiendra la preflion que l’eau exerce contre le plan.
Voyt{ les leçons de Phyflque expérimentale de Cotes ,
traduites de CAnglois par M. le Monnier. {/.)
§ CENTRER un verre, ( Lunet. ) Il y a encore
quelques autres moyens de centrer les verres
: fi l’on expofe au foleil un objeâ if convexe
des deux côtés , & qu’on faffe réfléchir l’image
du foleil fur les objets voifins, on voit deux images
: la plus vive doit être au centre de celle qui
eft la plus grande & la plus pâle ; fi elles ne font pas
exaftement concentriques, c’eft une preuve que le
verre eft mal centré ; on peut alors prendre un cercle
de carton qui foit ouvert circulairement, & le promener
fur l’objeûif jufqu’à ce que l’ouverture tombe
fur une partie.de verre qui foit centrée, & l’on fe Servira
feulement de cette partie de l'obje&if : le foyer
de réflexion de la furface concave ayant le même
axe que le foyer de réflexion de la furface convexe,
pn eft sûr que le verre eft bien centré.
£i l’on place un objettifàl’extrémitéd’un tube bien
rond , & qu’on faffe faite âiutube lin demi-tour fut
fon axe en regardant un objet terreftre, l’objet ne
doit pas changer de place ; il paroîtra toujours au
même point des fils du réticule,fi l’obje&if eft centré;
. s’il ne l’eft pas, on le fcellera avec de la cire molle
au bout d’un tube plus étroit que le verre, de maniéré
qu’il puiffe changer de place ; on fera tourner
le tube en donnant fucceffivement différentes fitua-
tions au verre fur le tube, & l’on verra celle qui eft
néceffaire pour que la portion du verre, qui répond
à l’ouverture du tube, faffe un o b jeâ if bien centré: ce
fera la partie du verre dont il faudra fe fervir.
La parallaxe optique dont M. Bouguer a beaucoup
parlé dans fon livre De la figure de la terre , lui
fourniffoit un troifieme moyen de centrer fa lunette.
On pointe fur un objet fort éclatant ; & ayant fixé
la lunette dans une Situation invariable, on enfonce
l’oculaire autant qu’il eft poflible, fans ceffer d’ap-
percevoir l’objet ; on le retire enfuite autant qu’on le
peut, toujours fans que la lunette varie. Si dans ce
mouvement de l’oculaire , l’objet que l’on regarde
paroît toujours fur le milieu des fils, & que la parallaxe
optique fe fafle autant d’un côté que de l’autre,
on eft affuré que le verre eft bien centré; car les deux
images que l’on voit dans ces deux Situations, étant
néceffairement fur l’axe optique principal * ne peuvent
être toutes deux fur le milieu de la lunette, à
moins que l’axe optique ne concoure avec le rayon
moyen ou avec l’axe du cône de lumière que donne
la lunette. Bouguer, Figure de la terre,pag. z i z . {M.
d e l a La n d e .)
CEON , ( Muflq. des anc.) Athénée dit, d’après
Ariftoxene, qu’Hyagnide le Prygien , avoit inventé
des chanfons nommées Ceon & Babys. Voy. Ba b y s ,
{Muflq. des anc.) Suppl. {F. D. C .)
CEPHALANTHE, {B o t.) en Latin cephalantus ,
en Anglois, button-wood.
Caractère générique.
Un grand nombre de fleurs monopétales font raf-
femblées en boule : chaque fleur a fon calice &c fon
pétale en tube, échancrés par les bords en quatre
parties. L’embryon eft environné de quatre étamines
& Surmonté d’un ftyle qui excede de beaucoup
le pétale ; c et embryon prend la forme d’une capfule
globuleufe & velue qui renferme une ou deux fe-
mences oblongues & anguleufes ; ces capfules fe
grouppent en boule fur un axe commun.
Efpeces.
1. Cephalanthe à feuilles oppofées trois à trois.
Cephalanthus foliis oppofitis ternifque. Flor. Virg.iS«
Button-tree, &c. Virginia button-tree.
z. Cephalanthe à feuilles oppofées.
Cephalanthus foliis oppofitis. Flor. Zeyl, j j ,
Africa button-tree.
Le cephalanthe de la première efpece fe leve tout
au plus à fix ou fept pieds de haut ; fes rameaux
fes feuilles naiffent oppofées ; les feuilles font ovales
, entières & pointues, foutenues par une nervure
longitudinale très-robufte ; l’écorce eft liffe ÔC
d’un brun rougeâtre.
Cet arbufte n’eft pas des plus aifés à élever;il craint
la féchereffe & le froid ; on le multiplie de femence ;
il faut, en automne, ou au plus tard en mars, femer
fes graines un peu clair dans de petites caifl'es emplies
de bonne terre légère & fraîche, mettre ces
caiffes fur une couche tempérée & ombragée, ÔC
donner fouvent des arrofemens modérés ; le mois
d’ottobre fuivant, placez vos caiffes fous des chaffis
vitrés , jufqu’au retour de la belle faifon ; vers la
mi-avril du fécond printems, vous en tranfplante-
. rez quelques-uns des plus forts dans des pots que
vous expofere? au levant, ainfi qüe les caiffes, en
leur donnant toujours beaucoup d’eau par la fécheT
reffe : à la fin d’oftobre de la même année, vouf
tranfplanterez ce qui refte dans les caiffes, dans des
planches de terre fraîche, que vous protégerez aveç
des paillaffons contre la rigueur du froid : un an ou
deux après, les arbuftes, tant de la pépinière que
des pots, feront en état d’être plantés à demeure,
alors ils ne demanderont plus d’autre foin que d’etre
arrofés de tems à autre, & il conviendra de mettre
de la menue paille , des gazons retournés y ou de la
moufle autour de leurs pieds ; fi l’hiver étoit fort
rude, on pourroit les empailler, félon la méthode
détaillée à l’article Alaterne, Suppl. Chacun, félon
le climat oû il fe trouve , interrogera l’expérience
fur le traitement que cet arbre demande relativement
au froid.
Cet arbufte eft, en juillet, tout couvert de petites
boules blanches fleuries ; ainfi il doit être un des
plus précieux ornemens des bofquets d’été.
Le cephalanthus, n°. z , croît de lui-même en Afrique
& dans l’Inde oii il devient un grand arbre ; mais
il fait peu de progrès dans nos ferres oii il fe reproduit
difficilement ; pendant fa jeuneffe, il demande
la ferre chaude ; & lorfqu’il eft devenu plus fo r t , il
s’accommode aifément d’une bonne orangerie ou
d’une ferre commune. {M. le Baron d e Tsch o v d i .)
CÉPHALÉ & PROCRIS, {Myth.) Céphale, fils
de Déjonée, roi de Phocide, époufa Procris , foeur
d’Orithie, & fille d’Erefthée, roi d’Athenes. Unis
l’un à l’autre par l’amour le plus tendre , ils avoient
les mêmes inclinations, le même penchant : ils vivaient
les plus contens, les plus heureux du monde,
lorfque la jaloufie troubla toute la douceur de leur
.vie. Un jour que Céphale chaffoit fur le mont Hy-
mete, l’Aurore l’apperçut, & éprife de fa beauté,
l ’enleva; mais Céphale, infénfible aux charmes de
fon amante, & à tous fes difeours , conferve fon
coeur à fa chere époufe. Aurore, laffée de fa confiance
, le renvoie à Procris, en le menaçant qu’il fe
repentira un jour de l’avoir tant aimée. Ces mots,que
le dépit feul avoit fait prononcer à l’Aurore, donnèrent
du foupçon à Céphale ; il craint l’effet de l’abfence
fur le coeur d’une jeune beauté ; il forme la réfolu-
îion de tenter lui-même la fidélité de fon époufe :
l ’Aurore, en changeant tous les traits de fon vifage,
favorife fon entreprife ; il rentre dans fon palais,
fans être connu de perfonne : il trouve Procris défo-
lée de fon abfence , il ne s’en tient pas là , il pour-
fuit fon deffein ; &lorfqu’à force de foins & de pro-
meffes éblouiffantes, il eft parvenu à fe faire écouter,
il découvre l’époux dans l’amant. Procris,hon-
teufe de fa foibleffe, s’enfuit dans le bois, & fe met
à la fuite de Diane, endéteftant tous les hommes.
Son abfence rallume bientôt l’amour dans le coeur de
Céphale, il s’accufe d’imprudence, & juftifie fon
époufe ; il va la confofer, & l’engage à revenir avec
lu i; les voilà réunis, & la réconciliation eft parfaite
; mais Procris, à fon tour, prend de la jaloufie,
& trouve la m ort, en voulant s’éclaircir. Elle avoit
fait préfent à Céphale d’un excellent chien de chaffe
que Diane lui avoit donné, & d ’un javelot dont la
vertu étoit de frapper toujours au but & de revenir
tout fanglant à fon maître. Céphale aimoit paflionné-
ment la chaffe : fi-tôt que le jour paroiffoit, il alloit
dans les forêts voifines, fans autres armes que fon
feul javelot ; & lorfqu’à force de tuer du gibier , il
fe trouvoit fatigué, il alloit f e repofer & fe rafraîchir
à l’ombre des arbres. Alors il appelloit Aura ,
c’eft-à-dire, le Zéphire, à fon fecours, & l’appelloit
des mêmes noms qu’il auroit pu donner à quelques
nymphes : « Viens foulager mon ardeur, difôit-il;.
» la douceur de ton haleine me charme , me ranime.,
.» & fait toute ma joie ; c’eft toi qui foutiens toutes
» mes forces abattues. Viens donc, Aura, viens
Tome II.
» donc à mon fecours» », Ce nom, qui eft celui du
-zéphire, fouvent répété, fut pris pour celui d’une
nymphe: quelqu’un en fit rapport à Procris, qui crut
fon mari infidèle ; elle voulut s ’en éclaircir par elle—
roênie : le lendemain, elle alla fe cacher dans un
buiflbn voifin du lieu oii Céphale venoit fe repofer;
elle l’entendit répéter fes douceurs au Zéphire : l’infidélité
ne parut plus douteufe à Procris ; elle ne put
fe contenir, & pouffa quelques foupirs qui furent
entendus de Céphale. Il tourne.la tête, &c voyant
remuer les broffailles qui étoient auprès de lu i, il
croit y appercevoir une bête fauve, & lui lance
fon dard ; mais il reconnoît la voix de Procris au cri
qu’elle fait ; il accourt, & à quelques paroles qu’elle
prononce, il devine fon erreur ; à peine a-t-il le
tems de la défabufer, elle expire entre fes bras.
. Céphale étoitbifaïeul d’Ulyffe. Euripide dit que l’Aurore
enleva aux deux Céphale, après la mort de
Procris. Céphale & Procris font le fujet d’un opéra ,
de Duché, & d’une comédie de Dancourt. (+ )
CEPHAS, { Hifl. facr .) nom que Jefus-Chrift
donna à Simon, fils de Jean, lorfque fonfrere André
le lui amena.
Cephas, en Syriaque, fignifie Pierre, comme l’explique
S. Jean. C’eft pourquoi les évangeliftes & les
apôtres écrivant en grec , ont appellé S. Pierre,
nl-rpoc, nom que les Latins ont traduit par Petrus,
& le s François par Pierre. Ils ont néanmoins.retenu
en quelques endroits le nom de Cephas. Telle eft ia
-véritable étymologie de ce mot, félon la remarque
de S. Jérôme , de Tertullien, de S. Auguftin & de
la plupart des commentateurs. Optât de Mileve fem-
ble infinuer que le nom de Cephas vient du grec
xtipctX» ; & Baronius a foutenu affirmativement que
c’étoit-là la véritable étymologie de ce nom. Mais
çette étymologie n’a aucune vraifemblance ; car Jefus
Chrift parloit Syriaque & avoit appellé S. Pierre
du nom Syriaque Cephas, qui, comme nous venons de
le remarquer, veut dire Pierre, au témoignage de
S. Jean même : Tu es Simon , fils de Jean, .dit Jé-
fus-Chrift, tu feras appellé Cephas, c’eft-à-dire Pierre,
ajoute l’évangelifte.
Jefus:Chrift parloit Syriaque, ainfi qu’on vient de
le dire ; & S. Matthieu, que l’on croit avoir écrit fon
Évangile en cette langue, avoit dit : Tu es Cèpha, &
fur cette cèpha je bâtirai mon églife. Ce paffage avoit
été traduit en grec, de cette forte : tm <rù 3 nirpoc, ^
t7Tl Tctoril TJ) UiTpcl OIKoS'i/J.l'urCû p.OU TJ»’ i ÜÜÂMcr/a!’. Dans ce
paffage , l’on a changé le nom de ns'rpa en celui de
nt'rjjoff , pour le faire convenir à la perfonne de Saint
Pierre. Mais, en François, il n’y a rien à changer
au nom. Tu es Pierre, & fur cette pierre j e bâtirai mon
CEPHRENÉS ou C ephus , {Hifl. des Egyptiens.)
frere & fuccefleur de Chéops, fut l’héritier de tous
fes vices. Son régné ne fut célébré que par fes impiétés
& fa tyrannie ; ennemi de tous les cultes , il
oublia qu’ily avoit des dieux, & perfécuta leurs adorateurs.
Les atrocités de fon frere furent renoùvellées;
& ce fut à fon exemple qu’il forma & fit exécuter plufieurs
entreprifes fans aucun motif d’utilité. Un prince
impie & fans fo i, ne pouyoit laiffer que des mo-
numenspour immortalifer fes crimes & fes débauches
: il fit conftruireune pyramide femblable à celle
qui avoit été bâtie par fon frere. C ’eft l’édifice le plus
entier qui foit dans l’Egypte : fon architefture régulière
& majeftueufe n’a point éprouvé l’injure ^dës
tems, excepté du côté du nord. Ces pyramides
avoient été deftinées à être le tombeau de leurs auteurs
; mais les complices de leur tyrannie eurent là
politique «de cacher le lieu de leur fépulture , perfua-
' dés que le peuple qui s’érigeoit en juge de fes rois
après leur mort, les iroit arracher de. leur tombeau
pour flétrir leur mémoire. L’Egypte, pendant ces
1 O o