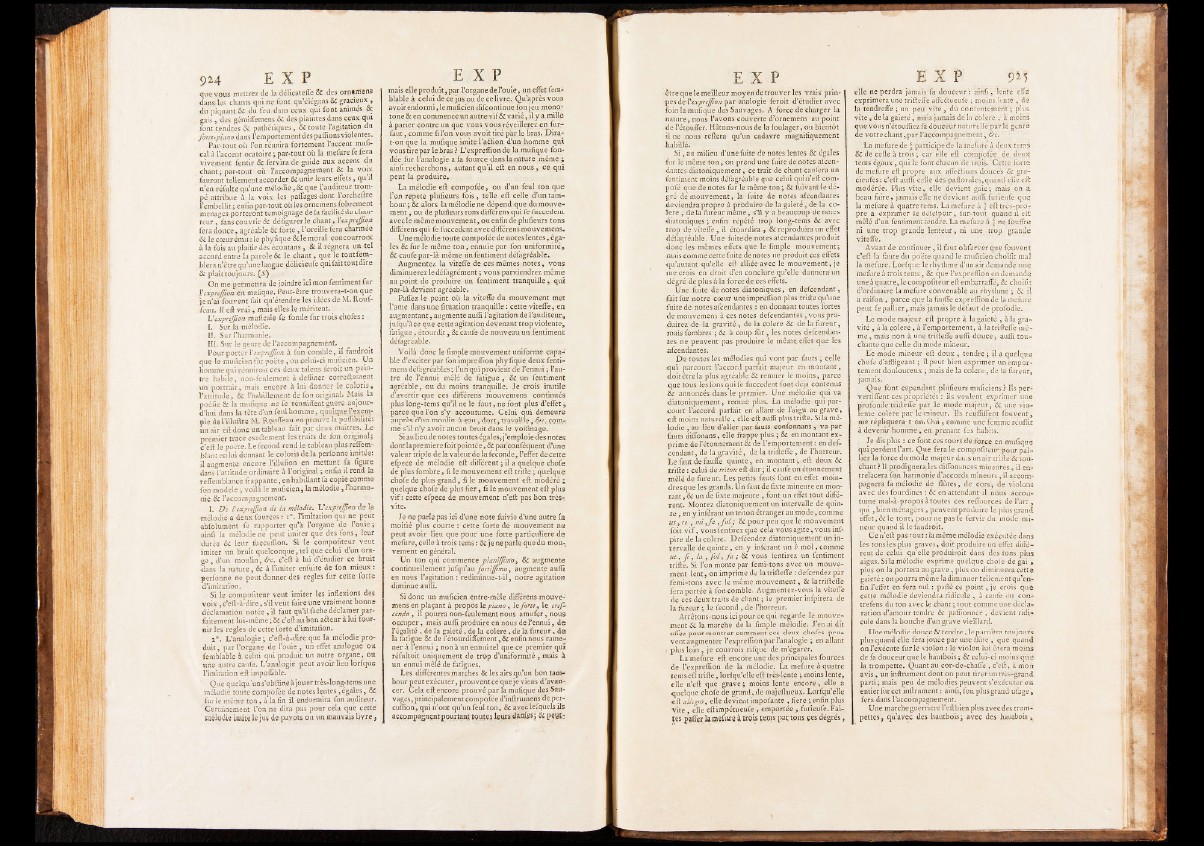
que vous mettrez de la .délicat elfe Sc des orniiwenS
dans les chants qui ne font qu’élégans & gracieux,
du piquant 6c du feu. dans ceux qui font animés &
gais , des gémiffemens & des plaintes dan? ceux qui
font tendres Sc pathétiques, 6c toute l’agitation du
forte-piano dans l’emportement des pallions violentes.
Par-tout où l’on réunira fortement l’accent mufi-
cal à l’accent oratoire ; par-tout où la mefure fe fera
vivement fentir 6c fervira de guide aux accens du
chant ; par-tout où l’accompagnement 6c la voix
fauront tellement accorder & unir leurs effets, qu’il
n’en réfulte qu’une mélodie ,& q u e l’auditeur trompé
attribue à la voix les paffages dont l’orcheftre
l’embellit ; enfin par-tout où les ornemens fobrement
ménagés porteront témoignage de la facilite du chanteur
, fans couvrir 6c défigurer le chant, Yexprefjion
fera douce, agréable 6c forte, l ’oreille fera charmee
6c le coeur ému : le phyfique 6c le moral concourront
à la fois au plaifir des écoutans, & il régnera un tel
accord entre la parole 6c le chant, que le toutfem-
blera n’être q.u’une langue délicieufe qui fait tout dire
& plaît toujours, ( f )
On me permettra de joindre ici mon fentiment fur
¥ exprejfion en mufique. Peut-être trouvera-t-on que
je n’ai fou vent fait qu’étendre les idées de M. Rouf-
feau. Il eft v ra i, mais elles le méritent.
Vexpreffioh muficale fe fonde fur trois chofes :
I. Surfa mélodie.
II. Sur l’harmonie.
III. Sur le genre de l’accompagnemént.
Pour porter l’exprejfion à fon comble, il faudroit
que le muficien fût p oëte, ou celui-ci muficien. Un
homme qui rénniroit ces deux talens feroit un peintre
habile, non-feulement à deffiner correftement
un portrait, mais encore à lui donner le coloris,
l’attitude, 6c l’habillement de fon original. Mais la
poéfie & la mufique ne fe réunirent guere aujourd’hui
dans la tête d’un feu! homme, quoique l’exemple
de l’illuftre M. Rouffeau en prouve la poffibilité:
un air eft donc un tableau fait par deux maîtres. Le
premier trace exaftement les traits de fon original;
c ’eft le poète. Le fécond rend le tableau plus reffem-
blanc en lui donnant le coloris delà perfonne imitée:
il augmente encore l’illufion en mettant fa figure
dans l’attitude ordinaire à l’original ; enfin il rend la
reffemblance frappante, enhabillantfa copie^ comme
fon modèle ; voilà le muficien, la mélodie, l’harmonie
6c l’accompagnement.
I. De l ’exprejfion de la mélodie. Vexprejfion de la
mélodie a deux fources : i° . l’imitation qui ne peut
abfolument fe rapporter qu’à l’organe de l’ouie ;
ainfi la mélodie ne peut imiter que des fons, leur
durée & leur fucceffion. Si le compofiteur veut
imiter un bruit quelconque, tel que celui d’un orage
, d’un moulin, &c. c’eft à lui d’étudier ce bruit
dans la nature, 6c à l’imiter enfuite de fon mieux :
perfonne ne peut donner des réglés fur cette forte
d’imitation.
Si le compofiteur veut imiter les inflexions des
voix , c’eft-à-dire, s’il veut faire une vraiment bonne
déclamation notée , il faut qu’il fâche déclamer parfaitement
lui-même ; & c’eft au bon a&eur a lui fournir
les réglés de cette forte d’imitation.
i ° . L’analogie ; c’eft-à-dire que la mélodie produit
, par l’organe de l’ouie , un effet analogue ou
femblable à celui qui produit un autre organe, ou
une autre caul'e. L’analogie peut avoir lieu lorfque
l’imitation eft impoffible.
Que quelqu’un s’obftine à jouer très-long-tems une
mélodie toute compofée de notes lentes, égalés, Sc
fur le même ton, à la fin il endormira fon auditeur.
Certainement l’on ne dira pas pour cela que cette
mélodie imite le jus de pavots ou. un mauvais liv re ,
mais elle produit, par l’organe de l’ouie, un effet fem*
blable à celui de ce jus pu de ce livre. Qu’après vous
avoir endormi, le muficien difcontinue fon jeu monotone
& en commence un autre v if 6c varié, il y a mille
à parier contre un que vous, vous réveillerez en fur-
faut, comme fi l’on vous avoit tiré pàr le bras. Dira-
t-on que la mufique imite l ’aélion d’un,homme qui
vous tire par le bras ? L’expreffionde la mufique fondée
fur l’analogie a fa fource dans la nature même ;
ainfi recherchons, autant qu’il eft en nous, ce qui
peut la produire.
La mélodie eft compofée, ou d’un feul ton que
l’on répété plufieurs fois , telle eft celle d’un tambour
;& alors la mélodie ne dépend que du mouvement
, ou de plufieurs tons différens qui fe fuccedent
avec le même mouvement, ou enfin de plufieurs tons
différens qui fe fuccedent avec différens rtiouvemens.
Une mélodie toute compofée de notes lentes, égales
& fur le même ton, ennuie par fon uniformité,
. 6c caufe par-là même un.fentiment défagréable.
Augmentez la vîteffé de ces mêmes notes., vous
diminuerez le défagrément ; vous parviendrez même
au point de produire un fentiment tranquille, qui
par-là devient agréable.
Paffez le point où la vîteffe du mouvement met
l’ame dans une fitüation tranquille : cette vîteffe, en
augmentant, augmente auffi l ’agitation de l’auditeur,
jufqu’àce que cette agitation devenant trop violente,
fatigue, étourdit, 6c caufe de nouveau un fentiment
défagréable.
Voilà donc le fimple mouvement uniforme capable
d’exciter par fon impreffion phyfique deux fenti-
mens défagréables ; l’un qui provient de l’ennui ; l’autre
de l’ennui mêlé de fatigue , 6c un fentiment
agréable, ou du moins tranquille. Je crois inutile
d’avertir que ces différens mouvemens continués
plus long-tems qu’il ne le faut, ne font plus d’effet,
parce que l’on s’y accoutume. Celui qui demeure
auprès d’un moulin à eau, dort, travaille, &c. comme
s’il n’y avoit aucun bruit dans le voifinage.
Si au lieu de notes toutes égales, j’emploie des notes
dont la première foit pointée, 6c par conféquent d’une
valeur triple de la valeur de la fécondé, l’effet de cette
efpece de mélodie eft différent ; il a quelque chofe
de plus fombre, fi le mouvement eft trifte ; quelque
chofe de plus grand, fi le mouvement eft modéré ;
quelque chofe de plus fier, fi le mouvement eft plus
v if : cette efpece de mouvement n’eft pas bon très-
YÎte.
Je ne parle pas ici d’une note fuivie d’une autre la
moitié plus courte : cette forte de mouvement ne
peut avoir lieu que pour une forte particulière de
mefure, celle à trois tems : 6c je ne parle que du mou»;
vement en général.
Un ton qui commence pianijjinio, & augmente
continuellement jufqu’au fortiffimo, augmente auflï
en nous l’agitation : rediminue-t-il, notre agitation
diminue auffi.
Si donc un muficien entre-mêle différens mouvemens
en plaçant à propos le piano, le forte, le cref-
cendo, il pourra non-feulement nous amufer, nous
occuper, mais auffi produire en nous de l’ennui, de
l’égalité, de la gaiete, de la colere, de la fureur, de
la fatigue 6c de l’étourdiffement, 6c enfin nous ramener
à l’ennui ; non à un ennui tel que ce premier qui
réfultoit uniquement de trop d’uniformité, mais à
un ennui mêlé de fatigues.
Les différentes marches & les airs qu’un bon tambour
peut exécuter, prouvent ce que je viens d’avancer.
Cela eft encore prouvé par la mufique des Sauvages,
principalement compofée d’inftrumens de per-
cuflion, qui n’ont qu’un feul ton, 6c avec lefquels ils
accpmpagnçnt pourtant toutes leqisdanfos; 6c peytêtre
que le meilleur moyen de trouver les vrais prin-
pes exprejfion par analogie féroit d’étudier avec
foin la mufique des Sauvages. A force de charger la
nature, nous l’avons couverte d’ornemens au point
de l’étouffer. Hâtons-nous de la foulager, ou bientôt
il ne nous reliera qu’un cadavre magnifiquement
habillé. >
S i , au milieu d’unè fuite de notes lentes 6c égales
fur le même ton, on prend une fuite de notes afoen-
dantes diatoniquement,. ce trait de chant caufera un
fentiment moins défagréable que celui qui n’eft com-
pofé que de notes fur le même ton ; & fùivànt le^é-
gré de mouvement, la fuite de notes afcendantes
deviendra propre à produire de la gaieté','de la colere
, de la fureur même, s’il y a beaucoup de notes
diatoniques enfin répété trop long-tems 6c avec
trop de vîteffe , il étourdira , 6c reproduira un effet
défagréable. Une fuite de notes afcendante&produit
donc les mêmes effets que le fimple mouvement;
mais comme cette fuite dénotés ne produit ces effets
qu’autant qu’elle eft alliée avec le mouvement, je
me crois en droit d’en conclure qu’elle donnera un
dégré de plus à la force de ces effets.
Une fuite de notes diatoniques, en defcendant,
fait fur notre coeur une impreffion plus trifte qu’une
fuite de notes afcendantes : en donnant toutes fortes
de mouvemens-à ces notes defcendantes, vous produirez
:de la gravité, de la colere 6c de la foreur,
•mais fombres ; 6c à coup fur , les notes defcendantes
ne peuvent pas produire le même-effet que lès
afcendantes.
D e toutes les mélodies qui vont par- fauts, Celle
qui parcourt l’accord parfait majeur en montant,
doit être la plus agréable 6c remuer le moins, parce
que tous lèsfons qui fe fuccedent font déjà contenus
6c annoncés dans le premier. Une mélodie qui va
diatoniquement , remue plus. La mélodie qui parcourt
l’accord parfait en allant de l’aigu au grave,
eft moins naturelle , elle eft auffi plus trifte. Sila mélodie
, au lieu d’aller par fauts eonfonnans , va par
fauts diffonans, elle frappe plus.; 6c en montant exprime
de l’étonnement 6c de l’emportement : en defcendant,
de la gravité, de la trifteffe, de l’horreur.
Le faut de fauffe quinte , en mqntant y eft doux &
trifte : celui de triton eft dur ; il caufe un étonnement
mêlé de fureur. Les petits fauts font en effet moindres
que les grands. Un faut de fixte mineure en montant
, 6c un de fixte majeure , font un effet tout différent.
Montez diatoniquement un intervalle de quinte
, en y inférant un triton étranger au mode, comme
u t, re , mi ,fa ,fo l; 6c pour peu que le mouvement
foit v i f , vous fendrez que cela vous agite, vous inf-
pire de la colere. Defcendez diatoniquement un intervalle
de quinte, en y inférant un b mol, comme
a/, J i , la-, fo l, fa ; 6c vous fentirez un fentiment
trifte. Si l’on monte par femi-tons avec un mouvement
lent, on imprime de la trifteffe : defcendez par
femi-tons avec le même.mouvement, & la trifteffe
fera portée à fon comble. Augmentez-vous la vîteffe
de ces deux traits de chant ; le premier infpirera de
la fureur ; le fécond , de l’horreur.
Arrêtons-nous ici pour ce qui regarde le mouvement
6c la marche de la fimple mélodie. J’en ai dit
affez pour montrer comment ces deux chofes peuvent
augmenter l’expreffion par l’analogie ; en allant
j plus loin , je çourrois rifque de m’égarer.
La mefure eft encore une des principales fources
de l’expreflion de la mélodie. La mefure à quatre
tems eft trifte , lorlqu’elle eft très-lente ; moins lente,
elle n’eft que grave ; moins lente encore, elle a
quelque chofe de grand, de majeftueux. Lorfqu’elle
eft allegro, elle devient impofante , fiere ; enfin plus
vite elle eftimpétueufe , emportée , furieufe. Faites
pâfferl&inçfuxe à trois tems par tous ces degrés,
elle ne perdra jamâîs‘fa douceur ': ainfi -, - lente elle
exprimera une trifteffe affeélueufe ; moins lente , dé
la tendreffe ; un peu v ite , du contentement'; plus
v ite , de la gaieté, mais jamais de la colère ; à' moins
que vous n’étouffiez fa' douceur naturellè'parle gcnrë
de votre chant, par l ’àccompagnement, &c. y
La mefure de f participe de la mefure a deux tems
6c de celle à trois ; car elle eft compofée de, deux
tems égaux, qui le font chacun dé trois. Cette forte
de mefure eft propre aux affections douces '& gracie
ufes: c’eft aùfîi celle des paftoralés,quand elle eft
modérée. Plus.vite, elle devient gaie; mais, on à
beau faire, jamais elle ne devient auffi funéufe que
la mefure à quatre ferïis. La mefure à | eft très-pro?
pre à. exprimer ledéfefpoir, fur-tout quand il eft
mêlé d’un fentiment tendre. La mefure à § ne fouffre
ni une trop grande lenreur, ni une trop grande
vîteffe.
Avant de continuer, il faut obférver que fouvent
c’eft la faute du poète quand le muficien choifit mal
la mefure. Lorfque le rhythme d’un air demande une
mefure à trois tems, Sc que l’expreffion en demandé
une à quatre, le compofiteur eft embàrraffé, & choifit
d’ordinaire la mefure convenable au rhythme ; & il
a raifon , parce que la fauffe expreffion de la mefure
peut fe pallier, mais jamais le défaut de profodie.
Le mode majeur eft propre à la gaieté , à la gravité
, à la colere, à l’em-portement, à la trifteffe même
, mais non à u’n.é trifteffe auffi douce , auffi touchante
que celle du mode mineur.
Le mode mineur eft doux , tendre ; il a quelque
chofe d’affligeant ; il peut bien exprimer un emportement
douloureux ; mais de la colere , de la fureur,
jamais.
Que font cependant plufieurs muficiens ? Ils per-
vertiffent ces propriétés : ils veulent exprimer une
profonde trifteffe par le mode majeur, 6c une violente
cplérè par le mineur. Ils rép;ffiffent fouvent,
me répliquera-t-on. O u i, comme une femme réuffit
à devenir homme , en prenant fes habits-.
Je dis plus : ce font ces tours de force en mufique
qui perdent l’art. Que fera le compofiteur-pour pallier
la force du mode majeur dans unair trifte & touchant
? Il prpdiguera. les diffonances mineutés, il entrelacera
fon harmonie d’accords, mineurs, il accompagnera
fa mélodie de flûtes, de cors, de violons
avec des fourdines : 6c en attendant il nous accoutume
mal-à-propos à toutes ces reffources de l’a r t ,
q u i, bien ménagées, peuvent produire le plus grand
effet, 6c le tout; pour ne pas fe fervir du mode mineur
quand il le faudroit.
Ce n’eft pas tout : la même mélodie exécutée dans
les tons les plus graves, doit produire un effet différent
de celui qu’elle produiroit dans- des tons plus
aigus. Si la mélodie exprime quelque choie de gai >
plus on la portera au grave, plus on diminuera cetté
gaieté : on pourra même la diminuer tellement qu’en-
nn l’ effet en fera nul : paffé ce point, je crois que
cette mélodie deviendra ridicule , à caufe clu con-
i trefensvdu ton avec le chant ; tout, comme une déela-
I ration d’amour tendre & paffionnée , devient ridi-
| cule dans la bouche d’un grave vieillard.
Unemélodie douce & tendre , 1e paroîtrâ toujours
i plus quand elle fera jouée par une flûte , que quand
on l’exécute fur le violon : le violon lui ôtera moins
de fa douceur que le hautbois ; 6c celui-ci moins qüé
la trompette. Quant au cor-de-chaffe , c’èft, à mon
avis, un infiniment dont on peut tirer un très-grand
parti; mais peu de mélodies peuvent s’éxécuter e'rt
entier fur cet inftrument : ainfi, fon plus grand ufage *
fera.dans l'accompagnement.
Une marche guerrierel’eft bien plus aveédes trompettes,
qu’avec des hautbois; avec des hautbois*