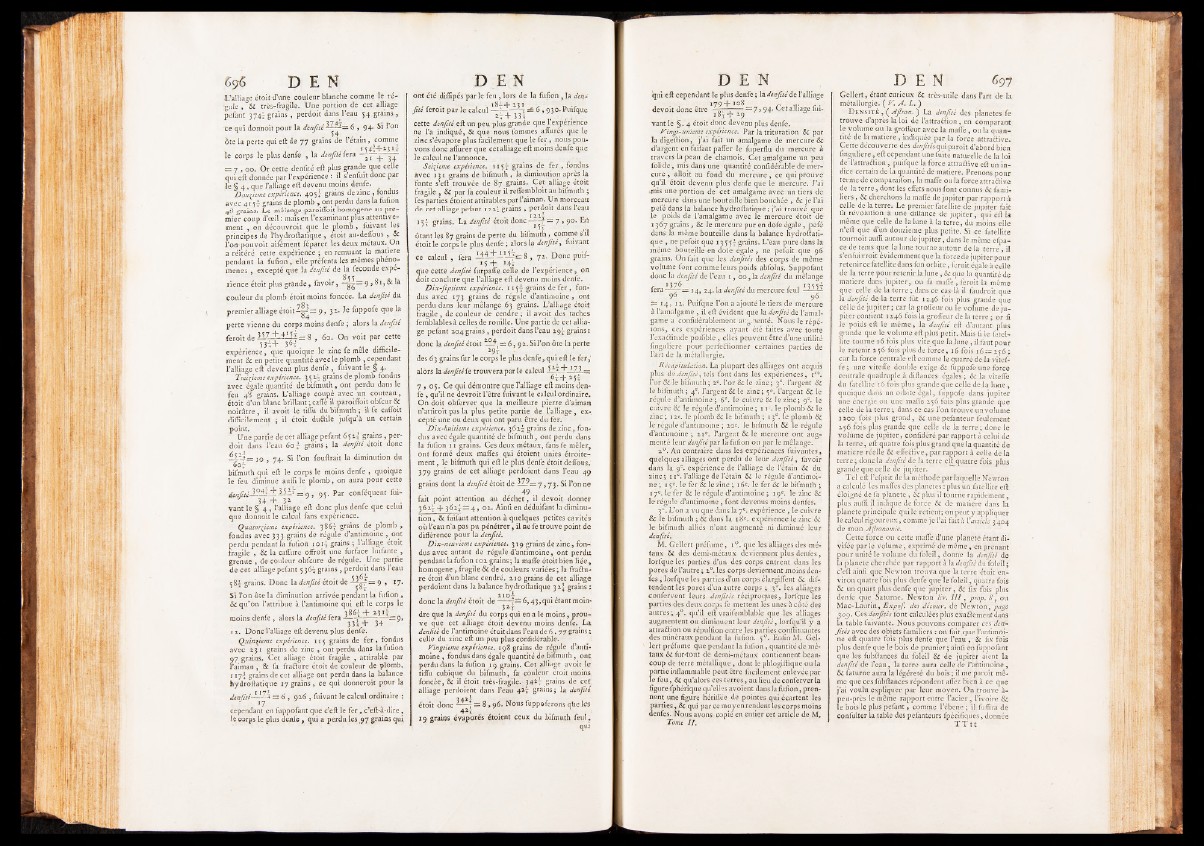
L’alliage étoit d’une couleur blanche comme le té-
teille , 8c très-fragile. 'Une portion de cet alliage
pefant 3747 grains , perdoit dans l ’eau 54 grains ,
te qui donnôit pour la d'enjité^-^zn 6 , 94* Si 1 on
ote la perte qui eft de 77 grains de l’étain , comme
• 154^+131,7
le corps le plus denle , la denjitéfera aI ^4
c= 7 ,, 00. Or cette denfité eft plus grande que celle
qui eft donnée par l’expérience : il s’enfuit donc par
le § 4 , que l’alliage eft devenu moins denfe.
Douzième expérience. 405 7 grains de zinc , tondus
avec 4157 grains de plomb > ont perdu dans la fufion
48 grains. Le mélange pàroiffoit homogène au premier
coup d’oeil : mais en l’examinant plus attentivement
, on découvroit que le plomo., fuivant les
principes de l ’hydroftatique , etoit au-deffous , Sc
l’on-pou voit aiiement féparer les deux métaux. On
a réitéré cette expérience ; en remuant la matière
penda nt la fufion, elle préfenta les mêmes phénomènes
, excepté que la denjité de la fécondé expérience
étoit plus grànde, favoir , — 9, 8i, & la
couleur du plomb étoit moins foncée. La denjité du
premier alliage é to it -^ j= 9 , 32, Ie fupp°^e ffue la
perte vienne du corps moins denfe ; alors la denjitc
feroit de —35.7 + .4J 5t _=c 8 , do. On voit par cette
expérience, que quoique le zinc fe mêle difficilement
6c en petite quantité avec le plomb , cependant
l ’alliage eft devenu plus denfe , fuivant le § 4’
Treizième expérience. 3 5 2 a grains de plomb fondus
avec égale quantité de bifmuth, ont perdu dans le
feu 48 grains. L’alliage coupé avec un couteau,
étoit d’un blanc brillant ; cafte il pàroiffoit obfcur 8c
noirâtre , il'- avoit le tiffu du bifmuth ; il fe caffoit
difficilement ; il étoit duttile jufqu’à un certain
point. . .
Une partie de cet alliage pefant 6 5ï j grains , perdoit
dans l’eau 60 7 grains ; la denjité étoit donc
z l z4 =: 10 , 74. Si l’on fouftrâit la diminution du
(ÿOf
bifmuth qui eft le corps le moins denfe , quoique
le feu diminue aulîi le plomb, on aura pour cette
9 , 95. Par conféquent fuivant
le § 4 , l’alliage eft donc plus denfe que celui
que donnoitle calcul fans expérience.
Quatorzième expérience. 3867 grains de plomb ,
fondus avec 333 grains de régule d’antimoine , ont
perdu pendant la fufion ioi-j grains ; l’alliage etoit
fragile , 8c la caffure offroit une furface luifante ,
grenue , de couleur obfcure de régule. Une partie
de cet alliage pefant 5367 grains , perdoit dans l’eau
587 grains. Donc la denjité étoit de — ^7 = 9 , 17.
Si l’on ôte la diminution arrivée pendant la fufion ,
ÔC qu’on l’attribue à l’antimoine qui eft le corps le
moins denfe , alors la denjité fera +~~3
i z . Donc l’alliage eu devenu plus denfe.
Quinzième expérience. 115 grains de f e r , fondus
avec 23 1 grains de zinc , ont perdu dans la fufion
97 grains. Cet alliage étoit fragile , attirable par
l’aiman , & fa fra&ure étoit de couleur de plomb.
1177 grains de cet alliage ont perdu dans la balance
hydroftatique 17 grains, ce qui donneroit pour là
d e n f i t é 4 = 6 , 926 , fuivant le calcul ordinaire :
B ■ . WM
cependant en fuppofant que c’eft le fe r , c’eft-à-dire,
le corps le plus denfe, qui a perdu les ,97 grains qui
ont été diffipés parle feu , lors de la fufion, la deh~
Jîté feroit par le calcul ■ * A: 6 ,9 36 . Puifque
cette denjité eft un peu plus grande que l’experience
ne l’a indiqué, & que nous fommes affurés que le
zinc s’évapore plus facilement que le fe r , nous pouvons
donc,affurer que cet alliage eft moins denfe que
le calcul ne l’annonce.
Seizième expérience. 1157 grains de fer , fondus
avec 131 grains de bifmuth , la diminution apres la
fonte s’eft trouvée de 87 grains. Cet alliage étoit
fragile , 8c par fa couleur il reffembloit au bifmuth ;
fes parties étoient attirables par l’aiman. Un morceau
de cet alliage pefant i z z î grains , perdoit dans l’eau
15Î gtains. La denjité étoit donc “ 7^1= 7 » 90, ^
ôtant les 87 grains de perte du bifmuth, comme s il
étoit le corps le plus denfe ; alors la denjite, fuivant
ée calcul B U 14i i ? + = 8 , 7*. Donc puif-
15 ■+■ !4*
que Cette denjité furpaffe celle de l’expérience, on
doit conclure que l’alliage eft devenu moins denfe.
Dix-feptieme expérience. 115-3- grains de fer , fondus
avec 173 grains de régule d’antimoine, ont
perdu dans leur mélange 63 grains. L’alliage étoit
fragile, de couleur de cendre ; il avoit des taches
femblables à celles de rouille. Une partie de Cet alliage
pefant 204 grains, perdoit dans l’eau 297 grains :
donc la denjité étoit 6 ,9 2 . Si l’on ôte la perte
des 63 grains fur le corps le plus denfe, qui eft le fer,
alors la denfité fe trouvera par le calcul —-
6 7+25Ÿ
7 , 0$. Ce qui démontre que l’alliage eft moins denfe
, qu’il ne devroit l ’être fuivant le calcul ordinaire.
On doit obferver que la meilleure pierre d’aiman
n’attiroit pas la plus petite partie de l’alliage , ex-,
cepté une ou deux qui ont paru être du fer.
Dix-huitieme expérience. 3627 grains de zinc., fondus
avec égale quantité de bifmuth, ont perdu dans
la fufion 11 grains. Ces deux métaux, fans fe mêler,
ont formé deux maffes qui étoient unies étroitement
, le bifmuth qui eft le plus denfe etoit deffous.
379 grains de cet alliage perdoient dans l’eau 49
grains dont la denjité étoit de 2Z ?= 7 ,7 3 . Si l’on ne
■ 4 9 ., , . ,
fait point attention au dechet, il devoit donner
3627 + 3627 — 4 , 02. Ainfi en déduifant la diminution
, & faifant attention à quelques petites cavités
oii l’eau n’a pas pu pénétrer, il ne fe trouve point de
différence pour la denjité.
Dix-neuvieme expérience. 319 grains de zinc , fondus
avec autant de régule d’antimoine, ont perdu
pendant la fufion ï 02 grains ; la maffe étoit bien liée ,
homogène, fragile 8c de couleurs variées ; la fraâu-
re étoit d’un blanc cendré. 210 grains de cet alliage
perdoient dans la balance hydroftatique 3 27 grains :
, 2107 . . ,
donc la denjité etoit de 6 ,43,qui étant momdre
que la denjité du corps qui en a le moins, prouve
que cet alliage étoit devenu moins denfe. La
denfité de l’antimoine étoit dans l’eau de 6 ,7 7 grains;
celle du zinc eft un peu plus confidérable.
Vingtième expérience. 198 grains de régule d’antimoine
, fondus dans égale quantité de_ bifmuth, ont
perdu dans la fufion 19 grains. Cet alliage avoit le
tiffu cubique du bifmuth, fa' couleur étoit moins
foncée, 8c il étoit très-fragile. 342,ï grains de cet
alliage perdoient dans l’eau 427 grains ; la denjité
étoit donc = 8 ,9 6 . Nous fuppoferons qùe les
427
19 grains évaporés étoient ceux du bifmuth feul,
qui
qui eft cependant le plus denfe ; la dtnjité de l’alliage
. . . A 179 + 10 8 H I ... . .
devoit donc etre —0 -----— 7 j 94* alliage fui-
18 7+ 2 9
vant le § . 4 étoit donc devenu plus denfe.
Vingt-unieme expérience. Par la trituration 8c par
la digeftion, j’ai fait un amalgame de mercure 8c
d’argent en faifant paffer le fuperflu du mercure à
travers la peau de chamois. Cet amalgame un peu
folide , mis dans une quantité confidérable de mercure
, alloit au fond du mercure, ce qui prouve
qu’il etoit devenu plus denfe que le mercure. J’ai
*mis une portion de cet amalgame avec un tiers de
mercure dans une bouteille bien bouchée , 8c je l’ai
pefé dans la balance hydroftatique ; j’ai trouvé que
le poids de l ’amalgame avec le mercure étoit de
1367 grains, 8c le mercure pur en dofe égale, pefé
dans la même bouteille dans la balance hydroftatique
, ne pefoit que 13 557 grains. L’eau pure dans la
même bouteille en dofe égale , ne pefoit que 96
grains. On fait que les denjîtés des corps de même
volume font comme leurs poids abfolus. Suppofant
donc la denjité de l’eau 1 , ô o , la denjité du mélange
fera — 7 — 14, 24. la denfité du mercure feul — - —
1 96 Wmm J m mm
==14, 12. Puifque l’on a ajouté le tiers de mercure
à l’amalgame , il eft évident que la denjité de l’amalgame
a eonfidérablement augmenté. Nous le répétons,
ces expériences ayant été faites avec toute
l’exactitude poffible , elles peuvent être d’une utilité
finguliere pour perfe&ionner certaines parties de
l’art de la métallurgie.
Récapitulation. La plupart des alliages ont acquis
plus de denjitéi tels font dans les expériences, i re.
l’or Sc ie bifmuth; 2e. l’or 8c le zinc; 3e. l’argent 8c
le bifmuth; 4e. l’argent8c le zinc; 5e. l’argent 8c le
régule d’antimoine ; 6e. le cuivre 8c le zinc; 9e. le
cuivre 8c le régule d’antimoine ; 1 r ‘. le plomb 8c te
zinc; 12«. le plomb 8c le bifmuth ; 13e. le plomb 8c
le régule d’antimoine ; 20e. le bifmuth 8c le régule
d’antimoine; 21e. l’argent 8c le mercure ont augmenté
leur denjité par la fufion ou par le mélange.
20. Au contraire dans les expériences fuivantes,
quelques alliages ont perdu de leur denjité, favoir
dans la 9e. expérience de l’alliage de l’étain 8c du
zinc; 11e. l’alliage de l’étain 8c le régule d’antimoine
; 15e. le fer 8c le zinc ; 16e. le fer 8c le bifmuth ;
17e. le fer 8c lé régule d’antimoine ; 19e. le zinc 8c
le régule d’antimoinè , font devenus moins denfes.
30. L’on a vu que dans la 7e. expérience, le cuiyre
8c le bifmuth ; 8c dans la 18e. expérience le zinc 8c
le bifmuth alliés n’ont augmenté ni diminué leur
denjité.
M. Gellert préfume, 1?. que les alliages des métaux
8c des demi-métaux deviennent plus denfes,
lorfque les parties d’un des corps entrent dans les
pores de l’autre ; 20. les corps deviennent moins déniés,,
lorfque les parties d’un corps élargiffent 8c dif-
tendent les pores d’un autre corps ; 30. les alliages
confervent leurs denjités réciproques, lorfque les
parties des deux corps fe mettent les unes à côté des
autres ; 40. qu’il eft vraifemblable que les alliages
augmentent ou diminuent leur denjité, lorfqu’il y a
attra&ion ou répulfion entre les parties conftituantes
des minéraux pendant la fufion. 50. Enfin M. Gellert
préfume que pendant la fufion, quantité de métaux
8c fur-tout de demi-métaux contiennent beaucoup
de terre métallique, dont le phlogiftique ou la
partie inflammable peut être facilement enlevée par
le feu, 8c qu’alors ces terres, au lieu de conferver la
figure fphérique qu’elles avoient dans la fufion, prennent
une figure hériflee de pointes qui écartent les
parties, 8c qui par ce moyen rendent les corps moins
denfes. Nous avons copié en entier cet article de M.
Tome II.
Gellert, étant curieux 8c très-utile dans Part de la
métallurgie. ( V. A. L. )
D ensité , ( Ajlron. ) La denjité des planètes fe
trouve d’après la loi de l’attrattion, en comparant
le volume ou I51 groflèur avec la maffe, ou la quantité
de la matière , indiquée par la force attraftive.
Cette découverte des denfuésqui paroîtd’abord bien
• finguliere, eft cependant une fuite naturelle de la loi
dé l’attra&ion, puifque la force attraûive eft un indice
certain de la quantité de matière. Prenons pour
terme de comparaifon, la maffe ou la force attractive
de la terre, dont Les effets nous font connus 8c familiers
, 8c cherchons la maffé de jupiter par rapport à
celle de la terre. Le premier fatellite de jupiter fait
fa révolution à une diftance de jupiter, qui eft la
même que celle de la lune à la terre, du moins elle
n’eft que d’un douzième plus petite. Si ce fatellite
tournoit auffi autour de jupiter, dans le même efpa-
ce de tems que la lune tourne autour de la terre , il
s’enfuivroit évidemment que la force de jupiter pour
retenirce fatellite dans fon orbite, feroit égale à celle
de la terre pour retenir la lune, 8c que la quantité de
matière dans jupiter, ou fa maffe, feroit la même
que celle de la terre ; dans eè cas-là il faudroi.t que
la denjité de la terre fût 1246 fois plus grande que
celle de jupiter ; car la groffeur ou le volume de jupiter
contient 1246 fois la groffeur de la terre ; or fi
le poids eft le même, la denjité eft d’autant plus
grande que le volume eft plus petit. Mais fi le fatellite
tourne 16 fois plus vite que la lune, il faut pour
le retenir 256 fois plus de force, 16 fois 16 = 2 5 6 ;
car la force centrale eft comme le quarré de la vîtef-
fe ; une viteffe double exige 8c fuppofe une force
centrale quadruple à. diftances égales ; 8c la vîteffe
du fatellite ï6 fois plus grande que celle d elà lune,
quoique dans un orbite égal, fuppofe dans jupiter
une énergie ou une maffe 256 fois plus grande que
celle de la terre ; dans ce cas l’on trouve un volume
1100 fois plus grand, 8c une pefanteur feulement
256 fois plus grande que celle de la terre ; donc le
volùme de jupiter, cônfidéré. par rapport à celui de
la terre, eft quatre fois plus grand que la quantité de
matière réelle 8c effeftive, par rapport à celle de la
terre ; donc la denjité de la terre efteptatre fois plus
grande que celle de jupiter.
Tel eft l’efprit de la méthode par laquelle Newton
a calculé les maffes des planètes : plus un fatellite eft
éloigné de fa planete, 8c plus il tourne rapidement,
plus auffi il indique de force 8c de matière dans la
planete principale qui le retient; on peut y appliquer
le calcul rigoureux, comme je l’ai fait à V article 3404
de mon Aflronomie.
. ; Çette force ou cette maffe d’une planeté étant di-
vifée par le volume, exprimé de même, èn prenant
pour unité le volume du foleil, donne la denfité de
la planete cherchée par rapport à la denjité du foleil ;
c’eft àinfi que Newton trouva que la terre étoit environ
quatre fois plus denfe que le foleil, quatre fois
8c un quart plus denfe que jupiter, 8c fix fois plus
denfe que Saturne. Newton liv. I I I , prop. 8 , ou
Mac-Laurin, Expof. des découv. de Newton., page
309. Ces denfttés font calculées plus exactement dans
la table fuivante. Nous pouvons comparer ces denjités
avec des objets familiers : on fait que l’antimoine
eft quatre fois plus denfe que l’eau , & fix fois
plus denfe que le bois de prunier; ainfi en fuppofant
que les fubftances du foleil 8c de jupirer aient la
denfité de l’eàù,Ta terre aura celle de l’antimoine,
8c faturne aura la légéreté du bois ; il me paroît même
que ces.fnbftances répondent affez bien à ce que
j’ai voulu expliquer par leur moyen. On trouve à-
peu-près le même rapport entre l’acier, l’ivoire 8c
le bois, le plus pefant, comme l’ébene ; il fuffira de
confulter la table des pefanteurs fpécifiques, donnée
T T tt