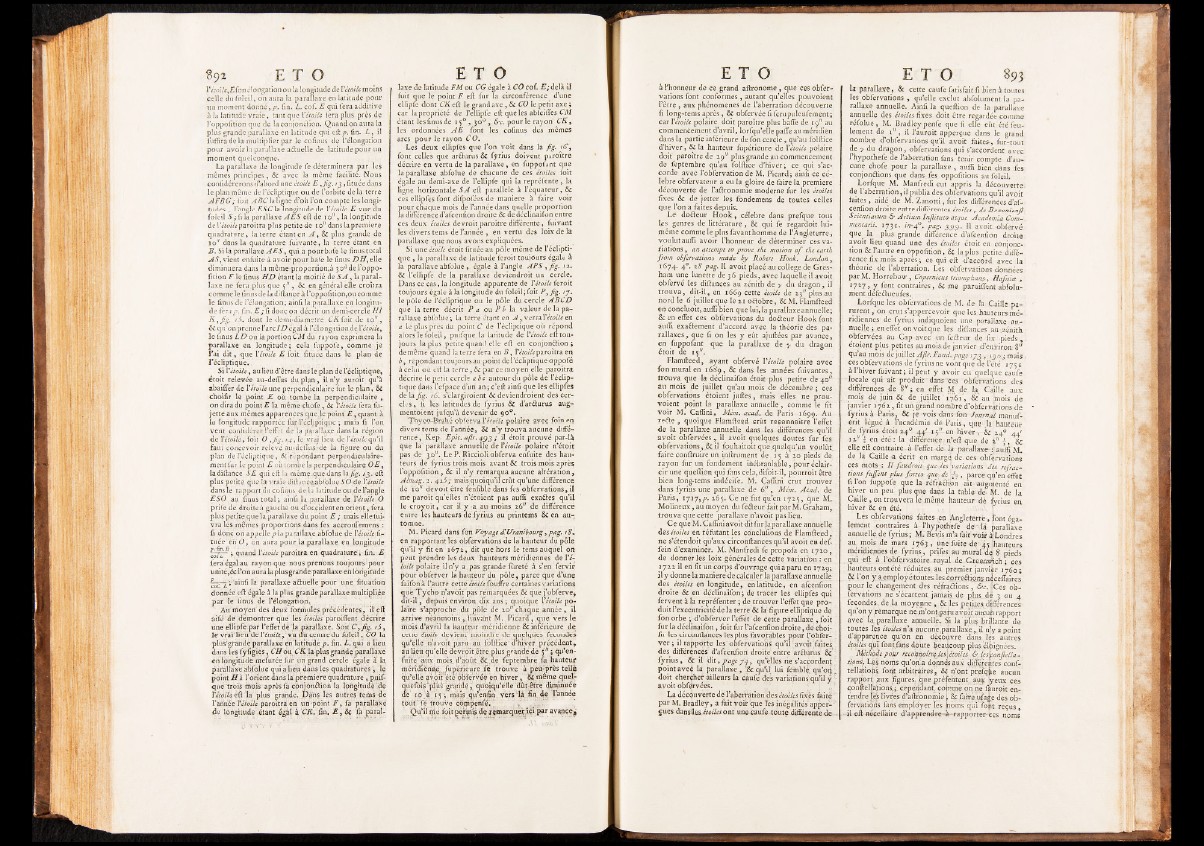
Y ètoilt,E(on élongation ou la longitude de Y étoile moins
celle du foleil, on aura la parallaxe en latitude pour
un moment donné,/>,. fin. L. cof. E qui fera additive
à la latitude vraie, tant que Y étoile fera plus près de j
J’oppofîtion que de la conjonction. Quand on auraIp
plus grande parallaxe en latitude qui eft p. fin. L , il
fuffira de là multiplier par le cofinus de l’élongation
pour avoir la parallaxe actuelle de latitude pour un
moment quelconque.
La parallaxe de longitude fe déterminera par les
mêmes principes, & avec la même facilité. Nous
confidérerons d’abord une étoile E ,fig. 13 , fituée dans
le plan même de l’écliptique ou de l’orbite de la terre
A F BG ; foit A B C la ligne d’oît l’on compte les longitudes
, l’angle ESC la longitude de Y étoile E vue du
foleil S ; fi la parallaxe A E S eft de \ou , la longitude
de Y étoile paroîtra plus petite de ioH dans la première
quadrature, la terre étant en A , & plus grande de
10" dans la quadrature fuivante,. la terre étant en
B. Si la parallaxe A E S , qui a potirbafe le finustotal
A S , vient enfuite à avoir pour bâfe le finus DH, elle
diminuera dans la même prôportion;à 3od de l’oppo-
fition F le fintis HD étant la moitié de S A , la parai--,
laxe ne fera plus que y1' , & en général elle croîtra
comme le finus de la diftance à l’oppofition,ou comme
le finus de l’élongation; ainfi la parallaxe.en longitude
fera p. fin. E ; fi donc on décrit-un demi-cercle HI
K , fig. iS. dont le demi-diametre C’if fo it de iO ;,
& qu’on prenne l’arc ID égal à l’élongation de Y étoile,
le finus L D oii la portion CM du rayon exprimera la
parallaxe en longitude; cela fuppofe, comme je
l’ai d i t , que Y étoile E foit fituée dans le plan de
l ’écliptique..
Si Y étoile, au lieu d’être dans le plan de l’écliptique,
étoit relevée au-deflûs du plan, il n’y auroit qu’à
abaiffer de Y étoile une perpendiculaire fur le plan, &
choifir le point E où tombe la perpendiculaire ,
on dira du point £ la même çkofe, & Y étoile fera fu-
jette aux mêmes apparences quefte point E , quant .à,
la longitude rapportée fur l’épliptique ; mais fi i’on
veut confidérer l’effet de la p'araü&x.e dans la région
de Y étoile, foit O ,fig. nM le.- vrailieu de Y étoile qu’il
feut concevoir relevé au-deffns.<de la figure ou du
plan de l’écliptique, & répondant perpendiculairement
fur le point E oii tompe la perpendiculaire O E ,
la diftance S E qui eft la même-.que dans la fig. /J. eft
plus 'petite que la vraie diftauçeabfolue SO de Yétoile
dans le rapport du cofinus de la latitude ou de l’angle
ESO au finustotal; ainfi la parallaxe de Y étoile O
prile de droite à gauche oud’occident en orientjfera
plus petite que la parallaxe du point E ; mais ellefui*
vra les niêmes proportions dans fes accroiffemens :
fi donc ori appelle p la parallaxe abfolue de Yétÿlefxf
tuée'èn'O, on aura pour, la parallaxe en lpngitude
qMand Y étoile paroîtra: en quadrature;ûn. E
fera égal au rayon, que nous prenons toujours1 pour
iinitéj&l’Dn aura la plusgrânde parallaxe eft lôdgifude
;'âinfi la parallaxe aftüelle pour une fituation
donnée eft égale à la plus grande parallaxe multipliée
par le finus de l’élongation. ..•!
Au moyen' des detix formules précédentes, il eft
aifé dë démontrer que les étoiles paroiffent décrire
une ellipfe.par l’effet dè la parallaxe. Soit C , fig. 16,
le vrai' liéii’de Y étoile, vu du centre du foleil, CO la
pliiS'gfânde parallaxe en1 latitude p. fin. Z., qui à fieu
dans les fyfigiês, CH ou CK îaplus grande parallaxe
en longitude mefurée fur ûri grand cerclé égale à* la,
parallaxe abfolue qui a lieu dans les quadratures , le;
point Hk l’o ri en t. d ànsîTpr e mi érë quadrature *puif-
que‘trois mois après fa conjônaion la lpngitude'de
Y.etoïti éft là plus grande. Dans les autres te ms de
Y&tiriêe'Yeéoflè.paroîtra en, un*pqmt F , fa parallaxe
lie longitude'/étant é^ Y k C K .fm , E , Sc faparnllaxe
de latitude FM ou CG égale à CO cof. E ; delà 1!
fuit que le point F eft fur la circonférence d’une
ellipfe dont CK eft le grand axe , & CO le petit axe ;
car la propriété de l’ellipfe eft que les ablciffe.s CM
étant les finus de 150 , 30° , &c. pour le rayon' C K ,
les ordonnées A Ê font les cofinus des mêmes
arcs pour le rayon C O.
Les deux ellipfes que l’on voit dans la fig. iC ,
font celles que aréhirus & fyrius doivent paroître
décrire en vertu de la parallaxe, en fuppofant que
la parallaxe abfolue de chacune de ces étoiles foit
égale au demi-axe de l’ellipfe qui la repréfente, la
ligne horizontale SA eft parallèle à l’équateur, &
ces ellipfes font difpofées de maniéré à faire voir
pour chaque mois de l’année dans quelle proportion
la différence d’afeenfion droite & dedéclinaifon entre
ces deux étoiles devroit paroître différente, fuivant
les divers tems de l’année, en vertu des lo ixd ela
parallaxe que nous avons expliquées.
Si une étoile étoit fituée au pôle même de l’écliptique
, la parallaxe de latitude feroit toujôurs égale à
la parallaxe abfolue , égale à l’angle A P S , fig. 12.
& l’ellipfe de la parallaxe deviendroit un cercle.
Dans ce cas, la longitude apparente de Y étoile feroit
toujours égale à la longitude du foleil;foit P, fig. 17.
le pôle de l’écliptique ou le pôle du cercle A BCD
que la terre décrit P a ou P b là valeur de la parallaxe
abfolue; la terre étant en A , verra Y étoile en
a le plus près du point C de l’écliptique où répond
alors le foleil, puifque la latitude de Y étoile eft tour
jours la plus petite quand elle eft en conjonftion ;
demêmëqùànd la terre fera en B , Y étoile paroîtra en
b , répondant toujours au* point de l’écliptique oppofé
à celui oit eft la terre, & parce moyen elle paroîtra
décrire le petit cercle abc autour du pôle de l’écliptique
dans l’efpace d’un an; c’eft ainfi que les ellipfes
de la fig. iC. s’élargiroient & deviendroient des cercles
, fi les latitudes de fyrius & d’ar&urus aug-
méntoient jufqu’à devenir de 90°.
Thyco-Brahé obier va Y étoile polaire avec foin en
divers tems de l’année, & n’y trouva aucune différence
, Kep. Epit. afir. 493 ; il étoit prouvé par-là
que la parallaxe annuelle de Y étoile polaire n’étoit
pas de 30". Le P. Ricçiolxobferva enfuite des hauteurs
de fyrius trois mois avant & trois mois après
l’oppofition , & il n’y remarqua aucune altération ,
AImag. 2. 426 ; mais,quoiqu’il crut qu’une différence
dè IO,, devoit être fénfible dans fes obfervations, il
me paroît qu’elles ri’étoient pas aufli exa&es qu’il
le croyoit, car il y -a au moins z6w de différence
entre les hauteurs ae iyriiis au printems & en automne.
M. Picard dans fon Voyage ÆUranibourg, pag. /<?,
en rapportant les obfervations de la hauteur du pôle
qu’il y fit en 16 7 1 , dit que hors le tems auquel on
peut prendre les deux hauteurs méridiennes de IV-
loilé polaire il n’y a . pas grande fureté à s’en, fervir
pour obfer.ver la hauteur du.pôle, parce que d’une
faifonà l’autre cette étoile fouffre certaines variations
quë'Tÿçho n’avôit pas remarquées ;& que j’pbferve*
dit-il, depuis environ, dix. ans ; quoique Y étoile polaire
s’approche :d,u pôle de 20w chaque année,. il
arrive néàntnoinT,‘fùivànt M. Picard, que. vers le
mois d’avril la hauteur - méridienne & inférieure de
cette étoile devient moindre de quelques fécondés
qu’elle ,n’avoit:"paru-:.?,u folftïce" d-’hiver précédent,
aù lieü qu’elle devroitptré. pliis grande dè x l ; qu'en-
fuiïe'’ aux;mois_ d'goÇit^Ôc ,de feptem.bre fa :hautçujf
méridienne fup‘éfiéüre, fe 'trouve à pèüVprès telle
qu’elle avçit étepbîeryéé çn. hiver, Sc même quel-
qüèfôis ^us'grqnaé* quoiqu’elle ‘dû^êfre diminuée
aë ipjà. i^ ;, niais bjii’en:fin vers 'là fin, de l’année
tout'‘Te trouve' côtppènféi, ’ , . , C ' 'r -.1 .
..Qu’il qté foit gérnu£ de f emarquçç,içi pqr qv^nçeji
à l’honneur de ce grand aftronome , que ces obfervations
font conformes , autant qu’elles pouvoient
l’être , aux phénomènes de l’aberration découverte
fi long-tems après, & obfervée fi fcrupuleufement;
car Y étoile polaire doit paroître plus baffe de 19'' au
commencement d’avril, lorfqu’elle paffe au méridien
dans la partie inférieure de fon cercle, qu’au folftice
d’hiver, & la hauteur fupérieure 'de Y étoile polaire
doit paroître de 19" plus grande au commencement
de feptembre qu’au folftice d’hivér; ce qui s’accorde
avec l’obfervation de M. Picard; ainfi ce célébré
obfervateur a eu la gloire de faire la première
découverte de l’aftronomie moderne fur les étoiles
fixes & de jetter les fondemens de toutes celles
que l’on a faites depuis.
Lë docleur Hook , célébré dans prefque tous
les genres de littérature, & qui fe regardoit lui-
même comme le plus favant homme de l’Angleterre;
voulut aufli avoir l’honneur de déterminer ces variations,
an attempt to prove the motion o f the earth
from obfervations maie by Robert Hook. London,
1674. 40. z8 pag. Il avoit placé au college de Gres-
ham une lunette de 36 pieds, avec laquelle il avoit
obfervé les diftances àu zénith de y du dragon, il
trouva, dit-il, en i6<$c) cette étoile de Z3W pins au
nord le 6 juillet que le 21 o&obre, &M . Flamfteed
en concîuoit, aufli bien que lui, la parallaxe annuelle;
& en effet ces obfervations du dofteur Hook font
aufli exa&ement d’accord avec la théorie des parallaxes,
que fi on les y eût ajuftées par avance,
en fuppofant que la parallaxe de y du dragon
étoit de ly".
Flamfteed, ayant obfervé Y étoile polaire avec
fon mural en 1689, & dans les années fuivantes,
trouva que la dédinaifon étoit plus petite de 40"
au mois de juillet qu’au mois de décembre ; ces •
obfervations ètoient juftës, mais elles ne prou-
voient point la parallaxe annueile, comme le fit
voir M. Caflini, Mèm. acad. de Paris 1699. Au
refte , quoique Flamfteed crût reçonnoître l’effet
de la parallaxe annuelle dans les différences qu’il
avoit o b fe r v é e s i l avoit quelques doutes fur Tes
obfervations,,8cil fouhaitoitqué.quelqu’un .voulût,
faire conftruire un mftrument de 15 à 20 pieds de
rayon fur un. fondement inébranlable, pour éclaircir
une queftion qui fans cela,difoit-il, pourroit être
bien long-tems indécife. M. Caflini crut trouver
dans fyrius unè parallaxe de 6 " , Mém. Acad, de
Paris, 1717,/». 265. Ce ne fu t qu’en 1725, que M.
Molineux, au moyen' du feâeur fait par M. Graham,
trouva que cette parallaxe n’avoit pas lieu.
Ce que M. Caflini avoit dit furjaparallaxe annuelle
des étoiles en réfutant les çônelufions de Flamfteed,
ne s’étendoit qu’aux circohftances qu’il avoit eu def-
fein d’examiner. M. Manfredi fe propofa en 1720,
de donner les loix générales de cette variation : en
1722 il en fit ùn corps d’ouvrage quiaparu en 1729;
il y donne la maniéré de calculer la parallaxe annuellè
des étoiles en longitude, en latitude, en afeenfion
droite & en dédinaifon; de tracer les ellipfes qui
fervent à la repréfenter ; de,trouver l’effet que produit
l’excentricité de la terre & la-figure elliptique dé
fon orbe ; d’obferver l’effet-‘de cette parallaxe , foit
fur la dédinaifon, foit fur l’afcenfîon droite, dé choifir
les circonftances les plus favorables pour i’pbfer7
v e r ; il rapporte les obfervations' qu’il'' avojtTàites
des différences d’afeenfion droite entre ardùrus &
fyrius, & il d i t ,page7 4 , qu’ëllés ne s’accordenÇ
point avec la parallaxe , !& qu’il lui femblè, qu’od ^
doit chercher ailleurs la éàufe des variations; qu’il ÿ |
avoit obfërvées.
La découverte de l’aberration des étoiles fixés faite
par M. Bradleÿ, a fait voir que Tes inégalités apper-!'
Sues dans-les étoiles ont une caufe. toute differente de •
la parallaxe , & cette caufe fatisfait fi bien à toutes
les obfervations , qu’elle exclut abfolument la pa-.
rallaxe annuelle. Ainfi la queftion de la parallaxe
annueile des étoiles fixes doit être regardée comme
réfolue , M. Bradley penfe que fi elle eût été feu-,
lement de 1 " , il l’auroit apperçue dans le grand
nombre d’obfervations qu’il avoit faites-, fur-tout
de y du dragon, obfervations qui s’accordent avec
1 hypothefe de l’aberration fans tenir compte d’aucune
chofe pour la parallaxe , aufli bien dans Tes
conjon&ions que dans fes oppofitions au foleil.
Lorfque M. Manfredi eut appris la découverte,
de l’aberration, il publia des obfervations qu’il avoit
faites, aidé de M. Zanotti, fur les différences d’af--
cenfion droite entre différentes étoiles, de Bononienß
Scientiarum & Artium lnfiituto atque Acadernia Com- ,
mentarii. 1731. in-40. pag. 39 9 . Il avoit obfervé
que la plus grande différence d’afeenfion droite
avoit lieu quand une des étoiles étoit en conjonction
& l’autre en oppofition, & la plus petite différence
fix mois après;, ce qui eft d’accord avec la
théorie de l’aberration. Les obfervations données
par M. Horrebow, Copernicus triomphants, Hafnia ,
1717 ),y font contraires, & me paroiffent abfolu-
ment defe&ueufes.,
Lorfque les obfervations de M. de là Caille: parurent
,: on crut s’appercevoir que les. hauteurs me- .
ridiennes de fyrius indiquoient Une parallaxe an-
effet on voit que les diftances .au ^zénith
obfervées au Cap avec un fefteur de fix pieds
etoient plus petites au mois de janvier d’ejiyir.on 8"
qu au mots de juillet Aßr. F~und. pa.gt 173. 4 "i.ÿo’j mais ;
ces obfervations de fyrius ne vont que de l’été 1751
à l’hiver fuivant; il peut y avoir eu"quelque caufe
-locale qui ait produit' dansxes obfefvâfions des.
différences -de 8" ; en. effe,t de la^ Caille aux
mois de juin & de Jüiliët ‘ 176 if, & au :mois de
janvier 1762, fit un grand nombre d’obfervations de
fyrius à Paris. & }e -voïs 6tm$-fon Joumal manuf-
crit légué à l’académie dé Paris, que la hauteur
de fyrius étoit 240- 44/--i-yîLen hiverv-& 240 44'
12" j en été: la différence?n’eft que de i " f &
elle eft contraire.à l’effet de^la paralIaxe-laufÇ M.
de la Caille/a écrit en m^rgé de. ces obf^rvations
ces mots-: I l faiidroj.tr quelles \variadotis 'dès refractions
fufient plus fortes- que-?, de , parce qu’en effet
fi l’on fuppofe que la -réfracHôn ait- augmenté en
hiver un peu plus quq daçs la table-de- de la
Caillé, on trouvera le-même hauteur dè fyrius en
hiver & en été.
Les obfervations faites ,ep iAngletérrè-, font également
contraires à l’hypothefe dë -13- parallaxe
annuelle de fyrius; M* Beyis m’a fait voir ^Londres
au-mois ,de mars 1763 , une fuite dé f i t »hauteurs
méridiennes de fyrius , prifesl au mural'dè 8 pieds
qui eft à l’obfervatoire royal de GreensÄch ; ces
hauteurs,.ont été réduites, au premier janvier 1760;
& l’on y a_ëmpIoyétoutes les cprr.eâiûns.nfceffaires
pour le changement 4es réfraftions, &c. jCes ob-
fèrvàtiorfs ne s’écartent jamais de plus d| 3 ou 4
fecohdes-.de.la moyenne, & les peti^eAdffférencës
qu’on y Remarqué nem’ont.pafu a vp iraittuh rapport
avec' la, parallaxe apnuellç, Si la ’pfu^ brillante de
toutes lès étoiles n’a ,aucune ,pàrallaxq , .il n’y a point
d’apparence qu’on .en découvre ‘dàn& j è s autres
étoiles quj font,fans dôute beaucoup plus élbignées.
M^éthQ&e pour recoqhoitr^lesJ étoiles. . &v (eshonfiella -
iions,. L£$ nonjs qu’oiTa donnés aux différentes conf-
tèllàtions foqt arbitraires^ &f n’pnt prefqpe aucun
rapport; gux figures, que présentent, àiix 'yeux ces
çonftelfaïions,;. cependant, comme ou ne fàuroit entendre
livres d’aftrônomie l & faire Wa|e des ob-
fervations fans employer les noms qui font reçus
-il eft néceffaire d’apprendre 4 - rapporter ces noms