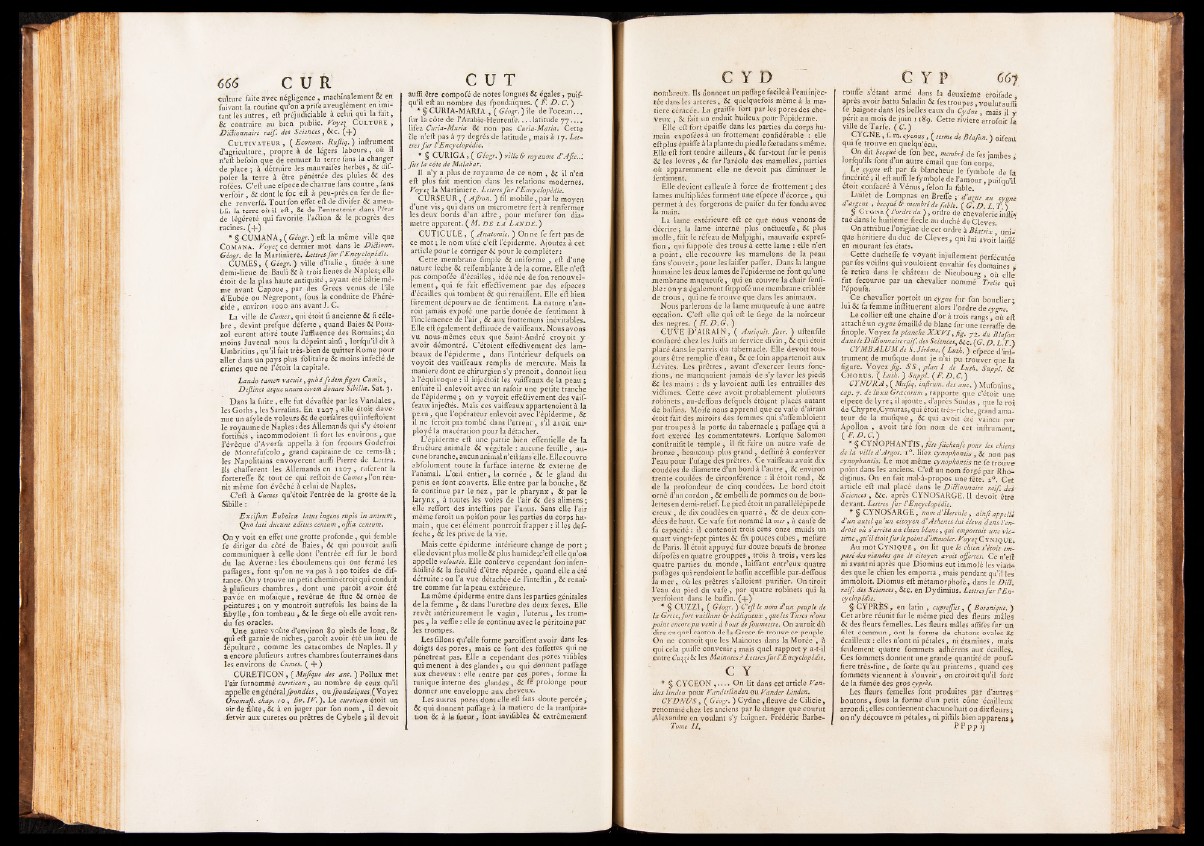
Ira
I | i
culture faite avec négligence , machinalement 6c en
fuivant la routine qu’on a prife aveuglément en imitant
lès autres, eft préjudiciable à celui qui la fait,
& contraire au bien public. Voye{ C u lture ,
Dictionnaire faif. des Sciences , & c . (+ )
C u l t iv at eu r , ( Econom. Rujliq. ) inftrument
d’agriculture., propre à de légers labours, oii il
n’eft befoin que de remuer la terre fans la changer
de place ; à détruire les mauvaifes herbes, 6c dif-
pofer la terre à être pénétrée des pluies 6c des
rofées. C ’eft une efpece de charrue fans coutre, fans
verfoir , 6c dont le foc eft à peu-près en fer de fléché
renverfé. Tout fon effet eft de divifer 6c ameublir
la terre oîi il e ft , & de l’entretenir dans l’état
de légérefé qui favorife l’aâion & le progrès des
racines. (+ )
* § CUMANA,(£éogr.) eft la même ville que
C oman a. Voye^ ce dernier mot dans le Dictionn.
Géogr. de la Martiniere. Lettres fur T Encyclopédie.
CUMES, ( Géogr. ) ville d’Italie , fituée à une
demi-lieue de Bauli 6c à trois lieues de Naples; elle
étoit de la plus haute antiquité, ayant été bâtie même
avant Capoue, par des Grecs venus de l’île
d’Eubée ou Négrepont, fous la conduite de Phéré-
cide , environ 1000 ans avant J. C.
La ville de Cumes, qui étoit fi ancienne & fi célébré
, devint prefque déferte , quand Baies 6c Pouz-
zoi eurent attiré toute l’affluence des Romains; du
moins Juvenal nous la dépeint ainfi , lorfqu’il dit à
Umbritius, qu’il fait très-bien de quitter Rome pour
aller dans un pays plus folitaire 6c moins infeâé de
crimes que ne l’étoit la capitale.
Lando tamen vacuis, quod fedem figere Cumis,
Dejtinet atque unum ciyem donare Sibilla. Sat. 3.
Dans la fuite , elle fut dévaftée par les Vandales,
les Goths , les Sarrafins. En 1107 , elle étoit devenue
un afy le de voleurs 6c de corfaires qui infeftoient
le royaume de Naples : des Allemands qui s’y étoient
fortifiés , incommodoient 'fi fort les environs, que
l’évêque d’Averfa appella à fon fecours Godefroi
de Montefufcolo., grand capitaine de ce tems-là ;
les Napolitains envoyèrent auffi Pierre de Lettra.
Ils chafferent les Allemands en 1 107 , raferent la
fortereffe & tout ce qui reftoit de Cumes, l’on réunit
même fon évêché à celui de Naples.
C’eft à Cumes qu’étoit l’entrée de la grotte de la
Sibille : ‘
Excifum Euboicce latus ingens rupis in antrum,
Que lati ducunt aditus centum, ojiia centum.
On y voit en effet une grotte profonde, qui femble
fe diriger du côté de Baies, & qui pouvoit auffi
communiquer à celle dont l’entrée eft fur le bord
du lac Averne : les éboulemens qui ont fermé les
paffages, font qu’on ne va pas à 100 toifes de distance.
On y trouve un petit chemin étroit qui conduit
à plufieurs chambres, dont une paroît avoir été
pavée en mofaïque, revêtue de ftuc & ornée de
peintures ; on y montroit autrefois les bains de la
fib y lle , fon tombeau, & le fiege oit elle avoit rendu
fes oracles.
Une autre voûte d’environ 80 pieds de lo n g ,&
qui eft garnie de niches, paroît avoir été un lieu de
lepulture, comme les catacombes de Naples. Il y
a encore plufieurs autres chambres fouterraines dans
les environs de Cumes. ( + )
CURETICON, ( Mujique des anc. ) Pollux met
l’air furnommé cureticon, au nombre de ceux qu’il
appelle en général fpondêes, ou fpondaïquesf Voyez
Onomajt. chap. 10 , Liv.IV.'). Le cureticon étoit un
air de flûte, & à en juger par fon nom , il devoit
fervir aux curetes ou prêtres de Cybele ; il devoit
auffi être compofé de notes longues & égales, puif-
qu’il eft au nombre des fpondaïques. ( F. D. C. )
* § CURIA-MARIA , ( Géogr.) \le de l’oceàn...
fur la côte de l’Arabie-Heureule.. . . latitude 7 7 . . . .
lifez Curia-Murin 6c non pas Curia-Maria. Cette
île n’eft pas à 77 degrés de latitude, mais à 17. Lettres
fur F Encyclopédie. -
* § CURIGA, ( Géogr. ) ville & royaume cCAjie.,'.
fu t la côte de Malabar.’
Il n’y a plus de royaume de ce nom , & il n’en
eft plus fait mention dans les relations modernes.
Voye^ la Martiniere. Lettres fur l'Encyclopédie.
CURSEUR, ( AJlron. ) fil mobile, par le moyen
d’une v is , qui dans un micromètre fert à renfermer
les deux bords d’un aftre , pour mefùrer fon diamètre
apparent. ( Af. d e l a L a n dé . )
CU T ICU LE , ( Anatomie. ) On ne fe fert pas de
Ce mot ; le nom ufité, c’eft l’épiderme. Ajoutez à cet
article pour le corriger 6c pour le compléter:
Cette membrane fimpie 6c uniforme , eft d’une
nature feche & rëffemblante à de la corne. Elle n’eft
pais compofée d’écailles, idée née de fon renouvellement
, qui fe fait effeâivement par des efpeces
d’écailles qui tombent 6c qui renaiffent. Elle eft bien
fûrement dépourvue de fentiment. La nature n’au-
roit jamais expofé une partie douée de fentiment à
l’inclémence de l’air , 6c aux frottemens inévitables.
Elle eft également deftituée de vaiffeaux. Nous avons
vu nous^mêmes ceux que Saint-André croyoit .y
avoir démontré. C’étoient effeâivement des lambeaux
de l’épiderme , dans l’intérieur defquels on
voyoit des vaiffeaux remplis de mercure. Mais la
maniéré dont ce chirurgien s’y prenoit, donnoit lieu
à l’équivoque : il injeâoit les vaiffeaux de la peau ;
enfuite il enlevoit avec un rafoir une petite tranche
de l’épiderme ; on y voyoit effeâivement des vaifi-
féaux injeâés. Mais ces vaiffeaux appartenoient à la
peau, que l’opérateur enlevoit avec l’épiderme, 6c
il ne ferçit pas tombé dans l’erreur, s’il avoit employé
la macération pour la détacher.
L’épiderme eft une partie bien effentielle de la
ftruâure animale 6c végétale : aucune feuille , aucune
branche, aucun animal n’eftfans'elle. Elle couvro
abfolument toute la furface interne 6c externe de
l’animal. L’oeil entier, la cornée , 6c le gland du
pénis en font couverts. Elle entre par la bouche, 6c
fe continue par le n e z , par le pharynx, & par le
larynx, à toutes les voies de l’air 6c des alimens ;
elle reffort des inteftins par l’anus. Sans elle l’air
même feroit un poifon pour les parties du corps humain
, que cet élément pourroit frapper : il les défi*
feche, 6c les prive de la vie.
Mais cette épiderme intérieure change de port ;
elle devient plus molle & plus humide;c’eft elle qu’on
appelle veloutée. Elle conl’erve cependant fon infen-
fibilité & la faculté d’être réparée, quand elle a été
détruite : on l’a vue détachée de l’inteftin , 6c renaître
comme fur la peau extérieure.
La même épiderme entre dans les parties génitales
de la femme , 6c dans l’urethre des deux fexes. Elle
revêt intérieurement le vagin , l’uterus , les trompes
, la veffie : elle fe continue avec le péritoine par
les trompes.
Les filions qu’elle forme paroiffent avoir dans les-
doigts des pores, mais ce font des foffettes qui ne
pénètrent pas. Elle a cependant des pores vifibles
qui mènent à des glandes, ou qui donnent paffage
[ aux cheveux : elle rentre par ces pores, forme la
tunique interne des glandes , 6c le prolonge pour
donner une enveloppe aux cheveux.
Les autres pores dont elle eft fans doute percée
& qui donnent paffage à la matière de la trarffpira-
tion & à la fueur, font inyifibles 6c extrêmement
hofiibreûîr. Ils donnent un paffage facile à l’eaiiirijec*
tée dans les arteres, & quelquefois même à la matière
céracée. La graiffe fort parles pores des cheveux
, 6c fait un enduit huileux pour l’épiderme.
Elle eft fort épaiffe dans Jes parties du Corps humain
expofées à un frottement confidérable : elle
eft plus épaiffe à la plante du pied le foetudans s même;
Elle eft fort tendre ailleurs, 6c fur-tout fur le pénis
6c les levres , 6c fur l’aréole des mamelles', parties
où apparemment elle ne devoit pals diminuer le
fentiment.
Elle devient calleufe à forcé de frottement ; des
lames multipliées forment une efpece d’écorce , qui
permet à des forgerons de puifer du fer fondu avec
la main.
La lame extérieure eft ce que nous venons de
décrire; la lame interne plus onâueufe, 6c plus
molle, fait le réfeau de Malpighi, mauvaife expref-
fion , qui fuppofe des’ trous à cette lame : elle n’en
a point, elle recouvre les mamelons.de la peau
fans s’ouvrir, pour les Iaiffer paffer. Dans la langue
humaine les deux lames de l’épiderme ne font qu’une
membrane muqueufe, qui en couvre la chair fenfi-
ble : on y a également fuppofé une membrane criblée
de trous, qui ne fe trouve que dans les animaux.
Nous parlerons de la lame muqueufe à une autre
occafion. C’eft elle qui eft le fiege de la noirceur
des negres. ( H. D . G. )
CUVE D ’AIRAIN, ( Antiquit. fàcr. ) uftenfilô
confacré chez les Juifs au\fervice divin , & q u i étoit
placé dans le parvis du tabernacle. Elle devoit toujours
être remplie d’eau, 6c ce foin appartenoit aux
Lévites. Les prêtres, avant d’exercer leurs fonctions
, né manquoient jamais de s’y laver les pieds
& les mains : ils y lavoient auffi les entrailles des
viâimes. Cette cuve avoit probablement plufieurs
robinets , au-deffous defquels étoipnt placés autant
de baffins. Moïfe nous apprend que ce vafe d’airain
étoit fait des miroirs des femmes qui s’affembloient
par troupes à la porte du tabernacle ; paffage qui a
fort exercé les commentateurs. Lorfque Salomon
conftruifit le temple, il fit faire un autre vafe de
bronze , beaucoup plus |rand , deftiné à eonferver
l’eau pour l’ufage des pretres. Ce vaiffeau aVoit dix
coudées de diamètre d’un borda l’autre, 6c environ
trente coudées de circonférence : il étoit rond, 6c
de la profondeur de cinq coudées. Le bord étoit
orné d’un cordon, 6c embelli de pommes ou de boulettes
en demi-relief. Le pied étoit un parallélépipède
creux , de dix coudées en quarré , 6c de deux con-
dées de haut. Ce vafe fut nommé la mer, à caufe de
fa capacité : il contenoit trois cens onze muids un
quart vingt-fept pintes & fix pouces cubes, mefure
de Paris. Il étoit appuyé fur douze boeufs de bronze
difpofés en quatre grouppes , trois à trois, vers les
quatre parties du monde, laiffant entr’eux quatre
paffages qui rendoient le baffin acceffible par-deffous
la mer,. ôû les prêtres s’alloient purifier. On tiroit
l ’eau du pied du v a fe , par quatre robinets qui la
yerfoient dans le baffin. (+ )
* § CUZZI, ( Géogr. ) Cejlle nom d?un peuple de
la Grece^fort vaillant & belliqueux, que les Turcs rCont
point encore,pu venir a bout de foumettre. On auroit dû
dire en quel canton de la G rece fe trouve ce'peuple.
On ne cgnnoît que les Mainotes dans la Morée , à
qui cela puiffe convenir ; mais quel rapport y a-t-il
.entre Cu\yi 6c les Mainotes? Lettres fur l'Encyclopédie.
C Y
* § CYCEON , i .. * On lit dans cet article Van-
'dus linden pour Vanderlinden ou Vander Linden.
C YD N U S , ( Géogr. ) Cydne , fleuve de Cilicie,
renommé chez les anciens par le danger que courut
;Alexandre en voulant s’y baigner. Frédéric Barbe-
Tome II,
rouffe s’étant armé dans la deiuiiefoe cfoifadé.
après avoir battu Saladin & fes troupes, voulutauiS
fe baigner dans l ib e l le s eaux du Cydne , mais il y
pdrit au mois de juin 1 185. Gette riviere arrofoit la
ville de Tarfe. ( Ç . )
C t G N E , f. ni. cyçnus , ( terme de Blafoa. ) 0ifeau
qui le trouve en quelqu’écu.
On dit becfui de fon bee, membri de fes jambes i
lorlqu ils iont d un autre email que fon corps.
Le fygne eft par fa blancheur le fymbolé de là
finçérité ; il eft auffi le fymbole de l’amour, puifqu’it
etoit confacré à Vénus , félon la fable. n
^ Luifet de' Lompnas en Breffe d'azur ate cygne
etargent becque & membri le fable. ( G . D . L. T. )
P Gy GNi ( tordre lu ) , ordre de chevalerie infti*
tue dans le huitième fieclë.Su duché de fcieves;
On attribue l’originé de cet ordres1 Beatrix ’ unique
héritière du duc de Cleves, qui lui àVoit laiffé
en mourant fes états.
‘ . Cette duehefle fe voyant injüflemeht derféciitée
par fes voidns qui vouioient envahir fes domaines -
fe retira dans lé château de Nieubourg , oii elle
fut fecourue par un chevalier nommé Trelie qui
l’époufa; “
Cfe chevalier portoit uri cygne fut- fon bouclier;
lui 6c fa femme inftituerent alors l’ordre de cygne.
Le collier eft une chaîne d’or à trois rangs, où eft
attaché un cygne émaillé de blanc fur une terraffe dô
finople. Voyez la planche X X V I 9 fig. / 2 . du Blafort
dans le Dictionnaire raif. des Sciènces, 6cc. (G. D. L. T.)
CYMBAtUM de S . Jérôme. ( Luth. ) efpece d ’inftrument
de mufique dont je n’ai pu trouver que la
figure. Voyez fg .. S S ,p la n i de Luth, Suppl. &
C horus. {Luth. ) Suppl. ( F. D . C. )
GYNURA, ( Mujîq. inflrum. des anc. ) Mufonius,'
cap. 7 . de luxu Groecorum, rapporte que c’étoit une
efpece de lyre ; il ajoute, d’après Suidas, que le roi
de Chypre,Cynuras, qui étoit très-riche, grand amateur
de là mufique, 6c qui avoit été vaincu paf
Apollon , avoit tiré fon nom de cet inftrument
( F .D .C . )
* § C YNO P H A NTI S , fêti fâcheufe pour les chien!
de la ville d'Argos. i° . lifez cynophontis , & non pas
cynophantis. Le mot même cynophontis ne fe trouve
point dans les anciens. C ’eft un nom forgé par Rho-
diginus. On en fait mal-à-propos une fête. z°. Cet
article eft mal placé dans le Dictionnaire raif des'
Sciences , &c. après CYNOSARGE. Il devoit être
devant. Lettres fur t Encyclopédie.
* § CYNOSARGE, ïtom d.'Hercule, ainfi appelù
d'un autel quün citoyen d'Athènes lui éleva dans l'endroit
ou s'arrêta un. chien blanc, qui emportoit une victime
, qu'il étoit fur le point d'immoler. Voye7 C Y N IQ U E ;
Au mot Cynique , on lit que le chien s'étoit emparé
des viandes que le citoyen avoit offertes). Ce n’eft
ni avant ni après que Diomius eut immolé les Vian*
des que le chien les emporta , mais pendant qu’il les
immoloit. Diomus eft métamorphofé, dans le Dicl.
raif. des Sciences, & c . en Dydiraius. Lettres fur U Encyclopédie.
% CY PR È S, en latin , cupreffus, ( Botanique. )
Cet arbre réunit fur le même pied des fleurs mâles
& des fleurs femelles. Les fleurs mâles affifes fur uri
filet commun, ont la forme de chatons ovales &
écailleux : elles n’ont ni pétales, ni étamiries, mais
feulement quatre fommets adhérens aux écailles.
Ces fommets donnent une grande quantité de pouf-
fiere très-fine, de forte qu’au printems, quand ces
fommets viennent à s’ouvrir, on croiroit qu’il foft
de la fumée des gros cyprès.
Les fleurs femelles foiit produites par d’aütreS
boutons , fous la forme d’un petit cône écailleux
arrondi; elles contiennent chacune huit ou dixâeurs ;
on n’y découvre ni pétales, ni piftils bien apparens 1
p p p p i j