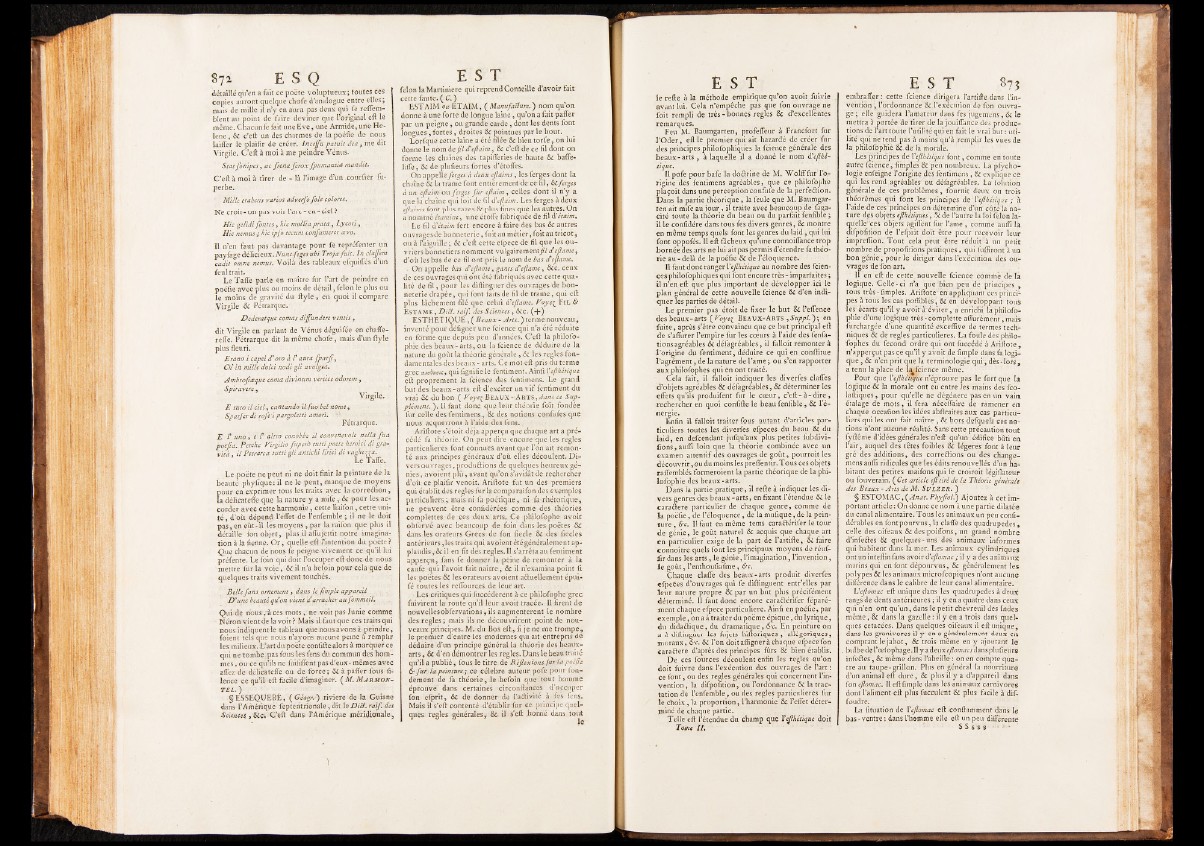
détaillé qu’en a fait ce poëte voluptueux; toutes ces
copies auront quelque chofe d’analogue entre elles;
mais de mille il n’y en aura pas deux qui fe reffem-
blent au point de faire deviner que l’original eft le
même. Chacun fe fait une Eve, une Armide,une He-
lene, & c’eft un des charmes de la poéfie de nous
laiffer le plaifir de créer. InceJJu patuit dea, me dit
Virgile. C’eft à moi à me peindre Vénus.
Stat fonipes, ac frena ferox fpumanda maudit.
C ’eft à moi à tirer de - là l’image d’un .courfier fu-
perbe.
Mille trahens varios adyerfo foie colores. ,
Ne croit-on pas voir l’arc-en-ciel?
Hic gelidi fontes, hic mollia prata, Lycori ,
Hic nemus; hic ipfo tecurn tonfumerer cevo.
Il n’en faut pas davantage pour fe repréfenter un
payfage délicieux. Nuncfegesubi Trojàfuit. lnclajfem
cadit onme nemus. Voilà des tableaux efquiffés d’un
feul trait.
Le Taffe parle en maître fur l’art de peindre en
poéfie avec plus ou moins de détail, félon le plus ou
le moins de gravité du f ty le , en quoi il compare
Virgile & Pétrarque.
Dederatque comas dijfundere vernis,
dit Virgile en parlant de Vénus déguifée en chaffe-
reffe. Pétrarque dit la même chofe, mais d’un ftyle
plus fleuri.
Erano i capei d’ oro à Ü aura fparji, (
Cli in mille dolci nodi gli avolgea.
Ambroficeque coma divinum vertice odorem ,
Spiravere,
Virgile.
E tuto il ciel, cantando il fuo bel nome,
■ Sparfer di rofe'i pargoletti amorï. ri
Pétrarque.
E 1' uno, t Ü altro conbbbe il convenevole nella fua
poefia. Perche Virgilio fuperb tutti poète hèroici di gravita
, i l Petrarca tutti gli antichi Lirici divaghe^a.
Le Taffe.
Le poëte ne peut ni ne doit finir la peinture de la
beauté pbyfique: il ne le peut, manque de moyens
pour en exprimer tous les traits avec la correôion,
la délicateffe que la nature y a m i f e & polir les accorder
avec cette harmonie;, cette liaifon , cetre unit
é , d’oii dépend l’effet de l’enfemble ; il ne le doit
pas, en eûtril lés moyens, par la raifon que plus il
détaille fon. objet, plus.il affujfettit notre imaginar
tion à là fiennê. O r , quelle eft d’intention du poëte ?
Que chacun de nous fe peigne vivement ce qu’il lui
préfente. Le foin qui doit l’occuper eft donc de nous
mettre für la vo ie, & il n ’a befoin pour cela que de
quelques traits vivement touchés*'
Belle fans ornement, dans le (impie appareil
D'une beauté quon vient d'arracher au fomme.il.
Qui-de nous,'à ces mots, ne voit pas Junie comme
Néron vient de la voir ? Mais ibfaut que ces traits qui
nousindiquenûle tableau qite nous avons à peindre,
foient tels que nous n’ayons aucune peine à remplir
les milieux. L’art du poëte confifte alors à marquer ce
qui ne tombe|pas fous les fens du commun des hommes
, ou- ce qu’ils né faififlënt pas d’eux - mêmes avec
affez de délicateffe ou de force; & à paffer fous fi-
lence ce qu’il eft facile d’imaginer. (Àf. Mârmon-
t e l . ) ; '
§ ESSEQUEBÉ, ( GèogrJ) -riviere de la Guiane
dans l’Amérique feptentrionale, dit-le Dicté fa if des
Science^ » & c ,i -,C’eft dans l’Amérique méridionale-,
félon la Martiniere qui reprend Corneille d’avoir fait
cette faute. ( C. )
ESTAIM ou ETAIM, ( Manufacture. ) nom qu’on
donne à une forte de longue laine, qu’on a fait paffer
par un peigne, ou grande carde, dont les dents font
longues, fortes, droites & pointues par le bout.
Lorfquë cette laine a été filée & bien torfe, on lui
donne le nom de fil d'efiaim, & c’eft de ce fil dont on
forme les chaînes des tapifferies de haute & baffe-,
liffe, & de plufieurs fortes d’étoffes.
On appelle ferges à deux efiaims, les ferges dont la
chaîne & la trame font entièrement de ce fil, & ferges
à un ejlaim ou ferges fur efiaim, celles dont il n’y a
que la chaîne qui foit de fil d'efiaim. Les ferges à deux
efiaims font plus razes & plus fines que les autres. On
a nommé étamine, une étoffe fabriquée de fil d'étaim.
Le fil d'étaim fert encore à faire des bas & autres
ouvrages de bonneterie, foit au métier, foit au tricot,
ou à l’aiguille ; & c’eft cette efpece de fil que les ouvriers
bonnetiers nomment vulgairementfil d'efiame,
d’oîi les bas de ce fil ont pris-le nom de bas d'efiame.
. On appelle bas d'efiame, gants d'efiame, &c. ceux
de ces ouvrages qui ont été fabriqués avec cette qualité
de fil, pour les diftinguer des ouvrages de .bonneterie
drapée, qui font faits de fil de trame, qui eft
plus lâchement filé que celui d'efiame. Voye* F i l &
ESTAME, Dict. raifi des Sciences, &c. (+ )
ESTHETIQU E , ( Beaux - Arts. ) terme nouveau,
inventé pour défigner une fcience qui n’a été réduite
en forme que depuis peu d’années. C’eft la philofo-
phie des beauxLarts, ou la fcience de. déduire de la
nature du goût la théorie générale, & les réglés fondamentales
fies beaux-arts. Ce mot eft pris du terme
grec ct/<râ»evç, qui fignifie le fentiment. Ainfi Vefihétique
eft proprement la fcience des fentimens. Le grand
but des beaux-arts eft d’exciter un v if fentiment du
vrai & dû bon ( Voye^ Beaux -;A rts , dans ce Supplément.
y. Il faut donc que. leur théorie foit. fondée
fur celle des fentimens., & .des notions co.nfufes que
nous acquerrons à l’aide des fens. ;
Ariftote s’étoit déja,apperçu que chaque art a précédé
fa théorie. On peut dire encore que les réglés
particulières font connues avant que l’on ait remonté
aux principes généraux d’oh elles découlent. Divers
ouvrages, productions de quelques heureux génies
, àvoient plû, avant qu’on s’avifât de rechercher
d’oît; ce plaifir venoit. Ariftote fut un des premiers
qui établit des réglés furîa comparaifon des exemples
particuliers,; mais ni fa poétique, ni fa rhétorique,
ne peuvent être confidérées comme des théories
complettes de ces deux'arts. Ce philofophe avoit
obfervé avec beaucoup de foin dans les poëtes &C
dans les orateurs Grecs-de fon fiecle & des fiecles
antérieurs ,les traits qui avôient été généralement applaudis,
& i l en fit des.regles.il s’arrêta au fentiment
apperçu, fans fe donner la peine de remonter à la
caufe qui l’avoit fait naître, & il n’examina point fi
les.poëtes & les orateurs avoient a&uellement épui-
fé toutes les reffources de leur art.
Les critiques qui fuccéderent à ce philofophe grec
fuivirent la route qu’il leur avoit tracée. Il:firent de
nouvellesobfervations, ils augmentèrent le nombre
des réglés ; mais ils ne découvrirent point de nouveaux,
principes. M. du Bos. eft., fi je ne me trompe,
le premier d’entre les modernes qui ait entrepris de
déduire d’un principe général la théorie des beaiix-
arts-, & d’en démontrer les régies. Dans le beat» traite
qu’il a publié , fous le titre .de Réflexions, fur la po'èfîe
& fur.) la peinturece célébré auteur, pofe pour fondement
de fa théorie, le ihefoin que.tout homme
éprouvé dans certaines cireonffanees d’occ,uper
fon efprit, & de donner de l’aélivité à fies fens.
Mais il s’eft contenté d’établir fur ce. principe quelques.
réglés générales, &. il s’eft borne dans tout
le
le refte à la méthode empirique qu’on ayoit fuivie
avant lui. Cela n’empêche pas que fon ôuvrâge ne
foit rempli de très - bonnes réglés & d’excellentes
remarques.
Feu M. Baumgarten, profeffeur à Francfort fur
l ’Oder, eft le premier qui ait hazardé de créer fur
des principes philofophiqués la fcience générale des
beaux-arts , à laquelle il a donné le nom d'eflhé-
tique.
Il pofe pour bafe la doârine de M. Wolfffur l’o,-
rigine dés fentimens agréables, que ce philofophë
plaçoit dans une perception confule de la perfeélion.
Dans la partie théorique, la feule que M. Baumgarten
ait mife au jour, il traite avec beaucoup de fugacité
toute la théorie du beau ou du parfait fenfible ;
il le confidére dans tous fes divers genres, & montre
en même temps quels font les genres du laid, qui lui
font oppofés. Il eft fâcheux qu’une connoiffance trop
bornée des arts ne lui ait pas permis d’étendre fa théorie
au - delà de la poéfie & de l’éloquence.
Il faut donc ranger Vefihétique au nombre des feien-
ces philofophiqués qui font encore très - imparfaites ;
il n’en eft que plus important de développer ici le
plan général de cette nouvelle fcience & d’en indiquer
les parties de détail.
Le premier pas étoit de fixer le but & l’effence
des beaux-arts ( Hoye^ Beaux-Arts , Suppl.fi, en
fuite, après s’être convaincu que ce but principal eft
de s’affurer l’empire fur les coeurs à l’aide des fenfa-
tions agréables & défagréables, il falloit remonter à
l ’origine du fentiment, déduire ce qui en conftitue
l ’agrément, de la nature de l ’ame ; ou s’en rapporter
aux philofophes qui en ont traité.
Cela fait, il falloit indiquer les diverfes claffes
d’objets agréables & défagreables, & déterminer les
effets qu’ils produifent fur le coeur, c’eft - à - dire ,
rechercher en quoi confifte le beau fenfible, & l’énergie.
Enfin il falloit traiter fous autant d’articles particuliers
toutes les diverfes efpeces du beau & du
laid, en defeendant jufqu’aux plus petites fubdivi-
fions,aufli loin que la théorie combinée avec un
examen attentif des ouvrages de goût, pourroit les
découvrir, ou du moins les preffèntir. Tous ces objets
raffemblés formeroient la partie théorique de la phi-
lofophie des beaux - arts.
Dans la partie pratique, il refte à indiquer les divers
genres des beaux-arts, en fixant l’étendue & le
carattere particulier de chaque genre, comme de
la poëfie, de l’éloquence, de la mufique, de la peinture
, &c. Il faut en même tems caraftérifer le tour
de génie, le goût naturel & acquis que chaque art
en particulier exige de la part de l’artifte, & faire
connoître quels font les principaux moyens de réuf-
4ir dans les arts, le génie, l’imagination, l’invention,
le goût, l’ enthoufiafme, &c.
Chaque claffe des beaux-arts produit diverfes
efpeCes d’ouvrages qui fe diftinguent entr’elles par
leur nature propre & par un but plus précifément
déterminé. Il faut donc encore caraétérifer féparé-
ment chaque efpece particulière. Ainfi en poéfie, par
exemple, on a à traiter du poëme épique, au lyrique,
du didactique, du dramatique, &c. En peinture on
a à diftinguer les fujets hiftoriques , allégoriques,
moraux, &c. & l’on doit afligner à chaque efpece fon
taraftere d’après des principes fûrs & bien établis.
De ces fources découlent enfin les réglés qu’on
doit fuivre dans l’exécution des ouvrages de l’art :
ce font, ou des réglés générales qui concernent l’invention
, la difpoution, ou l’ordonnance & la tractation
de l’ënfemble, ou des réglés particulières fur
le choix, la proportion, l’harmonie & l’effet déterminé
de chaque partie.
Telle eft l’étendue du champ que Vefihétique doit
Tome H»
einhrafter: c.ette fciqnce dirigera l’artifte.dans l’invention1,
l’ordonnance & .l’execiition de fon ouvragé
; elle guidera l’amateur dans fes 'jugein'ens, & le
mettra à pdrtée de tirer de la jouiffance des productions
de l’art toute l’utilité qui en fait le vrai but : utilité
qui ne tend pas à moins"qu’à remplir les vues de
la philbfppfriè &. de‘ là tftoràle.
Les principes de Vefihétiqüè font, comme en toute
aufrç fciefice, (impies & peu nombreux. La pfycho-
logië ënfeigne l’origine des fentimens, & explique ce
qui les rend agréables ou défagréables. La fôlution
générale de ces problèmes, fournit deux ou trois
théorèmes qui font les principes de Vefihétique ; k
l’aide de ces'principes on; détermine d’un' côté la nature
des objets ephétiques, & de l’autre la loi félon !a-
quelle‘'ces objets agiffent fur l’ame , comme aufîi là
difpOfitiort de l’ efprit doit être pour recevoir leur
impreflion. Tout cela peut être réduit'à un petit
nombre de propofitions pratiques, qui .fuftiront à un
bon génie ; pour le diriger dans rexécirtion des ouvrages
de fon art.
Il en eft de cette nouvelle fcience comme de là
logique. Celle-ci n’a qûe^bien peu de principes ,
tous très - Amples. Ariftote en appliquant ces principes
à tous les cas poffiblés; & en développant tous
les écarts qu’il y a voit àc éviter, a enrichi là philofor
phie' d’une logique très -cbmplette affurémènr, mais
furchargée d’une quantité exceflive de termes techniques
& de réglés particulières. La foule des philofophes
du fécond ordre qui ont fuccédé à Ariftote ,
n’apperçut pas ce qu’il y avoit de fimple dans fa logique
, & n’en prit que la terminologie qui , dès-lors,
a tenu la place de la/fcierice même. ■
Pour que Vefihéffifue n’éprouve pas le fort que la
logique & la morale ont eu entre les mains des fcô-
laftiques, pour qu’elle ne dégénéré pas en un vain,
étalage de mots, il fera néçeffaire de ramener en
chaque occafion les idées abftraites aux cas particuliers
qui les ont fait naître , & hors defquels ces notions
n’ont aucune réalité. Sans cette précaution tout
fyftênie d’idées générales n’eft qu’un édifice bâti en
l’air, auquel des têtes foibles & légères font à leur
gré des additions, des corre&ions ou des change-
mens aufîi ridicules que les édits renouvellés d’un habitant
des petites maifons qui fe croiroit légiflateur
ou fouverain. ( Cet article efi tiré de la Théorie générale
des Beaux- Arts de M. SuLZER. à
§ ESTOMAC, {Anat. Phyfolf) Ajoutez à cet important
article : On donne ce nom à une partie dilatée
du canal alimentaire. Tous lés.animaux,un peu confi-
dérables en font pourvus, la claffe des quadrupèdes ,
celle des oifeaux & des poiffons, un grand nombre
d’infeéles & quelques-uns des animaux informes
qui habitent dans la mer. Les animaux cylindriques
ontuninteftinfans avoir d'èflomac ; il y a des animaux
marins qui en font dépourvus, & généralement les
polypes & les animaux microfcopiques n’ont aucune
différence dans le calibre de leur canal alimentaire.
L'efiomac eft unique dans les quadrupèdes à deux
rangs de dents antérieures ; il y en a quatre dans ceux
qui n’en ont qu’un, dans le petit chevreuil dès Indes
même, & dans la gazelle : il y en a trois dans quelques
cetacées. Dans quelques oifeaux il eft unique,'
dans les granivores il y en a généralemertt deux .en
Comptant le jabot, & trois même en y àjbutarif lé
bulbe de l’oefophage. Il y a dzux eftomacsdans plufieurs
infeâes, & même dans l’abeille : on en compte quatre
au taupe-grillon. Plus en général la nourriture
d’un animal eft dure, & plus il y a d’apparéil dans
fon efiomac. Il eft fimple dans les-animaux carnivores
dont l’aliment eft plus fucculent & plus facile à dif-
foudre.
La fîfuation de Vefiomac^ eft .conftamment dans le
bas 7 ventre : dans i’hojnme elle eft un peu différente
$ S s's % ~l -