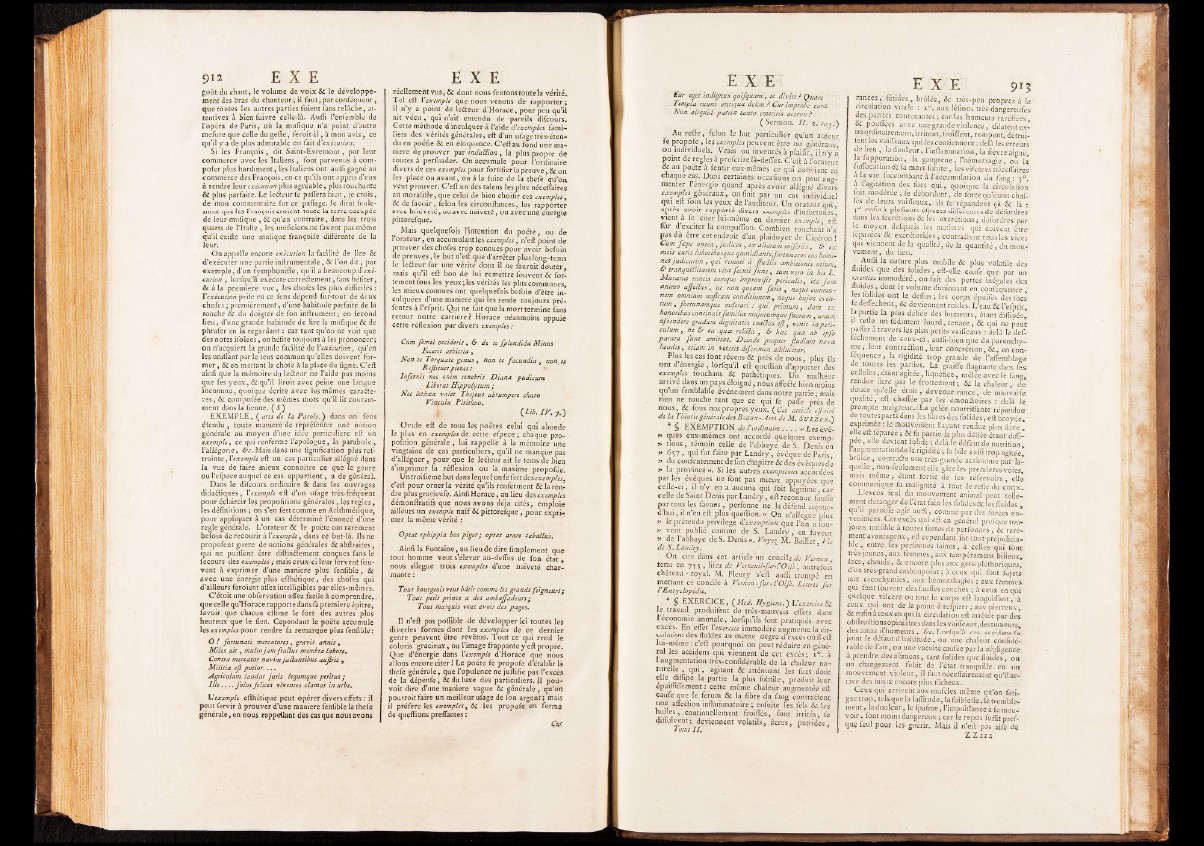
goût du chant, le volume de voix 6c le développement
des bras du chanteur ; il faut, par conféquent,
que toutes les autres parties foient fans relâche, attentives
à bien fuivre celle-là. Audi l’enfemble de
l’opéra de Paris, oit la. mufique n’a point d’autre
mefure que celle du gefte, feroit-il, à mon avis , ce
qu’il y a de plus admirable en fait à'exécution.
Si les François , dit Saint-Evremont, par leur
commerce avec les Italiens, font parvenus à com-
pofer plus hardiment, l'es Italiens ont aufli gagné au
commerce des François, en ce qu’ils ont appris d’eux
à rendre leur exécution plus agréable, plus touchante
& plus parfaite. Le le&eur fe paffera bien, je crois,
de mon commentaire fur ce paflage. Je dirai feulement
que les François croient toute la terre occupée
de leur mufique , 6c qu’au contraire, dans les trois
quarts de l’Italie , les muficiens ne favent pas même
qu’il exifte une mufique françoife différente de, la
leur.
On appelle encore exécution la facilité de lire 6c
d’exécuter une partie inftrumentale , & l’on dit, par
exemple, d’un iymphonifte, qu’il a beaucoup d'exécution,
lorfqu’il exécute correctement, fans héfiter,
& à la première vue, les chofes les plus difficilës :
Yexécution prife en ce fens dépend fur-tout de deux
chofes ; premièrement, d’une habitude parfaite de la
touche 6c du doigter de fon infiniment ; en fécond
lieu , d’une grande habitude de lire la mufique 6c de
phrafer en la regardant : car tant qu’on ne voit que
des notes ifolées, on héfite toujours à les prononcer;
on n’acquiert la grande facilité de Y exécution, qu’eii
les unifiant par le fens commun qu’elles doivent former
, & en mettant la chofe à la place du fignè. C ’eft
ainfi que la mémoire du lefteur ne l’aide pas moins
que fes yeux, & qu’il liroit avec peine une langue
inconnue, quoique écrite avec les mêmes caratte-
ves, 6c compofée,des mêmes mots qu’il lit Couramment
dans la fienne. ( S )
EXEMPLE, ( arts de la Parole. ) dans un fens'
étendu , toute maniéré de repréfenter une notion
générale au moyen d’une idée particulière eft un
exemple, ce qui renferme l’apologùe, la parabole,
l'allégorie, &c. Mais dans une lignification plus rëf-
trainte, l’exemple eft un cas particulier allégué dans
la vue de faire mieux connoître ce que le genre
ou l’efpece auquel ce cas appartient, a de général.
Dans le difcours ordinaire & dans les ouvrages
didaâiques, l’exemple eft d’un ufage très-fréquent
pour éclaircir les propofitions générales , les réglés,
les définitions ; on s’en fert comme en Arithmétique,
pour appliquer à un cas déterminé l’énoncé d’une
réglé générale. L’orateur & le poëte ont rarement
befoin de recourir à Y exemple, dans ce but-là. Ils ne
propofent guere de notions générales & abftraites,
qui ne puiffent être diftinôement conçues fans le
fecours des exemples ; mais ceux-ci leur fervent fou-
vent à exprimer d’une maniéré plus fenfible, &
avec une énergie plus efthétique, des chofes qui
d’ailleurs feroient affez intelligibles par elles-mêmes.
C’étoit une obfervation affez facile à comprendre,.
que celle qu’Horace rapporte dans fa première épirre,
favoir que chacun eftime le fort des autres plus
heureux que le fien. Cependant le poëte accumule
les exemples pour rendre fa remarqué plus fenfible :
O ! fortunati mercatores, gravis annis,
Miles ait, multo jam fraclus membra labore.
Contra mercator navim jaclantibus aujlris ,
Militia ejl potior. . . .
Agricolam laudat juris legumque périt us ;
l ll e . . . . folos felices viventes clamat in urbe.
L’exemple efthétique peut opérer divers effets : il
peut fervir à prouver d’une maniéré fenfible la thefe
générale, en nous rappeilant des casque nous avons
réellement vus, & dont nous fentons toute la vérité.
Tel eft Y exemple que nous venons de rapporter;
il n’y a point de lefteur d’Horace, poiir peu qu’il
ait v é cu , qui n’ait entendu de pareils difcours.
Cette méthode d inculquer à l’aide exemples familiers
des vérités générales, eft d’un ufage très-étendu
en poéfie 6c en éloquence. C’eft au fond une maniéré
de prouver par induction , la plus propre de
toutes à perfuader. On accumule pour l ’ordinaire
divers de ces exemples pour fortifier la preuve , & on
les place ou avant, ou à la fuite de la thefe qu’on
veut prouver. C ’eft un des talens les plus néceffaires
au moraiifte, que celui de bien choifir Ces exemples,
6c de favoir , félon les circonftances, les rapporter
avec brièveté, ou avec naïveté, ou avec une énergie
pittorèfque.
Mais quelquefois l’intention du poëte, ou de
l’orateur, en accumulant les exemples, n’eft point de
prouver des chofes trop connues pour avoir befoin
de preuves, le but n’eft que d’arrêter plus Iong-tems
le leâeur für une vérité dont il ne faurojt douter,
mais qu’il eft- bon de lui remettre fouvent 6c fortement
fous les yeux; les vérités les plus communes,
les mieux connues ont quelquefois befoin d’être inculquées
d’une- maniéré qui les rende toujours préfentes
à l’efprit. Qui ne fait que la mort termine fans
retour notre carrière? Horace néanmoins appuie
cetté réflexion par divers exemples :
Cum femel occîderis, & de te fplcndïdà Minos
Fecerit .arbitria,
Non te Torquate genus, non te facundia, non_ t?
Rejiituet pietas : *
Infernis nec enim tenebris Diana pudicum
Libérât Hippolytum ;
Nec lethoea valet Tkejeus abrumpert ckaro
Vincula Piritkoo.
(Lib. IV. y .)
Ovide eft de tous les poëtes celui qui abonde
le plus en exemples de cette efpece ; chaque proportion
générale, lui rappelle à la mémoire une
vingtaine de cas particuliers, qu’il ne manque pas
d’alléguer, pour que le le&eur ait le tems de bien
s’imprimer la réflexion ou Ta maxime propofée.
Un troifieme but dans lequel on fe fert des exemples,
c’eft pour orner la vérité qu’ils renferment & la rendre
plus gracieufe. Ainfi Horace, au lieu des exemples
démonftratifs que nous avons déjà cités, emploie
ailleurs un exemple naïf 6c pittoresque, pour exprimer
la même vérité :
Optât ephippia bos piger ; optât drare cabattus.
Ainfi la Fontaine, au lieu de dire Amplement que
tout homme veut s’élever au-deflus de fon état ,
nous allégué trois exemples d’une naïveté char-
m.ante :
Tout bourgeois veut bâtir comme les grands feigneurs;
Tout petit prince a des ambajfadeurs ;
Tout marquis veut avoir des pages.
Il n’eft pas poflible de développer ici toutes les
diverfes formes dont les exemples de ce dernier
genre peuvent être revêtus. Tout ce qui rend le
coloris gracieux, ou l’image frappante y eft propre.
Que d’énergie dans Ycxemplc d’Horace que nous
allons encore citer ! Le poëte fe propofe d’établir la
thefe générale, que l’opulence ne juftifie pas l’excès
de la.dépenfe, & du luxe des particuliers.il poü-
voit dire d’une manière vague 6c générale, qu’on
pourroit faire un meilleur ufage de fon argent ; mais
il préféré les exemples, 6c les propofe en forme
de queftions preffantes :
Çhc
6ür egetindignusquifquam, tedtvile? Quart
. \Templa-ruum antiqua dcûm ? Cur improbe rares
Non aliquidopacriae tanta rmctïris actrvo'f.t'. •
(Sermon. I I . ail
,, .'Au'refle," félon le but particulier qu’un auteur
le propofe , les exemples peuvent être ou généraux ’
ou individuels. Vrais ou inventés1! plaifir, iln ’v a
point de rpglej à prefçrire là-deHiis. C e i i à l'orateur
& au poëte à fentir eux-mêmés cë gui cofivierit en
chaque cas. Dans certaines ,‘oçcafions on peut au«-
menter l’énergie quand après avoir allégué divers
exemples générdtix, on finit par un cas individiiet
qui elt fous les yeux de l’auditeur. 'Un orateur qui
apres avoir rapporté divers exemples d’infortunes’,
.vient à fe citer lui-même en dernier ïxempio, eft
lur d exciter la. compalîiort. Combien touchant n’a
pas dû être cet endroit d’un plaidoyer de Cicéron !
Cum foepe arttea, judiccs , ex àiloriinsmiferiis , & èx
mets curis laboribusque quotidianisjorcunatos cos'Hômi-
nes juiicarim, qui remoti à jlu d iis ambitions àmtihè
.&tranqittûitatèlh vîtes feçuti fu n t , tumvtro in Ü ü t .
'Murante tamis lamque improriffs'pericuïîs,~ila?Jttrn
ammo affectées , ut mm queam fatis', àc$ïïpmmu-.
nem omnium noffram condilionem, neque htylîï’cvéhs
mm fortunàmque mifemri : qui primum , durfr'ép\
honoribus continués familles rnajorumque fuorum , niium
afeendere graduai dignitatis coaclùs icff , renie ' inperid
culum, ne & ea qux r e liffi, & hatc qietei tà 'îïfë
paraea funt amittat. Deinde propter Jtudium noya
taudis, ctiam in réécris diferirntn adducïtur. '
Plus les cas font récens & près'de;nous, plus ils
ont d energie , lorfqu’il eft queftion d’apporter des!
exemples touchans & pathétiques' ( Un malheur
arrivé dans un pays éloigné, nous affeéte bien moins
qu un femblable événement dans notre patrie; mais
rien ne touche tant que ce qui fe paffe près:'de
nous, 6c fous nos propres yeux. ( Cet article ejl tiré
de la Théorie générale des Beaux-Arts de M. S u l z e r .)
* § EXEMPTION de l'ordinaire. . . . *< Les éyêt
» quês eux-mêmes ont accordé quelques exemp-;
>> tions, témoin celle de l’abbaye de S. Denis en
y> 657 » qui fut faite par Landry, évêque de Paris,
» du confentement de fon chapitre & des évêques de
» la province ». Si les autres exemptions accordées
par les évêques ne font pas mieux appuyées que
ce lle-ci, il n y en a aucune qui foit légitime, car
celle de Saint Denis par Landry, eft reconnue fauffe
par tous les fa vans , perfonne ne. la défend aujourd’hui
, il n’ en eft plus qpeftion. « On n’allegue plus
» le prétendu privilège d’exemption que l’on a l'ou-
>> vent publié comme de S. Landry, en faveur
» de l’abbaye de S. Denis ». Voye\ M. Bailler, Vu
de S. Landry .
On cite, dans cet article un concile de Kernon ■
tenu en 755 , lifez de Verneuil-fur-l’Oife, autrefois-
château-royal. M. Fleury s’eft aufli trompé en
mettant ce concile à Vernon-fur-l'Oïfe. Lettres fur
V Encyclopédie,
* § EXERCICE, (Med. Hygiène. ) U exercice.6c
le^ travail produifent de très-mauvais effets dans
l ’économie animale, lorfqu’ils font pratiqués, avec
exces. En effet Yexercice immodéré augmente la circulation
des fluides au même dégré d’excès oîi il eft;
lui-même : c’eft pourquoi on peut réduire en géné-,
rai les accidens qui viennent,, de-cet excès; i ° . à
l ’augmentation très-confidérable de la chaleur naturelle
, q ui, agitant 6c atténuant les fues. dônt
®He diflipe la partie la plus fubtile, produit leur
épaifliflement : cette même chaleur augmentée eft
çaufe que le ferum & la fibre du fang contraient
une affeiion inflammatoire ; enfufte les fels 6c les
huiles, continuellement froiffés, font irrités fe
diflolvent;: deviennent volatils, âcres, putrides^
Tom e JI,
rances,, fétides, brûlés, & très-peu propres à la
circulation vitale : 2Ü; aux léfions très-dangereufes
des parties contenantes; car les humeurs raréfiées,
6c pouffees avec une grande violence, dilatent ex-
trao,rdin aire ment, irritent, froiflent, rompent, détrui-
lentles vaiffeaux qui les'cpntiennent : delà les erreurs
de heu , la douleur, l’inflammation, la fievre aiguë,
la fuppuratibn, la gangrené, l’hémorragie, ou la
iuffocation 6c la mort fubite , les vifeeres néceffaires
à la viè. fuccombant à l ’accumulation du fang: 30.
à l’agitation des fucs q ui, quoique la circulation
foit modérée, fe débordent, de forte qu’étant chaf-
fés derieurs vaiffeaux, ils fe'répandent çâ & là :
4°. enfîn-à plufieurs éfpeces differentes de défordres
1 bans .les fecrétions & les excrétions ; défordres par
• l-'T defquels les matières qui doivent être
leparees 6c excréioriées, contraient tous les vices
qui viennent de la qualité, de la quantité, du mouvement,
du lieu.
Aufli la nature plus mobile & plus volatile des
fluides que des folides, eft-elle caufe que par un
exercice immodéré, on Fait des pertes inégales des
fluides , dont le volume diminuant en conféquence 1
les folides ont le deffus ; les' corps épuifés des fucs
îedeffechent, 6c deviennent roides. L ’eau & l’efprit,
la partie la plus déliée des humeurs, étant diflioés,
il refte un fédiment lourd, tenace, 6c qui ne peut
pafler à travers les plus petits vaiffeaux : delà le def-
lechement de ceux-ci, aulîi-bien que du parenchyme,
leur contraftion, leur concrétion,& , en con-
lequence , la rigidité trop grande de l’affemblage
de toutes les parties. Là graiffe ftagnante dans fes
cellules, étant agitée, liquéfiée , mêlée avec le fang^
rendue acre par le frottement; & la chaleur, de
douce qu elle etoit, devenue rance, de mauvaife
qualité, eft chaflee par les ' émonâoires : delà la
prompte maigreur^Xa^gèlée. noürriflànte répandue
de toutes parts dans les fibre,s des folides , eft broyée,
“ P™?®? : le mouvensent % a f lt rendue plus âcre ,
elle eft feparee ; 6c fa partie-i,a plus déliée étant difli-
p e e , elle devient folides delà le défautde nutrition
[augmentation de la rigidité ; la bile aufli trop agitée,
bruiee, . contraâe une très-grande acrimonie par laquelle
, non-feulement elle gâte les premières voies
mais même, étant fortie de. fesèréfervoirs .-elle
communique fa-malignité à tout le refie du corps.
L ’excès feul du mouvement animaf peut tellement
déranger de l’état fain les folides & les fluides ,
qu’il paroiffe agir aulfi. comme par des forces en-'
yentmées. Cet excès qui eft.en général prefqive toujours,
nuifible à toutes fortes de perfonnes, & rarement
avantageux, eft cependant.fur-tout préjudiciable
,;entre-des perfonnes faines, à celles .qui font
tres-jeunes, aux femmes', aux tempéramens bilieux,
fées;,- chauds, & encore plus aux- gens pléthoriques’
d un très-grandembonpoint ; à ceux qui font fttjets
aux. cacochymies, aux hémorrhagies ; aux femmes
qui font fouvent des fauffes couchés ; à ceux en qui'
quelque vifeere ou tout le corps eft languiffant, à
ceux: .qui: ont de la peine à rclpirer; aux pierreux,.
& enfin à ceux çn qui la circulation eft arrêtée par dès.
obftmflionsdpiniâtres dans les vai(feaux,destumeurs,
des amas d humeurs , ô"c. Lorfqu.’à ces accidenstei
joint le defaut d’habitude , ou une chaleur.: confidé-:
rabte de l’air, ou une vacuité caufée parla négligence
à prendre des. alimens, tant folides que-fluides, ou
uni changement fubit vie l’éiat tranquille en un
mouvement violent, il fautnéceffairemdat qu’ifar-
rive des .maux encore plus.fdcheux.
Ceux qui. arrivent aux mufcles même qu’on fatigue:
trop, telsqueia laffitude, lafoibleflè ,1e tremble^
ment, ladouleur, le fpafme, l’impuiflance à fe mou-
PKbiÉl, font moins dangereux j car le repos .fuffit pref-
que feul pour les guérir. Mais il n’eà 'pa s aifé dq
Z Z z z i