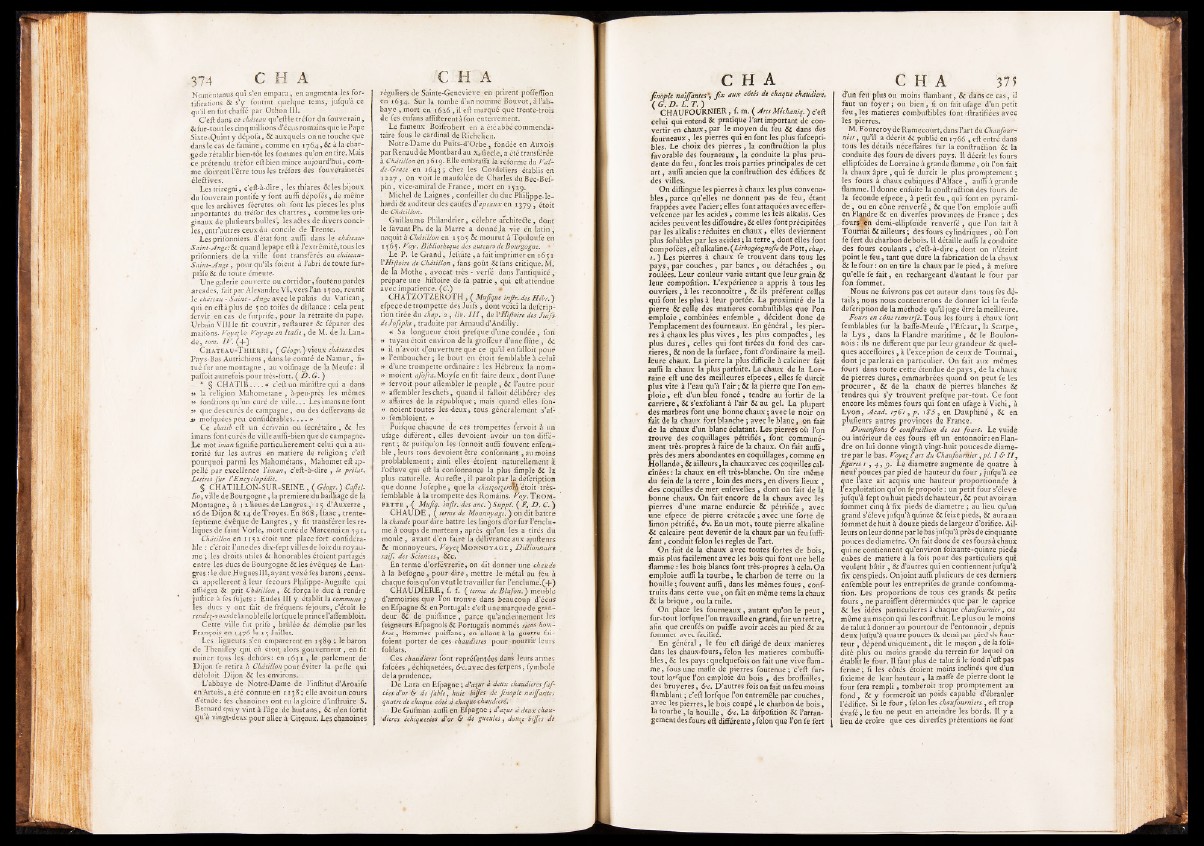
Nomentanus qui s’en empara, en augmenta les fortifications
& s’y foutint quelque teins, jufqu’à ce
qu’ilen fut chaffé par Othon III.
C’eft dans ce château qu’eftie tréfor du fouverain,
& fur-tout les cinq millions d’écus romains que le Pape
Sixte-.Quint y dépofa, 6c auxquels on ne touche que
dans le cas de famine, comme en 1764, & à la charge
de rétablir bien-tôt les fommes qu’on en tire. Mais
ce prétendu tréfor eft bien mince aujourd’hui, comme
doivent l’être tous les tréfors des fouverainetes
éleâives. ' , ..
Les triregni, c’eft-à-dire , les thiares & les bijoux
du fouverain pontife y font aufli dépofés, de même
que les archives fécretes oit font les pièces les plus
importantes du tréfor des Chartres, comme les originaux
de plufieurs bulles1, les aâes de divers conciles,
entr’autres ceux du concile de Trente.
Les prifonniers d’état font aufli dans le château-
Saint-Ange:6c quand lepape eft à l’extrémité,tous les
prifonniers de la ville font transférés au château-
Sctint-Ange , pour qu’ ils foient à l’abri de toute fur-
prife 6c de toute émeute.
Une galerie couverte ou corridor, foutenu pardes
arcades, fait par Alexandre VI, vers l’an 1500, réunit
le château - Saint - Ange avec le palais du Vatican ,
qui en eft à plus de 500 toifes de diftance : cela peut
fervir en cas de furprife, pour la retraite du pape.
Urbain VUIle fit couvrir, reftaurer 6c féparer des
maifons. Voyez le Voyage en Italie, de M. de la Lande,
tom. IV. (+ )
C hateau-T hierrï , ( Géogr.ymenx château des
Pays-Bas Autrichiens, dans le comté de Namur, fi-
tué fur une montagne , au voifinage de l,a Meufe: il
paffoit autrefois pour très-fort. ( D . G. )
* § C H A T I B . . c ’ eft un miniftre qui a dans
» la religion Mahometane , à-peu-près les mêmes
» fondions qu’un curé de ville.. . Les imans nefont
» que des curés de campagne , ou des deffervans de
j» mofqtiées peu confidérables.. . . »
Ce chatïb eft lin écrivain ou fecrétaire , 6c les
imans font curés de ville aufli-bien que de campagne.
L e mot iman lignifie particulièrement celui qui a autorité
fur les autres en matière de religion; c’eft
pourquoi parmi les Mahométans, Mahomet eft ap-
pellé par excellence Y iman, c’eft-à-dire , le prélat.
Lettres fur C Encyclopédie.
§ CHATILLON-SUR-SEINE , ( Géogr. ) Cafiel-
ïio, ville de Bourgogne, la première du bailliage de la
Montagne, à 12 lieues de Langres-,"' 1.5 d’Auxerre,
16 de Dijon 6c 14 deTroyes. En 868:, Ifaac , trente-
feptieme. évêque de Langres , y fit transférer les reliques
de faint Vorle, mort curé de Marcenaien 591.
Châtillon en 1152 étoit une place fort confidéra-
ble : c’étoit l’une des dix-fept villes de loix du royaume
; les droits utiles & honorables étoient partagés
entre les ducs de Bourgogne & les évêqutÿ de Langres
:1e duc HuguesIII,ayant;vexé fes barons,ceux-
ci appellerent à leur fecours Philippe-Augufte qui
afliégea & prit Châtillon, 6c força le duc à rendre
juftice à fes fujets : Eudes III y établit la commune ;
les ducs y ont fait de fréquens fejours, c’étoit le
rendez-vous de la nobleflè lorfque le prince l’affembloit.
Cette ville fut prife , bridée & démolie par les
François en 1476 le 15 Juillet.
Les ligueurs^ s’en emparerenten 1589 ; le baron
de Thenifley qui eh étoit, alors gouverneur, en fit
ruiner tous les dehors: en 1631 , le parlement de
Dijon fe retira à Châtillon pour éviter la pefte qui
défoloit Dijon & les environs.. .
L’abbaye de Notre-Dame de l’inftitut d’Aroaife
en Artois, a.été connue-en 113 8; elle avoit un cours
d’étude: fes chanoines ont eu la gloire d’inftruire S.
Bernard qui y vint à l’âge de huit ans, 6c rfen fortit
qu’à vingt-deux pour aller à Citçauxi Les chanoines
réguliers de Sainte-Genevieve en prirent poffeflîon
en 1634. Sur la tombe d’un nommé Bouvot jà l’ab-
baye , mort en 1626 , il eft marqué que' trente-trois
de fes enfans aflifterent à fon enterrement.
Le fameux Boifröbert en a été abbé commenda-
taire fous le cardinal de Richelieu.
Notre-Dame du Puits-d’Orbe, fondée en Auxois
par Renaud de Montbard au x«{iecle-, a été transférée
à Châtillon en 1619. Elle embraffa la réforme du VàG
de-Grace en 1643 » C^ez ^es Cordeliers établis en
1227 , on voit le maufolée de Charles du Bec-Bef-
pin, vice-amiral de France, mort en Ï529.
Michel de Laignes, confeiller du duc Philippe-le-
hardi 6c auditeur des caufes drapeaux en 1379 , étoit
de* Châtillon. ■
Guillaume Philandrier, célébré architeâe, dont
le favant Ph. de la Marre a donné,1a vie e*n latin ,
naquit à Châtillon en 1505 6c mourut à Touloufe en
1565. Voy. Bibliothèque des auteurs de Bourgogne. * ’
Le P. le Grand, Jefùite , a fait imprimer en 1651
YHißoire de Châtillon, fans goût 6c fans critique. M.
de la Mothe , avocat très - verfé dans l’antiquité ,
prépare une hiftoire de fa patrie , qui eft attendue
avec impatience. (C.)
CHATZOTZEROTH , ( Mufique inßr. des Hébr. )
efpece de trompette des Juifs , dont voici la defcrip-
tion tirée du chap. 2 , Uv. I I I , de YHißoire des Juifs-
deJofephe, traduite par Arnaud d’Andilly.
« Sa longueur étoit prefque-d’une coudée ; fon
» tuyau étoit environ delà groffeur d’une flûte , 6c
» il n’avoit d’ouverture que ce qu’il en falloit pour
» l’emboucher; le bout en étoit femblableà celui
» d’une trompette ordinaire : les Hébreux la nom-
» moient afojra. Moyfè en fit faire deux, dont l’une
» fervoit pour affembler le peuple , 6c l’autre pour
» affembler les chefs, quand il falloit délibérer des
» affaires de la république ; mais quand elles fqn^
» noient toutes les "deux, tous généralement s’af-
» femblôient. »
Puifqùe chacune de ces trompettes fervoit à un
ufage différent, elles devoiént avoir un ton différent
; & puifqu’on les fonnoit aufli fouvent enfem-
ble , leurs tons dévoient être confonnans , au moins
probablement ; ainfi elles étoient naturellement à
i’oâave qui eft la confonnance la plus Ample 6c là
plus naturelle. Au refte:, il paroît par la defcription
que donne Jofephe, que la ckâi{otzer*fcètoit très-
femblable à la trompette des Romàins. Voy. T rompet
te , •( Mufiq. inßr. des âne. ) Suppl. ( F, D . C. )
CHAUDE , ( terme de Monnoyage. ) on dit battre
la chaude pour dire battre les lingots d’or fur l’enclume
à coups de marteau, après qu’on les a tirés du
moule , avant d’en faire la délivrance aux ajufteurs
& monnoyeurs. Voyez Mo n n o y a g e , Dictionnaire
raif. des Sciences, 6cc.
En terme d’orfèvrerie, on dit donner une chaude
à la befogne, pour dire, mettre le métal au feu à
chaque fois qu’on veut le travailler fur l’enclume. (+ )
CHAUDIERE, f. f. ( terme de Blafon. ') meuble
d’armoiries que l’on trouve dans beaucoup d’écus
enEfpagne 6c en Portugal : c’eft une marque de grandeur
6c de puiffance fj parce qu’anciennement les
feigneurs Efpagnols & Portugais nommés ricos kom-
bres, Hommes puiffans, en "allant à la guerre fai—
foient porter de ces chaudières pour nourrir leurs
foldats.
Ces chaudières font'repréfentées dans leurs armes
fafcées , échiquetées, &c. avec des ferpens, fymbole
delà prudence.
De Lara en Efpagne ; iFazurà deux chaudières fafcées
dyor & de fable, huit biß es de finople naiffarites
quatre de chaque côté à chaque chaudieré.
De Giifman aufli en Efpagne ; £ azur à deux chau*
'dieres échiquetées d'or G de gueules, dou^t' bifes de
finople nalffanm*, f i x auic côtés de chaque chaudière.
( G. D . L. T. )
CHAUFOURNIER, f. m. ( Arts Méchaniq. ) c’eft
celui qui entend & pratique l ’art important de convertir
en chaux, par le moyen du feu & dans dès
fourneaux, les pierres qui en font les plus fufeepti-
blés. Le choix des pierres, la conftruâion la plus
favorable des fourneaux, la conduite la plus prudente
du feu, font les trois parties principales de cet
a r t , aufli ancien que la conftruâion des édifices 6c
des villes.
On diftingue les pierres à chaux les plus convenables,
parce qu’elles ne donnent pas de feu, étant
frappées avec l’acier ; elles font attaquées avec effer-
vefcence par les acides, comme les fels alkalis. Ces
acides peuvent les difloudre,& elles font précipitées
par les alkalis : réduites en chaux, elles deviennent
plus folubles par les acides ; la terre, dont elles font
compofées, eft alkaline. (Lithogéognojie de Pott, chap.
/ .) Les pierres à chaux fe trouvent dans tous les
pa ys , par couches, par bancs , ou détachées , ou
roulées. Leur couleur varie autant que leur grain 6c
leur compofttion. L’expérience a appris à tous les
Ouvriers, à les reconnoître , & ils préfèrent celles
qui font les plus à leur portée. La proximité de la
pierre & celle des matières combuftibles que l’on
emploie, combinées enfemble , décident donc de
l’emplacement des fourneaux. En général, les pierres
à chaux les plus v iv e s , les plus compactes, les
plus dures, celles qui font tirées du fond des carrières,
& non de la furface, font d’ordinaire la meilleure
chaux. La pierre la plus difficile à calciner fait
aufli la chaux la plus parfaite. La chaux de la Lorraine
eft une des meilleures efpeces, elles fe durcit
plus vite à l’eau qu’à l’air ; & la pierre que l’on emploie
, eft d’un bleu foncé , tendre au fortir de la
carrière, & s’exfoliant à l’air & au gel. La plupart
des marbres font une bonne chaux ; avec le noir on
fait de la chaux fort blanche ; avec le blanc, on fait
de la chaux d’un blanc éclatant. Les pierres où l’on
trouve des coquillages pétrifiés, font communément
très-propres à faire de la chaux. On fait aufli,
près des mers abondantes en coquillages, comme en
Hollande, & ailleurs, la chaux avec ces coquilles calcinées
: la chaux en eft très-blanche. On tire même
du fein de la terre , loin des mers, en divers lieux ,
des coquilles de mer enfevelies , dont on fait de la
bonne chaux. On fait encore de la chaux avec les
pierres d’une marne endurcie & pétrifiée , avec
une efpece de pierre crétacée ; avec une forte de
limon pétrifié, &c. En un mot, toute pierre alkaline
& calcaire peut devenir de la chaux par un feu fùffi-
fant, conduit félon les réglés de l’art.
On fait de la chaux avec toutes fortes de bois,
mais plus facilement avec les bois qui font une belle
flamme : les bois blancs font très-propres à cela. On
emploie aufli la tourbe, le charbon de terre ou la
houille ; fouvent aufli, dans les mêmes fours, conf-
fruits dans cette vu e , on fait en même tems là chaux
& la brique , ou la tuile.
On place les fourneaux, autant qu’on le peu t,
fur-tout lorfque l ’on travaille en grand, fur un tertre,
afin que creufés on puifle avoir accès au pied & au
fommet avec facilite.
En général, le feu eft dirigé de deux maniérés
dans les chaux-fours, félon les matières combuftibles
, 6c les pays : quelquefois on fait une vive flamme
, fous une maffe de pierres foutenue ; c’eft fur-
tout lorsque l’on emploie du bois , des broffailles,
des bruyères, &c. D ’autres fois on fait un feu moins
flamblant ; c’eft lorfque l’on entremêle par couches,
avec les pierres, le bois coupé, le charbon de bois,
la tourbe, la houille, &c, La difpofition 6c l’arrangement
desfours eft différente, félon que l’on fe fort
d’un feu plus ou moins flambant, Sc dahs Ce cas , il
faut un foy er ; où bien, fi on fait ufage d’un petit
feu , les matières combuftibles font 'ftratifiées avec
les pierres.
M. Fourcroy de RamecOürt, dans l’art du Chaiifour-
nier, qu’il a décrit & publié en 1766 , eft entré dans
tous les détails néceffaires fur la conftruâion & la
conduite des fours de divers pays. Il décrit les fours
ellipfoïdes de Lorraine à grande flamme, où l’on fait
la chaux âpre , qui fe durcit le plus promptement ;
les fours à chaux cubiques d’Alface , aufli à grande
flamme. Il donne enfuite la conftruâion des fours de
la fécondé efpece, à petit fe u , qui font en pyramide
, ou en cône renverfé, 6c que l’on emploie aufli
en Flandre 6c en diverfes provinces de France ; des
-Tours|en demi-ellipfoïde renverfé , que l’on fait à
Tournai & ailleurs; des fours cylindriques , où l’on
fe fert du charbon debois. 11 détaille aufli la conduite
des fours coulants, c’eft-à-dire, dont on n’éteint
point le feu, tant que dure la fabrication de la chaux
6c le four : on en tire la chaux par le pied, à mefure
qu’elle fe fait, en rechargeant d’autant le four par
fon fommet.
Nous ne fuivrons pas cet auteur dans tous fes détails
; nous nous contenterons de donner ici la feule
defcription de la méthode qu’il juge être la meilleure.
Fours en cône renverfé.'Tous lés fours à chaux font
femblables fur la bafle-Meufe , l’Efcaut, la Scarpe,
la Lys , dans la Flandre maritime, & le Boulon-
nois : ils ne different que par leur grandeur 6c quelques
acceffoires, à l’exception de ceux de Tournai,
dont je parlerai en particulier. On fait aux mêmes
fours dans toute cette étendue de pays, de la chaux
de pierres dures, emmarbrées quand on peut fe les
procurer, 6c de la chaux de pierres blanches 6c
' tendres qui s’y trouvent prefque par-tout. Ce font
encore les mêmes fours qui font en ufage à Vichi, à
Ly on , Acad. iy€ i, p. 186 , en Dauphiné , 6c en
plufieurs autres provinces de France.
Dimenjions & cohflruciion de ces fours. Le vuidé
ou intérieur de ces tours eft un entonnoir : en Flandre
on lui donne vingt à vingt-huit pouces de diamètre
par le bas. Voyezl'art du Chaufourhier, pi. I & I I ,
figures 1 , 4 , jp. Le diamètre augmente de quatre à
neuf pouces par pied de hauteur du four , jufqu’à ce
que l’axe ait acquis une hauteur proportionnée à
l’exploitation qu’on fe propofe : un petit four s’élève
jufqu’à fept ou huit pieds de hauteur, 6c peut avoir au
fommet cinq à'fix pieds’ de diamètre ; au lieu qu’un
grand s’élève jüfqu’à quinze 6i feize pieds, 6c aura au
fommet de huit à douze pieds de largeur d’orifice. Ailleurs
on leur donné par le bas jufqu’à près de cinquante
pouces de diamètre. On fait donc de ces fours à chaux
qui ne contiennent qù’énviron foixantë-quinze pieds
cubes de matière à la fois pour des particuliers qui
veulent bâtir , 6c d’autres qui en contiennent jufqu’à
fix cens pieds. On joint aufli plufieurs de ces derniers
énfemble pour les entreprifes de grande confomma-
tion. Les proportions de tous ces grands & petits
fours , ne paroiffént déterminées que par le caprice
6c les' idées particulières à chaque chaufournier, ou
même au maçon qui les conftruit. Le plus ou le moins
de talut à donner au pourtour de l’entonnoir, depuis
deux jùfqu’à quatre pouces & demi par pied de hauteur
, dépend uniquement, dit le maçon , de la foli-
dité plus ou moins grande du terrein fur lequel on
établit le four. 11 faut plus de talut fi le fond n’eft pas
férme ; fi les côtés étoient moins inclinés que d’un
fixiemë de leur hauteur, la maffe de pierre dont le
four fera rempli, tomberoit trop promptement au
fond , 6c y formeroit un poids capable d’ébranler
l’édifice. Si le four, félon les -chaufourniers, eft trop
évafé, le feu ne peut en atteindre les bords. Il y a
lieu de croire que ces diverfês .prétentions ne font