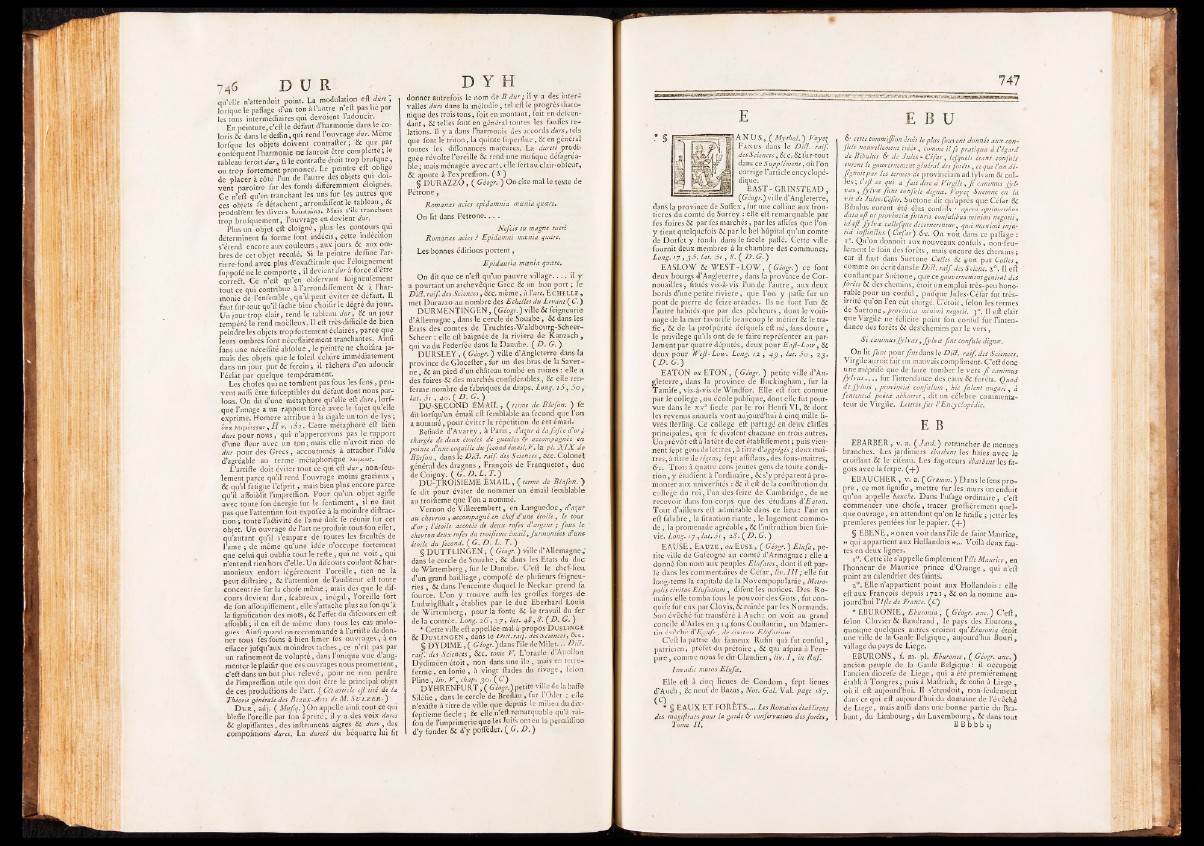
qu’elle n’attendoit point. La modulation eft dure ,
lorfque le paflage d’un ton à l’autre n’eft pas lie par
les tons intermédiaires qui dévoient l’adoucir.
En peinture, c’eft le défaut d’harmonie dans le co-
loris & dans le deflin,qui rend l’ouvrage dur. Même
lorfque les objets doivent contrafter ; & que par
conféquent l’harmonie ne fauroit être complette ; le
tableau feroit dur, fi le contrafte étoit trop brufque,
ou trop fortement prononcé. Le peintre eft oblige
de placer à côté l’un de l’autre des objets qui doivent
paroître fur des fonds différemment éloignés.
C e n’eft qu’en tranchant les uns fur les autres que
ces objets fe détachent, arrondiflent le tableau, &
produifent les divers lointains. Mais s’ils tranchent
trop brufquement, l’ouvrage en devient dur.
Plus un objet eft éloigné, plus les contours qui
déterminent fa forme font indécis, cette indécifion
s’étend encore aux couleurs, aux jours & aux ombres
de cet objet reculé. Si le peintre defline l’ar-
riere-fond avec plus d’exa&itude que leloignement
fuppofé ne le comporte , il devient dur à force d etre
correft. Ce n’eft qu’en obfervant foigneufement
tout ce qui contribue à l’arrondiffement & a 1 harmonie
de l’enfemble, qu’il peut éviter ce défaut. Il
faut fur-tout qu’il fâche bien choifir le dégré du jour.
Un jour trop clair, rend le tableau dur, & un jour
tempéré le rend moelleux. Il eft très-difficile de bien
peindre les objets trop fortement éclaires, parce que
leurs ombres font néceffairement tranchantes. Ainfi
fans une néceflité abfolue , le peintre ne choifira jamais
des objets que le foleil éclaire immédiatement
dans un jour pur & f^rein ; il tâchera d’en adoucir
l ’éclat par quelque tempérament.
Les chofes qui ne tombent pas fous les fens, peuvent
aufli être fufceptibles du defaut dont nous parlons.
On dit d’une métaphore qu’elle eft dure, lorfque
l’image a un rapport forcé avec le fujet qu’ elle
exprime. Bomere attribue à la cigale un ton de lyS ;
ottcl tetpiôtqffctv, IIV . 1S2. Cette métaphore eft bien
dure pour nous , qui n’appercevons pas le rapport
d’une fleur avec un tpn ; mais elle n avoit rien de
dur pour des Grecs, accoutumes a attacher 1 idee
d’agréable au terme métaphorique Xapouc.
L’artifte doit éviter tout ce qui eft dur, non-feu-
lement parce qu’il rend l’ouvrage moins gracieux ,
& qu’il fatigue l’efprit, mais bien plus encore parce
qu’il affoiblit l’impreflion. Pour qu’un olpjet agiffe
avec toute fon énergie fur le fentiment, il ne faut
•pas que l’attention foit expofee à la moindre diffraction
; toute l’aâtivité de l’ame doit fe réunir fur cet
objet. Un ouvrage de l’art ne produit tout-ffon effet,
qu’autant qu’il s’empare de toutes les facultés de
l’ame ; de même qu’une idee n’occupe fortement
que celui qui oublie tout le refte, qui ne v o i t , qui
n’entend rien hors d’elle. Un difeours coulant & harmonieux
endort légèrement l’oreille, rien ne la
peut diftraire, & l’attention de l’auditeur eft toute
concentrée fur la chofe même ; mais dès que le difeours
devient dur, feabreux, inégal, l’oreille fort
de fon affoupiffement, elle s’attache plus au fon qu à
la lignification des mots, & ,l’effet du difeours en eft
affoibli; il en eft de même dans tous les cas analogues.
Ainfi quand on recommande à l’artifte de donner
tous fes foins à bien limer fes ouvrages, à en
effacer jufqu’aux moindres taches, ce n’eft pas par
un rafinement de volupté, dans l’unique vue d’augmenter
le plaifir que ces ouvrages nous promettent,
c’eft dans un but plus relevé, pour ne rien perdre
de l’impreflion utile qui doit être le principal objet
de ces produttions de l’art. ( Cét article eft tiré de la
Théorie générale des Beaux-Arts de M. S u LZER. )
D ur , adj. ( Muftq. ) On appelle ainfi tout ce qui
bleffe l’oreille par fon âpreté; il y a des voix dures
& glapiffantes, des inftrumens aigres & durs , des
comportions dures. La dureté du béquarre lui fit
donner autrefois le nom de B dur ; il y a des intervalles
durs dans la mélodie, tel eft le progrès diatonique
des trois tons, foit en, montant, foit en delcen-
dant, & telles font en général tontes les fauffes relations.
Il y a dans l’harmonie des accords durs, tels
que font le triton, la quinte fuperflue, & en général
toutes les diffonances majeures. La dureté prodiguée
révolte l’oreille & rend une mufique défagréa-
ble; mais ménagée avec art, ellefertauclair-obfcur,
& ajoute à l’expreflion. ( 5 )
§ D U R A ZZO , ( Géogr. ) On cite mal le texte de
Pétrone,
Romanas actes epidamnia mania quarc.
On lit dans Petrone.. . .
Neftcis tu magne tueri
Romanas acies ? Epidamni mania quare.
Les bonnes éditions portent,
Epidauria mania quàre.
On dit que ce n’eft qu’un pauvre village.. . . il y
a pourtant un archevêque Grec & un bon port ; le
Dicl. raif. des Sciences, & c. même, à Yart. ECHELLE ,
met Durazzo au nombre d es Echelles du Levant (C .)
DURMENTINGEN, (Géogr. ) ville & feigneurie
d’Allemagne , dans le cercle de Souabe, & dans les
Etats des comtes de Truchfes-'W'aldbourg-Scheer-
Scheer : elle eft baignée de la riviere de Kanzaçh ,
qui va du Federfée dans le Danube. (D . G.')
DURSLEY, ( Géogr. ) ville d’Angleterre dans la
province de Glocefter, fur un des bras de la Saver-
ne, & au pied d’un château tombé en ruines : elle a
des foires & des marchés confidérables, & elle ren-
‘ ferme nombre de fabriques de draps. Long. iS ,S o ,
lat. Si y 40. ( D . G.')
DU-SECOND ÉMAIL, ( terme de Blafon. ) fe
dit lorfqu’un émail eft femblable au fécond que l’on
a nommé, pour éviter la répétition de cet émail.
Befiade d’Avarey, à Paris, d'azur à la fafee d’or J
chargée de deux étoiles de gueules & accompagnée en
pointe d’une coquille du fécond émail, V. la pl. X IX de
Blafon, dans le Dicl. raif. des Sciences, &c. Colonel
général des dragons , François de Franquetot, duc
deCoigny. (G . D. L .T . )
DU-TROISIEME ÉMAIL, ( terme de Blafon. )
fe dit pour éviter de nommer un émail femblable
au troiueme que l’on a nommé.
Vernon de Villerembert, en Languedoc, £a^ur
au chevron , accompagné en chef d'une étoile, le tout
d’or ; l'étoile accotée de deux rofes d’argent ; fous le
chevron deux rofes du troifieme émail, furmqntèes £ une
étoile du fécond. (G . D. L. T .)
§ DUTTLINGEN, ( Géogr. ) ville d’Allemagne,'
dans le cercle de Souabe, & dans les Etats dû duc
de Wurtemberg , fur le Danube. C’eft le chef-lieu
d’un grand bailliage, compofé de plufieurs feigneu-
ries , & dans l’enceinte duquel le Neckar prend fa
fource. L’on y trouve aufli les grottes forges de
Ludwigfthalt, établies par le duc Eberhard Louis
de Wirtemberg, pour la fonte & le travail du fer
de la contrée. Long. 2 (S, 2 7 , lat. 48., 8. (D . G.')
* Cette ville eft appellée mal-à-propos D uslinge
& D uslingen , dans le Dicl. raif. des Sciences, & c .
§ DYDIME, ( Géogr.)dans l’îledeMilet.. • Dicl.
raif. des Sciences, &c. tome V. L’oracle d’Apollon
Dydiméen étoit, non dans une île , mais en terre-
ferme , en Ionie , à vingt ftades du rivage , félon
Pline , liv. V , chap. 30. ( C ) , _
DYHRENFURT, ( Géogr.) petite ville de la baffe
Siléfie , dans le cercle de Breflau, fur l’Oder : elle,
n’exifte à titre de ville que depuis le milieu du dix-
feptieme fiecle ; & elle n’èft remarquable qu’à rai-
fon de l’imprimerie que les Juifs ont eu la permiffion
d’y fonder & d’y poffeder. Ç G, D. )
E E B U
A N U S , ( Mythol. ) Voye{
F anus dans le Dicl. raif.
des Sciences, & c. & fur-tout
dans ce Supplément, oii l’on
corrige l’article encyclopédique.
E A S T-G R IN ST EA D ,
(Géogr.) ville d’Angleterre,
dans la province de Suffex, fur une colline aux frontières
du comté de Surrey : elle eft remarquable par
fes foirès & par fes marchés, par les aflifes que l’on-
y tient quelquefois & par le bel hôpital qu’un comte
de Dorlet y fonda dans le fiecle pafle. Cette ville
fournit deux membres à la chambre des communes.
Long. 17 y 3S. lat. S i , 8. ( D . G. )
EASLOW & W E S T -L OW , (Géogr.) ce font
deux bourgs d’Angleterre, dans la province de Cornouailles,
fitués vis-à-vis l’un de l’autre, aux deux
bords d’une petite riviere, que l’on y pafle fur un
pont de pierre de feize arcades. Ils ne font l’un &
l’autre habités que par des pêcheurs , dont le voifi-
nage de la mer favorife beaucoup le métier & le trafic
, & de la profpérité defquels eft né, fans doute ,
le privilège qu’ils ont de fe'faire repréfenter au parlement
par quatre députés, deux pour Eafl-Low, &
deux pour Weft-Low. Long. 12 , 4$ , lat. So , 23.
( 2). G .)
EATON ou E TO N , ( Géogr. ) petite ville d’Angleterre,
dans la province de Buckingham, fur la
Tamife, vis-à-vis de Windfor. Elle eft fort connue
par le college, ou école publique, dont elle fut pourvue
dans le x v e fiecle par le roi Henri V I , & dont
les revenus annuels vont aujourd’hui à cinq mille livres
fterling. Ce college eft partagé pn deux claffes
principales, qui fe divifent chacune en trois autres.
Un prévôt eft à la tête de cet établiffement ; puis viennent
fept gens de lettres ,_à titre d’aggrégés ; deux maîtres,
à titre de régens; fept afliftans, des fous-maîtres,
&c. Trois à quatre cens jeunes gens de toute condition,
y étudient à l’ordinaire, & s ’y préparent à promonter
aux univerfités : & il eft de la conftitution du
college du roi, l’un des feize de Cambridge, de ne
recevoir dans fon corps que des étudians d'Eaton.
Tout d’ailleurs eft admirable dans ce lieu : l’air en
eft falubre, la fituation riante, le logement commode
, la promenade agréable, & l’inftruftion bien fui-
vie. Long. 1 7 , lat. S i , 28. ( D . G. )
EAUSE, Eauze , ou Eu se , ( Géogr. ) Elufa, petite
ville de Gafcogne au comté d’Armagnac : elle a
donné fon nom aux peuples Elufates, dont il eft parlé
dans les commentaires de Céfar, liv. I I I ; elle fut
long-tems la capitale de la Novempopulanie, Métro-
polis civitas Elufatium, difent les notices. Des Romains
elle tomba fous le pouvoir des G ots, fut con-
quife fur eux par Clovis, & ruinée par les Normands.
Son évêché fut transféré à Auch : on voit au grand
concile d’Arles en 314 fous Conftantin, un Mamer-
tin évêché d Eçufe, de civitate Elofatium.
C’eft la patrie du fameux Rufin qui fut conful,
patricien, préfet du prétoire , & qui afpira à l’empire
, comme nous le dit Claudien, liv. 1 , in Ruf.
Jnvadit muros Elufæ.
d’Auch, & neuf de Bazas, Not. Gai. Val. page i8p
(C) .
* § EAUX ET FORÊTS.... Les Romains établiren
des magiflrats pour la garde & confervation des forêts
Tome II,
& cette commiffion étoit le plus fouvent donnée aux conflits
nouvellement créés , comme il fe pratiqua à l'égard
de Bibulus & de Jules - Céfar, lefquels étant confuls
eurent le gouvernement général des forêts ce que l'on dé-
ftgnoitp ar les termes de provinciam ad fylvam & colles
; c e(i ce qui a fait dire à Virgile, f i canimus fy l •
vas 9 fiylvoe funt confule -dignoe. Voye£ Suetone en la
vie de Jules-Céfar. Suetone dit qu’après que Céfar 8c
Bibulus eurent été élus confuls : opéra optimatibus
data eft ut provinciæ futuris confulïbus minimi negotii ,
. ƒ/? fy}viz callefque decernerentur, quâ maxime inju-
Hâ inftinclus (Ccejdr) &c. On voit dans ce paflage :
ï °. Qu’on donnoit aux nouveaux confuls, non-feulement
le foin des forêts, mais encore des chemins ;
car il faut dans Suetone Calles & gon pas Colles,
comme on écrit dans le Dicl. raifdesScienc. z°. Il eft
confiant par Suetone, qu’e ce gouvernement général des
forêts & des chemins, étoit un emploi très-peu honorable
pour un conful, puifque Jules-Céfar fut très-
irrité qu’on l’en eût chargé. C’étoit, félon les termes
de Suetone, provincia minimi negotii. 30. Il eft clair
que Virgile ne félicite point fon conful fur l’intendance
des forêts & des'chemins par le v ers,
Si canimus fylvas, fylvee fint confule dignee.
On lit funt pour fint dans le Dicl. raif. des Sciences.
Virgileauroitfait un mauvais compliment. C ’eft donc
uneméprife que de faire tomber le vers f i canimus
fylvas. . . . fur l'intendance des eaux & forêts. Quod
de fylvis , provincia confulum , hic foient nugari , à
fententiâ poïtee abhorret, dit un célébré commentateur
de Virgile. Lettres fur l'Encyclopédie.
E B
EBARBER , v. a. ( Tard. ) retrancher de menues
branches. Les jardiniers ébarbent les haies avec le
croiffant & le cifeau. Les fagoteurs ébarbent les fagots
avec la ferpe; (+ )
EBAUCHER , v. a. ( Gramm. ) Dans le fens propre
, ce mot fignifie, mettre fur les murs un enduit
qu’on appelle bauche. Dans l’ufage ordinaire, c’eft
commencer une chofe, tracer grofliérement quelque
ouvrage, en attendant qu’on le finifle ; jetterles
premières penfées fur le papier. (+ )
§ EBENE, » on en voit dans l’île de faint Maurice
» qui appartient aux Hollandois »... Voilà deux fautes
en deux lignes.
i°. Cette île s’appelle fimplemènt Y île Maurice, en
l’honneur de Maurice prince d’Orange, qui n’eft
point au calendrier des'faints.
z°. Elle n’appartient point aux Hollandois : elle
eft aux François depuis 1 7 1 1 , & on la nomme aujourd’hui
Ylfle de France. (C)
* EBURONIE, Eburonia, ( Géogr. anc.) C ’eft,
félon Clavier & Baudrand , le pays des Eburons ,
quoique quelques autres croient c\\x’Eburonia étoit
une ville de la Gaule Belgique, aujourd’hui Bouri,
village du pays de Liege.
EBURONS , f. m. pl. Eburones, ( Géogr. anc. )
ancien peuple de la Gaule Belgique : il occupoit
l’ancien diocefe de Liege, qui a été premièrement
établi à Tongres, puis à Maftrich, & enfin à Liege ,
oii il eft aujourd’hui. II s’étendoit, non-feulement
dans ce qui eft aujourd’hui du domaine de l’évêché
de Liege, mais aufli dans une bonne partie du Brabant,
du Limbourg, du Luxembourg, & dans tout
B B b b b ij