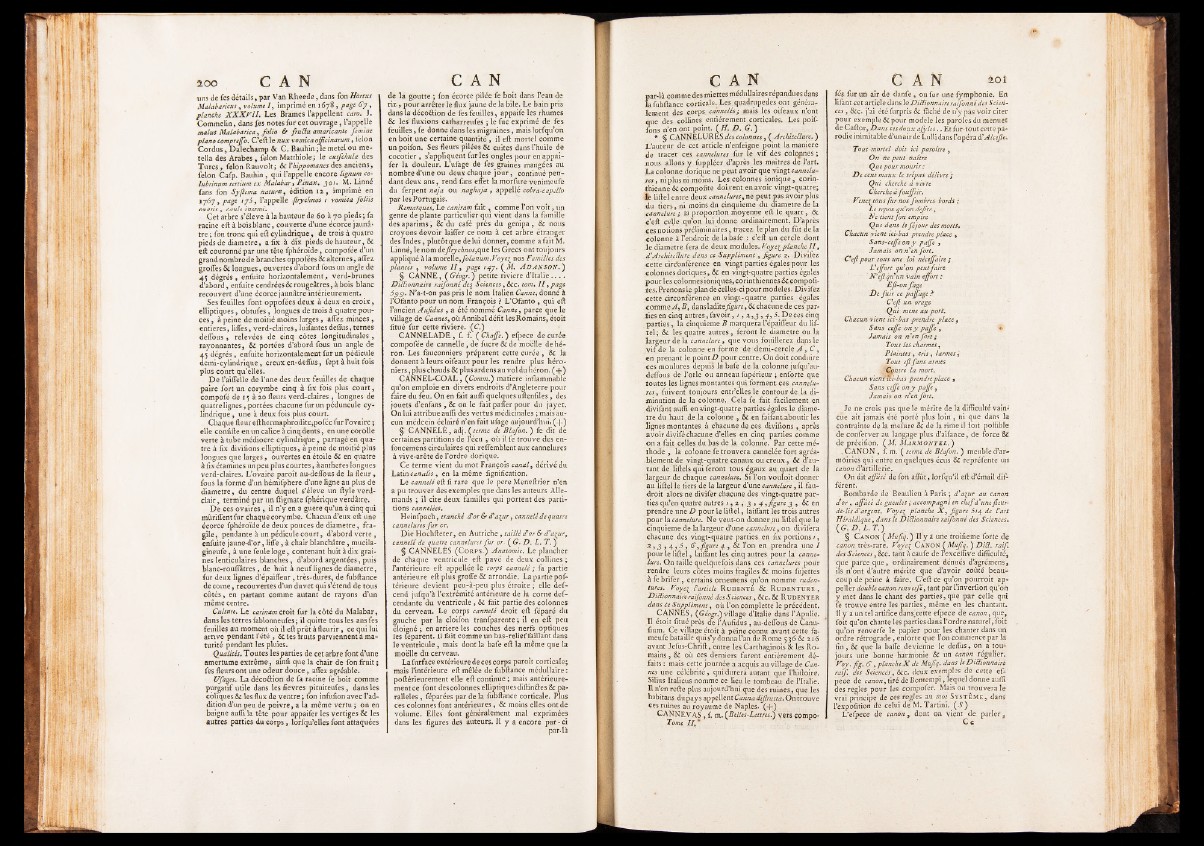
» 1
uns de fesdétails, par Van Rheede, dans fonHortus
Malabaricus , volume I , imprimé en 1678, page Gy,
planche X X X V I I . Les Brames l’appellent caro. J.
Commelin, dans fes notes fur* cet ouvrage, l'appelle
malus Malabarica, folio & fructu amaricante femine
piano compreffo. C’eft le nux vomie a ofjicinarum, félon
Cordus, Dalechamp & C. Bauhin ; le metel ou me-
tella des Arabes, félon Matthiole; le cutfchula des
Tu rc s , félon Rauvolt; & Vhippomanes des anciens,
félon Cafp. Bauhin , qui l’appelle encore lignum co-
lubrinum tertium ex Malabar, P inox, 30/. M» Linné
fans ion Syftema natures, édition i z , imprimé en
1 76 7 , page lyS , l’appelle Jbychnos 1 vomica foliis
ovatis, caule inermi.
Cet arbre s’élève à la hauteur de 60 à 70 pieds ; fa
racine eft à bois blanc, couverte d’une écorce jaunâ*
tre ; fon tronc qui eft cylindrique, de trois à quatre
pieds de diamètre, a fix à dix pieds de hauteur, 8c .
eft couronné par une tête fphéroïde, compofée d’un
grand nombre de branches oppofées 8c alternes, affez
groffes 8c longues, ouvertes d’abord fous un angle de
45 dégrés , enfuite horizontalement, verd-brunes
d’abord, enfuite cendrées & rougeâtres, à bois blanc
recouvert d’une écorce jaunâtre intérieurement.
Ses feuilles font oppofées deux à deux en croix,
elliptiques, obtufes, longues de trois à quatre pouces
, à peine de moitié moins larges, affez minces,
entières, liffes, verd-claires, luifantes deffus, ternes
deffous , relevées de cinq côtes longitudinales ,
rayonnantes, ôc portées d’abord fous un angle de
45 dégrés , enfuite horizontalement fur un pédicule
demi-cylindrique, creux en-deffus, fept à huit fois
plus court qu’elles.
De l’aiffelle de l’une des deux feuilles de chaque
paire fort un corymbe cinq à fix fois plus court,
compofé de 15 à 20 fleurs verd-claires , longues de
quatre lignes, portées chacune fur un péduncule cylindrique
, une à deux fois plus court.
Chaque fleur efthermaphrodite,pofée fur l’ovaire ;
elle confifte en un calice à cinq dents, en une corolle
verte à tube médiocre cylindrique, partagé en quatre
à fix divifions elliptiques, à peine de moitié plus
longues que larges, ouvertes en étoile 8c en quatre
à fix étamines un peu plus courtes, à anthères longues
verd-claires. L’ovaire paroît au-deffous de la fleur,
fous la forme d’un hémifphere d’une ligne au plus de
diamètre, du centre duquel s’élève un ftyle verd-
clair, terminé par un ftigmate fphérique verdâtre.
De ces ovaires , il n’y en a guere qu’un à cinq qui
mûriffentfur chaque corymbe. Chacun d’eux eft une
écorce fphéroïde de deux pouces de diamètre, fragile,
pendante à un pédicule court, d’abord verte,
enfuite jaune-d’o r , liffe, à chair blanchâtre, mucila-
gineufe, à une feule loge, contenant huit à dix graines
lenticulaires blanches, d’abord argentées, puis
blanc-rouffâtres, de huit à neuf lignes de diamètre,
fur deux lignes d’épaiffeur, très-dures, de fubftance
de corne, recouvertes d’un duvet qui s’étend de tous
côtés, en partant comme autant de rayons d’un
même centre.
Culture. Le carinamcroît fur la côté du Malabar,
dans les terres fablonneufes ; il quitte tous les ans fes
feuilles au moment où il eft prêt à fleurir, ce qui lui
arrive pendant l’été , 8c fes fruits parviennent à maturité
pendant les pluies.
Qualités. Toutes les parties de cet arbre font d’une
amertume extrême, ainfi que la chair de fon fruit ;
fes fleurs ont une odeur douce, affez agréable.
Ufages. La déco&ion de fa racine fe boit comme
purgatif utile dans les fievres pituiteufes, dans les
coliques & les flux de ventre ; fon infïifion avec l’addition
d’un peu de poivre, a la même vertu ; on en
baigne aufli la tête pour appaifer les vertiges 8c les
autres parties du corps, lorfqu’elles font attaquées
de la goutte ; fon écorôe pilée fe boit dans l’eau de
r iz , pour arrêter le flux jaune de la bile. Le bain pris
dans la décoâion de fes feuilles, appaife les rhumes
8c les' fluxions catharreufes ; le fuc exprimé de fes
feuilles, fe donne dans les migraines, mais lorfqu’on
en boit une certaine quantité , il eft mortel comme
un poifon. Ses fleurs pilées & cuites dans l’huile de
cocotier , s’appliquent furies ongles pour en appaifer
la douleur. L’ufage de fes graines mangées au
nombre d’une ou deux chaque jou r, continué pendant
deux ans, rend fans effet la morfure venimeufe
du ferpent naja ou naghaja , appellé cobra-capdlo
par les Portugais.
Remarques. Le caniram f a it , comme l ’on v o it , un
genre de plante particulier qui vient dans la famille
des aparims, 8c du café près du genipa, 8c nous
croyons devoir laiffer ce nom à cet arbre étranger
des Indes, plutôt que de lui donner, comme a fait M.
Linné, le nom dejtrychnos,que les Grecs ont toujours
appliqué à la morelle,folanum.Voye%_ nos Familles des
plantes , volume I I , page i4y. ( M. A d a n so n . )
§ CANNE, ( Géogr. j petite riviere d’Italie. . . .
Dictionnaire raifonné des Sciences, & c. torn. I l , page
5ç)C). N’a-t-on pas pris le nom Italien Canne, donné à
l’Ofanto pour un nom François ? L’Ofanto , qui eft
l’ancien Aufidus , a été nommé Canne, parce que le
village de Cannes, où Annibal défit les Romains, étoit
fitué fur cette riviere. (C.)
CANNELADE, f. f. ( Chaffe. ) efpece de curée
compofée de cannelle, de fucre 8c de moelle de héron.
Les fauconniers préparent cette curée, 8c la
donnent à leurs oifeaux pour les rendre plus héro-
niers, plus chauds & plus ardens au vol du néron. (-b)
CANNEL-COAL, (Comm.) matière inflammable
qu’on emploie en divers endroits d’Angleterre pour
faire du feu. On en fait aufli quelques uftenfiles, des
jouets d’enfans , & on le fait paffer pour du jayef.
On lui attribue aufli des vertus médicinales ; mais aucun
médecin éclairé n’en fait ufage aujourd’hui, ( - f )
§ CANNELÉ, adj. ( terme de Blafon. ) fe dit de
certaines partitions de l’écu , oit il fe trouve des en-
foncemens circulaires qui reffemblent aux cannelures
à vive-arête de l’ordre dorique. .
Ce terme vient du mot François canal, dérivé du
Latin canalis , en la même lignification.
Le cannelé eft fi rare que le pere Meneftrier n’en
a pu trouver des exemples que dans les auteurs Allemands
; il cite deux familles qui portent des partitions
cannelées.
Heinfpach, tranché d’or & d'azur, cannelé dè quatre
cannelures fur or.
Die Hochfteter, en Autriche, taillé P or & d ’azur,
cannelé de quatre cannelures fur or. ( G. D. L. T. )
§ CANNELÉS (C orps.) Anatomie. Le plancher
de chaque ventricule eft pavé de deux collines ;
: l’antérieure eft appellée le corps cannelé ; fa partie
antérieure eft plus groffe 8c arrondie. La partie pof-
térieure devient peu-à-peu plus étroite ; elle def-
cend jufqu’à l’extrémité antérieure de la corne def-
cendante du ventricule , 8c fait partie des colonnes
du cerveau. Le corps cannelé droit eft féparé du
gauche par la cloifon tranfparente ; il en eft peu
éloigné ; en arriéré les couches des nerfs optiques
les leparent. Il fait comme un bas-relief faillant dans
le ventricule, mais dont la bafe eft la même que la
moelle du cerveau.
La furface extérieure de ces corps paroît corticale;
mais l’intérieure eft mêlée de fubftance médullaire :
poftérieurement elle eft continue ; mais antérieure-
ment.ee font descolonnes elliptiques diftinôes 8c parallèles
, féparées par de la fubftance corticale. Plus
ces colonnes fçnt antérieures, 8c moins elles ont de
volume. Elles font généralement mal exprimées
dans les figures des auteurs. Il y a encore par - ci
par-là
par-là comme des miettes médullaires répandues dans
la fubftance corricale. Les quadrupèdes ont généra:-
lement des corps, cannelés ; mais les oifeaux n’ont
que des collines entièrement corticales. Les poif-
ions n’en ont point. ( H, D . G. )
* § CANNELURES.*/« colonnes, ( Architecture. )
L ’auteur de cet article n’enfeigne point la maniéré
de tracer ces cannelures fur le v if des eolqpnes ;
.nous allons y fuppléer d’après les maîtres de l’art.
La colonne dorique ne peut avoir que vingt cannelures,
ni plus ni moins. Les colonnes ionique, corinthienne
8c compofite doivent en avoir vingt-quatre;
le liftel entre deux cannelures, ne peut pas avoir plus
du tiers ni moins du cinquième du diamètre de la
cannelure ; la proportion moyenne eft le quart, 8c
c’eft ce\Je qu’on lui donne ordinairement. D ’après
ces notions préliminaires, tracez le plan du fût de la
colonne à l’endroit de la bafe : c’eft un cercle dont
.le diamètre fera de deux modules. Voye^planche I I ,
d’Architecture dans ce Supplément, figure 2. Divifez
cette circonférence en vingt parties égales pour ies
•colonnesdoriques, 8c en vingt-quatre parties égales
pour les colonnes ioniques, corinthiennes & compofi-
îes. Prenons le plan de celles-ci pour modèles. Divifez
cette circonférence en vingt-quatre parties égales
comme t, B, dans laditefigure, 8c chacune de ces parties
en cinq autres, favoir.,./, 2 , 3 , 4 , 5. De ces cinq
parties, la cinquième B marquera l’épaiffeur du liftel;
& les quatre autres, feront le diamètre ou la
largeur de la cannelure , que vous fouillerez dans le
v if de la colonne ;en forme de demi-cercle A , C ,
en prenant le pointZ> pour centre. On doit conduire
ces moulures depuis la bafe de la colonne jufqu’au-
déffous de l’orle ou anneau fupérieur ; enforte que
toutes les lignes montantes qui forment ces cannelures,
fuivent toujours entr’elles le contour de la diminution
de la colonne., Cela fe fait facilement en
divifant aufli en vingt-quatre parties égales le diamètre
du haut de la colonne , 8c en faiiant aboutir les
lignes montantes à chacune de ces divifions , après
avoir divifé chacune d’elles en cinq parties comme
on a fait celles du bas de la colonne. Par cette méthode
, la colonne fe trouvera cannelée fort agréablement
de vingt-quatre canaux ou creux, 8c d’autant
de liftels qui feront tous égaux au quart de la
largeur de chaque cannelure. Si l ’on vouloit donner
au liftel le tiers de la largeur d’une cannelure, il faudrait
alors ne divifer chacune des vingt-quatre parties
qu’en quatre autres 1 ,2 , . 3 , 4 , figure 3 , & en
prendre une D pour le liftel, laiffant les trois autres
pour la cannelure. Ne veut-on donner.au liftel que le
cinquième de la largeur d’une, cannelure, on divifera
chacune des vingt-quatre parties en fix portions/ ,
2 , 3 , 4 ,S , G, figure 4 , 8C l’on en prendra une /
pour le liftel, laiflant les cinq autres, pour la cannelure.
On taille quelquefois dans ces cannelures pour
rendre leurs côtes moins fragiles 8c moins fujettes
à fe brifer , certains ornemens qu’on nomme ruden-
tures. Voyei f article R uüENTÉ 8c RuDENTURE ,
Dictionnaire raifonné des Sciences , & c. 8c RUDENTER
dans te Supplément, où l’on complette le précédent.
CANNES, (Géo^r.) village d’Italie dans l’Apulië.
Il étoit fitué près de l’Aufidus , au-deffous de Canu-
fium. Ce village étoit à peine connu avant cette fa-
meufe bataille qui s’y donna l’an de Rome 5 3 6 & 216
avant JefusrChrift, entre les Carthaginois & fes Romains
, & où ces derniers furent entièrement défaits
: mais cette journée a acquis au village de Cannes
une célébrité, qui durera autant que l’hiftoire.
Silius Italiens nomme ce lieu le tombeau de l’Italie.
Il n’en refte plus aujourd’hui que des ruines, que les
habitans dupays appellent Canna dijlruttai On trouve
ces ruines au royaume de Naples. (+ )
CANNEVAS , f . m. {Belles-Lettres.') vers compo-
Tome //, *
fés fur lin air de danfe, ou fur une fymphonie. En
lifant cet article dans le Dictionnaire raifonné des Sciences
, &c. j’ai été furpris & fâché de n’y pas voir citer
pour exemple & pour modèle les paroles du menuet
de Caftor, i>a/zs ces doux afyles.. Et fur-tout cette parodie
inimitable d\m air de Lulli dans l’opéra d’Àlcefiet,
Tout mortel doit ici paroître , .
On ne peut tiaître
Que pour mourir t
D e cent maux le trépas délivre ;
Qui cherche à vivre
Cherche à fouffrir.
V ’.newtons fur nos f ombres bords :
Le repos qu’on défire,
Ne tient fon empire
Que dans le fèjour des morts.
Chacun vient ici-bas prendre place ,
Sans-ceffe on y pajfe ,
Jamais on n’en fort.
C’eft pour tous une loi nécejfaire ;
V effort qu’on peut faire
N ’ejt qu’un vain effort :
Ejl-onfage
De fuir ce paffage?.
C’eft un orage
Qui mene au port.
Chacun vient ici-b as prendre place ,
Sans ceffe on y paffe ,
Jamais on n’en fort ,*
Tous les charmes,
Plaintes , cris, larmes î
Tout ejt fans armes
Contre la mort.
Chacun vienfWi-bas prendre place ,
Sans ceffe On y p'aft >
Jamais on rf en fort.,
Je rie crois pas que le mérite de là difficulté vaincue
ait jamais été porté plus loin , ni que dans la
contrainte de la mefiire & de la rime il foit poflible
de confetver aU langage plus d’aifânee, de force 8c
de précifiôri. (M. MaRMo n te l . )
, C AN O N , f. m. ( terme, dé Blafon. ) meuble d’ar-
môiries qui entre en quelques écus 8c repréfente un
canon d’artillerie.
On dit affûté dè fort affût, lorfqu’il eft d’émail différent.
. Bombarde dé Beaulieu'à Paris ; d’agir au canon
a or, affûté de gueules ; accompagné en chefd’une fleur-
de-lis d’argent. Voye%_ planche X , figure 614 de fart
Héraldique, dans le Dictionnaire raifonné des Sciences•
(G . D . L. T .)
§ C anon ( Mufij.) Il y â une troifieme forte dè
canon très-rare. Voye{ C anon ( Mufiq. ) Dicl. raif.
des Sciences, Sec. tant àcâufe de l’excéffive difficulté*
que parce que, ordinairement dénués d’àgrémens,
ils n’ont d’autre mérite que d’avoir coûté beauà
coup de peine à faire. C’eft Ce qu’on pourrait ap-
peller double canon renverfé, tant par 1 inverfiori qu’ori
y met dans le charit des parties, que par celle qui
le trouve entre les parties, même en les chantant*
Il y a un tel artifice dansicette efpece de canon, que,
foit qu’on chante les parties dans l’Ordre naturel, foit
qu’on renverfe lé papier pour les chanter dans uii
ordre rétrograde , enforte que l’on commence par la
fin , 8c que la baffe devienne le deffus, on^ a toujours
urte bonne harmonie 8c un canon régulier.
Voy. fig. G , planche X de Mtifiq. dans le Dictionnaire
raif, des Sciences, &c. dèiix exemples de cette ef-'
pece de canon', tiré de Boritempi, lequel donne aufli
des régies pour les compofer. Mais on trouvera lé
vrai principe de cés réglés au mot Sy s t èm e , dans
l’expofîtion de celui de M. Tartini. ( 5 )
L’efpece de canon, dont on vient de parler 3
C e