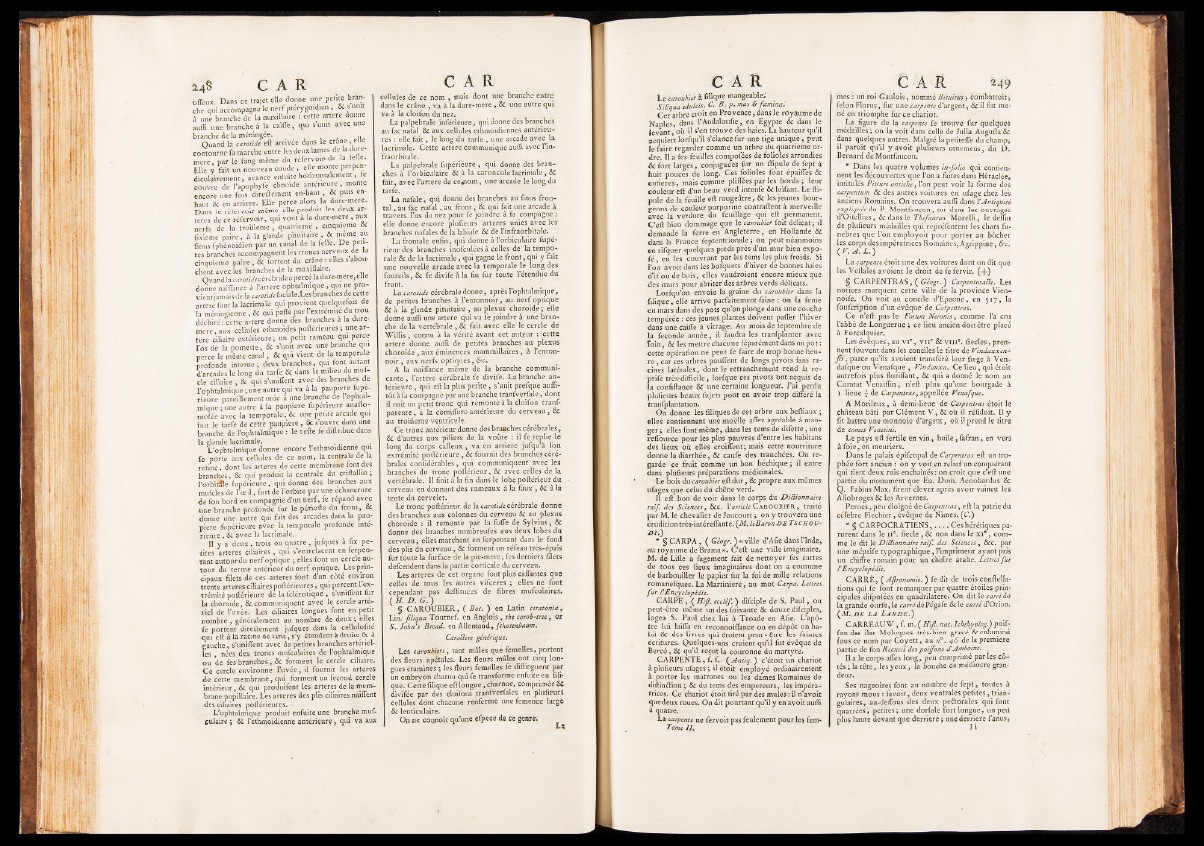
éffeux. Dans ce trajet èlle donné «ne pente branche
qtri accompagne le nerf ptérygoidten , & s unit
à une branche de la maxillaire I cette artere donne
auffi une branche à la afilfe» qui s unit avec une ,
branche de la méningée. ii„
Quand la camcidc eft arrivée dans le crâne , elle
contourne fa marche entre iesdeuxlames de la dure-
mere, par le fang même du réferyom de B lene.
Elle y fait un nouveau coude , elle monte perpendiculairement,
avance énluirehomontalement, le
couvre de l’apophyfe clinoîde anterieure, monte
encore Une fois direûement en-haut , & puis en-
haut & en arriéré. Elle perce alors la dure-mere.
Dans le rélervOif. même elle produit les deux artères
de ce réfervoir, qui vont à la divre-mere , aux
nerfs de la troifieme , quatrième , cinquième SC
fixieme pairey# la glande pituitaire , & meme au
finus fphénoidien par un canal de la telle. De petites
branches:accompagnent les troncs nerveux de la
cinquième paire , & (orient du crâne-: elles s abpu-
chenî avec les? branches de la maxillaire, . , " I
f M M M W M M H H i a perceladure-mere, elle
donne naiffance à l’arlere ophtalmique , qui ne pro-
vientiamais de la ommAfaciale.Les blanches de cette
artere font la lacrimale qui provient quelquefois de
la méningienne , Sc qui paffe parl’extréinue du trou
déchiré : cette artere donne des branches à la dure-
mere, aux- cellules ethmoïdes poftérieures; une artere
ciliaire extérieure; umpetit rameau qui perce
l’os de la pomettè, 6c s’unit avec une branche qui
perce le même canal, Scqui vient de la temporale
profonde interne ; deux branches, q«' font alital«
d’arcades le long du tarfe Sc dans le mi lieu du mul-
cle c-üaire , & qui s'unifient avec des branches de
rophtalmique; une autre qui va h la paupière uipe-
rieure pareillement unie à une branche de 1 ophtalmique,
latine autre, à la paupière fuperieure analto-
mofée avec la- temporale, 8c une petite arcade qui
fuit le tarfe de cette paupière ,. & s’puvre dans une
branche de l’ophtalmique s le telle fe diftribue dans
la glande lacrimale.
L'ophtalmique donne encore l'ethmoidienne qui
fe porte aux cellules de ce nom, la centrale de la
cetine, dont les artères.de cette membrane font des
branches, Sc qui produit la centrale du criftdllm ;
l’-orbitfle fupérieure, qui donne des branches aux
mufcles de l'oeil, fort de l orbitë par une échancrure
de fon bord encompagnie d’un nerf, fe répand avec
-une branche profonde fur le périofte du front, &
donne une autre qui fait des arcades dans la paupière
fupérieure avec la temporale profonde inté-
•rieure, & avec la lacrimale.
Il y a deux , trois ou quatre , jufques à fix petites
arteres ciliaires , qui s’entrelacent en ferpen-
tant autour du nerf optique ; elles-font un cercle autour
du terme antérieur du nerf optique. Les principaux
filets-de ces -arteres font d’un côté environ
trente arteres ciliaires poftérieures, qui percent l’extrémité
poftérieure de la felérotique , s'unifient fur
la choroïde, & communiquent avec le cercle arte-.
riel de l’uvée. Les ciliaires longues font en petit
nombre , généralement au nombre de deux ; elles
ie portent dire&ement jufques dans la cellulofite
qui eft à la racine de l’iris, s’y étendent à droite Jk à
gauche, s'unifient avec de petites branches artérielles
nées des troncs mufculaires de l’ophtalmique
ou de fes b ran c h e s& forment le cercle ciliaire.
C e cercle environne l'avée-, il fournit les arteres
de cette membrane, qui forment un fécond cercle
intérieur, & qui produifent les arteres de la membrane
pupillaire. Les arteres des plis ciliaires naiffent
-des ciliaires poftérieures. • v .
L’ophtalmique produit enfuite une branche muf-
culaire ; St l’ethmoïdienne antérieure, qui va aux
éellules de ce nom , mais dont une branche entre
dans le crâne , va à la dure-mere , St une autre qui
va à la cloifon du nez.
La palpébrale inférieure, qui donne des branches
au fac nafal St aux cellules ethmoïdiennes antérieures
: elle fait, le long du tarfe , une arcade avec la
lacrimale. Cette artere communiqué aüfli avec l’in-
fraorbitale.
La palpébrale fupérieure , qui donne des branches
à l’orbiculaire & à la caroncule lacrimale, St
fait, avec l’artere de ce^iom, une arcade le long du
tarfe.
La nafale, qui donne des branches au finus frontal
, au fac nafal, au front, St qui fait une arcade à
travers l’os du nez pour fe joindre à fa compagne :
elle donne encore plulieurs arteres unies ayec les
branches nafales de la labiale & de l’infraorbitale. ^
La frontale enfin, qui donne à l’orbiculaire fupé-
rieur des branches inofculées à celles de la.temporale
St de la lacrimale, qui gagne le front, qui y fait
une nouvelle arcade avec la temporale le long des
fourcils, St fe divife à la fin fur toute l’étendue du
front.
La carotide cérébrale donne, après l’ophtalmique,
de petites branches à l’entonnoir, au nerf optique
& à la glande pituitaire , au plexus choroïde ; elle
donne aufli une artere qui va fe joindre à une branche
de la vertébrale , & fait- avec elle le cercle de
W illis , connu à la vérité avant cet autour : cette
artere donne aufli de petites branches au plexus
choroïde, aux éminences mammillaires , à l’enton,-
noir, aux nerfs optiques, &c.
A la naiffance même de la branche communicante,
l’artere cérébrale fe divife. La branche antérieure
, qui eft la plus petite , s’unit prefque aufli-
tôtàfa compagne par une branche tranfverfale, dont
il naît un petit tronc qui remonte à la cloifon tranf-
parente, à la comiffure antérieure du cerveau, St
au troifieme ventricule.
Ce tronc antérieur donne des branches cérébrales,"
St d’autres aux piliers de la voûte : il fe replie le
long du corps calleux, va en arriéré jufqu’à fon
extrémité poftérieure , St fournit des branches cérébrales
confidérables , qui communiquent" avec les
branches du tronc poftérieur, St avec celles de la
vertébrale. Il finit à la fin dans le lobe poftérieur du
cerveau en donnant des rameaux à la faux , & à la
tente du cervelet.
Le tronc poftérieur de la carotide cérébrale donne
des branches aux colonnes du cerveau St au plexus
choroïde : il remonte par la foffé de Sylvius, St
donne des branches nombreufes aux deux lobes du
cerveau ; elles marchent en ferpentant dans le fond
des plis du cerveau, & forment un réfeau très-épais
fur toute la furface de la pie-mere ; fes derniers filets
defeendent dans la partie corticale du cerveau.
Les arteres de cet organe font plus caftantes que
celles de tous les autres vifeeres ; elles ne font
cependant pas deftituées de fibres mufculaires.
( H. D . G. )
§ CAROUBIER, ( Bot. ) en Latin ceratonia|
Lin. Jiliqua Tournef. en Anglois , the corob-tree, or
S. Johns Bread. en Allemand, fchoteübaum.
Caractère générique.
Les caroubiers, tant mâles que femelles » portent
des fleurs apétales. Les fleurs mâles ont cinq longues
étamines ; les fleurs femelles fe diftinguent par
I un embryon charnu qui fe transforme enfuite en fili*
que. Cette filique eft longue »charnue, comprimée St
divifée par des cloiforis tranfverfales en plufieürs
cellules dont chacune renferme une femence large
St lenticulaire.
On ne connoît qu’une efpece de ce genre.
t é càrmhicr à filique mangeable.’
SlUtua edulcis. C. B. p. mas Sr famma:
Cet arbre croît en Provence, dans le royaume dè
Naples, dans l’Andaloufie, en Egypte St dans le
levant où il s’en trouve des haies. La hauteur qu’il
acquiert lorfqu’ii s’élance fur une tige unique, peut
le faire regarder comme un arbre du quatrième ordre.
Il a fes feuilles compofées de folioles arrondies
& fort larges, conjuguées fur un ftipule de fept à
huit poUces de long. Ces folioles font epaiffes St
entières, mais comme pliffées par les bords; leur
couleur eft d’un beau verd intenfe Sc luifant. Le ftipule
de la feuille eft rougeâtre, St les jeunes bourgeons
dè couleur purpurine contraftent à merveille
avec la verdure du feuillage qui eft permanent.
C’eft bien dommage que le caroubier foit délicat; il
demande la ferre en Angleterre, en Hollande &
dans la France feptentrionale ; on peut néanmoins
en rifquer quelques pieds près d’un mur bien exposé
en les couvrant par les tems les plus froids. Si
l’on a voit dans les bofquets d’hiver de bonnes haies
d’i f ou de buis, elles vaudroient encore mieux que
des murs pour abriter des arbres verds délicats.
Lorfqu’on envoie la graine du caroubier dans la
filique, elle arrive parfaitement faine : on la ferne
en mars dans des pots qu’on plonge dans une couche
tempérée : ces jeunes plantes doivent paffer l’hiver
dans une caiffe à vitrage. Au mois de feptembre de
la fécondé année, il faudra les tranfplanter avec
lo in , & les mettre chacune féparément dans un pot :
cette opération ne peut fe faire de trop bonne heure
, car ces arbres pouffent de longs pivots fans racines
latérales, dont le retranchement rend la re-
prife très-difficile, lorfque ces pivots Ont acquis de
la cohfiftance & une certaine longueur. J’ai perdu
plufieürs beaüx fujets pour en avoir trop différé la
tranfplantation.
On donne les liliques de cet arbre aux beftiaux ;
elles contiennent une moelle affez agréable à manger
; elles font mêmé, dans les tems de difette, une
reffource pour les plus pauvres d’entre les habitans
des lieux où elles croiffent; mais cette nourriture
donne la diarrhée, St caufe des tranchées. On regarde
ce fruit comme un bon béchique ; il entre
dans plufieürs préparations médicinales.
Le bois du caroubier eft dur, & propre aux mêmes
ufages qïie celui du chêne verd.-
Il eft bon de voir dans le 'corps du Dictionnaire
raif. des Sciences, &c. ¥ article C aroubier , traité
par M. lé chevalier de Jaücourt ; on y trouvera une
érudition très-intéreffante. (M. LeBaron d e Ts ch o u ‘
237.)
* § G ARPA, ( Géogr. ) «ville d’Afie dans l’Inde,
au royaume de Brama». C’eft une ville imaginaire.
M. de Lifte a fagement fait de nettoyer fés cartes
de tous ces lieux imaginaires dont on a coutume
de barbouiller le papier fur la foi de mille relations
romanefques. La Martiniere, au mot Carpa. Lettres.
Jur ÛEncyclopédie.
CARRE , ( Hiß. eccléf. ) difdiple dé S. Paul, .ou
peut-être même un des foixante & douze difciples,
logea S. Paul chez lui à Troade en Afie. L’apôtre
lui lâiffa en recorinoiffance ou en dépôt un habit
& des livres qui étoient peut - être les faintes
écritures. Quelquès-uns Croient qü’il fut évêque de
Bercé, & qu’il reçut la couronne du martyre.
C ARPENTE, f. f. ( Antiq. ) c ’étoit un chariot
à plufieurs ufages ; il étoit employé ordinairement
à porter les matrones Ou les dames Romaines de
diftin&ion ; & du tems des empereurs, les impératrices.
Ce chariot étoit tiré par des mules : il ri’avoit
que deux roues. On dit pourtant qu’il y enavoit aufli
à quatre.
La carpente ne fervoit pas feulement pour les fem^
Tome I f
niés : uii roi Gaulois, nommé Bituitus ; cbmbattoit;
félon Florus, fur une carpente d’argent, & il fut mei
né en triomphe fur ce chariot.
Là figure de la càrpente fe trouve fur quelqueè
médaillés ; on la voit dans celle de Julia Augufta St
dans quelques autres. Malgré la petiteffe du champs
il paroît qu’il y avoit plufieurs ôrnemens ; dit D.
Bernard de Montfaucon.
* Dans les quatre volumes in-folio qui contiennent
les découvertes que l’on a faites dans Héraclée;
intitulés Pitture antiche, l’on peut voir là forme des
carpentum Sc des autres voitures en ufage chez les
anciens Romains. On trouvera auffi dans [’Antiquité
expliquée du P. Montfaucon, ou dans les ouvrages
'd’Oifellius, & dans lé Thefaurus- Morelli, le deffiii
de plufieurs médailles qui repréfentent les chars funèbres
que l’on employoit pour porter au bûchef
les corps des impératrices Romaines, Agrippine, &c.
( r .A . L . ) ;
La carpente étoit une des voitures dont on dit que
les Veftales avoient le droit de fefervir. (+ )
§ CARPENTRAS, ( Géogr. ) Carpentoracle. Les
notices marquent cette ville de la province Vien-
noife. On voit au concile d’Epaone, en 5 1 7 , là
foufeription d’un évêque de Carpentras.
Ce n’eft pas le Forum. Neronis, comme l’a cru
l’abbé de Longuerue ; ce lieu ancien doit être placé
à Forcalquier.
Les évequës, au v ie, vu® & vm e. fiecles, prennent
fouvent dans les conciles le titre de Vindauxen-
ß s , parce qu’ils avoient transféré leur fiege à Ven-
dafque ou Venafqüe , Vindauxa. Ce lieu, qui étoit
autrefois plus floriffant, & qui a donné le nom au
Comtat Venaiflin, n’eft plus qu’une bourgade à
1 lieue 7 de Carpentras y appellée Venafqüe.
A Morileux, à demi-lieue de Carpentras étoit lé
château bâti par Clément V , & où il réfidoit. Il y
fit battre une monnoie d’argent, où il prend le titre
de cornes Venetini.
Le pays eft fertile en v in , huile, fafran, en vers
à foie, en meuriers.
Dans le palais épifcopal de Carpentras eft un trophée
fort ancien : on y voit en relief un conquérant
qui tient deux rois enchaînés: on croit que c’eft une
partie du monument que En. Dom. Aenobardus St
Q. Fabius Max. firent élever après avoir vaincu les
Allobroges St les Arve,mes.
Pernes, peu éloigné de Carpentras, eft la patrie du
céfebre Flechier, évêque de Nîmes. (C )
* § CARPOCRATIENS,. . . . Ces hérétiques parurent
dans le 11e. fiecle , St non dans le XIe , comme
le dit lè Dictionnaire raif. des Sciences, Sic. par
une méprife typographique, l’imprimeur ayant pris
un chiffre romain pour un chiffre arabe. Lettres fur
l'Encyclopédie.
CARR É, ( Aßronomie. ) fe dit de trois conftella-
tions qui fe font remarquer par quatre étoiles principales.
difpofées en quadrilatère* On dit le carré de
la grande ourfe,le carré dePégafe & le carré d’Orion*
l a L a n d e *)
CARRE AU V » f. m. ( Hiß. nat. ichthyolog.) poif-
fon des îles Moluques très-bien gravé & enluminé
fous ce nom par C oye tt, au n°. 46" de la première
partie de fon Recueil des poijfons d'Amboina .
Il a le corps affez long, peu comprime par les côtés
; la tête, les y eux , la bouche de médiocre grandeur*
Ses iiageoires fönt au nombre de fept; toutes à
rayons mous : favoir, deux ventrales petites, triant
gulairès, au-deffous des deux peôprales qui forit
quarrées ; petites ; une dörfale fort longue 4 un peit
plus haute devant que derrière ; une derrière l’anusj