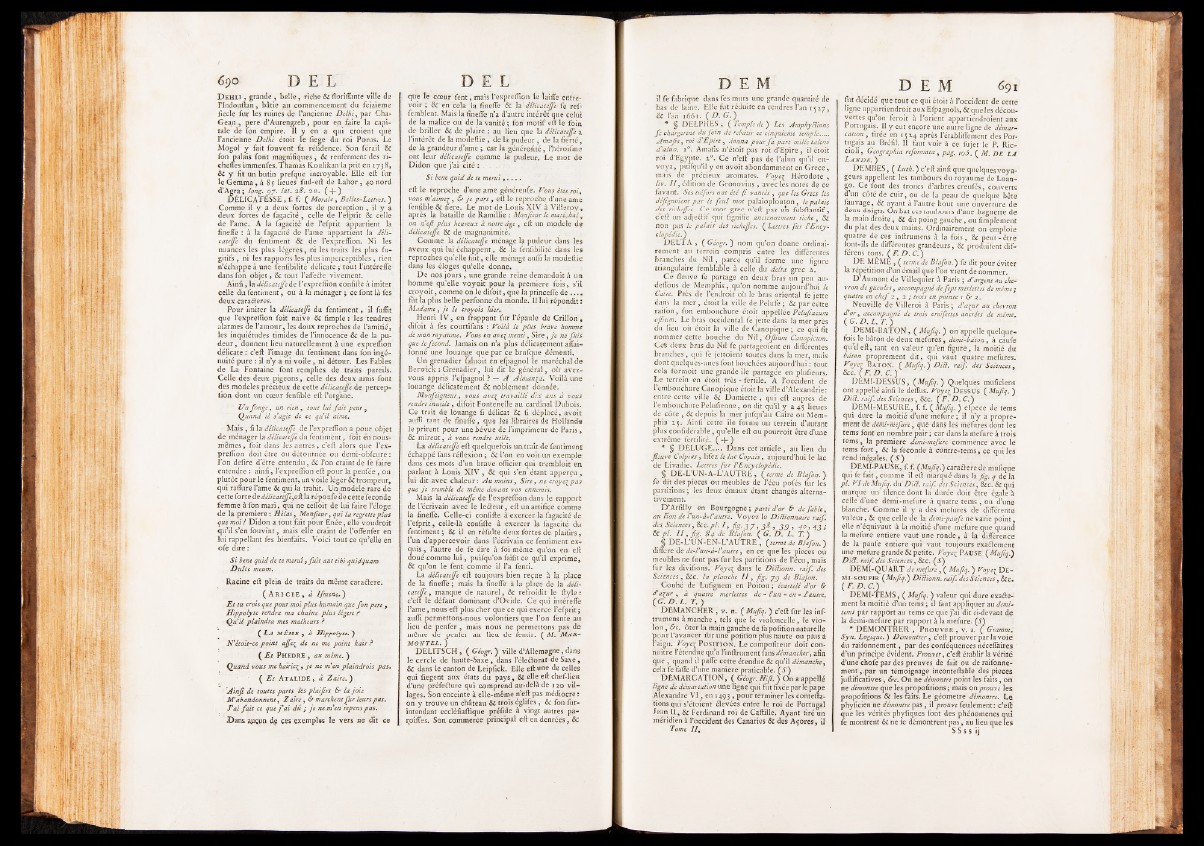
D ehli , grande , belle, riche & floriffante ville de
l’Indouftan, bâtie an commencement du feizieme
fiecle fur les ruines de l’ancienne Delhi, par Cha-
G e an , p,ere d’Aurengzeb, pour en faire la capitale
de fon empire. Il y en a qui croient que
l’ancienne Delhi étoit le fiege du' roi Porus. Le
Mogol y fait fouvent fa réfidence; Son férail &
fon palais font magnifiques, & renferment des ri-
chefies immenfes. Thamas Koulikan la prit en 173 8,
& y fit un butin prefque incroyable. Elle eft fur
le Gemma , à 85 lieues fud-eft de Lahôr, 40 nord
d’Agra ; long. $ j . lat. 28. 20. ( '+ )
DÉLICATESSE, f. f. ( Morale , Belles-Lettres. )
Comme il y a deux fortes de perception, il y a
deux fortes de fagacité, celle de l’efprit & celle
de l’ame. A la fagacité de l’efprit appartient la
finefle : à la fagacité de l’ame appartient la' délicatejfe
du fentiment & de l’expreflion. Ni les
nuances les plus légères, ni les traits les plus fugitifs
, ni les-rapports les plus imperceptibles , rien
n’échappe à une fenfibilité délicate ;- tout l’intérefle
dans fon objet, & tout l’affeéle- vivement.
Ainfi, la dèlicdtejfe de l ’expreffion confifte à imiter
celle du fentiment, ou à la ménager ; ce font là fes
deux caraéleres.
Pour imiter la délicatejfe du fentiment, il fuffit
que l’expreflion foit naïve & fimple : les tendres
alarmes de l’amour, les doux reproches de l’amitié,
les inquiétudes timides de l’innocence & de la pudeur
, donnent lieu naturellement à une expreflion
délicate : c’eft l’image du fentiment dans fon ingénuité
pure : il n’y a ni vo ile , ni détour. Les Fables
de La Fontaine font remplies de traits pareils.
Celle des deux pigeons, celle dés deux ,amis font
des modèles précieux de cette délicatejfe de perception
dont un coeur fenfible eft l’organe.
Un fonge, un rien, tout lui fait peur ,
Quand i l s'agit de ce qii il aime.
Mais, fi la délicatejfe de l’expreflion a.pour.objet
de ménager la délicatejfe du fentiment, foit en nous-
mêmes, foit dans les autres, c’eft alors que l’expreffion
doit être ou détournée ou demi-obfcure :
l’on defire d’être entendu, & l’on craint de fe faire
entendre : ainfi, I’expreflîon eft pour la penfée, ou
plutôt pour le fentiment, un voile léger & trompeur,
qui raflure l’ame & qui la trahit. .Unmodele. rare de
cette forte de délicatejfe^tft.la répônle de cetteîeconde
femme à fon mari, qui ne ceffoit de lui faire l’éloge
de la première : Hélas, Monjieur, qui la regrette plus
que moi! Didon a tout fait pour Enée, elle voudroit
qu’il s’en fouvînt, mais elle craint de l’offenfer en
lui rappellant fes bienfaits. Voici tout ce qu’elle en
oie dire :
Si bene quid de te merui , fuit aut tibi quidquam
Dulce meum.
Racine eft plein de traits du même caraélere.
(A R I C I E , à Ifnene, )
E t tu crois que pour, moi plus humain que fon. pere ,
Hippolyte rendra ma chaîne plus légère .<*
Qu'il plaindra mes malheurs ?
( La mêm e , à Hippolyte. )
N'étoit-ce point affe£ de ne me point haïr ?
( E t PHEDRE , au même. )
Quand vous me hoirie^, je ne m’en plaindrois pas.
( E t ATALIDE, à Zàire. )
'Ainfi de toutes parts les plaifirs & la joie
M’abandonnent y Z aire y & marchent fur leurs pas.
T ai fait ce que j ’ai dû ; je ne m’en repens pas.
Dans aucun de ces exemples le yers ne dit ce
qlie le coeur fent, mais l’expreflion ie Iaifle erittë-
voir ; &c en cela la finefle & la dèlicatejje fe ref-
femblent. Mais la finefle n’a d’autre intérêt que celui
de la malice ou de la vanité ; fon* motif eft le foin
de briller & de plaire ; au lieu que la délicatejfe a
l’intérêt de la modeftie, de la pudeur, de la fierté,
de la grandeur.d’aine ; car la générofité, l’héroïfme
ont leur délicatejfe cotmme la pudeur. Le mot de
Didon que j’ai cité : . .
Si bene quid de te mefui , . . . .
eft le reprpche d’une .ame généreufe. Vous êtes roi*
vous m’aime^, 6* je pars t eft le reproche, d’une ame
fenfible fiere. Le mot de Louis XIV àViUeroy,
après la bataille de RamiUie : Monfieur le maréchal,
on n’efi plus heureux a notre âge , eft un m.odele de
délicatejfe. & de magnanimité.
Comme la délicatejfe ménage 1? pudeur dans les
aveux qui lui échappent, & la fenfibilité dans le?
reproches qu’elle fait, elle ménage aufli l.a modeftie
dans les élog.es qu?eüe donne.
De nos jours , une grande reine demandoit à un
homme qu’elle VQyoit pour la première fois, s’il
croyoit, comme on le difoit, que la princefle de . . . -
fut la plus belle perfonne' du monde. Il lui- répondit i
Madame f je le croyois hier.
Henri IV , en frappant fur I’épàule dé Crillon ,
difoit à fes courtifans : Voilà le plus brave homme
de mon royaume. Vous en ave[ menti, Sire, Je ne fuis
que le fécond. Jamais on n’a plus délicatement affai-
fonné une louange que par ce brufque démenti.
Un grenadier faluôit ën efpagnol le maréchal de
Berwick : Grenadier, lui dit le général, oif avez-
vous appris l’efpagnol ? — A Aimanta. Voilà une
louange délicatement & noblement donnée.
Monfeigneür y vous ave^ travaillé dix ans et vous
rendre inutile , difoit Fontenellë au cardinal Dubois.
Ce trait de louange fi délicat & fi déplacé, avoit
aufli tant de finefle, que les libraires de Hollande
le prirent pour une bévue de rimprimeur de Paris ,
& mirent, à vous rendre utile.
La délicatejfe eft quelquefois un.tEait.de fentiment
échappé fans réflexion ; & l’on en voit, un exemple
dans ces mots d’un brave officier, qui tremblait en
parlant à Louis X IV , & qui s’en étant apperçu ,
lui dit avec chafeur: Au moins y Sirey ne croy ez.pas
que je tremble de même devant vos ennemis. .
Mais la délicatejfe de l’expreffion dans le rapport
de l’écrivain avec le le â eu r , eft lin. artifice comme
la finefle. Celle-ci confifte à exercer, la fagacité de
l’efprit, celle-là confifte à exercer la fagacité du
fentiment; & il en réfulte deux fortes de plaifirs,
l’un d’appercevoir dans l’écrivain ce fentiment exquis
, l’autre de fe dire à foi-même, qu’on en eft
doué comme- lu i, puifqu’on faifit ce qu’il exprime,
& qu’on le fent. comme il l’a fenti.
La délicatejfe eft toujours bien reçue à la place
de la finefle ; mais la finefle à la place de la délicatejfe
y manque de naturel, & refroidit le ftyle :
c’eft le défaut dominant d’Ovide. Ce qui intérefle
l’ame, nous eft plus cher que ce qui exerce l’efprit ;
aufli permettons-nous volontiers que l’on fente au
lieu de penfer, mais nous ne permettons- pas de
même dé penfer au lieu de fentir. ( M. Ma r -
MONTE L . )
DELITSCH , ( Gèogr. ) ville d’Allemagne, dans
le cercle de haute-Saxe, dans l’éleûorat de Saxe,
& dans le canton de Leipfick. Elle eft une de celles
qui fiegent aux états du pays, & elle eft chef-lieu
d’une préfecture qui comprend au-delà de 120 villages.
Son enceinte à elle-même n’eft pas médiocre:
on y trouve un château & trois églifes , & fon fur-
intendant eccléfiaftique préfide à vingt autres pa-
roifles. Son commerce principal eft en denrées, ÔC
il fe fabrique dans fes murs une grande quantité de
bas de laine. Elle fut réduite en cendres l’an 1527,
fk l’an 1661. ( D. G. )
* § DELPHES , ( Temple de ) Les Amphyétions
fe chargèrent du foin de rebâtir ce 'cinquième temple.....
Amafisy roi d’Epire, donna pour fâ part mille talens
d’alun. i°. Amafis n’étoit pas roi d’E pire, il étoit
roi d’Egypte. 20. Ce n’eft pas de l’alun qu’il en-
voya, puifqu’il y en avoit abondamment en Grece,
mais de' précieux aromates. Voye[ Hérodote ,
liv. U y édition de Gronovius , avec les notes de ce
favant. Ses trèfors ont été (1 vantés y que les Grecs les
dèfignoient par le feul mot palaioplouton, le palais
des richefes. Ce mot grec n’eft pas un fubftantif,
c’eft un adjeftif qui fignifie anciennement riche , &
non paS le palais des richefjes. ( Lettres fur lEncyclopédie.
v
DELTA , ( Géogr. ) nom qu’on donne ordinairement
au terrein compris entre les différentes
branches du N il, parce qu’il forme une figure
triangulaire femblable à celle du delta grec a.
Ce fleuve fe partage en deux bras un peu au-
deffous de Memphis, qu’on nomme aujourd’hui le
Caire. Près de l’endroit oli le bras oriental fe jette
dans la mer, étoit la ville de Peliïfe ; & par.cette
raifon, fon embouchure étoit appëllée Pelufiacum
oftium. Le bras^ occidental fe jette dans la mer près
du lieu oit étoit la ville de Canopique ; ce qui fit
nommer cette bouche du N il, Oftium Canopicum.
Ce$ deux bras du Nil fe partageoient en différentes
branches, qui fe jettoient toutes dans la mer, mais
dont quelques-unes font bouchées aujourd’hui : tout
cela formoit une grande île partagée en plufiëürs.
Le terrein en étoit très - fertile. A l’occident de
l’embouchure Canopique étoit là ville d’Alexandrie:
entre cette ville & Damiette-, qui eft auprès de
l’embouchure Pelufienne, on dit qu’il y a 45 lieues
de côte , & depuis la mer jufqu’au Caire ou Memphis
25. Ainfi cette île forme un terrein d’autant
plus confidérabîe, qu’elle eft ou pourroit être d’une
extrême fertilité. ( -J- )
* § DÉLUGE.... Dans cet article, au lieu du
fleuve Colpias, lifez le lac Copais, aujourd’hui le lac
de Livadie. Lettres fur P Encyclopédie.
. § DE-L’UN-A-L’AU TR E , ( te rme de Blafon. 7
fe dit des pièces ou meubles de l’ecu pofés fur les
partitions ; les deux émaux étant changés alternativement.
D’Arfilly en Bourgogne ; parti dlor & de fable,
au lion de L’un-à-Cautre. Voyez le Dictionnaire raif.
des. Sciences y fkc.pl. I , fig. 3J7 , 38 , 3g , 4 0 ,4 3 ;
èc p l. I I , fig. 84 de Blafon. ( G. D . L. T. )
§ DE-L’UN-EN-L’A U T R E , ( t erme de Blafon. )
différé de de-t’un-ù-Cautre, en ce que les pièces ou
mëûbles ne font pas fur les partitions de l’écu, mais
fur l.es divifions. Voye[ dans le Diciionn. raif. des
Sciences, & c . la planche I I , fig. yo) de Blafon.
Conhé de Lufignem en Poitou; écartelé d’or &
d’azur , a quatre merlettes de - F un - en -Xautre.
( G. D. L. T. )
DÉMANCHER , v. n. ( Mufiq.J c’eft fur les inf-
trumens à manche , tels que le violoncelle, le violon
, &c. ôter la main gauche de fa pofition naturelle
pour l’avancer fur une pofition plus haute ou plus à
l’aigu. Voye^ Position. Le compofiteur doit con-
noître l’étendue qu’a l’inftrument fans démancher y afin
que , quand il paffe cette étendue & qu’il démanche y
cela fe fafle d’uhe maniéré praticable. ( S )
DÉMARCATION, ( Géogr. Hifi. ) On a appellé
ligne de démarcation une ligne qui fut fixée par le pape
Alexandre V I , en 1493 , pour terminer les contefta-
tions qui s’étoïent élevées entre le roi de Portugal
Jean II, & Ferdinand roi de Caffille. Ayant tiré un
méridien à l’occident des Canaries & des Açores, il
Tome II,
fut décidé que tout ce qui étoit à l’occident de cette
ligne appartiendroit aux Efpagnols, & que les découvertes
qu’on feroit à l ’orient appartiendroient aux
Portugais. Il y eut encore une autre ligne de démarcation
y tirée en 1524 après l’établiflement des Portugais
au B réfil. Il faut voir à ce fu jet le P. Ric-
cioll, Geographia reformata, pag. 10S. ( M. DE LA
L a n d e . )
DEMBES, ( Luth. ) c’eft ainfi que quelques voyageurs
appellent les tambours du royaume de Loan-
go. Ce font des troncs d’arbres creufés, couverts
d’un coté de cuir, ou de la peau de quelque bête
fauvage, & ayant à l’autre bout une ouverture de
deux doigts. On bat ces tambours d’une baguette de
la main d roite, & du poing gauche, ou Amplement
du plat des deux mains. Ordinairement on emploie
quatre de ces inftrumens à la fois, & peut-être
font-ils de différentes grandeurs, & produisent dif-
férens tons. ( F. D . C.")
DE MÊME, ( terme de Blafon.) fe dit pour éviter
la répétition d’un émail que l’on vient de nommer.
D ’Aumont de Villequier à Paris ; d’argent au chevron
de gueules, accompagné de fept merlettes de même ;
quatre en chef 2 , 2 ; trois en pointe 1 & 2.
Neuville de Villeroi à Paris ; d’à^ur au chevron
<For y accompagné de trois croifettes ancrées de même.
(G . D. L. T. )
DEMI-BATON, ( Mufiq. ) on appelle quelquefois
le bâton de deux mefures, demi-bâton y à caufe
qu’il eft, tant en valeur qu’en figure, la moitié du
bâton proprement dit, qui vaut quatre mefureS.'
Voyei ÊA TON. (Mufiq.) D ici. raif. des Sciences.
&c. ( F .D .C . )
DEMI-DESSUS, (Mufiq.) Quelques muficiens
ont appellé ainfi le deflus. Voye1 Dessus ( Mufiq. )
Dict. raif. des Sciences, &c. ( F . D. C.)
DEMI-MESURE, f. f. (Mufiq. ) elpece de tems
qui dure la moitié d’une mefure ; il n’y a proprement
de demi-mefure 'y que-dans les mefures dont les
tems font en nombre pair ; car dans la mefure à trois
tems, la première demi-mefure commence avec le
tèms fort, & la fécondé à côritre-rems, ce qui les
rend inégales. ( S )
DEMI-PAUSE, f. f. (Mufiq.) cara&erede mufiqùe
qui fe fait, comme il eft marqué dans la fig. q de la
pl. Vide Mufiq. du Dict. raif. des Sciences y &c. & q u i
marque un filencedont la durée doit être égale à
celle d’une demi-mefure à quatre tems , ou d’une
blanche. Comme il y a des mefures 'de différente
valeur, & que celle de la demi-paufe ne varie point,
elle n’équivaut à la moitié d’une mefure que quand
la mefure entière vaut une ronde, à la différence
de la paufe entière qui vaut toujours exa&ement
une mefure grande & petite. Voye^ Pause (Mufiq!)
Dict. raif.-des Sciences y &c. ( 5)
DEMI-QUART de mefure , ( Mufiq. ) Voye^ DÈ-
MI-SOUPIR (Mufiq.) Dictionn. raif. des Sciences y & c .
{ F .D . c . )
DEMI-TEMS, ( Mufiq. ) valeur qui dure exafte-
ment la moitié d’un tems ; il faut appliquer au demi-
ttms par rapport au tems ce que j’ai dit ci-devant de
la demi-mefure par rapport à la mefure. (S)
* DÉMONTRER , Prouver , v. a. ( Gramml
Syn. Logique.) Démontrer, c’eft prouver par la voie
du raifonnement, par des conféquénces néceflàires
d’un principe évident. Prouver y c’eft établir la vérité
d’une chofe par des preuves de fait ou de raifonnement,.
par un témoignage inconteftable des pièces
juftificatives, &c. On ne démontre point les faits, on
ne démontre que les propofitions ; mais on prouve les
propofitions fk les faits. Le géomètre démontre. Le
phyficien ne démontre pas, il prouve feulement : c’eft
que les vérités phyfiques font des phénomènes qui
fe montrent & ne fe démontrent pas, au lieu que les
S S s s ij