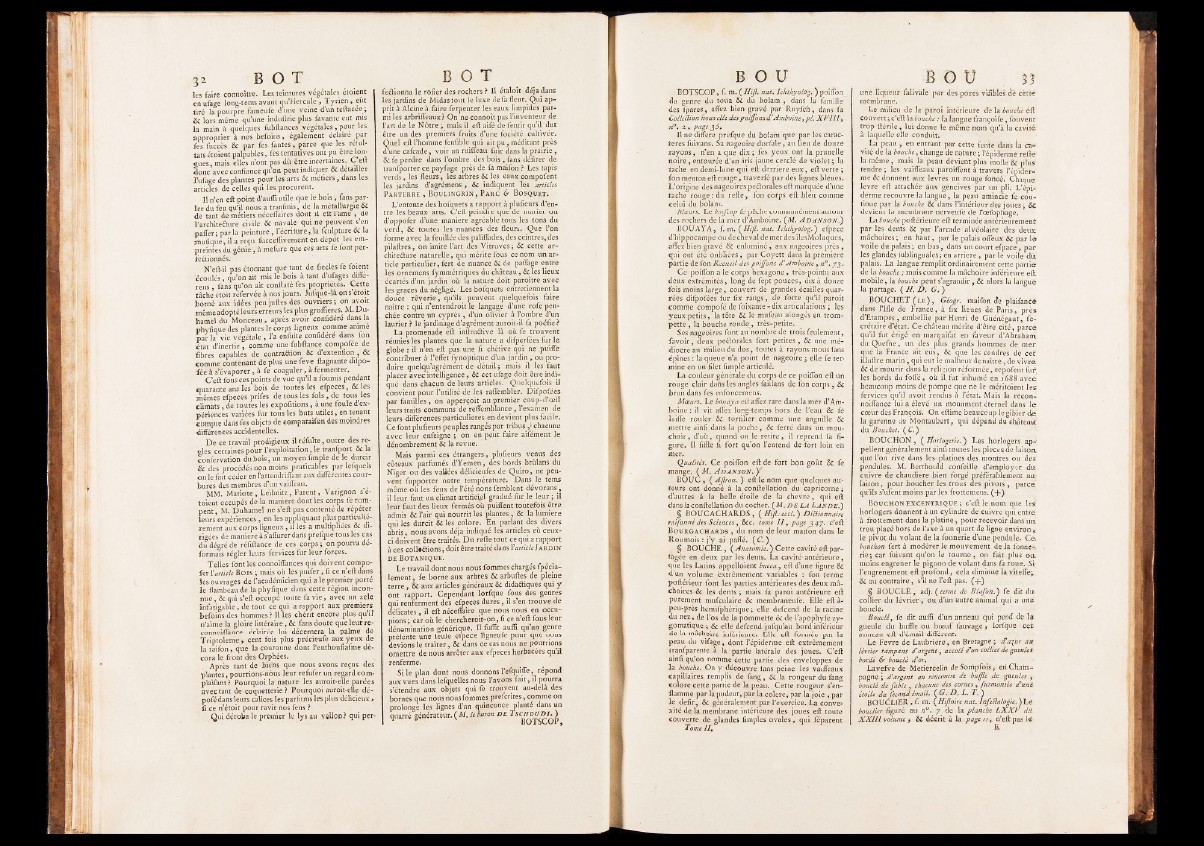
les faire connoître. Les teintures végétales étoient
enufage long-tems avant qu’Hercule , T y n e n , eut
tiré la pourpre fameufe d’une veine d’un teflacée ;
& lors même qu’une induflrie plus lavante eut mis
la main à quelques fubftances végétales . pour les
approprier à nos befoins, également éclaire par
les fiiccès & par les fautes,j parce que les reful-
tatsétoient palpables, fes tentatives ont pu etrelon-
gues, mais elles n’ont pas dû être incertaines. C eft
donc avec confiance qu’on peut indiquer 6c détailler
l’ufage des plantes pour les arts ôc métiers, dans les
articles de celles qui les procurent.
Il n’en eft point d’aufli utile que le bois, fans parler
du feu qu’il nous a tranfmis, de la métallurgie ôc
de tant de métiers néceffaires dont il eft 1 ame , de
l ’architeûure. civile & navale qui ne peuvent s’en
paffer; parla peinture, l’écriture, la fculpture ôc la
mufique, il a reçu fucceflivement en dépôt les empreintes
du génie, àmefure que ces arts fe fontper-
feûionnés.
N’eft-il pas étonnant que tant de fiecles fe foient
'■ écoulés, qu’on ait mis le bois à tant d’ufagès diffé-
rens , fans qu’on ait conftaté fes propriétés. Cette
tâche étoit réfervée à nos jours. Jufque-là on s etoit
borné aux idées peu juftes des ouvriers ; on avoit
même adopté leurs erreurs les plus groflieres. M. D uhamel
du Monceau, après avoir confideré dans la
phyfique des plantes le corps ligneux comme anime
par la vie végétale , l’a enfuite confidéré dans fon
état d’inertie, comme une fubftance compofée de
fibres capables de contraûion ôc d extenfion , ôc
comme contenant de plus une feve ftagnante difpo-
fée à s’évaporer, à fe coaguler, à fermenter.
C ’eft fous ces points de vue qu’il a fournis pendant •
quarante ans les bois de toutes les efpeces, ôc les
mêmes efpeces prifes de tous les fols , de tousses |
climats, de toutes les expofitions, à une foule d’expériences
variées fur tous les buts utiles, en tenant
compte dans fes objets de comparaifon des moindres
différences accidentelles.
De ce travail prodigieux il réfulte, outre des réglés
certaines pour l’exploitation, le tranfport oc la
confervation dubois, un moyen fimple de le durcir
& des procédés non moins praticables par lefquels
on le fait céder en f’attendriflant aux différentes courbures
des membres d’un vaiffeau. ^
MM. Mariote, Leibnitz, Parent, Varignon se-
toient occupés de la maniéré dont les corps fe rompent
, M. Duhamel ne s’eft pas contenté de répéter
leurs expériences , en les appliquant plus particulie--
rement aux corps ligneux, il les a multipliées ôc dirigées
de maniéré à s’affurer dans prefque tous les cas
du dégré de réfiftance de ces corps ; on pourra déformais
régler leurs fervices fur leur forces.
Telles font les connoiffances qui doivent compo-
fer l'article Bois ; mais oii les puifer, fi ce n’ eft dans
les ouvrages de l’académicien qui a le premier porté
le flambeau de la phyfique dans cette région inconnue,
& qui s’eft occupé toute fa v ie , avec un zele
infatigable , de tout ce qui a rapport aux premiers
befoins des hommes? Il les chérit encore plus qu’il
n’aime la gloire littéraire, ôc fans doute que leur re-
connoiffance éclairée lui décernera la palme de
Triptoleme, cent fois plus précieufe aux yeux de
la raifon, que la couronne dont l’enthoufiafme décora
le front des Orphées.
Après tant de biens que nous avons reçus des
plantes, pourrions-nous leur refufer un regard com-
plaifant ? Pourquoi la nature les auroit-elle parées
avec tant de coquetterie? Pourquoi auroit-elle dé-,
pofé dans leurs calices les parfums les plus délicieux »
U ce n’étoit pour ravir nos fens ?
Qui déroba le premier le lys au yallon? qui perfeétionfia
le rouer des rochers ? Il étàloit déjà dans
lès jardins de Midastout le luxe de fa fleur. Qui apprit
à Àlcine à faire ferpenter les eaux limpides parmi
les arbriffeaux? On ne connoît pas l’inventeur de
l’art de le Nôtre ; mais il eft aifé de fentir qu’il dut
être un des premiers fruits d’une fociété 'cultivée*
Quel eft l’homme fenfible qui ait pu, méditant près
d’une cafcade, voir un ruiffeau fuir dans la prairie ,
ôc fe perdre dans l’ombre des bois , fans délirer dé
tranfporter ce payfage près de fa maifon ? Les tapis
verds, les fleurs, les arbres ôc les eaux compofent
les jardins d’agrémens , ôc indiquent les articles
Parterre , Boulingrin , Parc 6- Bosquet.
L’entente des bofquets a rapport à plufieurs d’entre
les beaux- arts. C’eft peindre que de marier ou
d’oppofer d’uhe maniéré agréable tous les tons du
verd, ôc toutes les nuances des fleurs. Que l’on
forme avec la feuillée des paliffades, des ceintres,des
pilaftres, on imité l’art des Vitruves ; & cette architecture
naturelle, qui mérite fous ce nom un ar-
ticle particulier, fert de nuance & de paffage entre
les ornemens fymmétriques du château, & les iieux
• écartés d’un jardin où la nature doit paroître avec
les grâces du négligé. Les bofquets entretiennent la
douce r,êverie, qu’ils peuvent quelquefois faire
naître : qui n’entendroit le langage d’une rofe penchée
contre un cyprès , d’un olivier à l’ombre d’un
laurier ? le jardinage d’agrément- auroit-il fa poéfie ?
La promenade eft inftruûive là où fe trouvent
réunies les plantes que la nature a difperfées fur le
globe : il n’èn eft pas une fi chétive qui ne .puiffe
contribuer à l’effet fynoptique d’un jardin , ou produire
quelqu’agrément de détail ; mais il les faut
placer avec intelligence, ôc cet ufage doit être indiqué
dans chacun de leurs articles. Quelquefois il
convient pour l’utilité de les raffembler. Difpofées
par familles, on apperçoit au premier coup-d’oeil
leurs traits communs de reffemblance, l’examen de
leurs différences particulières en devient plus facile.
Ce font plufieurs peuples rangés par tribus ,* chacune
avec leur enfeigne ; on en peut faire aifément le
dénombrement & la revue.
Mais parmi ces étrangers, plufieurs venus des
coteaux parfumés d’Yemen, des bords brulàns du
Niger ou des vallées délicieufes de Quito, ne peuvent
fupporter notre température. Dans le tems '
même où les feux de l’été nons femblent dévorans,
il leur faut un climat artificiel gradué fur le leur ; il
leur faut des lieux fermés où puiffent toutefois être
admis ôc l’air qui nourrit les plantes , & la lumière
qui les durcit & les colore. En parlant des divers
abris, nous ayons déjà indiqué les articles eù ceux-
ci doivent être traités. Du refte tout ce qui a rapport
à ces colls&ions, doit être traité dans Xarticle Jardin
de Botanique.
Le travail dont nous nous fommes chargés fpéçia-
lement, fe borne aux arbres ôc arbuftes de pleine
terre, ôc aux articles généraux Ôc didactiques qui y
ont rapport. Cependant lorfque fous des genres
qui renferment des efpeces dures, il s’en trouve de
délicates, il eft néceffaire que nous nous en occupions
; car où lé chercheroit-on, fi ce n’eft fous leur
dénomination générique. Il fuffit auffi qu’un genre
préfente une feule efpece ligneufe pour que nous
devions le traiter, ôc dans ce cas nous ne pourrions
omettre de nous arrêter aux efpeces herbacées qu’il
renferme.
Si le plan dont nous donnons l’efquiffe, répond
aux vues dans lefquelles nous l’avons fait, il pourra
s’étendre aux objets qui fe trouvent au-delà dès
bornes que nous nous fommes prefcrites, comme on
prolonge les lignes d’un quinconce plante dans un
quarré générateur. (AJ. le baron d e Ts c h o u d i . )
BOTSCOP, f. m. ( Hiß. nat. Ichthyolog. ) poiffon
du genre du toua ôc du bolam , dans la famille
des fpares, affez bien gravé par Ruyfch, dans fa
Collection houvelle des poiffons f Amboine, pi. X V I I I ,
n°. z , page $6.
Il ne différé prefque du bolam que par les caractères
fuivans. Sa nageoire dorfale, au lieu de douze
rayons, n’en a que dix ; fes yeux ont la prunelle
noire, entourée d’un iris jaune Cerclé de violet ; la
tache en demi-lune qui eft derrière eux, eft verte ;
fon mènton eft rouge, traverfé par des. lignés bleues.
L ’origine des nageoires pedoràles eft marquée d’une
tache rouge : du refte, fon corps eft bleu comme
celui du bolam.
Moeurs. Le botfcop fe pêche communément autour
des rochers de la mèr d’Amboine. (AJ. A d a n s o n .)
BO UA YA , f. m, (Hiß. nat. Ichthyolog. ) efpece
d’hippocampe ou de cheval de mer des îlesMoluques,
affez bien gravé ôc enluminé , aux nageoires près ,
qui ont été oubliées, par Coyett dans la première
pârt'ie de fôn Recueil des poijfons d?Ambo\ne ,-n°.yg.
Ce poiffon a le corps hexagone, très-pointu aux
deux extrémités, long de fept pouces, dix à douze
fois moins large, couvert de grandes écailles quar-
féès difpofées fur fix rangs, de forte qu’il paroît
comme compofé de foixante - dix articulations ; les
yeux petits , la tête ôc lé mufeau alongés en trompette
, la bouche ronde^, très-petite.
Ses nageoires font au nombre de trois feulement,
fa voir, deux peéiôrales fort petites , ôc une médiocre
au milieu du dos, toutes à rayons mous fans
épines : la queue n’a point de nageoire ; elle fe tef-
mine en un filet fimple articulé.
La couleur générale du corps de ce poiffon eft Uù
rouge clair darts les angles faillàns de fon corps, ôc
brun dans fes enfoncemens.
Moeurs. Le bottaya eft afléz tare dans la mer d’Amboine
: il vit affez long-temps hors de l’eau & fé
laiffe rouler & tortilier comme une anguille ôc
mettre ainfi dans la. poche, Ôc ferré dans un mouchoir
, d’o ù , quand on le retire, il reprend fa figure.
Il fiffle fi fort qu’on l’entend de fort loin eft
mer.
Qualités. Ce poiffon eft de fort bon goût ôc fe
mange. ( M. A d a n so n . Y
BOUC , ' ( Afiron. ) eft le nom que quelques aiû
teurs.ont donné à la conftellation du capricorne;
d’autres à la belle étoile de la chevre, qui eft
dans la conftellation du cocher. (AJ. d e l a La n d e .}
§ BOUCACHARDS , ( Hiß. eccL ) Dictionnaire t
raifonnè des Sciences, ÔCc. tome I ! , page j 47. c’eft
Bourgachards , du nom de leur maifon dans le
Roumois : j’y ai pàffé. ( C . )
§ BOUCHE , .( Anatomie. ) Cette cavité eft partagée
en deux par les dents. La cavité' antérieure,
que les Latins appelloient bucca, eft d’une figure ôc
d’un volume Extrêmement variables : fon terme
poftérieur font les parties antérieures des deux mâchoires
& les dents ; mais fa paroi antérieure eft
purement mufculaire Ôc membraneufe. Elle eft à-
peu-près hé.mifphérique ; elle defcend de la racine
du nez , de l’os de la pommette Ôc de l’apophyfe zy-
gomatique ; 6c elle defcend jufqu’au bord inférieur
de la mâchoire inférieure. Elle eft formée par la
peau du vifâge, dont l’épiderme eft extrêmement
tranfparente a la • partie latérale des joues. C ’eft
ainfi qu’on nomme cette partie des enveloppes de
la bouche. On y découvre lans peine les vaiffeaux
capillaires remplis de fang, 6c la rougeur du fang
colore cette partie de la peau. Cette rougéur s’enflamme
par là pudeur, par la colere, par la joie ,• par
le defir, 6c généralement par l’exercice. La conve-
xité de la membrane intérieure des joues eft toute '
couverte de glandes Amples ovales, qui féparent
Tome II,
une liqueur fàlivàle pat des pores viiibîes âè cètté
membrane.
Le milieu de la jparoi intérièiiré de là bouche éft
couvert ; c’efl la bouche : la langue françoife, fouvent
trop ftérile, lui donné le même nom qu’à la cavité
à laquelle elle conduit.
^ La peau , en entrant par cette fente flans ià M
vité de la bouche -, change de nature ; l’épiderme refté
la même, mais la peau dévient plus molle 6c plus
tendre ; les vaiffeaux paroiffent à travers l’épiderme
6c donnent aux levres un rouge foncé; Chaque-
levrè eft attachée aux gencives par un pli; L’épi-;
derme recouvre la langue, la peau amincie fe cou-1
tinue par la bouche ôc dans l’intérieur des jolies ; ôc
devient la membrane nerveufe dé l’oefophage.
La bouche poftérieure eft terminée antérieurement
par Tes dents ôc par l’arcade alvéolaifé des deux
mâchoires; en haut, pat le palais offeux 6c par 1er
voile du palais ; en b a s, dans un court efpace, par
les glandes fubliriguales; en arriéré, par le Voile dù
palais. La langue remplit ordinairement cette parti*
de la bouche ; mais comme la mâchoire inférieure eft
mobile, la bouche peut s’agrandir, 6c alors la langue
la partagé. {H . D . G .}
BOUCHET ( le) , Gcogr. maifon de plaifancè
dans l’Ifle de France, à fix lieues de Paris, près
d’Etampes, embellie par Henri dé Guénégaut, fe-
crétaire d’état. Ce château mérite d’être cité, parcei
qu’il fut érigé en marquifat en faveur d’Abràham
du Quefne, un des plus grands hommes dé mer
que la FranCe ait eus, 6c que les Tendres de cet
illuftre marin, qui eut le malheur denaîtrè, de vivre
6c de mourir dans la religion réformée, repofent fur,
les. bords du foffé, où il fut inhumé en 1688 avec
beaucoup moins de pompe que ne le méritoient les
fervices qu’il avoit rendus à l’état. Mais la recon-
noiffance lui a élevé un monument éternel'dans lé
coeur dès François. On eftime beaucoup le gibier dé
la garenne de Montaubert, qui dépend du château;
du Bouchet. (C .)
BOUCHON, ( Horlogerie. ) Les horlogers ap-'
pelient généralement ainfi toutes les pièces de laiton,
que l’on rive dans les* platines des montres ou dés
pendules» M. Berthould confeille d’employer du
cuivre de chaudière bien forgé préférablement au:
laiton, pour boucheries,trous des pivots , parcei
qu’ils s’ufent moins par les frottemens. (+ )
Bouchon excentrique ; c’eft le.nom que le*
horlogers donnent à un cylindre de cuivre qui entré
à frottement dans la platine, pour recevoir dans un
trou placé hors de l’axe à Un quart de ligne environ*
le pivot du volant de la fonnèrie d’une pëndulé. Ce>
bouchon fert à modérer le mouvement de la fonne^
rie; car fuivant qu’on le tourne, on fait plus ou»
moins engrener le pignon de volant dans fa roue. Si
l’engrenement eft profond, cela diminué la vîteffe;
6c au contraire, s’il ne l’eft pas. (+ )
§ BOUCLÉ , adj. ( terme de Blafôîi.) fe dit dit
collier du lévrier-, ou d’un autre animal qui a uné
boucle.
Bouclé, fe dit aufli d’un anrtëau qui pend de la
gueule du buffle ou boeuf fauvage, lorfque cet>
anneau eft d’émail différent»
Le Fevre de Laubriére, en Bretagne; dta^ur du
lévrier rampant d'argent, accolé Tun collier de gueules>
bordé & bouclé cl or.
Lavefve de Metiércelih de Sompfois, eh Champagne
; £ argent au rencontre de buffle de gueules ,
bouclé de fable , chacune des cornes , furmontée d'uni
étoile du fécond émail. ( G . D. L. T-. )
BOUCLIER, f m. ( Hijloire nat.Infecîologiéi ) Lé
bouclier figuré au n°. 7 de la plaûcke L X X V dit
XXIIIvolume > ôc décrit à la page //,. n’eft pas lé