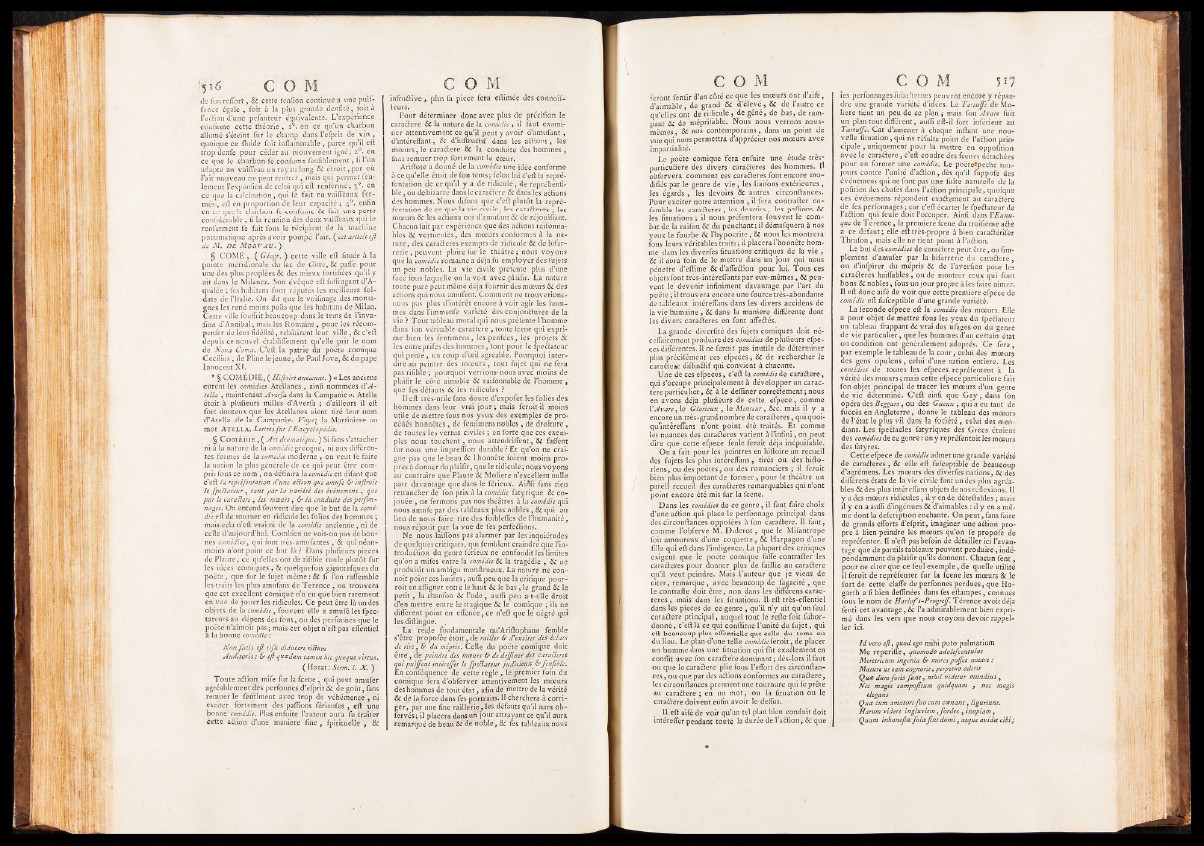
de fon reffort, 6c cette tenfiôn continue a une puif-
far.ce égale , foit à la plus grande denfité, foit a
l’aâiond’uné pefanteur équivalente. L’expérience
confirme cette théorie , i° . en ce qu’un charbon
allumé s’éteint fur le champ dans l’efprit de vin ,
quoique ce fluide foit inflammable, parce qu’ il eft
trop denfe pour céder au mouvement igné; 2 • en
c e que le charbon fe confume fenfiblement, fi r on
iidapte au vâifîeau un tuyau long 6c étroit, par oii
l’air nouveau ne peut rentrer , mais qui permet' feulement
l’expànfion de celui qui eft renfermé; 30. en
c e que la calcination, qui fe fait en vaifleaux fermés,
eft en proportion dé leur capacité ; 40. enfin
e'n ce que le charbon fe confunie & fait une perte
conlidérable, fi la réunion des deux vaifleaux qui le
renferment fe fait fous le récipient de la machine
pneumatique après avoir pompé l’air, (cet articlecjl .
de M. DE M o R V A U .y
§ COME , ( Géogr. ) cette ville eft fituée à la
pointe méridionale du lac de Corne, 6c paffe pour
une des plus peuplées 6c des mieux fortifiées qu’il y
ait dans le Milanez. Son évêque eft fuffragant d’A-
quilée ; fés habitans font réputés les meilleurs fol-
dats de l’Italie. On dit que le voifinage des montagnes
les rend moins polis que les habitans de Milan.
Cette ville fouffrit beaucoup dans le tems de l’inva-
iîon d’Annibal; mais les Romains , pour les récom-
penfer de leur fidélité, rebâtirent leur ville , 6c c’eft
depuis ce nouvel établiffement qu’elle prit le nom
de ftova Coma. C’eft la patrie du poëte comique
Cecilius, de Pline le jeune, de PaûlJove, & d u pape
Innocent XI.
* § COMÉDIE, ( Hifloire ancienne. ) « Les anciens
eurent les comédies Atellanes , ainfi nommées d'A -
tella , maintenant Averfa dans la Campanie». Atella
étoit à plufieurs milles d’Averfa ; d’ailleurs il eft
fort douteux que les Atellanes aient tiré leur nom
d’Atella de la Campanie. Voye£ la Martiniere au
mot Atella. Lettres fu r l'Encyclopédie.
§ C o m é d i e , ( Ar t dramatique. ) Si fans Vattacher
fii à la nature de la comédie grecque, ni aux differentes
formes de la comédie moderne , oh veut fe faire
la notion la plus générale de ce qui peut être compris
fous ce nom , on définira la comédie en difant que
c’eft la repréfentation d'une action qui amufe & inflruit
le fpeclateur, tant par la variété des èvénemens , que
par le caractère , les moeurs, & la conduite des perfon-
nages. On entend fouvent dire que le but de la comédie
eft de tourner en ridicule les folies des hommes ;
mais cela ri’eft vrai ni de la comédie ancienne , ni de
celle d’aujourd’hui. Combien ne voit-on pas de bonnes
comédies, qui font très-amufantes , & qui néanmoins
n’ont point ce but là ? Dans plufieurs pièces
de Plaute, ce qu’elles ont de rifible roule plutôt fur
les idées comiques , & quelquefois gigantefques du
poëte , que fur le fujet même : & fi l’on raffemble
les traits les plus amufans de Terence , on trouvera
que cet excellent comique n’a eu que bien rarement
en vue de jouer les ridicules; Ce peut êtredà un des
objets de la comédie, fouvent elle a amufé les fpec-
tateiirs au dépens des fous, ou des perfonnes que le
poëte ii’àimoit pas ; mais cet objet n’ eft pas effentiel
à la bonne comédie :
Non fa tis ejl rifu diducere rictum
Auditoris : & eft quoedam tamen hic quoquevirtus.
( Horat : Serm. I. X . )
Toute attion mife fur la fcene’, qui peut amüfer
âgréablementdès perfonnes d’efprit 6c de goût, fans
rem.uer le fentiment avec trop de véhémence., ni
exciter fortement des pallions férieufes , eft une
b o n n t 1 comédie. Plus enfuite l’auteur aura fu traiter
ie tte aûion d’une manière fine, fpirituélle , 6c
infruôive , plus fa piecë fera eftimée des connoif-
leurs. '
Pour déterminer donc avec plus de précifion le
carafïere 6c la nature de la comédie , il faut examiner
attentivement ce qu’il peut y avoir d’amufant,
d’intéreffant, 6c d’inftruéhf dans les allions , les
moeurs, le caraâere & la conduite des hommes ,
fans remuer trop fortement le coeur.
Ariftote a donné de la comédie une idée conforme
à ce qu’elle étoit de fon tems; félon lui c’eft la repréfentation
de ce qu’il y a de ridicule, de repréhenfi-
ble, ou de bizarre dans le caraftere 6c dans les actions
des hommes. Nous difons que c’eft plutôt la repréfentation
de ce que la vie civile, les caraéteres , les
moeurs 6c les aftions ont d’amufant 6c de réjouiffant.
Chacun fait par expérience que des aêlions raifonna-
bles 6c vertueufes, des moeurs conformes à la nature
, des caraderes exempts de ridicule 6c de bifar-
rerie , peuvent plaire fur le théâtre ; nous voyons
que la. comédie romaine a déjà fu employer des fujets
un peu nobles. La vie civile préfente plus d’une
face fous laquelle on la voit avec plaifir. La nature
toute pure peut même déjà fournir des moeurs 6c des
actions qui nous amufent. Comment ne trouverions-
nous pas plus d’intérêt encore à voir agir les hommes
dans l’immenfe variété des conjonctures de la
vie ? Tout tableau moral qui nous préfente l’homme
dans fon véritable caradere , toute fcene qui exprime
bien les fentimens, lespenfées, les projets &
les entreprifes des hommes, font pour le fpedateur
qui penlè, un coup d’oeil agréable. Pourquoi interdire
au peintre des moeurs, tout fujet qui ne fera
pas rifible ; pourquoi verrions-nous avec moins de
plaifir le côté aimable 6c raifonnable de l’homme ,
que fes défauts 6c fes ridicules ?
Il eft très-utile fans doute d’expofer les folies des
hommes dans leur vrai jour ; mais feroit-il moins
utile de mettre fous nos yeux des exemples de procédés
honnêtes , de fentimens nobles , dé droiture ,
de toutes les vertus civiles ; en forte que ces exemples
nous touchent, nous attendriffent, 6c faffent
lur nous une impreffion durable ? Et qu’on ne craigne
pas que le beau & l'honnête foient moins propres
à donner du plaifir, que le ridicule; nous voyons
au contraire que Plaute 6c Moliere n’excellent nulle
part davantage que dans le férieux. Aiflfi fans rien
retrancher de fon prix à la comédie fatyrique 6c enjouée
, ne fermons pas nos théâtres à la comédie qui
nous amufe par des tableaux plus nobles , & qui au
lieu de nous faire rire des foibleffes de l’humanité,
nous réjouit par la vue de fes perfedions.
Ne nous laiflons pas alarmer par les inquiétudes
de quelques critiques, qui femblent craindre que l’in-
trodudion du genre férieux ne confondît les limites
qu’on a mifes entre la comédie 6c la tragédie ," 6c ne
produisît un ambigu monftrueux. La nature ne con-
noît pointées limites, aufli peu que la critique pour-
roit en affigner entre le haut 6c le bas, le grand & le
p e tit, la chanfon 6c l’ode, aufli peu a-t-elle droit
d’en mettre entre le tragique 6c le comique ; ils ne
different point en eflence, ce n’eft que le dégré qui
les diftingue. ,
La réglé fondamentale qu’Ariftophane femble
s’être propofée étoit, de railler & d!exciter des éclats
de rire , & du méprisï Celle du poëte comique doit
être', de peindre des moeurs & de deffiner des caractères
qui puiffent intérejfer le fpeclateur judicieux & fenfible.
En conféquence de cette réglé , le .premier foin du
comique fera d’obferver attentivement les moeurs
des hommes de tout état, afin de mettre de la vérité
6c de la force dans fes portraits. Il cherchera à corriger,
par une fine raillerie, les défauts qu’il aura ob-
fervés ; il placera dans un. jour attrayant ce qu’il aura
remarqué de beau & dé noble, & fes tableaux nous
feront fentir d’un côté ce que les moeurs ont d'aifë,
d’aimable, de grand 6c d’é le v é , 6c de l’autre ce
qu’elles ont de ridicule , de gêné, de bas, de rampant
6c de méprifable. Nous nous verrons nous-
mêmes, 6c nos contemporains , dans un point de
vue qui nous permettra d’apprécier nos moeurs avec
impartialité.
Le poëte comique ‘fera enfuite une étude très-
particulière des divers caraderes des hommes. Il
obfervera comment ces caraderes font encore modifiés
par le genre de v ie , les liaifons extérieures,
les égards , les devoirs 6c autres circonftances.
Pour exciter notre attention , il fera contrafter en-
femble les caraderes, les devoirs, les pallions 6c
les fituations ; il nous préfentera fouvent le combat
de la raifon 6c du penchant; il démafqitera à nos
yeux le fourbe & l’hypocrite, 6c nous les montrera
fous leurs véritables traits ; il placera l’honnête homme
dans les diverfes fituations critiques de la vie ,
6c il aura foin de le mettre dans un jour qui nous
pénétré d’eftime 6c d’affedion pour lui. Tous ces
objets font très-intéreffants par eux-mêmes, 6c peuvent
le devenir infiniment davantage par l’art du
poëte ; il trouvera encore une fource très-abondante
de tableaux intéreffans dans les divers accidens de
la vie humaine, 6c dans la maniéré différente dont
Jes divers caraderes en font affedés.
La grande diverfité des fujets comiques doit né-
Ceffairement produire des comédies de plufieurs efpe-
ces différentes. Il ne feroit pas inutile de déterminer
' plus précifément ces efpeces, 6c de rechercher le
caradere diftindif qui convient à chacune.
Une de ces efpeces, c’eft la comédie de caradere,
qui s’occupe principalement à développer un caractère
particulier, 6c à le deffiner corredement ; nous
en avons déjà plufieurs de cette efpece, comme
XAvare, le Glorieux , le Menteur, &c. mais il y a
encore un très-grand nombre de caraderes, quiquoi-
qu’intéreffans n’ont point été traités. Et comme
les nuances des caraderes varient à l’infini, on peut
dire que cette efpece feule feroit déjà inépuifable.
On a fait pour les peintres en hiftoire un recueil
des fujets les plus intéreffans, tirés ou des hifto-
riens, ou despoëtes, ou des romanciers ; il feroit
bien plus important de former, pour le théâtre un
pareil recueil des caraderes remarquables qui n’ont
point encore été mis fur la fcene.
Dans les comédies de ce genre, il faut faire choix
d’une adion qui place le perfonnage principal dans
dés circonftances oppofées à fon caradere. Il faut,
comme l’obferve M. Diderot, que le Mifantrope
foit amoureux d’une coquette, 6c Harpagon d’une
fille qui eft dans l !indigence. La plupart des critiques
exigent que le poëte comique faffe contrafter les
caraderes pour donner plus de faillie au caradere
qu’il veut peindre. Mais l ’auteur que je viens de
citer, remarque, avec beaucoup de fagacité , que
le contrafte doit être, non dans les differens caractères
, mais dans les fituations. Il- eft très-effentiel
dâns les pièces de ce genre , qu’il n’y ait qu’un feul
caradere principal, auquel tout le refte foit fubor-
donné, c’eft là ce qui conftitue l ’unité du fujet, qui
eft beaucoup plus effentielle que celle du tems ou
du lieu. Le plan d’une telle comédie feroit, de placer
un homme dans une fituation qui fut eXadement en
conflit avec fon caradere dominant; dès-lors il faut
ou que le caradere plie fous l’effort des circonftances
, ou que par des adions conformes au caradere,
les circonftances prennent une tournure qui fe prête
au caradere ; en un mot, ou la fituation ou le
caradere doivent enfin avoir le defliis.
II.eft aifé de voir qu’un tel plan bien conduit doit
intéreffer pendant toute la durée de l’adion, 6c que
les perfonnàgèsfubaltemes peuvent enôôirê y répart»
dre une grande variété d’idées. Le Tartufe de Molière
tient un peu de ce plan ; mais fon Avare fuit
un plan tout différent, auffi eft-il fort inférieur au
Tartuffe. Car d’amener à chaque inftant une nou*
vd le fituation, qui ne réfulte point de l’adion prin*
cipale, uniquement pour la mettre en oppofition
avec le caradere, c’eft coudre des fcenes détachées
pour en former une comédie. Le poëretpeche toujours
contre l’unité d’ad ion, dès qu’il fuppofe des
événemens qui ne font pas une fuite naturelle de la
pofition des chofes dans l’adion principale, quoique
ces événemens répondent exadement au caradere
de fes perfonnages ; car c’eft écarter le fpedateur de
l’adion qui feule doit l’occuper. Ainfi dans VEunuque
de T erence, la première fcene du troifieme ade
a ce défaut ; elle eft très-propre à bien caradérifer
Thrafon, mais elle ne tient point à l ’adion.
Le but des comédies de caradere peut être, ou Ample
nient d’amufer par la bifarrerie du caradere,
ou d’infpirer du mépris 6c de l’averfion pour , les
caraderes haïffables, ou de montrer ceux qui font
bons 6c nobles, fous un jour propre à les faire aimer.
Il eft donc aifé de voir que cette première efpece de
comédie eft fufceptible d’une grande variété.
La fécondé efpece eft la comédie des moeurs. Elle
a pour objet de mettre fous les yeux du fpedateur
un tableau frappant 6c vrai des ufages ou du genre
de vie particulier, que les hommes d’un certain état
ou condition ont généralement adoptés. Ce fera,
par exemple le tableau de la cour, celui des moeurs
des gens opulens, celui d’une nation entière. Les
comédies de toutes les efpeces repréfentent à la
vérité des moeurs ; mais cette efpece particulière fait
fon objet principal de tracer les moeurs d’un genre
de vie déterminé. C’ eft ainfi que G a y , dans fon
opéra des Beggars, ou des Gueux , qui a eu tant de
fuccès en Angleterre, donne le tableau des moeurs
de l ’état le plus vil dans la fociété , celui des men-
dians. Les fpeftacles fatyrïques des Grecs étoient
des comédies de ce genre : on y repréfentoit les moeurs
des fatyres.
Cette efpece de comédie admet une grande variété
de caraéteres, & elle eft fufceptible de beaucoup
d’agrémens. Les moeurs des diverfes nations, & des
differens états de la vie civile font un des plus agréables
&des plus intéreffans objets de nos réflexions. II
ÿ a des moeurs ridicules, il y en de déteftables ; mais
il y en a auffi d’ingénues 6c d’aimables : il y en a même
dont la defcription enchante. On peut, fans faire
de grands efforts d’efprit, imaginer une aâion propre
à bien peindre les moeurs qu’on fe propofe de
repréfenter. Il n’eft pas befoin de détailler ici l ’avantage
que de pareils tableaux peuvent produire, indépendamment
du plaifir qu’ils donnent. Chacun fent,
pour ne citer que ce feul exemple, de quelle utilité
il feroit de repréfenter fur la lcene les moeurs & le
fort de cette claffe de perfonnes perdues, que Hogarth
a fi bien deffinées dans fes eftampes, connues
fous le nom de Harlof s-Progreff Térence avoitdéja
fenti cet avantage, & l’a admirablement bien exprimé
dans les vers que nous croyons devoir rappel-
ler ici.
Id vero eft, quod ego mihi puto palmarium
Me reperiffe, quomodo adolefcentulus,
Meretricurn ingénia & mores poffet no tare i
Mature ut eam cognorit, perpetuo oderit
Qute dum forts funt, nikil videtur mundius ,
Nec ,magis compofitum quidquam , nec magis
elegans
Qute cum amatore fuo cum ccenant, liguriunt.
f l arum videre ingluviem ,fordes , inopiam,
Quam inhonefte folce fintdomi, atque avidoe cibij