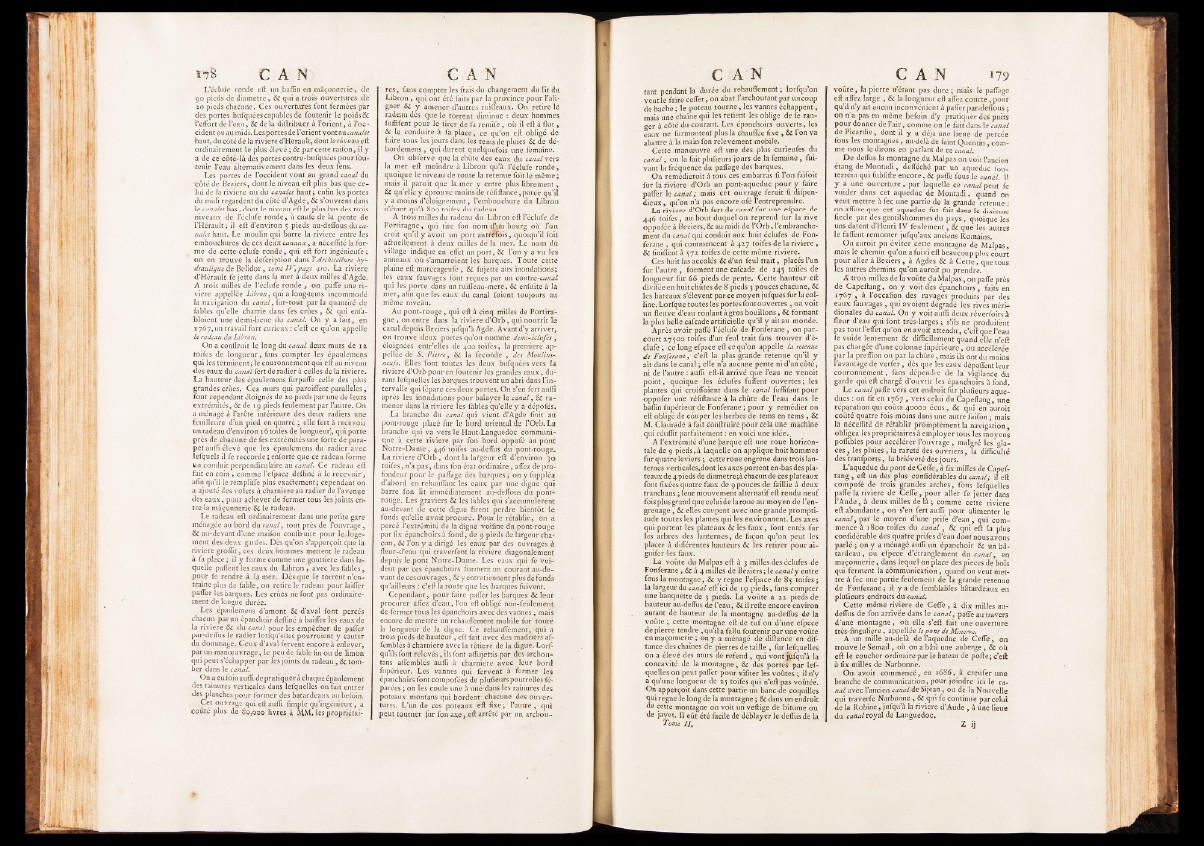
L’écluie ronde eft un baffin en maçonnerie*, de
'90 pieds de diamètre, & qui -a trois ouvertures dé'
20 pieds chacune. Ces ouvertures font fermées par
des portes bufquées capables de foutenir le poids &
l’effort de l’eau, & de la diftribuer à l’orient, à l’oc *
cident ouau midi. Lespor tes de l’orient vontau canalu
haut, du côté de la riviere d’Hérault, dont le niveau eft
ordinairement le plus élevé ;.& parcette raifon, il y
a de ce côté-là des portes contrerb.ufquées pour fou-
tenir l’eau alternativement dans les deux lens.
Les portes de l’occident vont au grand canal du
'côté de Beziers, dont le niveau eft plus bas que celui
de la riviere ou du canalet haut; enfin les.portes
du midi regardent du côté d’Agde, & s’ouvrent dans
le canalu bas, dont le niveau eft le plus bas des trois
niveaux de l’éclufe ronde, à caufe de la pente de
l ’Hérault^; il eft d’environ 5 pieds au-deffous du ca-
nalet haut. Le moulin qui -barre la riviere entre les
embouchures de ces deux canaux, a néceflité la forme
de cette éclufe ronde, qui eft fort ingénieufe;
on en trouve la defcription dans VArchitecture hydraulique
de Belidor, tome IV,page 4/0. La riviere
d’Hérault fe jette dans la mer à deux milles d’Agde.
A trois milles de l’éclufe ronde , on paffe une riviere
appellée Libron, qui a long-tems incommodé
la navigation du canal, fur-tout par la quantité de
fables qu’elle charrie dans fes crues, & qui enfa-
hloient xme demi-lieue du canal. On y a fait., en
1767,1m travail fort curieux: c’eft ce qu’on appelle
•le radeau du Libron,
On a conftruit le long du canal deux murs de 12
toifes de longueur, fans compter les épaulemens
qui les terminent; le couronnement qui eft au niveau
des eaux du canal fert de radier à celles de la riviere.
La hauteur des épaulemens furpaffe celle des plus
grandes crues. Ces murs qui paroiffent parallèles,
font cependant éloignés,de 20 pieds par une de leurs
extrémités, & de 19 pieds feulement par l’autre. On
a ménagé à l’arête intérieure des deux radiers une
feuilleure d’un pied en quarré ; elle fert à recevoir
un radeau d’environ 16 toifes de longueur', qui porte
près de chacune de fes extrémités une forte de parapet
àuffi élevé que les épaulemens du radier avec
lefquels il fe raccorde ; enforte que ce radeau forme
un conduit perpendiculaire au c/zzz<z£ Ce radeau eft
fait en coin, comme l’efpace deftiné à le recevoir”,
afin qu’il le rempliffe plus exaâement; cependant on
a ajouté des volets à charnière au radier de l’avenue
des eaux, pour achever de fermer tous les joints entre
la maçonnerie & le radeam ■
Le radeau eft ordinairement dans une petite gare
ménagée au bord du canal, tout près de l’ouvrage,
& au-devant d’une maifôn conftruite pour le+loge-
ment des deux gardes. Dès qu’on s’apperçoit que la
riviere groffit, ces deux hommes mettent le radeau
à fa place ; il y forme comme une gouttière dans laquelle
paffent les eaux du Libron , avec les fables,
pour fe rendre à la mer. Dès que le torrent n’entraîne
plus de fable, on retire le radeau pour biffer
paffer les barques. Les crues ne font pas ordinairement
de longue durée.
Les épaulemens d’amont & d’aval font percés
chacun par un épanchoir deftiné à baiffer les eaux de
la riviere & du canal pour les empêcher de paffer
par-deffus ie radier lorfqu’elles pourroient y caufer
du dommage: Ceux d’aval fervent encore à enlever,
par un manoeuvrage, le peu de fable fin ou de limon
qui peut s’échapper par les joints du radeau, & toril-
ber dans le canal»
On a eu foin aufli de pratiquer à chaque épaulement
des rainures verticales dans iefquelles on fait entrer
des planches pour former des batardeaux au befoin.
Çet ouvrage qui eft aufli Ample qu’ingénieux, a
coûté plus de 89,000 livres à JVJM. les propriétaires',
fans compter les frais du changement du lit du
Libron, qui ont été faits par la province pour l’aligner
&c y amener d’autres, ruifl’eaux. On retire lè
radeau dès que le torrent diminue : deux hommes
fuffifent pour le tirer de fa remife, oh .il eft à flo t ,
& le conduire à fa place, çe qu’on eft obligé de
faire tous les jours dans les tems de pluies & de dé;
bordemens, qui durent quelquefois une femaine.
On obferve qué la chute des eaux du canal vers
la mer eft moindre à Libron qu’à l’éclufe ronde,
quoique le niveau de toute la retenue foit le même ;
mais il paroît que la mer y entre plus librement,
& qu’elle y éprouve moins de réfiftance, parce qu’il
y a moins d’éloignement, l’embouchure du Libron
n’étant qu’à 800 toifes du radeau.
A trois milles du radeau du Libron eft l’éclufe de
Portiragne, qui tire fon nom d’un bourg oh l’on
croit qu’il y àvoit un port autrefois, quoiqu’il foît
aftuellement à deux milles de' la nier. Le nom dit
village indique en effet un port, & l’ori y a vu les
anneaux oh s’amarroient les barques. Toute cetté
plaine eft marécageufe , & fujette aux inondations;
les eaux fauvages font reçues par ùn contre-canal
qui les porte dans un ruiffeau-riiere, & enfuite à la
mer, afin que les eaux du canal foient toujours au
même niveau.
Au pont-rouge , qui eft à cinq milles de Portira-
gne, on entre dans la riviere d’O rb , qui nourrit le
canal depuis Beziers jufqù’à Agde. Avant d’y arriver,
on trouve deux portes qu’on nomme demi-éclufes ;
éloignées entr’elles dè 400 toifes; la première appellée
de S. Pierre, & la féconde , des Moulins
neufs. Elles font toutes les deux bufquées vers là
riviere d’Orb pour en foutenir les grandes eaux, durant
Iefquelles les barques trouvent un abri dans l’intervalle
qui fépare ces deux portes. On s’eri fert aufli
après les inondations pour balayer le canal, & ramener
dans la riviere lès fables qu’elle y à dépofés.
La branche du canal qui vient d’Agde finit aù
pont-rouge placé fur le bord oriental de l’Orb. La
branche qui va vers lé Haut-Languedoc communique
à cette riviere par fôri bord ôppofé au pont
Notre-Daitiè, 446 toifes au-deffus du pont-rouge^
La riviere d’Orb, dont là largèur eft d’environ 30
toifes, n’a pas, dans fori état Ordinaire, affez de profondeur
pour le paffage des barques ; on y fuppléa
d’abord en rehauffant les eaux par une digue qui
barre fon lit immédiatement au-deffous du pont-
rouge. Les graviers & lés fables qui s’accumulerént
au-devant dé cette digue firent perdre bientôt le
fonds qu’elle avoit pfoCuré'. Pour lé rétablir, on à
percé l’extrértiité de la digue voifine du pont-rouge
par fix épanchoirs à fond, de 9 pieds de largeur chacun,
& l’on y a dirigé les éaûx par des ouvrages à
fleur-d’eau qui traverfent la riviere diagonàlement
depuis le pont Notre-Dame. Les eaux qui fe vui-
dent par 'ces épanchoirs forment un courant au-devant
de ces ouvrages, & y entretiennent plus de fonds
qu’ailleurs : c’eft la route'que les barques fiiivent.
Cependant, pour faire paffer les barques & leur
procurer affez d’eau, l’on eft obligé non-feulement
de fermer tous les épanchoirs avec des vannes , mais
encore de mettfe un réhauffemént mobile fur touté
la longueur de la digue. Ce rehauffêment, qui à
trois pieds de hauteur , eft fait avec des madriers af-
femblés à charnière avec la- têtiere de la digue. Lorfi
qu’ilsfont relevés , ils font affujettis par desarebou-
tans affemblés aufli à charnière avec leur bord
fupérieur. Les vannes qui . fervent à fermer les
épanchoirs font compofées de plufieurs poutrelles fé-
parées ; ôn les coule une à unë dans les rainures des
poteaux montans qui bordent • chacune des Ouvertures.
L’ün de ces' poteaux eft fixe ; Pautre , qui
peut tourner fur fon axe, eft arrêté par un arçboutant
pendant la durée du rehauffement ; lorfqu’on
veut le faire ceffer, on abat l’arcboutant par lin coup
de hache ; le poteau tourne, les vannes échappent,
mais une chaîne qui les retient les oblige de le ranger
à côté du courant. Les épanchoirs ouverts, les
eaux ne furmontent plus la chauffée fixe , & l’on va
abattre à la main fon relèvement mobile.
Cette manoeuvre eft une des plus curieufes du
canal, on la fait plufieurs jours de la femaine, fui-
vant la fréquence du paffage des barques.
On remédieroit à tous ces embarras fi l’on faifoit
fur la riviere d’Orb un pont-aqueduc pour y faire
paffer le canal; mais cet ouvrage feroit fi.difpen-
dieux, qu’on n’a pas encore ofé l’entreprendre.
La riviere d’Orb fert de canal fur une efpace de
446 toifes, au bout duquel on reprend fur la rive
oppofée à Beziers, & au midi de l’Orb, l’embranchement
du canal qui conduit aux huit éclufes de Fon-
ferane , qui commencent à 427 toifes de la riviere,
& finiffent à 572 toifes de cette même riviere.
Ces huit fas accolés & d’un feul trait, placés l’un
fur l’autre , forment une cafcade de 145 toifes de
longueur fur 66 pieds de pente. Cette hauteur eft
divifée en huit chûtes de 8 pieds 3 pouces chacune, &
les bateaux s’élèvent parce moyen jufques fur la colline.
Lorfque toutes les portes fontou vertes , on voit
un fleuve d’eau roulant à gros bouillons, & formant
la plus belle cafcade artificielle qu’il y ait au monde.
Après avoir paffé l’éclufe de Fonferane, on parcourt
27500 toifes d’un feul trait fans trouver d’é-
clufe ; ce long efpace eft ce qu’on appelle la retenue
de Fonferane t c’eft la plus grande retenue qu’il y
ait dans le canal ; elle n’a aucune pente ni d’un côté,
ni de l’autre : aufli eft-il arrivé que l’eau ne venoit
point, quoique les éclufes fuffent ouvertes; les
plantes qui croiffoient dans le canal fufRfant pour
oppofer une réfiftance à la chûte de l’eau dans le
baflin fupérieur de Fonferane ; pour y remédier on
eft obligé de couper les herbes de tems en tems , &
M. Claurade a fait conftruire pour cela une machine
qui réuflit parfaitement : en voici une idée.,
A l’extrémité d’une barque eft une roue horizontale
de 9 pieds,à laquelle on applique huit hommes
fur quatre leviers ; cette roue engrene dans trois lanternes
verticales,dont les axes portent en-bas des plateaux
de 4 pieds de diametre;à chacun de ces plateaux
font fixées quatre faux de 9 pouces de faillie à deux
tranchans ; leur mouvement alternatif eft rendu neuf
fois plus grand que celui de la roue au moyen de l’engrenage
, & elles coupent avec une grande promptitude
toutes les plantes qui les environnent. Les axes
qui portent les plateaux & les faux, font entés fur
les arbres des lanternes, de façon qu’on peut les
placer à différentes hauteurs & les retirer pour ai-
guifer les faux.
La voûte du Malpas eft à 3 milles des éclufes de
Fonferane, & à 4 milles de Beziers ; le canal y entre
fous la montagne, & y régné l’efpace de 85 toifes ;
la largeur du canal eft ici de 19 pieds, fans compter
une banquette de 3 pieds. La voûte a 22 pieds de
hauteur au-deffus de l’eau, & il refte encore environ
autant de hauteur de la montagne au-deffus de la
voûte; cette montagne eft de tuf ou d ’une efpece
de pierre tendre , qu’il a fallu foutenir par une voûte
en maçonnerie ; on y a ménagé de diftancë en distance
des chaînes de pierres de taille , fur Iefquelles
on a élevé des murs de refend , qui vont jjufqu’à la
concavité de la montagne, & des portes par iefquelles
on peut paffer pour vdfiter les voûtes ; il n’y
a qu’une longueur de 25 toifes qui n’eft pas voûtée.
On apperçoit dans cette partie un banc de coquilles
qui régné le long de la montagne ; & dans un endroit
de cette montagne on voit un veftige de bitume ou
de jayet. Il eût été facile de déblayer le deffus de la
Tome II,
voûte, la pierre n’étant pas dure ; mais le paffage
eft affez large , & la longueur eft affez courte, pour
qu’il n’y ait aucun inconvénient à.paffer par-deffous ;
on n’a pas eu même befoin d’y pratiquer des puits
pour donner de l’air, comme on le fait dans le canal
de Picardie , dont il y a déjà une lieue de percée
fous les montagnes, au-delà de faint Quentin, comme
nous le dirons en parlant de ce canal.
De deffus la montagne clu Malpas on voit l’ancien
étang de Montadi, defféché par un aqueduc fou-
terrein quifubfifte encore, & paffe fous le canal. 11
y a une ouverture, par laquelle ce canal peut fe
vuider dans cet aqueduc de Montadi, quand on
veut mettre à fec une partie de la grande retenue :
on affure que cet aqueduc fut fait dans le dixième
fiecle par des gentilshommes du pays, quoique les
uns datent d’Henri IV feulement, & que les autres
le faffent remonter jufqu’aux anciens Romains.
On auroit pu éviter cette montagne de Malpas,
mais le chemin qu’on a fuivi eft beaucoup plus court
pour aller à Beziers, à Agdes & à Ce tte, que tous
les autres chemins qu’on auroit pu prendre.
A trois milles de la voûte du Malpas, on paffe près
de Capeftang, on y voit des épanchoirs, faits en
1767 , à l’occafion des ravages produits par des
eaux fauvages, qui avoient dégradé les rives méridionales
du canal. On y voit aufli deux réverfoirs à
fleur d’eau qui font très-larges ; s’ils ne produifent
pas tout l’effet qu’on en avoit attendu, c’eft que l ’eau
fe vuide lentement & difficilement quand elle n’eft
pas chargée d’une colonne fupérieure, ou accélérée
par la preflion ou par la chûte, mais ils ont du moins
l’avantage de v erfer, dès que les eaux dépaffent leur
couronnement, fans dépendre de la vigilance du
garde qui eft chargé d’ouvrir les épanchoirs à fond.
Le canal paffe vers cet endroit fur plufieurs aqueducs
: on fit en 1767 , vers celui du Capeftang, une
réparation qui coûta 40009 écus, & qui en auroit
coûté quatre fois moins dans une autre faifon ; mais
la néceflité de rétablir promptement la navigation ,
obligea les propriétaires à employer tous les moyens
poffibles pour accélérer l’ouvrage, malgré les glaces
^ les pluies , la rareté des ouvriers, la difficulté
des tranfports, la brièveté des jours. 1
L’aqueduc du pont de Ceffe, à fix milles de Capeftang
, eft un des plus confidérables du canal; il eft
compofé de trois grandes arches, ToiVs Iefquelles
paffe la riviere de Ceffe, pour aller fe jetter dans
l’Aude, à deux milles de là ; comme cette riviere
eft abondante , on s’en fert aufli pour alimenter le
canal, par le moyen d’une prife d’eau, qui commence
à 1800 toifes du canal , & qui eft la plus
confidérable des quatre prifes d’eau dont nous avons
parlé ; on y a ménagé aufli un épanchojr & un bâ-
tardeau, ou èfpece d’étranglement du canal, en
maçonnerie, dans lequel on place des pièces de bois
qui ferment la cômihunication, quand on veut mettre
à fec une partie feulement de la grande retenue
de Fonferane ; H y a de femblables bâtardeaux en
plufieurs endroits du cariai.
Cette même rivière de C e ffe , à dix milles au-
deffus de fon arrivée dans le canal, paffe au travers
d ’une montagne, oh elle s’eft fait une ouverture
très-finguliere, appellée le pont de Minerve.
A un mille au-delà de l’aqueduc de Ceffé, on
trouve le Semail, oh on a bâti une auberge , & oh
eft le coucher ordinaire par le bateau de pofte; c’eft
à fix milles de Narbonne.
On avoit commencé, en 1686, à crèufer une
branche de communication, pour joindre ici le canal
avec l’ancien canal de Sijean, ou de la Nouvelle
qui traverfe Narbonne , & qui fe continue par celui
de la Robine, jufqu’à la riviere d’A u de, à une lieue
du canal royal de Languedoc. z ij