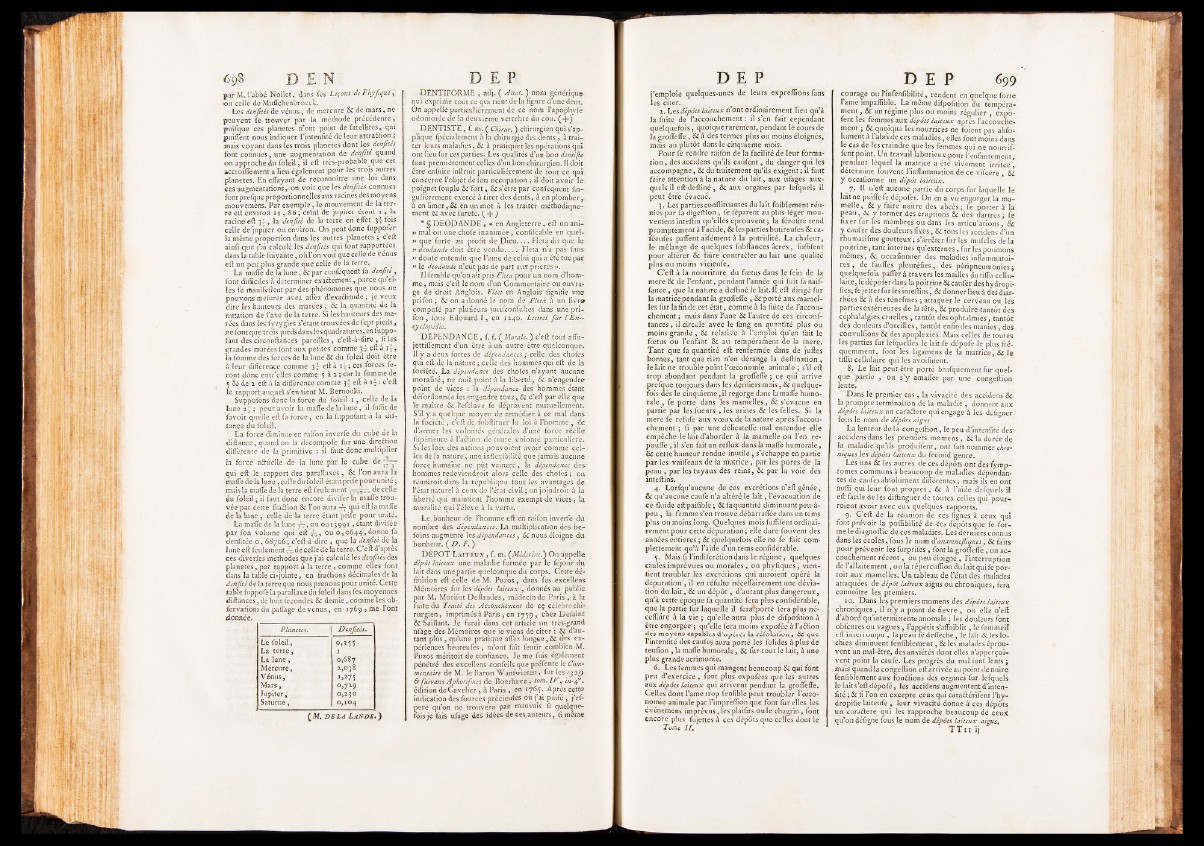
par M. l'abbé Nollet, dans fes Leçons de Phyjique,
•■ ou celle de Muffchenbroeck.
Les denjètés de venus , de mercure 8c de mars, -ne
peuvent Te trouver par la méthode precedente,
puifque ces planètes n’ont point de fatellites, qui
puiffent nous indiquer Tintenfité de leur attra&ion ;
mais voyant dans les trois planètes dont 1es denjites
Ibnt connues, une augmentation de denjîu quand
on approche du foleil, il eft très-probable que cet
accroiffement a lieu également pour les trois autres
planètes. En effayarit de reeonnoître une loi dans
ces augmentations, *on voit que les denjites connues
fontprefque proportionnelles aux racines des moyens
mouvemens. Par exemple , le mouvement de la terre
eft environ 1 1 ,8 6 ; celui de jupiter étant i , la
racine eft 37, la denjité de la terre en effet 3’» fois
celle de jupiter ou environ. On peut donc fuppofer
la même proportion dans les autres planètes ; c eft
ainfi que j’ai calculé les denjites qui font rapportées
dans la table fuivante, oit l’on voit que celle de venus
eft un peu plus grande que celle de la terre.
La maffe de la lune, 8c par conféquertt fa denjite ,
font difficiles à déterminer exaûement, parce qu’elles
fe manifeftent par des phénomènes que nous ne
pouvons mefurer avez affez d’exaâitude ; je veux
dire les hauteurs des marées , & la quantité de la
nutation de l’axe de la terre. Si les hauteurs des marées
dans les fyzygies s’étant trouvées de fept pieds,
ne font que trois pieds dans les quadratures, en ïuppo-
fant des circonftances pareilles, c’eft-à-dire , fi les
grandes marées font aux petites comme 37 eft à i£,
la fomme des forces de la lune 8c du foleil doit être
à leur différence comme 3^ eft à i^; ces forces feront
donc entr’elles comme 5 à 1 ; car la fomme de
15 &■ de 2 eft à la différence comme 3t eft à : c’eft
le rapport auquel s’ en tient M. Bernoulli.
Suppofons donc la force du foleil 1 , celle de la
lune r'z ; pour avoir la maffe de la lune, il fuffit de
fa voir quelle eft fa force, en la fuppofant à la dif-
tance du foleil.
• La force diminue en raifon inverfe du cube de la
diftance-, quand on la décompofe fur une direction
différente de la primitive : il faut donc multiplier
la force actuelle de la lune par le cube de *
qui eft le rapport des parallaxes, 8c l’on aura la
maffe de la lune, celle du foleil étant prife pour unité ;
mais la maffe de la terre eft feulement} 5 9^ -0 de celle
du foleil ; il faut donc encore divifer la maffe trouvée
par cette fraftion 8c l’on aura qui eft la maffe
de la lune, celle de la terre étant prile pour unité.
La maffe de la lune ^7, ou 0013991, étant divifée
par fon volume qui eft 5^, ou 0,0644, donne fa
denlïtée o , 68706; c’eft-à-dire , que la denjité de la
lune eft feulement ~ de celle de la terre. C’eft d’après
ces diverfes méthodes que j’ai calculé les denjites des
planètes, par rapport à la terre , comme elles font
dans la table ci-jointe, en fraftions décimales de la
denjité de la terre que nous prenons pour unité. Cette
table fuppofe la parallaxe du foleil dans fes moyennes
diftancés, de huit fécondés 8c demie, comme les ob-
fervationsdu paffage de vénus, en 1769, me l’ont
donnée.
Planètes. Denjités.
Le foleil, °>2 5S
La terre, 1
La lune, .0,687
Mercure, 2,038
Vénus, W 5
Mars, 0,729
Jupiter, 0,230
Saturne 9 0,104
( M. d e l a La n d e . )
DENTIFORME , adj. ( Anat. ) nom générique
qui exprime tout ce qui tient delà figure d’une dent.
On appelle particuliérement de ce nom l’apophyfe
odontoïde de la deuxieme vertebre du cou. (4-)
DENTISTE, f. m. ( Chiner. ) chirurgien qui s’applique
fpécialement à la chirurgie des dents ,, à traiter
leurs majadies, 8c à pratiquer les opérations qui
ont lieu fur ces parties. Les qualités d’un bon dentifle
font premièrement celles d’un bon chirurgien. 11 doit
être enfuite inftruit particuliérement de tout ce qui
concerne l’objet de fon occupation ; il doit avoir le
poignet fouple 8c fort, 8c s’être par conféquent fin-
guliérement exercé à tirer des dents, à en plomber,
à en limer,8c en un mot à les traiter méthodiquement
& avec fureté. ( + )
* § DEOD AN D E, « en Angleterre, eft un ani-
» mal ou une chofe inanimée, confifcable en quel-
» que forte au profit de Dieu.. . . Fleta dit que le
» deodande doit être vendu.. . . Fleta n’a pas fans
» doute entendu que l’ame de celui qui a été tué par
» le deodande n’eut pas de part aux prières ».
Il femble qu’on ait pris Fleta pour un nom d’homme
, mais c’eft le nom d’un Commentaire ou ouvrage
de droit Anglois. Fleèt en Ariglois fignifie une
prifon ; & on a donné le nom de Fleta à un livre
compofè par plufieurs jurifconfultes dans une prifon
, fous Edouard I , en 1240. Lettres fur l'Encyclopédie.
DÉPENDANCE, f. f. ( Morale. ) c’eft tout affu-
jettiffement d’un être à un autre être quelconque.
Il y a deux fortes de dépendances ; celle des chofes
qui eft de la nature ; celle des hommes qui eft de la
fociété. La dépendance des choies n’ayant aucune
moralité, ne nuit point à la liberté, & n’engendre
point de vices : la dépendance des hommes étant
défordonnée les engendre tous, 8c c’eft par elle que
le maître 8c l’efclave fe dépravent mutuellement.
S’il y a quelque moyen de remédier à ce mal dans
la fociété , c’eft de fubftituer la loi à l’homme , 8c
d’armer les volontés générales d’une force réelle
fupérieure à l’a&ion de toute volonté particulière.
Si les loix des nations pouvoient avoir comme celles
de la nature, une inflexibilité que jamais aucune
force humaine ne pût vaincre, la dépendance des
hommes redeviendroit alors celle des chofes ; on
réuniroit dans la république tous les avantages de
l’état naturel à ceux de l’état civil ; on joindroit à la
liberté qui maintient l’homme exempt de vices , la
moralité qui l’éleve à la vertu.
Le bonheur de l’homme eft en raifon inverfe du
nombre des dépendances. La multiplication des be-
foins augmente les dépendances, 8c nous éloigne du
bonheur. (Z?. F. )
DÉPÔT Laiteux , f. m. (Médecine.) On appelle
dépôt laiteux une maladie formée par le féjour du
lait dans une partie quelconque du corps. Cette définition
eft celle de M. Puzos, dans fes excellons
Mémoires fur les dépôts laiteux , donnés au public
par M. Morifot Deflandes, médecin de Paris , à la
fuite du Traité des Accouchemens de cç célébré chirurgien
, imprimés à Paris , en 1759, chez Defaiht
& Saillant. Je ferai dans cet article un très-grand
ufage des Mémoires que je viens de citer ; & d’autant
plus, qu’une pratique affez longue, 8ç des expériences
heureufes, m’ont fait fentir combien M.
Puzos méritoit de confiance. Je me fuis également
pénétré des excellens confeils que préfente le Commentaire
de M. le Baron Wanfwieten, fur les /52CJ
& fuivans Aphorifmes de Boerhave, tom. IV , in-40.
édition deCavelier , à Paris , en 1765. Après cette
indication des fources précieufes oit j’ai piiifé , j’ef-
peré qu’on ne trouvera pas mauvais fi quelque-
fois je fais ufage des idées de ces auteurs, fi même
j ’emploie quelques-unes de leurs expreflions fans
les citer.
2. Les dépôts Iditeux n’ont ordinairement lieu qu’à
la fuite de l’accouchement: il s’en fait cependant
quelquefois, quoique rarement, pendant le cours de
la groffeffe, 8c à des termes plus ou moins éloignés,
mais au plutôt dans le cinquième mois.
Pour fe rendre raifon de la facilité de leur formation,
des accidens qu’ils câufent, du danger qui les
accompagne, 8c du traitement qu’ils exigent ; il faut
faire attention à la nature du lait, aux ufages auxquels
il eft deftiné , 8c aux organes par lefquels il
peut être évacué.
3. Les parties conftituantes du lait foiblement réunies
par la digeftion , fe féparent au plus léger mouvement
inteftin qu’ elles éprouvent ; la férofité tend
promptement à l’acide, 8c les parties butireufes & ca-
îeeufes paffent aifément à la putridité. La chaleur,
le mélange de quelques fubftances âcres, fuflifent
pour altérer & faire contrarier au lait une qualité
plus ou moins vicieufe.
C ’eft à la nourriture du foetus dans le fein de la
mere 8c de l’enfant, pendant l’année qui fuit fa naif-
fance, que la nature a deftiné le lait. Ï1 eft dirigé fur
la matrice pendant la grofleffe , & porté aux mamelles
fur la fin de cet é tat, comme à la fuite de l’accouchement
; mais dans l’une 8c l’autre de ces circonftances
, il circule avec le fang en quantité plus ou
moins grande, 8c relative à l’emploi qu’én fait le
foetus ou l’enfant 8c au tempérament de la mere.
Tant que fa quantité eft renfermée dans de juftes
bornes, tant que rien n’en dérange la deftination ,
le lait ne trouble point l’oeconomie animale ; s’il eft
trop abondant pendant la groffeffe ; ce qui arrive
prefque toujours dans les derniers mois, 8c quelquefois
dès le cinquième, il regorge' dans la maffe humorale
, fe porte dans les mamelles, 8c s’évacue en
partie par ies fueurs , les urines & les felles. Si la
mere fe f efufe aux voeux de la nature après l’accouchement
; fi par une délicateffe mal'entendue elle
empêche le lait d’aborder à la mamelle ou l’en repouffe
, il s’en fait un reflux dans la maffe humorale,
8c cette humeur rendue inutile , s’échappe en partie
par les vaiffeauxde la matrice , par les pores de la
peau , par les tuyaux des reins, 8c par la voie des
inteftins.
4. Lorfqu’aucune de ces excrétions n’eft gênée,
& qu’aucune caufe n’a altéré lé lait, l’évacuation de
ce fluide eftpaifible; & fa quantité diminuant peu-à-
peu , la femme s’en trouve débarraffée dans un tems
plus ou moins1 long..Quelques mois fuflifent ordinairement
pour cette dépuration; elle dure fou vent des
années entières ; 8c quelquefois elle ne fe fait com-
plettement qu’ à l’aide d’un tems. confidérable.
5. Mais fi l’indifcrétion dans le régime, quelques
caufes imprévues ou morales, ou phyfiques, viennent
troubler les excrétions qui auroient opéré la
dépuration , il en réfulte néceffairement une déviation
du lait, 8c un dépôt, d’atltant plus dangereux,
qu’à cette époque fa quantité fera plus confidérable,
que la partie fur laquelle il ferâvporté fera plus né-
ceffaire à la vie ; qu’elle aura plus de difpofîtion à
être engorgée ; 'qu’elle fera moins expofée à l’aérion
des moyens capables d’opérer la réfolution ; 8ç que
l’intenfité des caufes aura porté les folides à plus de
tenfion , la maffe humorale, 8c fur-tout le lait, à une
plus grande acrimonie.
6. Lés femmes qui mangent beaucoup 8c qui font
peu d’exercice, font plus expofées que les autres
aux dépôts laiteux qui arrivent pendant la groffeffe.
Celles dont l’ame trop fenfible peut troubler l’oeco-
nomie animale par l’impreflion que font fur elles les
événemens imprévus, les plaifirs ouïe chagrin , font
encore plus fujettes à ces dépôts que celles dont le .
Tome II,
courage ou l’infenfibilité, rendent en quelque forte
l’ame impaffible. La même difpofition du tempérament
, & un régime plus ou moins régulier , expo-
fent les femmes aux dépôts laiteux après l’accouchement
; 8c quoique les nourrices ne foient pas absolument
à 1 abri de ces maladies, elles font moins dans
le cas de les craindre que les femmes qui ne noitrrif-
fent point. Un travail laborieux pour l’enfantement,
pendant lequel la matrice a été vivement irritée
détermine fouvent l’inflammation de ce vifcere 8c
y oceafionne un dépôt laiteux.
7. Il n’eft aucune partie du corps fur laquelle le
lait ne puiffe fe dépofer. On en a vu engorger la mamelle
, 8c y faire naître des abcès ; le porter à la
peau , & y former des éruptions 8c des dartres ; fe
fixer fur les membres ou dans les articulations, 8c
y caufer des douleurs fixes, & tous lès accidens d’un
rhumatifme goutteux; s’arrêter fur les mufcles de la
poitrine, tant internes qu’externes, fur les poumons
mêmes, 8c oçcafionner des maladies inflammatoires
, de fauffes pleuréfies, des péripneumonies ;
quelquefois paffer à travers les mailles du tiffu cellulaire,
fe dépofer dans la poitrine &caufer des hydropi-
fies; fe jetter fur les inteftins \ & donner lieu à des diarrhées
8c à des ténefmes ; attaquer le cerveau ou les
parties extérieures de la tête, 8c produire tantôt des
céphalalgies cruelles , tantôt des ophtalmies, tantôt
des douleurs d’oreilles, tantôt enfin des manies, des
convulfions 8c des apoplexies. Mais celles de toutes
les parties fur lefquelles le lait fe dépofe le plus fréquemment,
font les ligamens de la matrice, 8c le
tiffu cellulaire qui les avoifinent.
8. Le lait peut être porté brufquemerit fur quelque
partie , ou s’y amaffer par une congeftion
lente. :
Dans le premier cas , la vivacité des accidens 8c
la prompte terminaifon de la maladie , donnent aux.
dépôts laiteux un cara&ere qui engage à les défigner
fous le nom de dépôts aigus.
La lenteur de la congeftion, le peu d’intenfité des
accidens dans les premiers.momens, & la durée de
la maladie qu’ils produifent, ont fait nommer chro-.
niques les dépôts laiteux du fécond genre.
Les uns 8c les autres de ces dépôts ont des fymp-
tomes communs à beaucoup de maladies dépendantes
de caufesabfolument différentes; mais ils en ont
aufîi qui leur font propres, 8c à l’aide dêfquels if
eft facile de les diftinguer de toutes celles qui pour-
roient avoir avec eux quelques rapports.
9. C ’eft de la réunion de ces fignes â ceux qui
font prévoir la poflibilité dë ces dépôts que fe forme
le diagnoftic de ces maladies. Les derniers connus
dans les écoles, fous le nom à'anamnefliques, & faits
pour prévenir les furprifes , font la groffeffe , un accouchement
récent, pu peu éloigné , l’interruption
de l’allaitement, ou là répercuflion du lait qui fe por-
toit aux mamelles. Un tableau de l’état des malades
attaquées de dépôt laiteux aigus ou chroniques, fera
connoître les premiers.
1 o. Dans les premiers momens des dépôts laiteux
chroniques, il n’y a point de fievre^, ,ôu elle n’eff
d’abord qu’intermittente anomale ; les douleurs font
obfcures ou vagues , l’appétit s’affoiblit, le fommeil
eft interrompu , là peau lé deffeche, le lait &Ies lochies
diminuent fenfiblement, & le s malades éprouvent
un mal-être, des anxiétés dont elles n’apperçoi-
vent point la caufe. Les progrès du mal font lents ;
mais quand la congeftion eft arrivée au point de nuire
fenfiblement aux ronélions des organes fur lefquels
le laits'eftdépofé, les accidens augmentent d’intenfité
; & fi l’on en excepte ceux qui caraftérifent l’hy-
dropifie laiteufe , leur vivacité donne à ces dépôts
un caraftere qui les rapproche beaucoup de ceux
qu’on défigne fous le nom dë dépôts laiteux aigus,
T T t t ij