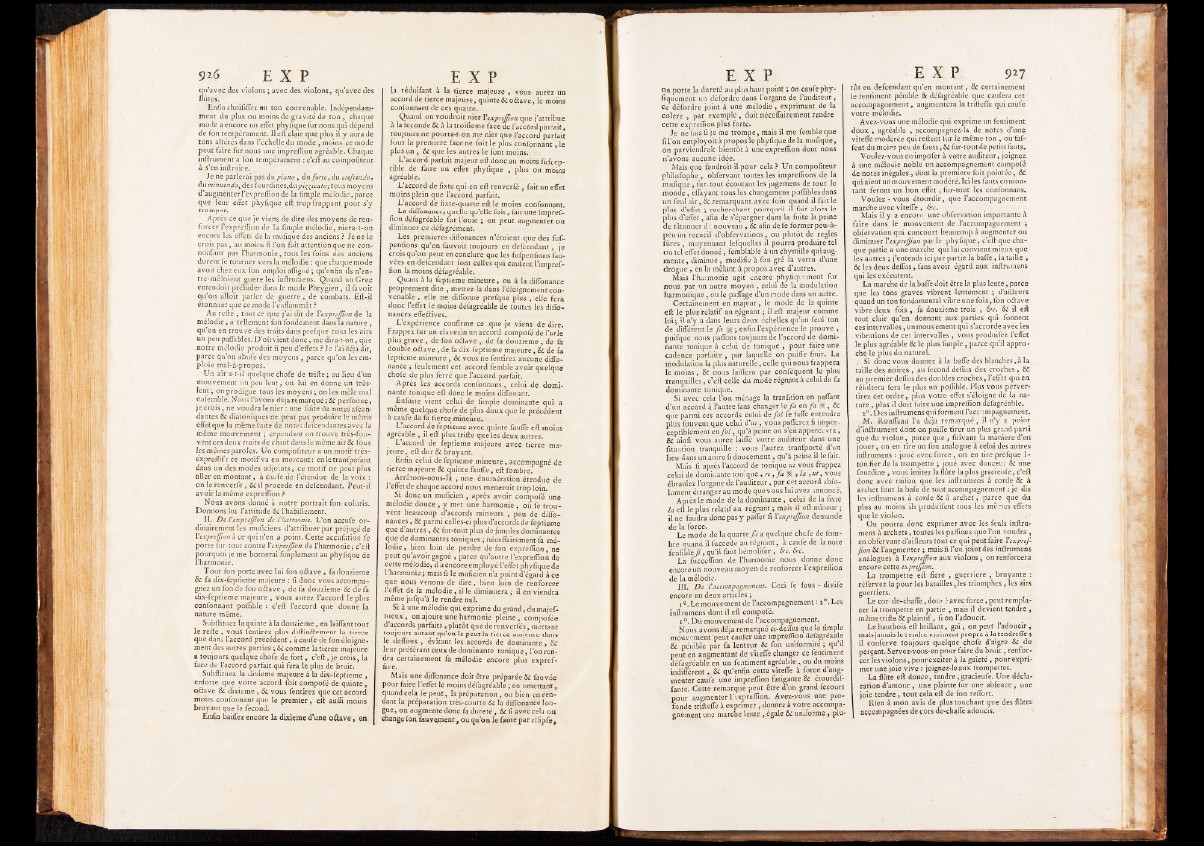
qu’avec des violons ; avec des violons, qu’avec des
flûtes.
Enfin choififfez un ton convenable. Indépendamment
du plus ou moins de gravité de ton , chaque
mode a encore un effet phyfique fur nous qui dépend
de fon tempérament. Il eft clair que plus il y aura de
tons altérés dans l’échelle du mode , moins ce mode
peut faire fur nous une impreflion agréable. Chaque
ïnftrument a fon tempérament : c’eft au compofiteur
à s’en inftruire.
Je ne parlerai pas du piano , du forte, du crefcendo,
dxxminuendo, des fourdines,dupi^icato; tous moyens
d’augmenter l’expreflîon de la fimple mélodie,parce
que leur effet phyfique eft trop frappant pour s’y
tromper.
Après ce que je viens de dire des moyens de renforce
rTexpreflîon de la fimple mélodie, niera-t-on
encore les effets delà mufique des anciens ? Je ne le
crois pas, au moins fi l’on fait attention que ne con-
noiffant pas l’harmonie, tous les foins des anciens
durent fe tourner vers la mélodie : que chaque mode
avoit chez eux fon emploi afligné ; qu’enfin ils n’en-
tre-mêloienî guère les inftrumens. Quand un Grec
entendoit préluder dans le mode Phrygien, il favoit
qu’on alloit parler de guerre, de combats. Eft-il
étonnant que ce mode l’enflammât ?
Au refte , tout çe que j’ai dit de Yexpreffion de la
mélodie, a tellement fon fondement dans la nature ,
qu’on en trouve des traits dans prefque tous les airs
un peu paffables. D’oîi vient donc, me dira-t-on, que
notre mélodie produit fi peu d’effets ? Je l’ai déjà dit,
parce qu’on abufe des moyens , parce qu’on les emploie
mal-à-propos.
Un air a-t-il quelque chofe de trifte ; au lieu d’un
mouvement un peu lent, on lui en donne un très-
lent ; on prodigue tous les moyens ; on les mêle mal
enfemble. Nous l’avons déjà remarqué ;& perfonne,
je c rois, ne voudra le nier : une fuite de notes amendantes
& diatoniques rie peut pas produire le même
effet que.la même fuite de notes descendantes avec le
même mouvement ; cependant on trouve très-fou-,
vent ces deux traits de chant dans le même air & fous
les mêmes paroles. Un compofiteur a un motif très-
expreflif: ce motif va en montant: enletranfpofànt
dans un des modes adjoints, ce motif ne peut plus
aller en montant, à càufe de l’étendue de la voix :
on le renverfe , & il procédé en defcendant. Peut-il
avoir la même expreflion ?
Nous avons donné à notre portrait fon coloris.
Donnons lui l’attitude & l’habillement.
II. De PexpreJJion de L'harmonie. L’on accufe ordinairement
les muficiens d’attribuer par préjugé de
Yexpreffion à ce qui n’en a point. Cette accufation fe
porte fur-tout contre Yexpreffion de l’harmonie ; c’eft
pourquoi je me bornerai Amplement au phyfique de
l ’harmonie.
Tout fon porte avec lui fon ottave , fa douzième
& fa dix-feptieme majeure : fi donc vous accompagnez
un fon de fon o&ave, de fa douzième- & de fa
dix-feptieme majeure , voys aurez l’accord le plus
confonnant poffible : c’eft l’accord que donne la
nature même.
Subftituez la quinte à la douzième , en laiffanttout
le refte , vous fentirez plus diftin&ement la tierce
que dans l’accord précédent, à caufe de fon éloignement
des autres parties ; & comme la tierce majeure
a toujours quelque chofe de fort, c’eft, je crois, la
face de l’accord parfait qui fera le plus de bruit.
Subftituez la dixième majeure à la dix-feptieme ,
enforte que votre accord loir compofé de quinte,
oûave & dixieriie , & vous fentirez que cet accord
moins confonnant que le premier, eft auflx moins
bruyant que le fécond.
Enfin baiffez encore la dixième d’une o&ave, en
la réduifant à la tierce majeure , vous aurez un
accord de tierce majeure, quinte & oétave, le moins
confonnant de ces quatre.
Quand on voudroit nier Yexpreffion que j ’attribue
à la ietonde &L a la troifieme face de l’accôrd parlait,
toujours ne pourra-t-on me nier que l’accord parfait
fous la première face ne foit le plus confonnant, le
plus un , & que les autres le font moins.
L’accord parfait majeur eft donc au moins fufcep-
tible de faire un effet phyfique , plus ou moins
agréable.
L’accord de fixte qui en eft renverfé , fait un effet
moins plein que l’accord parfait.
L’acçord de fixte-quarte eft le moins confonnant.
La diffonance, quelle qu’elle foit, fait une impreffion
défagréable iu r l’oniè ; on peut augmenter ou
diminuer ce défagrément.
Les premières diflbnances n’étoient que des fuf-
penfions qu’on fauvoir toujours en defcendant, je
crois qu’on peut en conclure que les fufpenfions fau-
vées en defcendant font celles qui caulènt l’impref-
fion la moins défagréable.
Quant à la feptieme mineure, ou à la diffonance
proprement dite , mettez-la dans l’éloignement convenable
, elle ne difforme prefque plus ,.elle fera
donc l’effet le moins défagréable de toutes les diffo-
nances effectives.
L’expérience confirme ce que je viens de dire.
Frappez lur un clavecin un accord compofé de Parle
plus gra v e, de fon oétave , .de fa douzième, de la
double oCtave, de fa dix-feptieme majeure, & de fa
feptieme mineure , & vous rie fentirez aucune diffonance
; feulement cet accord femble avoir quelque
chofe de plus ferré que l’accord parfait.
Après les accords confonnans, celui de dominante
tonique eft donc le moins diffonant.
^Enfuite vient celui de fimple dominante qui a
meme quelque chofe de plus doux que le précédent
à eaufe de fa tierce mineure.
L’accord de feptieme avec quinte fauffe eft moins
agréable , il eft plus, trifte que les deux autres.
L’accord de feptieme majeure avec tierce majeure
, eft dur & bruyant.
Enfin celui de feptieme mineure, accompagné de
tierce majeure & quinte fauffe, eft fombre.
Arretons-nous-la , une énumération étendue de
l ’effet de chaque accord nous meneroit trop loin.
Si donc un muficien , après avoir compofé une
mélodie douce , y met une harmonie , oii fe trouvent
beaucoup d’accords mineurs , peu de diffo-
nances, & parmi celles-ci plus d’accords de feptieme
que d autres , & fur-tout plus de fimples dominantes
que de dominantes toniques ; néceffairement fa mélodie
, bien loin de perdre de fon expreflion, ne
peut qu’avoir gagné , parce qu’outre l ’expreflion de
cette mélodie, il a encore employé l’effet phyfique de
l ’harmonie ; mais fi le muficien n’a point d’égard à ce
■ que nous venons de dire, bien loin de renforcer
l’effet de fa mélodie, il le diminuera ; il en viendra
même jufqu’à le rendre nul.
Si à une mélodie qui exprime du grand, du majestueux
, on ajoute une harmonie pleine , compofée
d’accords parfaits, plutôt que de renverfés, mettant
toujours autant qu’on le peut la tierce majeure dans
le deffous , évitant les accords de dominante, &:
leur préférant ceux de dominante tonique, l’on rendra
certainement fa mélodie encore plus expref-
five.
Mais une diffonance doit être préparée & fauvée
pour faire l’effet le moins défagréable ; en omettant,
quand cela fe peut, la préparation , ou bien en rendant
la préparation très-courte &c la diffonance longue,
on augmente donc fa dureté, & fi avec cela oa
change-fon lauvement, ou qu’on le faute par ellipfe,
on porte la dureté au plus haut point ; On caufe phy-
fiquement un défordre dans l’organe de l’auditeur,
ce défordre joint à une mélodie, exprimant de la
colere , par exemple, doit néceffairement rendre
cette expreflion plus forte.
Je ne fais fi je me trompe, mais il me femble que
fi l’on employoitàproposle phyfique de la mufique,
on parviendroit bientôt à une expreflion dont nous
n’avons aucune idée.
Mais que faudroit-il pour cela ? Un compofiteur
philofopne , obfervant toutes les impreflions de la
mufique , fur-tout écoutant les jugemens de tout le
monde, effayant tous les changemens poflibles dans
un feul a ir, & remarquant.avec foin quand il fait le
plus d’effet ; recherchant pourquoi il fait alors le
plus d’effet, afin de s’épargner dans la fuite la peine
de tâtonner d ; nouveau, & afin de fe former peu-à-
peù un recueil d’obfervations, ou plutôt de réglés
fûres , moyennant lefquelles il pourra produire tel
ou tel effet donné, femblable à un chymifte qui augmente,
diminue, modifie’à fon gré là vertu d’une
drogue , en la mêlant à propos avec d’autres.
Mais l’harmonie agit encore phyfiqa'î'riient fur.
nous par un autre moyen , celui de la modulation
harmonique, ouïe paffage d’un mode dans un autre.
Certainement en majeur, le mode de la quinte
eft le plus relatif au régnant ; il eft majeur comme
lui; il n’y a dans leurs deux échelles qu’un feul ton
de différent le fa ^ ; enfin l’expérience le prouve ,
puifque nous paffons toujours de l’accord de dominante
tonique à celui de tonique , pour faire une
cadence parfaite , par laquelle on puiffe finir. La
modulation la plus naturelle, celle qui nous frappera
le moins, & nous biffera par conféquent le plus
tranquilles, c’ eft celle du mode régnant à celui de fa
dominante tonique.
Si avec cela l’on ménage la tranfition en paffant
d’un accord à l’autre fans changer le fa en fa ^ , &
que parmi ces accords celui de fo l fe faffe entendre
plus fouvent que celui d'ut, vous.pafferez fi imperceptiblement
en fo l x qu’à peine on s’en apperec vra,
& ainfi vous aurez laiffé votre auditeur dans une
fituation tranquille : vous l’aurez tranfporte d’un
lieu dans un autre fi doucement, qu’à peine il le fait.
Mais fi après l’accord de tonique ut vous frappez
celui de dominante tonique , re , fa % 9 la , ut, vous
ébranlez l’organe de l’auditeur, par cet accord abfo-
lument étranger au mode que vous lui avez annoncet
Après le mode de la dominante, celui de la fixte
la eft le plus relatif au régnant ; mais il eft mineur ;
il ne faudra donc pas y paffer fi Yexpreffion demande
de la force.
Le mode de la quarte fà a quelque chofe de fombre
quand il fuccede au régnant, à caufe de la note
fen fiole ƒ , qu’il faut bémolifer , &c. &c.
La fucceflion de l’harmonie nous donne donc
encore un nouveau moyen de renforcer l’expreflion
de la mélodie. ^
III. De Ûaccompagnement. Ceci fe fous - divife
encore eri deux articles ;
i °. Le mouvement de l’accompagnement : z°. Les
inftrumens dont il eft compofé.
i °. Dû mouvement de l’accompagnement.
Nous avons déjà remarqué ci-deffüs que le fimple
mouvement'peut caufer une impreflion defagreable
& pénible par fa lenteur & fon uniformité ; qu’il
peut en augmentant de vîteffe changer ce fentiment
défagréable en un fentiment agréable , ou du moins
indifférent, & qu’enfin cette vîteffe à force d’augmenter
caufe une impreflion fatigante & étourdif-
fante. Cette remarque peut être d’un grand fecours
pour augmenter E'-xpreffion. Avez-vous une profonde
trjftefle à exprimer, donnez à votre accompa^-
gnement une marche lente., égalé & uniforme, plutôt
en. defcendant qu’en montant, & certainement
ie fentiment pénible & défagréable que caufera cet
accompagnement, augmentera la trifteffe qui caufe
votre mélodie.
Avez.-vous une mélodie qui exprime un fentiment
doux , agréable , accompagnez-la de notes d’une
vîteffe modérée qui reftent fur le même ton , ou faf-r
fent du moins peu de fauts, & fur-tout de petits faut$.
Voulez-vous en impofer à votre auditeur, joignez
à une mélodie noble un accompagnement compofé
de notes inégales, dont la. première foit pointée, &C
qui aient un mouvement modéré. Ici les fauts en montant
feront un bon effet, fur-tout les confonnans.
Voulez - vous étourdir, que l’accompagnement
marche avec vîteffe , &c.
Mais il y a encor»; une obfervation importante à
faire dans le mouvement de l’accompaguement ;
obfervation qui concourt beaucoup à augmenter ou
diminuer Yexpreffion par le phyfique, c’eft que chaque
partie a une marché qui lui convient mieux que
les autres ; j’entends ici par partie la baffe, la taille ,
& les. deux deffus, fans avoir égard aux inftrumens
qui les exécutent.
La marche de la baffe doit être la plus lente, parce
que les tons graves vibrent lentement ; d’ailleurs
quand un ton fondamental vibre une fois, fon oCtave
vibre deux fois , fa douzième trois , &c. & il eft
tout clair qu’en donnant aux parties qui fonnent
ces intervalles, un mouvement qui s’accorde avec les
vibrations de ces intervalles , vous produifez l’effet
le plus agréable & le plus fimple, parce qu’il approche
le plus du naturel.
; Si donc vous donnez à la baffe des blanches, à la
taille des noires , au fécond deffus des croches, Ôt
au premier deffus des doubles croches, l’effet qui en
résultera fera le plus un poflible. Plus vous perver?
tirez Cet ordre, plus votre effet s’éloigne de la nature
, plus il doit faire une impreflion défagréable.
i ° . Des inftrumens qui forment l’acc ompagnement.
M. Rouffeau l’a déjà remarqué, il n’y a point
d’inftrumept dont on puiffe tirer un plus gr.-.nd parti
que du violon, parce que , fuivant la maniéré d’en
jou er, on en tire un fon analogue à celui des autres
inftrumens : joué avec force, on en tire prefque J*
ton fier de la trompette ; joué avec douceur & une
fourdine , vous imitez la flûte la plus gracieufe, c’eft
donc avec raifon que les inftrumens à corde & à
archet font la bafe de tout accompagnement : je dis
les inftrumens à corde & à archet, parce que du
plus au moins ils produifent tous les mènes effets
que le .violon.
On pourra donc exprimer avec les feiils inftru-
mens à archets, toutes les pallions que l’on voudra,
en obfervant d’ailleurs tout ce qui peut faire Yexpreffion
& l’augmenter ; mais fi l’on joint des inftrumens
analogues à Yexpreffion aux violons, on renforcera
encore cette expreffion.
La trompette eft fiere , guerrierè , bruyante :
réfervez la pour les batailles,les triomphes, les airs
guerriers.
Le cor • de-chaffe, don» c avec force, peut remplacer
la trompette en partie , mais il devient tendre,
même trifte & plaintif, fi on l’adoucit.
Le hautbois eft brillant, gai, on peut l’adoucir ,
mais jamais le rendre vraiment propre à latendreffe ;
il conferve toujours quelque chofe d’aigre & de
perçant. Servez-vous-en pour faire du b ruit, renforcer
les violons, pour exciter à la gaieté, pour exprimer
une joie vive : jpignez-le aux trompettes.
La flûte eft douce, tendre, gracieufe. Une déclaration
d’amour, une plainte fur une abfenee , une
joie tendre, tout cela eft de fon reffort.
Rien à mon avis de plus touchant que des flûtes
accompagnées de cors de-chaffe adoucis.