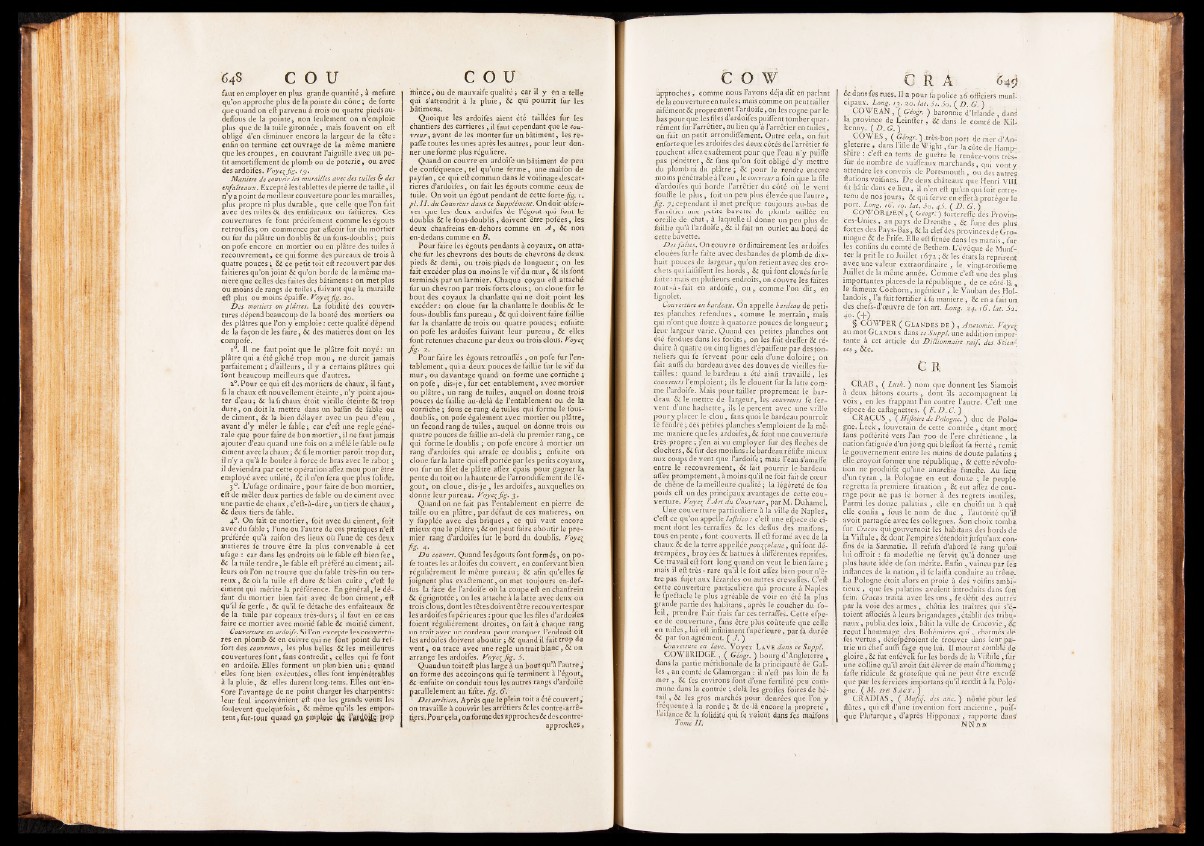
faut en employer en plus grande quantité, a mefuré
qu’on approche plus de la pointe du cône ; de forte
que quand on eft parvenu à trois ou quatre pieds au*-
deffous de la pointe, non feulement on n’emploie
plus que de la tuile gironnée, mais fouvent on eft
obligé d’en diminuer encore la largeur de la tête :
enfin on termine cet ouvrage de la même maniéré
que les croupes, en couvrant l’aiguille avec un petit
amortiffement de plomb ou de poterie, ou avec
des ardoifes. Voyez fig. ry.
Maniere de couvrir les murailles avec des tuiles & des
enfaîteaux. Excepté les tablettes de pierre de taille, il
n’y a point de meilleur couverture pour les murailles,
plus propre ni plus durable, que celle que l’on fait
avec des tuiles 8c des enfaîteaux ou faîtieres. Ces
couvertures fe font précifement comme les égouts
retrouffés; on commence par affepir fur du mortier
ou fur du plâtre un doublis 8c un fous-doublis; puis
on pofe encore en mortier ou en plâtre des tuiles à
recouvrement, ce qui forme des pureaux de trois à
quatre pouces ; 8c ce petit toit eft recouvert par des-
faîtieres qu’on joint 8c qu’on borde de la même maniéré
que celles des faîtes des bâtimens : on met plus
ou moins de rangs de tuiles, fuivant que la muraille
eft plus ou moins épaiffe. Voye^fig. 20.
Des mortiers ou plâtres. La folidité des couvertures
dépend beaucoup de la bonté des mortiers ou
des plâtres que l’on y emploie : cette qualité dépend
de la façon de les faire, 5c des matières dont on les
compofe.
i° . 11 ne faut point que le plâtre foit noyé: un
plâtre qui a été gâché trop mou, ne durcit jamais
parfaitement ; d’ailleurs, il y a certains plâtres qui
font beaucoup meilleurs que d’autres.
x°. Pour ce qui eft des mortiers de chaux, il faut,
fi la chaux eft nouvellement éteinte, n’y point ajouter
d’eau; & la fi chaux étoit vieille éteinte 6c trop
dure, on doit la mettre dans un baflin de fable ou
de ciment, ôc la bien délayer avec un peu d’eau ,
avant d’y mêler le fable ; car c’eft une réglé générale
que pour faire de bon mortier, il ne faut jamais
ajouter d’eau quand une fois on a mêlé le fable ouïe
ciment avec la chaux; 6c fi le mortier paroît trop dur,
il n’y a qu’à le bouler à force de bras avec le rabot ;
il deviendra par cette opération affez mou pour être
employé avec utilité, ôc il n’en fera que plus folide.
3 °. L’ufage ordinaire, pour faire de bon mortier,
eft de mêler deux parties de fable ou de ciment avec
une partie de chaux, c’eft-à-dire, un tiers de chaux,
6c deux tiers de fable.
40. On fait ce mortier, foit avec du ciment, foit
avec du fable ; l’une ou l’autre de ces pratiques n’eft
préférée qu’à raifon des lieux oît l’une de ces deux
matières fe trouve être la plus convenable à cet
ufage : car dans les endroits oit le fable eft bien fe c ,
6c la tuile tendre, le fable eft préféré au ciment ; ailleurs
oît l’on ne trouve que du fable très-fin ou terreux
, 6c oît la tuile eft dure 6c bien cuite , c’eft le
ciment qui mérite la préférence. En général, le défaut
du mortier bien fait avec de bon ciment, eft
qu’il fe gerfe, 6c qu’il fe détache des enfaîteaux 6c
de la tuile par copeaux très-durs ; il faut en ce cas
faire ce mortier avec moitié fable 6c moitié ciment.
Couverture en ardoife. Si l’on excepte les couvertures
en plomb 6c en cuivre qui ne font point du ref-
fort des couvreurs, les plus belles 6c les meilleures
couvertures font, fans contredit, celles qui fe font
en ardoife. Elles forment un plan bien uni : quand
elles font bien exécutées, elles font impénétrables
à la pluie, ôc elles durent long-tems. Elles ont Encore
l’avantage de ne point charger les charpentes :
leur feul inconvénient eft que les grands vents les
foulevent quelquefois, 6c même qu’ils les emportent,
fur-tout quand 9.a emploie i ç U°'P
thince \ pu de mauvaife qualité ; car il y en a telle
qui s’attendrit à la pluie, 6c qui pourrit fur les
bâtimens.
Quoique les ardoifes aient été taillées fur les
chantiers des carrières, il faut cependant que le couvreur
y avant de les monter fur un bâtiment, les re-*
paffe toutes les unes après les autres, pour leur don»
ner une forme plus régulière.
Quand on couvre en ardoife un bâtiment de peu
de conféquence, tel qu’une ferme, une maifon de
payfan, ce qui eft commun dans lé voifinage des carrières
d’ardoifes, on fait les égouts comme ceux de
tuile. On voit un égout pendant de cette forte fig. 1.
pl. 11. du Couvreur dans ce Supplément. On doit obfer-
ver que les deux ardoifes de l’égout qui font le
doublis 6c le fous-doublis, doivent être pofées, les
deux chanfreins en-dehors comme en A , ôc non
en-dedans comme en B.
Pour faire les égouts pendants à coyaux, on attache
fur les chevrons des bouts de chevrons de deux
pieds 6c demi, ou trois pieds de longueur; on les
fait excéder plus ou moins le v if du mur, 6c ils font
terminés par un larmier. Chaque coyau eft attaché
fur un chevron par trois forts clous ; on cloue fur le
bout des coyaux la chanlatte qui ne doit point les
excéder : on cloue fur la chanlatte le doublis 6c le
fous-doublis fans pureau, 6c qui doivent faire faillie
fur la chanlatte de trois ou quatre pouces; enfuite
on pofe les ardoifes fuivant leur pureau, 6c elles
font retenues chacune par deux ou trois clous. V?ye£
fig•
Pour faire les égouts retrouffés , on pofe fur l’entablement
, qui a deux pouces de faillie fur le v if du
mur, ou davantage quand on forme une corniche ;
on pofe, dis-je, fur cet entablement, avec mortier
ou plâtre, un rang de tuiles, auquel on donne trois
pouces de faillie au-delà de l’entablement ou de la
corniche ; fous ce rang de tuiles qui forme le fous-
doublis, on pofe également avec mortier ou plâtre,
un fécond rang de tuiles, auquel on donne trois ou
quatre pouces de faillie au-delà du premier rang, ce
qui forme le doublis ; on pofe encore à mortier un
rang d’ardoifes qui arrafe ce doublis ; enfuite on
cloue fur la latte qui eft portée par les petits coyaux,
ou fur un filet de plâtre affez épais pôur gagner la
pente du toit ou la hauteur de l’arrondiffement de l’égout,
on cloue, dis-je , les ardoifes, auxquelles on
donne leur pureau. Voye^fig. 3.
Quand on ne fait pas l’entablement en pierre de
taille ou en plâtre, par défaut de cés matières, on
y fupplée avec des briques , ce qui vaut encore
mieux que le plâtre ; 6c on peut faire aboutir le premier
rang d’ardoifes fur le bord du doublis. Voye^
fig• 4-
Du couvert. Quand les égouts font formés, on pofe
toutes les ardoifes du couvert, en conferyantbien
régulièrement le même pureau ; 6c afin qu’elles fe
joignent plus exactement, on met toujours en-def-,
fus la face de l’ardoife oîi la coupe eft en chanfrein
6c égrignotée ; on les attache à la latte avec deux ou
trois clous, dont les têtes doivent être recouvertes par
les ardoifes fupérieures : pour que les files d’ardoifes
foient régulièrement droites, on fait à chaque rang
un trait avec un cordeau pour marquer l’endroit oît
les ardoifes doivent aboutir ; 6c quand il fait trop de
vent, or trace avec une réglé un trait blanc, 6c on
arrange les ardoifes. Voye^fig. 5.
Quand un toit eft plus large à un bout qu’à l’autre
on forme des accoinçons qui fe terminent à l’égout,
6c enfuite on conduit tous les autres rangs d’ardoife
parallèlement au faîte, fig. 6.
Desarrêtiers. Après que le plein toit a été couvert,'
on travaille à couvrir les arrêtiers ôc les contre-arrê-
t^çrs. Pour çela> on forme desapproches 6c des contre-
approches ,
approches, comme nous l’avons déjà dit en parlant
de la couverture en tuiles; mais comme on peut tailler
aifément 6c proprement l’ardoife, on les rogne par le
ta s pour que les files d’ardoifes puiffent tomber quar-
rément fur l’arrêtier, au lieu qu’à l’arrêtxer en tuiles ?
ôn fait un petit arrpndiffement. Outre cela , on fait
enforte que les ardoifes des deux cotés de l’arrêtier fe
touchent affez exa&ement pour que l’eau n’y puiffe
pas pénétrer, 6c fans qu’on foit obligé d’y mettre
au plomb ni du plâtre ; 6c pour le rendre encore
moins pénétrable à l’eau , le couvreur a foin que la file
d’ardoifes qui borde l’arrêtier du côté où le vent
fouffle le plus, foit un peu plus élevée que l’autre,
fig. 7 ; Cependant il met prefque toujours au-bas de
l’arrêtier une petite bavette de plomb taillée en
oreille de chat, à laquelle il donne un peu plus de
faillie qu’à l’ardoife, 8c il fait un ourlet au bord de
Cette bavette;
Des faites. On couvre ordinairement les ardoifes
clouées furie faîte avec des bandes, de plomb de dix-
huit pouces de largeur, qu’on retient avec des crochets
qui faififfent les bords, 6c qui font cloués fur le
faîte : mais en plufieurs endroits, on couvre les faîtes
to u tà - fa it en ardoife, o u , comme l’on dit* eh
lignolet.
Couverture en bardeau. On appelle bardeau de petites
planches refendues:, comme le merrain, mais
qui n’ont que douze à quatorze pouces de longueur ;
feur largeur varie. Quand ces petites planches ont
été fendues dans les forêts j on les fait dreffer 6c réduire
à quatre ou cinq lignes d’épaiffeuf par des tonneliers
qui fe fervent pour cela d’une doloiré ; on
fait auffi du bardeau avec des douves de vieilles futailles.:
quand le bardeau a été ainfi travaillé, les
couvreurs l’emploient ; ils le clouent fur la latte Comme
l’ardoife. Mais pour tailler proprement le bardeau
6c le mettre de largeur, les couvreurs fe fervent
d’une hachette, ils le percent avec une vrille
poury placer le clou, fans quoi le bardeau pourrait
fe fendre ; ces petites planches s’emploient de la même
maniéré que les ardoifes, 6c font une couverture
très-propre ; j’en ai vu employer fur de$ fléchés de
clochers, ÔC fur des moulins : le bardeau réfifte mieux
aux coups de vent que i’àrdoife ; mais l’eaù s’amaffe
entre le recouvrement, 6c fait pourrir le bardeau
affez promptement, à moins qu’il ne foit fait de coeur
de chêne de la meilleure qualité ; la légèreté de fon
poids eft un des principaux avantages de cette couverture.
Voye^ l'Art du Couvreur, parM; Duhameï.
Une couverture particulière à la ville de Naples ,
c’eft ce qu’on appelle laflrico : c’eft une efpece de ciment
d o n t les terrafies 6c les deffus dés maifons,
tous en pente, font couverts. Il eft formé àyec de la
chaux 8c de la terre appellée pou^olane, qui font détrempées
, broyées 6çbattues a différentes reprifes.
Ce travail eft fort long quand on veut le bien faire ;
mais il eft très - rare qu’il le foit affez bien pouf n’ê-
tre pas fujet aux lézardes ou autres crevaffes. C’eft
cette couverture particulière qui procuré à Naples
le fpeétacîe le plus agréable de voir en été là plus
grande partie des habitans, après le coucher du fo-
leil, prendre l’air frais fur ces terraffes. Cette efpece
de cquvèrture, faiis être plus côûteufe que celle
en tuiles, lfii eft infiniment fupérieure, par la durée
Ôc par Ion agrément. ( /. )
Couverture en lave. Voyez L a v e dans ce Suppl.
COWBRIDGE , ( Géogr. ) bourg d’Angleterre ,
dans la partie méridionale de la principauté dè Gafr
les , au comté de Glamorgan : il n’eft pas loin de la
mer , 6c fes environs font d’une fertilité peu commune
dans la contrée ; delà les groffes foires de bétail
, 8c les gros marchés’ pour denrées que l’on y
frequente à ,1a ronde ; & de-là encore la propreté ,
! aifance 6c' la folidité qui fe voient dans fes maifons
Tome 11)
& dans fes rues. Il a pour fa police 16 officiers municipaux.
kl
Long. i j . 2 0 . lat. S i . S o . ( D .G . ) ,
GOWEAN , ( Géogr. ) baronnie d’Irlande , dan^
la province de Leinfter , ÔC dans le comté de Kil-
lcenny. (2). G .)
COWE S, ( Géogr. ) . très-bon port de mer d’An-
„.eterre , dans M e de W ight, fur la côte de Hamp-
shire : c’eft en tems de guerre le rendez-vous très-
fur de nombre de vaiffeaux marchands, qui vont y
attendre les convois de PortsmoutÜ , ou des autres
ftations voifines; De deux châteaux que Henri VIIÎ
fit bâtir dans ce lieu , ii n’en eft qu’un qui foit entretenu
de nos jours; 6c qui ferve en effet à protéger l e .
port. Long. ifi. /o.. lut. <$o. 4 J .C D . G .),
CO\VORDEN, ( Géogr;) fortereffe des Provin-
Ces-Umes , au pays de Drenthe , 6c l’une des plus
fortes des Pays-Bas, 6c la clef des provinces dçGro-
ningue 8c de Frife. Elle eftfituée dans les marais, fur
les confins du comté de Bethém. L’évêque dé Munf-
ter la prifle 10 Juillet 1672 ; 6c les états la reprirent
avec une valeur extraordinaire , le, vingt-troifieme
Juillet de la même année. Comme c’eft une des plus
importantes places de la république , de ce côté-là ,
le fameux Coehorn, ingénieur \ le Vauban des Hol-
landois, l’a fait fortifier à fa maniéré , 6c en à fait un
des chefs-d’oeuvre de fon art. Long. 24. iG. Iat. S z l
40i (+).
§ CCVWPER ( Glandes de ) , Anatomie. Voyez
au mot Glandes dans, ce Suppl, une addition importante
à cet article du Dictionnaire raif. des S tien-
ces, ÔCC.
C R
CRAB , ( Luth. ) nom que donnent les Siamois
à deux bâtons courts , dont ils accompagnent la
voix , en les frappant l’un contre l’autre. C’éft une
efpece de caftagnettes. ( F. D . C. )
CRACUS , ( Hijloire de Pologne. ) duc de Pologne.
Leck , fouverain de cette contrée, étant mort
fans poftérite vers l’an 700 de i’eré chrétienne , la
nation fatiguée d’un joug qui bleffôit fa fierté, remit
le gouvernement entre les mains de douie palatins ;
elle croyoit former une république, & cette révolution
ne produifît qu’une anarchie fùnefté. Au lieu
d’un tyran , la Pologde en eut doute ; le peuplé
regretta fa première fituàtion , 6c eut affez de courage
pour né pas fe borner à des regrets inutiles.
Parmi les douze palatins , elle en choifit un à qui
elle confia , fous le nom de duc , l’autorité qu’il
avoit partagée avec fes collègues. Son choix tombé
fur Cracks qui gouvernoit les habitans des bords dè
la V iftule, 8c dont l’empire s’étehdoit Jufqu’aux confins
de la Sarmatie. 11 refufa d’abord lé rang qu’ori
lui offroit : fa modeftie ne fervit qu’à donner unè
plus haute idée de fon mérite. Enfin , vaincu par lés
inftances de la nation, il fe laiffà conduire au trône.
La Pologne étoit alors en proie à des yolfins ambitieux
, que les palatins avoient introduits dans fort
fein; Cracus traita avec les uns , fe défit des autres
par la voje des armes, châtia les traîtres, qui s’é-
toient àffociés à leurs brigandages , établit des tribunaux,
publia des lo ix, bâtit la ville de Crâcovie, 8ç
reçut l’hommage des Bohémiens q u i, charmés dé
fes vertus , déiefpéroient de trouver dans leur patrie
un chef auffi fage que lui. Il nîourut comblé de
gloire, ôc fut enféveli fur les bords de la Viftule , fur
une oolljne qu’il avoit fait élever dé main d’homme ;
fafte ridicule ôc gfotefque qui ne peut être exeufé
que par lés férvices impôrtàns qu’il rendit à la Pologne.
( M. d e Sâ c y . ')
CRÂDIA'S , ( Mnjiq. des anc. ) nômé pour les1
flûtes , qui eft d’une invention fort ancienne , puîf-
que Plutarque, d’après Hipponax , rapporte dans'
N N h h