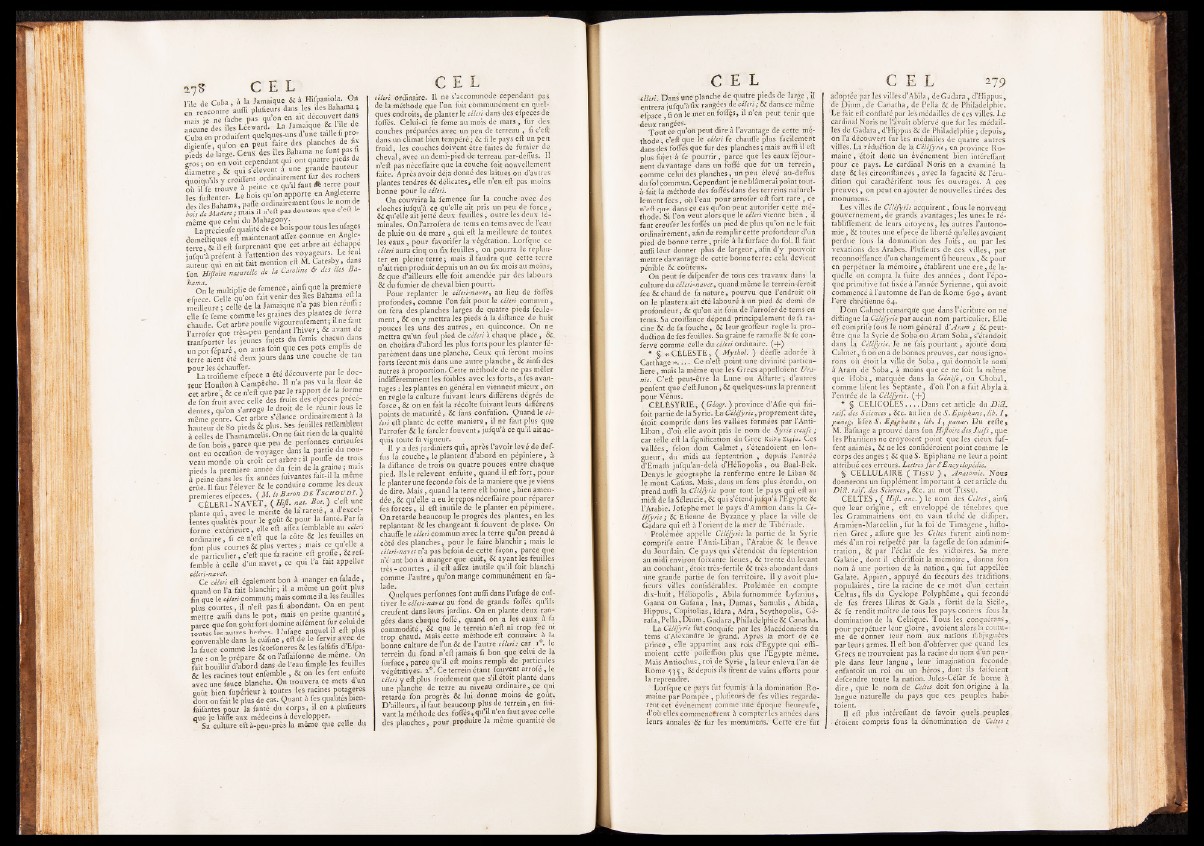
l'îl» Je Cuba ; à la Jamaïque & .à Hifpanio'a. On
'en rencontre uuffi plufieurs dans les îles Bahama ;
mais je ne fâche pas qu’on en ait découvert dans
aucune des îles Léesrard. La Jamaïque &B îles de
Cuba en produifent quelques-uns d une E i S g t I Ü
dirieüfe , qu’on en peut faire des planches de gg
pilds de large. Ceux des îles Bahama ne font pas fi
gros'; on «n voit cependant qui ont quatre pieds de
Siametre, & qui s’élèvent g une grande hauteur
S u ’Us y croiffent ordinairement fur des rochers
où îl fe trouve à peine ce qu’il faut * terre pour
les Luttent«. Le bois qu’on apporte en Angleterre
des îles Bahama, paffe ordinairement fous le nom de
bois de Modéré ; mais il n’eft.pas douteux que c eft le
même que celui du Mahagony. . r
La précieufe qualité de ce bois pour tous les ufages
domeuiqües eft maintenant affea connue en Angleterre,
& il eft furprenant que cet arbre ait échappé
iufqu’à préfent h l’ attention des voyageurs. Lefeul
auteur qui en ait fait mention eft M. Catesby, dans
fon Hiftoire naturelle de lu Caroline & des ilfs Ba-
On le multiplie de femence, ainfi que la première
efpece. Celle qu’on fait venir des îles Bahama cilla
meilleure ; celle de la Jamaïque n’a pas bien reufli :
elle fe feme comme les grames des plantes de ferre
chaude. Cet arbre pouffe vigonreufement ; il ne faut
Tarrofer que très-peu pendant 1 hiver ; 5c avant de
tranfporter les jeunes fujets du femis chacun dans
un pot féparé, on aura foin que ces pots emplis de
terre aient été deux jours dans une; couche de ,m
pour les échauffer. HBR M H
La troifieme efpece a été decouverte par le docteur
Houfton à Campêche. Il n’a pas vu la fleur de
cet arbre', & ce n’eft que par le rapport de la forme
de fon fruit avec celle des fruits des ef]ieces prece-,
dentes, qu’on s’arroge le droit de le reunir fous e
même genre. Cet arbre s’ élance ordinairement à la
hauteur de 8o pieds & plus. Ses feuilles reflemblçnt
à celles de l’hàmamoelis. On ne fait rien de la qualité
de fon bois, parce que peu de perfonnes cuneufes
ont eu occafion de voyager dans la partie du nouveau
monde olfi croît cet arbre : i pouffe de trois,
pieds la première année du fem de la graine ; mais
à peine dans les fix années fulvantes fait-il la meme
crue. Il faut l’élever & le conduire comme les deux
premières elpeces. ( M. le Baron d e Ts ch o u d i . )
C É LER I-N A VE T, ( Hift.nae. Bot.) c eft une
plante qui, avec le mérite de la rarete, a, d excelr
lentes qualités pour le goût ■ pour la fonte. Par fa
forme extérieure , elle eft affez femb able au eelen
ordinaire , fi ce n’eft que là cote & les feuilles, en
font plus courtes & plus vertes ; mais ce qu elle a
de particulier , c’eft que fa racine eft greffe ,& ref-
femble à celle d’un nâvet, ce qui la fait appeller
céleri-navet. , ‘ , ,
Ce celai eft également bon à manger en lalade,
quand on l’a fait blanchir; il a même un goiÛt plus
fin que le céleri commun; mais comme il a les feuilles
plus courtes, il n’eft pas fi abondant. On en peut
mettre aufli dans le pot, mais en petite quantité,
parce que fon goût fort domine aifement fur celui de
toutes les autres herbes. L’ufage auquel il eft plus
convenable dans lacuifme , eft de le fervir .avee de
la fimee comme les feorfoneres & les falfifis d Elpa-
Ene : on le prépare & ohl’affaifonne de même. On
fait bouillir d’abord dans de l’eau fimple les feuilles
& les racines tout enfemble , & on les fert enfuite
avec une fauce blanche. On trouvera ce mets d un
eoût bien fupérieur à toutes les racines potagères
dont on fait le plus de cas. Quant à fes qualités bien-
faifantes pour la fanté du corps, il en a plufieurs
que je laiffe aux médecins à développer.
Sa culture eft à-peu-près la même que celle du
céleri ordinaire. Il ne s’accommode cependant pas
de la méthode que l’on fuit communément en quelques
endroits, de planter le céleri dans des efpeces de
foffés. Celui-ci fe feme au mois de mars , fur des
couches préparées avec un peu de terreau , fi c’eft
dans un climat bien tempéré ; & ii le pays eft un peu
froid, les couches doivent être faites de fumier de
cheval, avec un demi-pied de terreau par-deffus. Il
n’eft pas nécefiaire que la couche foit nouvellement
faite. Après avoir déjà donné des laitues ou d’autres
plantes tendres & délicates, elle n’en eft pas moins
bonne pour le céleri.
On couvrira la femence fur la couche avec des
cloches jufqu’à ce qu’elle ait pris un peu de force,
& qu’elle ait jetté deux feuilles, outre les’deux fé-
minales. On l’arrofera de tems en tems avec de l’eau
de pluie ou de mare , qui eft la meilleure de toutes
les eaux, pour favorifer la végétation. Lorfque ce
céleri aura cinq ou fix feuilles, on pourra le replanter
en pleine terre ; mais il faudra que cette terre
n’ait rien produit depuis un an ou fix mois au moins,-
& que d’ailleurs elle foit amendée par des labours
& du fumier de cheval bien pourri.
Pour replanter le céleri-navet, au lieu de folles
profondes, comme l’on fait pour le céleri commun,
on fera des planches larges de quatre pieds feulement
, & on y mettra les pieds à la diftance de huit
pouces les uns des autres, en quinconce. On ne
mettra qu’un feul pied de céleri à chaque place, Ôc,
on choifira d’abord les plus forts pour lés planter fé-
parémentdans une planche. Ceux qui feront moins
forts feront mis dans une autre planche, & ainfi des
autres à proportion. Cette méthode de ne pas mêler
indifféremment les foibles avec les forts, a fes avan-
tuges : les plantes en général en viennent mieux, on
en réglé la culture fuivant leurs differens dégrés de
force, & on en fait la récolte fuivant leurs différens
points de maturité, & fans confiifion. Quand le céleri
eft planté de cette maniéré, il ne faut plus que
l’arrofer & lé farder fou vent, jufqu’à ce qu’il ait acquis
toute fa vigueur.
11 y a des jardiniers qui, après l’avoir levé de def-
fus la couche, le plantent d’abord en pépinière, à
la diftance de trois ou quatre pouces entre chaque
pied. Ils le relevent enfuite, quand il eft fort, pour
le planter une fécondé fois de la maniéré que je viens
de dire. Mais, quand la terre eft bonne , bien amendée,
& qu’elle a eu le repos nécefiaire pour réparer
fes forces, il eft inutile de le planter en pépinière..
On retarde beaucoup le progrès des plantes, en les
replantant & les changeant fi fouvent de place. On
I chauffe le céleri commun avec la terre qu’on prend à
côté des planches, pour le faire blanchir ; mais le
i céleri-navet n’a pas befoin de cette façon, parce que
n’é‘ ant bon à manger que cuit, & ayant les feuilles
très-courtes , il eft affez inutile qu’il foit blanchi
comme l’autre, qu’on mange communément en fa-
lade.
Quelques perfonnes font aufli dans I’iifage de cultiver
le céleri-navet au fond de grands foffés qu’ils
creufent dans leurs jardins. On en plante deux rangées
dans chaque fofle, quand on a les eaux à fa
commodité, & que le terrein n’eft ni trop fec ni
trop chaud. Mais cette méthode eft contraire à la
bonne culture de l’un & de l’autre céleri: car i°. le
terrein du fond n’eft jamais fi bon que celui de la
furface, parce qu’il eft moins rempli de particules
végétatives. z°. Ce terrein étant fpuvent arrofé, le
. céleri y eft plus froidement que s’il étoit planté dans
une planche de terre au niveau ordinaire, ce qui
retarde fon progrès & lui donne moins de goût.
D ’ailleurs, il faut beaucoup plus de terrein, en fuivant
la méthode des foffés, qu’il n’en faut avec celle
des planches, pour produire la même quantité de
-cileri. Elans une planche de quatre pieds de large K
entrera jufqu’à fix rangées de céleri; & dans ce même
efpace , fi on le met en foffçs, il n’en peut tenir qüe
•deux rangées. ■ , „ , ’ . : ■
Tout ce qu’on peut dire a 1 avantage de cette méthode
e’eft que le céleri fe chauffe plus facilement
dans des foffés que fur des planches ; mais aufli il eft
plus ftijet à fe pourrir, parce que les eaux féjo'ur-
nent davantagé dans un foffé que fur un tèfrèin,
comme celui dès planches, un peu élevé au-deffus
du fol commun. Cependant je ne blâmerai poinuout-
à-fait la méthode des foffés dans des terreins naturellement
fees j o iil’eau pour arrofer eft fort rare , ce
n’eft que dans ce cas qu’on peut autorifer cette méthode.
Si l’on veut alors que le céleri vienne bien , il
faut creufer les foffés un pied de plus qu’on ne le fait
ordinairement, afin de remplir cette profondeur d’un
pied de bonne terre, prife à la furface du fol. Il fàttt
aufli leur donner plus de largeur, afin d’y pouvoir
mettre davantage de cette bonne ferre : cela devient
pénible & coûteux.
On peut fe difpenfer de tous cés- travaux dans- la
culture du céleri-navet, quand même le terreinTèroit
fec & chaud de fa nature, pourvu que l’endroit oiï
oii le plantera ait été labouré à un pied & demi de
profondëur, & qu’on ait foin de farroferde tems en
tems. Sa croiffance dépend principalement de fa racine
& de fa fouche, & leur groffeur réglé la production
de fes feuilles. Sa graine fe ramaffe & fe con-
ferve comme celle du céleri ordinaire. (4-)
* § «CÉ LESTE , ( Mytkol. ) déeffe adorée à
Carthage » . . . . Ce n’ett point une divinité particulière,
mais la même que les Grecs appelloient Uranie.
C ’eft peut-être la Lune ou Aftarte ; d’aii très
penfent que c’eftJunon, & quelques-uns la prennent
pour Vénus.
CÉLÉSYRIE, (Géogr.') province d’A fie qui fai-
foit partie de la Syrie. La Céléfyrie, proprement dite,
étoit comprife.dans les vallées formées par l’Anti-
Liban, d’oîi elle avoit pris le nom de Syrie creufe ;
car telle eft la lignification du G rec Ko/x» Zopia. Ces
vallées, félon dom Calmet, s’étendoient en longueur,
du midi au feptentrion , depuis l’entrée
d’Emath jufqu’au-delà d’Héliopolis, ou Baal-Bek.
Denys le géographe la renferme entre le Liban &
le mont Cafiùs. Mais, dans un fens plus étendu,'on
prend aufli la. Céléfyrie pour tout le pays qui eft au
midi deïa Sèleucie, & qui s’étend julgu’à l’Egypte &
l’Arabie. Jofephe met lé pays d’Amffion dans ta Cé-
léfyrie; & Etienne de Byzance y place la ville de-
Gadare qui eft à l’orient de la mer de Tibériade.
Ptolémée appelle Céléfyrie la partie dé la Syrie
com p rit entre l’Anti-Liban, l’Arabie & le fleuve
du Jourdain. Ce pays qui s’étendoit du feptentrion
au midi environ foixante lieues, & trente du levant
au couchant, étoit très-fertile & très-abondant dans
line grande partie de fon territoire. Il y avoit plufieurs
villes confidérables. Ptolémée en compte
dix-huit, Héliopolis , Abilà furnommée Lyfanius,
Gaana ou Gafana, Ina, Damas, Samulis ; Abida,
Hippus, Capitol'ias, Idara, Adra, Scythopolis, Gé-
rafa, Pella, Dium, Gadara, Philadelphie & Canatha.
La Céléfyrie fut conquife par les Macédoniens du
tems d’Alexandre le grand. Après la mort de ce
prince, elle appartint aux rois d’Egypte qui efti-
rnoient cette ' poffefliOn plus que l’Egypte même.
Mais Antiochus, roi de Syrie , la leur enleva l’an de
Rome 535, & depuis ils firent de vains efforts pour-
la reprendre.
Loffque ce pays fut fournis* à- la domination Romaine
par Pompée , plufieurs de fes villes regardèrent
cet événement comme une époque fiëuréufe,
d’oii elles commencèrent à compter les années dans
leurs annales 6t fur les monumens. Cette eïe'fut
adoptée par les villes d’Abila, de Gadara , d’Hippus,
de Dium, de Canatha, de Pella & de Philadelphie.
Le fait eft conftatépar les médailles de ces villes. Le
cardinal Noris ne l’avoit ôbfervé que fur les médailles
de Gadara, d’Hippus S i de Philadelphie ; depuis,
on l’a découvert fur les médailles de quatre autres
vjlles. Là réduction de la Céléfyrie, en province Romaine
, 'étoit dofic un événement bien intéreffant
pour cè pays. Le cardinal Noris en a examiné la
daté & les circonftâncés , avec la fagacité & l’éru-
ditiori qui caraûérifent tous fes ouvragés. A ces
preuVès, on peut en ajouter de nouvelles tirées des
ftionunièqs.
Les villes de CéléfyHe acquirent, fous le nouveau
gouvernement, de grands avantages; les unes le ré-
tabliffement de leurs citoyens, les autres l’autonomie
, & toutes une efpéce de liberté qu’elles avoient
perdue fous la domination des Juifs, ou par les
vexations des Arabes. Plufieurs de cés .villes, par
reconnoiffance d’un changement fi heureux, & pour
en perpétuer la mémoire, établirent une ere , de laquelle
on compta la fuite des années , dont l’époque
primitive fut fixée à l’année Syrienne, qui avoit-
commencé à l’automne de l’an de Ro.me 690, avant
l ’erë chrétienne 64.
Dôm Calmet remàrqute que dans l’écriture on né
diftingue \a Céléfyrie par aucun nom particulier. Elle
eft cômprife fous le nom général d'Âram • ££ peut-
être que la Syrie deSoba ou Aram Soba,Vétendoit
dans la Céléfyrie.' Je ne fais pourtant, ajouté dom
Calmet, fi on en a de bonnes preuves, car nous'ignorons
ôiV étoit la ville dé Sofia, quidonnÔitle nom
a Airàm dé Soba, à moins que ce ne foit la même
que Hôba, marquée dans la Génèfe , QÙ Cfiobal,
comme lifènt les Septante, d’oîi l’on a fait Abyla Û.
l’entrée de la Céléfyrie. (-f-)
* § CELICOLES. . . . Dans cet article du Dict.
ra.if. des Sciences , &c. au lieu dë S. Epiphane, lib. / ,
paneg. lifèz S. Epiphane , lib. / , panar. Du refte,
M. Bafnage a prouvé dans fon Hiftoire des J u if s , que
les Pharifiens ne croyôient point que les cièux fuf-
fent animés, & ne lés confidéroient point comme le
corps des anges ; & que S. Epiphane ne leur a point
attribué ces erreurs. Lettres fur P Encyclopédie.
§ CELLULAIRE ( T is su ) , Anatomie. Nous
donnerons un fupplément important à cet article du
D i cl. raif. des Sciences, & c . au mot TlSSU.
CELTES , ( Hft. anc. ) le nom des. Celtes, ainfi
que leur' origine, eft enveloppé de ténèbres que
lès Grammairiens ont en vain tâché de difliper.
Aramien-Marcellin , fur la foi'de Timâgene , hiftô-
rien G re c , affure que les Celtes furent ainfi nommés
d’un roi refpeélé par la fageffe de fon adminif-
tration, & par l’éclat de fes vittoires. Sa mere
Galatie, dont il chériffoit la mémoire.,., donna fon
nom à une portion de la nation, qui fut appellée
Galate. Appien, appuyé du fecours des traditions,
populairès, tire la racine de ce mot d’un certain
Celtus, fils du Cyclope Polyphême, qui fécondé
de fes freres Illirus & Gala , fortit deïa Sicile,
& fe rendit maître de tous les pays-, connus fous la
domination de la Celtique. Tous les conquérans
pour perpétuer leur gloire, avoient alors la coutume
de donner leur nom aux nations fubjuguées
par leurs armes. 11 eft bon d’obferver que quand les
Grecs ne trouvoient pas la racine dunom d’ùn peuple
dans leur langue, leur imagination fécondé
enfantbit un roi ou un héros, dont ils faifoient
dèfcendre toute la nation. Jules-Cefar fe borne à
dire, que le nom de Celtes doit fon.origine à la
langue naturelle du pays que ees peuples habi-
toient. ^
Il eft- plus intéreffant de favoir quels.peuples
• étbient compris fous la dénomination de 'Celtes •