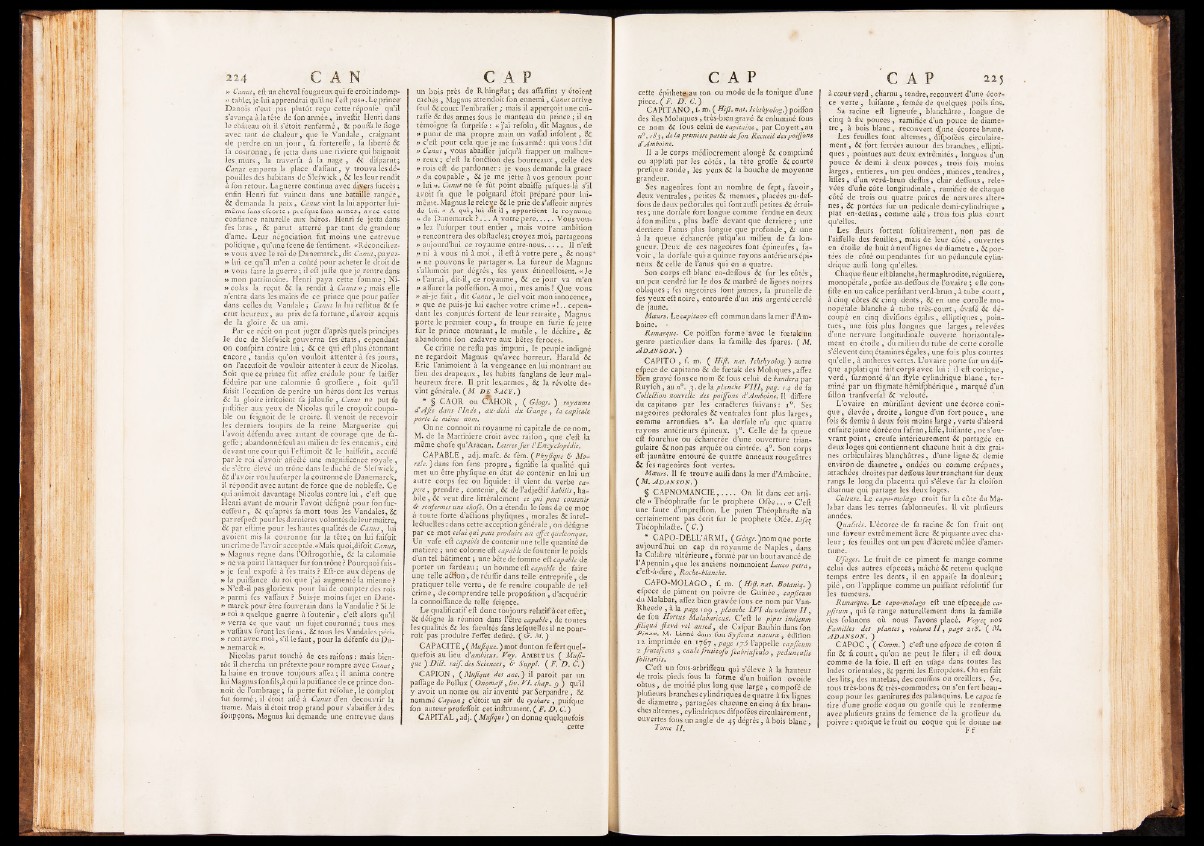
» Canut-, eft un cheval fougueux qui fe croit indomp-
» table; je lui apprendrai qu’il ne l’eft pas». Le prince'
Danois n’eut pas plutôt reçu cette réponfe qu’il
s’avança à la tête de fon armée, inveftit Henri dans
le château oh il s’étoit renfermé , & pouffa le liege
avec tant de chaleur, que le Vandale, craignant
de perdre en un jo u r , fa fortereffe , fa liberté &
fa couronne , fe jetta dans une riviere qui baignoit
les,murs-, .la traverfa à la n a g e . & difparut;
Canut emporta la place d’affaut, y trouva les dépouilles
des habitans deSle fwick, & les leur rendit
a fon retour. La guerre continua avec.di^rs fuccès ;
enfin Henri fut vaincu dans une bataille rangée,
& demanda la paix, Canut vint la lui apporter lui-
même fans efcorte, prefquefans armes, avec cette
confiance naturelle aux héros. Henri fe jetta dans
fes bras , & parut atterré par tant de grandeur
d ’ame. Leur négociation fut moins une entrevue
politique, qu’une fcene de fentiment. «Réconciliez-
» vous avec le roi de Danemarck, dit Canut, payez-
» lui ce qu’il m’en a coûté pour acheter le droit de
» vous faire la guerre ; il eft jufte que je rentre dans
» mon patrimoine. Henri paya cette fomme ; Ni-
» colas la reçut & la rendit à Canut » ; mais elle
n’entra dans les mains de ce prince que pour paffer
dans celles du Vandale ; Canut la lui refïitua & fe
crut heureux, au prix de fa fortune, d’avoir acquis
de la gloire & un ami. .
Par ce récit on peut juger d’après quels principes
le duc de Slefwick gouverna fes états, cependant
on confpira contre lui ; & ce qui eft plus étonnant
encore, tandis qu’on vouloit attenter à fes jours,
on l’accufoit de vouloir attenter à ceux de Nicolas.
Soit que ce prince fût allez crédule pour fe laiffer
féduire par une calomnie fi groffiere , foit qu’il
faisît l’occafion de perdre un héros dont les vertus
tk. la gloire irritoient fa jaloufie , Canut ne put fe
juftifier aux yeux de Nicolas qui le croyoit coupable
ou feignoit de le croire. Il venoit de recevoir
les derniers foupirs de la reine Marguerite qui
l ’avoit défendu avec autant de courage que de fa-
geffe ; abandonné feul au milieu de fes ennemis, cité
devant une cour qui l’eftimoit & le haïffdit, accufé
par le roi d’avoir affeâé une magnificence royale,
de s’être élevé un trône dans le duché de Slefwick,
& d’avoir voulu ufurper la couronne de Danemarck,
il répondit avec autant de force que de nobleffe. Ce
qui animoit davantage Nicolas contre lu i, c’eft que
Henri avant de mourir l’avoit défigné pour fon fuc-
ceffeur, & qu’après fa mort tous les Vandales, &
parrefpeft pour les dernieres volontés de leur maître,
& par eftime pour les hautes qualités de Canut, lui
avoient mis la couronne fur la tête ; on lui faifoit
un crime de l’avoir acceptée.«Mais quoi,difoit Canut,
» Magnus régné dans l’Oftrogothie, & la calomnie
» né va point l’attaquer fur fon trône? Pourquoi fuis-
» je feul expofé à fes traits ? Eft-ce aux dépens de
» la puiffance du roi que j’ai augmenté la mienne ?
» N’eft-il pas glorieux pour lui de compter des rois
» parmi fes vaffaux ? Suis-je moins fujet en Dane-
» marck pour être fouverain dans la Vandalie ? Si le
» roi a quelque guerre à foutenir , c’eft alors qu’il
» verra ce que vaut un fujet couronné ; tous mes
» vaffaux feront les fiens, &tou s les Vandales péri-
» ront avec moi, s’il le faut, pour la défenfe du Da-
» nemarck ».
Nicolas parut touché de cesraifons: mais bientôt
il chercha un prétexte pour rompre avec Canut ;
la haine en trouve toujours affez ; il anima contre
lui Magnus fon fils,à qui lapuiffance de ce prince don-
noit de l’ombrage; fa perte fut réfolue, le complot
fut formé ; il étoit aifé à Canut d’en découvrir la
trame. Mais il étoit trop grand pour s’abaiffer à des
Soupçons. Magnus lui demande une entrevue dans
un bois près de Rhingftat; des affafîins yètoierit
cachés , Magnus attendoit fon ennemi, Canut arrivé
feul & court l’embraffer ; mais il apperçoit une cui-
raffé & des armes fous le manteau du prince ; il en
témoigne fa furprife : « j’ai refolu, dit Magnus, de
» punir de ma propre main un vaffal infolent, &
» c’eft pour cela que je me fuis armé : qui vous ! dit
» Canut, vous abaiffer jufqu’à frapper un malheu-
» reu x ; c’eft la fonction des bourreaux , celle des
» rois eft de pardonner : je vous demande la grâce
» du coupable , & je me jette à vos genoux pour
» lui ». Canut ne fe fût point abaiffé jufques-là s’il
avoit fu que le poignard étoit préparé pour lui-
même. Magnus le rele^e & le prie des’affeoir auprès
de lui. « A qui, lui dit-il, appartient le royaume
» de Danémarck ? . . . A votre p ere.. . . * Vous vou-
» lez l’ufurper tout entier , mais votre ambition
» rencontrera des obftacles; croyez moi, partageons
» aujourd’hui ce royaume entre-nous......... Il n’eft
» ni à vous ni à moi, il eft à votre pere , & nous1
» ne pouvons le partager». La fureur de Magnus
s’allumoit par dégrés, fes yeux étincelloient. « Je
» l’aurai, dit-il, ce royaume, & ce jour va m’en
» affurer la poffeflion. A m oi, mes amis ! Que vous
» ai-je fa it , dit Canut, le ciel voit mon innocence,
» que ne puis-je lui cacher votre crime»!., cependant
les conjurés fortent de leur retraite, Magnus
porte le premier cou p, fa troupe en furie fe jette
lur le prince mourant, le mutile , le déchire, &
abandonne fon cadavre aux bêtes feroces.
Ce crime ne refta pas impuni, le peuple indigné
ne regardoit Magnus qu’avec horreur. Harald &c
Eric l’animoient à la vengeance en lui montrant au
lieu des drapeaux, les habits, fanglans de leur malheureux
frere. Il prit les»armes, & la révolte devint
générale. (M d e Sa c y .)
* § CAOR ou A h OR , ( Géogn ) royaume
(TAJie dans CI n ie , au-delà du Gange, la capitale
porte le meme nom.
On ne. connoît ni royaume ni capitale de ce nom.
M. de la Martiniere croit avec raifon, que c’eft la
même chofe qu’Aracan. Lettres fur C Encyclopédie.
CAPABLE , adj. mafe. & fém. ( Phyfique & Morale.
) dans fon fens propre, fignifie la qualité qui
met un être phyfique en état de contenir en lui un
autre corps fec ou liquide : il vient du verbe ca-
pere, prendre, contenir, & de l’adjeftif habilis, habile
, & veut dire littéralement ce qui peut contenir
& renfermer une chofe. On a étendu le fens de ce mot
à toute forte d’aftions phyfiques, morales & intellectuelles
: dans cette acception générale, on défigne
par ce mot celui qui peut produire un effet quelconque.
Un vafe eft capable de contenir une telle quantité de
matière ; une colonne eft capable de foutenir le poids
d’un tel bâtiment ; une bête de fomme eft capable de
porter un fardeau j un homme eft capable de faire
une telle aâ ton , de réufîir dans telle entreprife, de
pratiquer telle vertu, de fe rendre coupable de tel
crime, de comprendre telle propofition, d’acquérir
la connoiffance de telle fcience.
Le qualificatif eft donc toujours relatif à cet effet,'
& défigne la réunion dans l’être capable, de toutes
les qualités & les facultés fans lefquelles il ne pour-
roit pas produire l’effet déliré. ( G. M. )
CAPACITÉ ,{Mufique. ) mot dont on fe fer t quelquefois
au lieu d’ambitus. Voy. A m b i t u s ( Mufî-
que ) Dicl. raif. des Sciences, & Suppl. ( F . D .C . )
CAPION, ( Mufique des anc.) il paroît par un
paffage de Pollux ( Onomafl, liv. VI. chap. cj ) qu’il
y avoit un nome ou air inventé par Serpandre , &
nomme Capion; c’étoit un air de cythare , puifque
fon auteur profeffoit cet infiniment. { F . D . C. )
CA PITA L, adj. {Mufique) on donne quelquefois
cette
cette épithet%au ton ou mode de la tonique d’une
piece. ( F. D . C, )
CAP1T A N O , f. m. ( Hiß. nat. Ichthyolog.). poiffon
des îles Moluques , très-bien gravé & enluminé fous
ce nom & fous, celui de capitaine, par Coyett ,au
n°. i8y, de la première partie de fort. Recueil- des poiffon s
d'Amboine.
Il a le corps médiocrement alongé & comprimé
ou applati par les côtés., la tête groffe & courte
prefque ronde, les yeux & la bouche de moyenne
grandeur.
Ses nageoires font au nombre de fept, fa voir ,
deux ventrales, petites & menues, placées au-def-
fous de deux peûorales qui font aufli petites & étroites
; une dorlale fort longue comme fendue en deux
à fon milieu, plus baffe devant que derrière; une
derrière l’anus plus longue que profonde, & une
à la queue échancrée jûfqu’au milieu de fa longueur.
Deux de ces nageoires font épineufes, favoir
, la dorfale qui a quinze rayons antérieurs épineux
& celle de l’anus qui e-n a quatre.
Son corps eft blanc en-deffous & fur les côtés,
lin peu cendré fur le dos & marbré de lignes noires
obliques ; fes nageoires font jaunes, la prunelle de
fes yeux eft noire, entourée d’un iris argenté cerclé
de jaune.
Moeurs. Le capitano eft commun dans la mer d’Am-
boine. *
Remarque. Ce poiffon forme‘avec le foetak nn
genre particulier dans la famille des fpares. ( M.
A d a n so n . )
CAPITO , f. m. ([ Hi(l. nat. Ichthyologe') autre
efpece de capitano & de feetak des Moluques, affez
Bien grayé fous ce nom & fous celui dé bandera par
Ruyfch, au n°. 3 . de la planche VIII, pag. 14 de fa
Collection nouvelle des poiffons d'Amboine. IT différé
du capitano par les carafteres fuivans: i° . Ses
nageoires peôorales & ventrales font plus larges,
comme arrondies. La dorfale n’a que quatre
rayons antérieurs épineux. 30. Celle de la queue
eft fourchue ou échancrée d’une ouverture triangulaire
& non pas arquée ou cintrée. 40. Son corps
eft jaunâtre entouré de quatre anneaux rougeâtres
& fes nageoires font vertes.
Moeurs. Il fe trouve aufli dans la mer d’Amboine.
( M. A d an so n . )
§ CAPNOMANCIE, . . . . On lit dans cet article
« Théophrafte fur le prophète O fé e . . .» C ’eft
une faute d’impreflion. Le païen Théophrafte n’a
certainement pas écrit fur le prophète Ofée. Life?
Théophilaôe. ( C. )
* C APO-DELL’ARMI, {Géogr.) nom que porte
aujourd’hui un cap du royaume de Naples , dans
la Calabre ultérieure, formé par un bout avancé de
l’Apennin, que les anciens nommoient Leuco petra,
c’eft-à-dire, Roche-blanche.
CAPO-MOLAGO , f. m. {Hiß. nat. Botaniq. )
efpece de piment ou poivre de Guinée, capßcum
du Malabar, affez bien gravée fous ce nom par Van-
Rheede , à la page ioc) , planche LVI du volume I I ,
de fon Hortus Malabaricus. C ’eft le piper indicum
filiqiuî fiavâ yel aureâ, de Gafpar Bauhin dans fon
Pinax. M. Linné dans fon Syßema naturce, édition
12 imprimée en 1767 , page tyS l’appelle capßcum
2. frutefeens , caule fruticofo fcabriufculo , pedunculis
folitariis.
C’eft un fous-arbriffeau qui s’élève à la hauteur
de trois pieds fous la forme d’un buiffon ovoïde
obtus, de moitié plus long que large , compofé de
plufieurs branches cylindriques de quatre à fix lianes
de diamètre, partagées chacune en cinq à fix branches
alternes, cylindriques difpofées circulairement
ouvertes fous un angle de 45 dégrés, à bois blanc \
à coeur v e rd , charnu, tendre, recouvert d’une écorce
verte , luifante , femie de quelques poils fins»
Sa racine eft ligneufe, blanchâtre, longue de
cinq, à fix pouces , ramifiée d’un pouce de diamètre
, à bois blanc, recouvert d’une écorce brune*
Les feuilles font alternes, difpofées circulairement
, & fort ferrées autour des branches, elliptiques
, pointues aux deux extrémités, longues, d’un
pouce & demi , à deux pouces , trois fois, moins
larges, entières, un peu ondées., minces, tendres,
liffes, d’un verd-brun deffus, clair deffo.us,, relevées
d’ude côte longitudinale , ramifiée de chaque
côté de trois ou quatre paires de nervures alternes
, & portées fur un pédicule demi-cylindrique ,
plat en-deffus, comme aîlé , trois, fois plus court
qu’elles.
Les fleurs fortent folitairement, non pas de
l’aiffelle des feuilles, mais de leur côté , ouvertes
en étoile de huit à neuf lignés de diamètre , & portées
de côté ou pendantes fur un péduncule cylin-:
drique aiiflx long qu’éllesr.
Chaque fleur eft blanche, hermaphrodite, régulière,
mono pétale, pofée au-deftbus de 1’o.vaire ; elle con-
fifte en un calice.perfiftantverd-brun, à tube court,
à cinq côtes 6c cinq dents, & en une corolle monopétale
blanche à tube très-court, évafé & découpé
en cinq divifions égales, elliptiques , pointues,
unp fois plus longues que larges, relevées
d’une nervure longitudinale ouverte horizontalement
en étoi'l'e , du milieu du tube de cette corolle
s’élèvent cinq étamines égales, une fois plus coùrtes
qu’elle, à anthères vertes. L’ovaire porte fur un dif-
que applati qui fait corps avec lui : il eft conique,
verd, furmonté d’un ftyle cylindrique blanc, terminé
par un ftigmate hémifphérique, marqué d’un
fillon tranfverfal & velouté.
L’ovaire en mûriffant devient une écorce conique,
élevée , droite, longue d’un fort pouce, une
fois & demie à deux fois moins large, verte d’abord
enfuite jaune dorée ou fafran, liffe, luifante, ne s’ouvrant
point, creufe intérieurement & partagée en
deux loges qui contiennent chacune huit à dix graines
orbiculaires blanchâtres, d’unè ligné & demie
environ de diamètre, ondées ou comme crépues,
attachées droites par deffous leur tranchant fur deux
rangs le long du placenta qui s’élève fur la cloifon
charnue qui partage les deux loges.
Culture. Le capo-molago croît fur la côte du Malabar
dans les terres fablonneufes. Il vit plufieurs
années.
Qualités. L’écorce de fa racine & fon fruit ont
une faveur extrêmement âcre & piquante avec chaleur
; fes feuilles ont un peu d’âcreté mêlée d’amertume.
Ufages. Le fruit de ce piment fe mange comme
celui des autres efpeces ; mâché & retenu quelque
temps entre les dents, il en appaife la douleur;
p ilé , on l ’applique comme un puiffant réfolutif fur
les tumeurs.
Remarque. Le capo-jnolago eft une efpece^de ca-
pficum, qui fe range naturellement dans la famille
des folanons oît nous l’avons placé. Voye% nos
Familles des plantes , volume I I , page 2.18. { M,
A d a n s o n . )
CAPOC , ( Çomm. ) c’eft une efpece de coton fi
fin & fi court, qu’on ne peut le,filer; il eft doux
comme de la foie.-Il eft en ufage dans toutes les
Indes orientales, & parmi les Européens; On en fait
des lits, des matelas-, des couflins ou oreillers, &c.
tous très-bons & très-commodes.;- on s’en fert beaucoup
pour les garnitures des palanquins. Le capoc fe
tire d’une grofle coque ou gouffé qui le renferme
avec plufieurs grains de femence de la groffeur du
poivre : quoique le fruit ou coque qui le donne ne