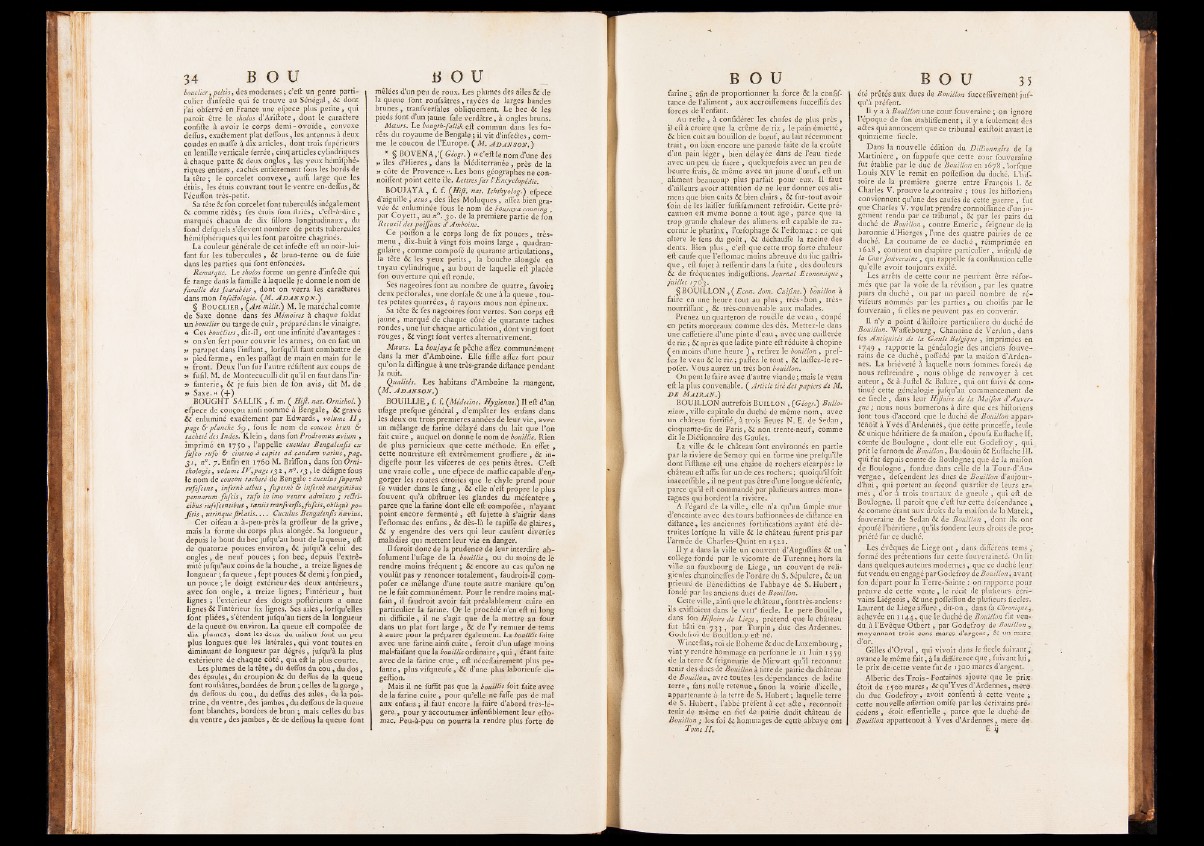
bouclier, peltis, des modernes ; c’eft un genre particulier
d’irifeâe qui fe trouve au Sénégal, &c dont
j’ai obfervé en France une efpece plus petite , qui
paroît être le tholos d’Ariftote t dont le caraftere
çonfifte à avoir le corps demi - o voïde, convexe
deflus, exactement plat deffous, les antennes à deux
coudes en maffe à dix articles, dont trois fupérieurs
en lentille verticale ferrée, cinq articles cylindriques
4 chaque patte & deux ongles , les yeux hémifphé-
riques entiers, cachés entièrement fous les bords de
la tête ; le corcelet convexe, aufli large que les
étliis, les étuis couvrant tout le ventre en-deflus, &
l’écuffon très-petit.
Sa tête & fon corcelet font tuberculés inégalement
& comme ridés; fes étuis fontftriés, c’eft-à-dire,
marqués Chacun de dix filions longitudinaux, du
fond defquels. s’élèvent nombre de petits tubercules
hémifphérjques qui les font paroître chagrinés.
La couleur générale de. cet infe&e eft un noir-lui-
fant fur les tubercules, & brun-terne ou de fuie
dans les parties qui font enfoncées.
Remarque. Le tholos forme un genre d’infefle qui
fe range dans la famille à laquelle je donne le nom de
famille des fcarabées, dont on verra les cara&eres
dans mon Infeçlologie. {M. A d a n s o n .')
§ Bouclier , {Art milit.') M. le maréchal comte
de Saxe donne dans fes Mémoires à chaque foldat
un bouclier pu targede cuir, préparé dans le vinaigre.
« Ces boucliers, dit-il, ont une infinité d’avantages :
» on s’en fert pour couvrir les armes; on en fait un
» parapet dans l’inftant, lorfqu’ii faut combattre de
» pied ferme, en les paffaqt de main en main fur le
» front. Deux l’un fur l’autre réfiftent aux coups de
» fufil. M; de Montecuculli dit qu’il en faut dans l’in-
» fenteriç, & je fuis bien de fon avis, dit M. de ,
» Saxe. » (+ )
BOUGHT SA L LIK, f. m. ( ffijl. nat. Ornithol. )
efpece de couçou ainfi nommé à Bengale, & grave
& enluminé exactement par Edwards, volume I I ,
page & planche 5ÿ , fous le nom de coucou brun &
tacheté des Indes. Kle in , dans fon Prodromus avium ,
imprimé en 1750 , l’appelle cuculus Bengalenjis ex
fufco rufo 6* cinereo à capite ad caudam varias, pag.
j 1, n°. y . Enfin en 1760 M. Briflon, dans fon Ornithologie,
volume IV,page 132 , nq. 13 , le défigne fous
le nom de coucou tacheté de Bengale : cuculus fupernh
rufefcens , infernè albus, fuperhè & infernè marginibus
pennarum fufcis, rufo in imo ventre admixto ; reclri-
cibus rufefcentibus , tamis tranfvcrjts,fufcis, obliqué po-
fitis , utrinque Jtriatis. . . . Cuculus Bengalenjis navius.
Cet oifeau a à-peu- près la groffeur de la grive,
mais la forme du corps plus alongée. Sa longueur,
depuis le bout du bec jufqu’au bout de la queue, eft
de quatorze pouces environ, & jufqu’à celui des
ongles, de neuf pouces ; fon bec, depuis l’extrémité
jùfqu’aux coins de la bouche, a treize lignes de
longueur ; fa queue , fept pouces & demi ; fon pied,
un pouce ;.le doigt extérieur des deux antérieurs,
avec fon ongle, a treize lignes ; l’intérieur, huit
lignes ; l’extérieur des doigts poltérieurs a onze
lignes & l’intérieur lix lignes. Ses ailes, lorfqu’elles
font pliées, s’étendent jufqu’au tiers de la longueur
de la queue ou environ. La queue eft compofée de
dix plumes, dont les deux du milieu font un peu
plus longues que les latérales, qui vont toutes en
diminuant de longueur par dégres, jufqu’à la plus
extérieure de chaque cô té , qui eft la plus courte.
Les plumes de la tête, du deflus du cou , du dos,
des épaules, du croupion & du deflus de la queue
font roufsâtres, bordées de brun ; celles de la gorge ,
du deffous du cou, du deflus des ailes, de la poitrine
, du ventre, des jambes, du deflous de la queue
font blanches, bordées de brun ; mais celles du bas
du ventre, des jambes, & de deffous la queue font
mêlées d’un peu de roux. Les plumes des ailes & de
la queue font roufsâtres, rayées de larges bandes
brunes, tranfverfales obliquement. Le bec & les
pieds font d’un jaune fale verdâtre, à ongles bruns.
' Moeurs. Le bougth-fallik eft commun dans les forêts
du royaume de Bengale.; il vit d’infeiles, comme
le coucou de l’Europe. ( M. A d a n son.)
* § BOVENA ,!( Géogr.) « c ’eft le nom d’une des
» îles d’Hieres, dans la Méditerranée ,. près de la
» côte de Provence ». Les bons géographes ne con-
noiffent point cette île. Lettres fur ü Encyclopédie.
BOUJAYA, f. f. {Hiß. nat. Ichthyolog.) efpece
d’aiguille , acus, des îles Moluques , affez bien gravée
& enluminée fous le nom de boujaya couning,
par C o y e tt , au n°. 30. de la première partie de fon
Recueil des poijfons d'Amboine.
Ce poiffon a le corps long de fix pouces, très-
menu , dix-huit à vingt fois moins large , quadran-
gulaire, comme compofé de quarante articulations ,
la tête & les yeux petits, la bouche alongée en
tuyau cylindrique , au bout de laquelle eft placée
fon ouverture qui eft ronde.
Ses nageoires font au nombre de quatre, favoir;
deux pectorales, une dorfale & une à la queue, toutes
petites quarrées, à rayons mous non épineux.
Sa tête & fes nageoires font vertes. Son corps eft
jaune, marqué de chaque côté de quarante taches
rondes, une fur chaque articulation, dont vingt font
rouges, & vingt font vertes alternativement.
Moeurs. La boujaya fe pêche affez communément
dans la mer d’Amboine. Elle fiffle affez fort pour
qu’on la diftingue à une très-grande diftance pendant
la nuit.
Qualités. Les habitans d’Amboine la mangent,
{M. A d a n so n . )
BOUILLIE , f. f. {Médecine. Hygienne.) Il eft d’un
ufage prefque général, d’empâter les enfans dans
les deux ou trois premières années de leur v ie , avec
un mélange de farine délayé dans du lait que l’on
fait cuire , auquel on donne le nom de bouillie. Rien
de plus, pernicieux que cette méthode. En effet ,
cette nourriture eft extrêmement grofîiere, & iri-
digefte pour les vifceres de ces petits êtres. C’eft
une vraie co lle , une efpece de maftic capable d’engorger
les routes étroites que le chyle prend pour
fe vuider dans le fang , & elle n’eft propre le plus
fouvent qu’à obftruer les glandes du méfentere ,
parce que la farine dont elle eft compofée , n’ayant
point encore fermenté, eft fujette à s’aigrir dans
l’eftomac des enfans, & dès-là le tapiffe de glaires,
& y engendre des vers qui leur caufent diverfes
maladies qui mettent leur vie en danger.
Il feroit donc de la prudence de leur interdire ab-
folument l ’ufage de la bouillie, ou du moins de le
rendre moins fréquent ; & encore au cas qu’on ne
voulût pas y renoncer totalement, faudroit-il com-
pofer ce mélange d’une toute autre maniéré qu’on
ne le feit communément. Pour le rendre moins mal-
fain, il faudroit avoir fait préalablement cuire en
particulier la farine. Or le procédé n’en eft ni long
ni difficile, il ne s’agit que de la mettre au four
dans un plat fort large, & de l’y remuer de tems
à autre pour la préparer également. La bouillie faite
avec une farine ainfi cuite , feroit d’un ufage moins
mal-feifant que la bouillie ordinaire, qui étant faite
avec de la farine cru e, eft néceffairement plus pe-
fante, plus vifqueufe, & d’une plus laborieufe di-
geftion.
Mais il ne fuffit pas que la bouillie foit faite avec
de la farine cuite , pour qu’elle ne falle pas de mal
aux enfans ; il faut encore la faire d’abord très-lé-
gere,, pour y accoutumer infenfiblement leur efto-
mac. Peu-rà-peu on pourra la rendre plus forte de
farine afin de proportionner la force & la cbnfif-
tance de l’aliment, aux accroiffemens fucceflifs des
forces de l’enfant.
Au refte , à confidérer les chofes de plus près ,
il eft à croire que la crème de riz , le pain émietté ,-
& bien cuit au bouillon de boeuf, au lait récemment
tra it, ou bien encore une panade faite de la croûte
d’un pain léger, bien délayée dans de l’eau tiede
avec un peu de fucre , quelquefois avec un peu de
beurre frais, & même avec un jaune d’oeuf, eft un
aliment beaucoup plus parfait pour eux. Il faut
d’ailleurs avoir attention de ne leur donner ces ali-
mens que bien cuits & bien clairs , & fur-tout avoir
♦ foin de les làiffer fuffifamment refroidir. Cette précaution
eft même bonne à tout âg e, parce que la
trop grande chaleur des alimens eft capable de racornir
le pharinx, l’oefophage & l’eftomac : ce qui
altéré le fens du g o û t, & déchauffe la racine des
dents. Bien plus , c’eft que cette trop forte chaleur
eft caufe que l’eftomac moins abreuvé du fuc gaftri-
que , eft fujet à reffentir dans la fuite , des douleurs
& de fréquentes indigeftions. Journal Economique ,
juillet tyCy.
§ BOUILLON, ( Econ. dom. Cuijine.) bouillon à
faire en une heure tout au p lus, très-bon, très-
nourriffant, & très-convenable aux malades.
Prenez un quarteron de rouelle de veau , coupé
en petits morceaux comme des dés. Mettez-le dans
une caffetiere,d’une pinte d’eau , avec une cuillerée
‘de riz ; & après que ladite pinte eft réduite à chopine
( en moins d’une heure ) , retirez le bouillon, pref-
lez le veau & le riz ; paffez le tou t, & laiffez-le re-
pofer. Vous aurez un très-bon bouillon.
On peut le faire avec d’autre viande ; mais le veau
eft la plus convenable. ( Article tiré des papiers de M.
D E Ma IRAN. )
BOUILLON autrefois Buillon , {Géogr.) Bullo-
nium, ville capitale du duché de même nom, avec
un château fortifié, à trois lieues N. E. de Sedan,
cinquante-fix de Paris, & non trente-neuf, comme
dit le Di&ionnaire des Gaules.
La ville & le château font environnés en partie
par la riviere de Semoy qui en forme une prefqu’île
dont l’ifthme eft une chaîne de rochers efcarpés : le
château eft aflis fur un de ces rochers ; quoiqu’il foit
inacceffible, il ne peut pas être d’une longue défenfe,
parce qu’il eft commandé.par plufieurs autres montagnes
qui bordent la riviere.
A l’égard de la v ille, elle n’a qu’un fimple mur
d’enceinte avec des tours baftionnées de diftance en
diftance, les anciennes fortifications ayant été détruites
lorfque la ville & le château furent pris par
l’armée de Charles-Quint efi 15.21.
Il y a dans la ville un couvent d’Auguftins & un
college fondé par le vicomte de Turenne; hors la
ville au fauxbourg de Liege, un couvent de reli-
gieufes chanoineffes de l’ordre du S. Sépulcre, & un
prieuré de Bénédiftins de l’abbaye de S. Hubert,
fondé par les anciens ducs de Bouillon.
Cette ville, ainfi que lé château, font très-anciens : j
ils exiftoieot dans le vm e fiecle. Le pere Bouille, |
dans fon Hifioire de Liege, prétend que le château-
fut bâti en.733 , par Turpin, duc des Ardennes.
Godefroi de Bouillon .y eft né.
ij Winceftas, roi de Boheme & duc de Luxembourg,.
vint y rendre hommage en perfonne le 11 Juin 1359
de la terre & feigneurie de Mirwart qu’il reconnut
tenir des ducs de Bouillon à titre de pairie du château
de Bouillon, avec toutes les dépendances de ladite
terre, fans nulle retenue , finon la voirie d’icelle,
appartenante à la terre de S. Hubert ; laquelle terre
dé S. Hubert, l’abbé préfent à cet a&e , reeonnoît
tenir de même en .fief de pairie dudit château de
Bouillon ; les foi & hommages de cett'e abbaye ont
Tome II.
été prêtés aux ducs de Bouillon fuccefîîvemeiit juf*
qu’à préfent.
11 y à à Bouillon une cour fotiveraine ; on ignoré
l ’époque de fon établiffement ; il y a feulement des
aêtes qui annoncent que ce tribunal exiftoit avant lé
quinzième fiëcle.
Dans la nouvelle édition dû Dictionnaire de \i
Martiniere, on fuppofe que cette cour fouVeraine
fut établie par le duc de Bouillon en 1678 , lorfque
Louis X IV le remit en poffeflion du duché. L’hif-
toire de la première guerre entre François I. &
Charles V. prouve le>eontraire ; tous les hiftoriens
conviennent qu’une des caufes de cette guerre, fut
que Charles V. voulut prendre connoiffance d’un jugement
rendu par ce tribunal,' & par les pairs du
duché de Bouillon, contre Emeric -, feigneur de là
baronnie d’Hierges, l’une des quatre pairies de ce
duché. La Coutume de ce duché, réimprimée en
1628 , contient un chapitre particulier , intitulé de
la Cour Joùveraine, qui rappelle fa conftitution telle
qu’elle avoit toujours exifté.
Les arrêts de cette cour ne peuvent être réformés
que par la voie de la rëvifion, par les quatre
pairs du duché, ou par un pareil nombre de ré-
vifeurs nommés par les parties, ou choifis par le
fôuverain , fi elles ne peuvent pas en convenir.
Il n’y a point d’hiftoire particulière du duché de
Bouillon. Waffebourg, Chanoine de Verdun , dans
fes Antiquités de la Gaule Belgique , imprimées en
1749 , rapporte la généalogie des anciens fouve-
rains dé ce duché, poffédé par la maifon d’Ardennes.
La brièveté à laquelle nous fommes forcés de
nous reftreindre , nous oblige de renvoyer à cet
auteur, & à-Juftel & Baluze, qui ont fuivi & continué
cette généalogie jufqu’au commencement de
ce fiëcle , dans leur Hifioire de la Maifon d'Auvergne
; nous nous bornerons à dire que ces hiftoriens
font tous-d’accord que le duché de Bouillon appar-
tenoit à Yves d’Ardennes, que cette princeffe, feule
& unique héritière de fa maifon, époufa Euftache II.
comte de Boulogne , dont elle eut Godefroy, qui
prit le furnom de Bouillon, Baudouin & Euftache III.
qui fut depuis comte de Boulogne ; que de la maifon
de Boulogne , fondue dans celle de la Tour-d’Auvergne
, defeendent les ducs de Bouillon d’aujourd’hui
, qui portent au fécond quartier de leurs armes
, d’or à trois tourtaux de gueule , qui eft de
Boulogne. Il paroît que c’eft fur cette defcendance ,
& comme étant aux droits de la maifon de la Marck,
fouveraine de Sedan & de Bouillon , dont ils ont
époufé l’héritiere, qu’ils fondent leurs droits de propriété
fur ce duché.
Les évêques de Liege o n t , dans1 différens tems
formé des prétentions fur cette fouveraineté. On lit
dans quelques auteurs modernes, que ce duché leur
fut vendu ou engagé par Godefroy de Bouillon, avant
fon départ pour la Terre-Sainte : on rapporte pour
preuve de cette vente, le récit de plufieurs écrivains
Liégeois, & une poffeflion de plufieurs fiécles.
Laurent de Liege affure, dit-on,, dans: fa Chronique,
achevée en 1 144 , que le duché de Bouillon fut vendu
à l’Evêque Otb ert, par Godefroy de Bouillon,
moyennant trois cens marcs d’argent, & un marc
d’or.
Gilles d’Orv al, qui vivoit dans le fiecle fuivant
avance le même fait, à la différence que, fuivant lui,
le prix de>cette vente fut de 1300 marcs d’argent.
Alberic des Trois - Fontaines ajoute que le prix
étoit de 150b marcs , & qu’Yves d’Ardennes, mere
du duc Godefroy, avoit confenti à cette vente ;
cette nouvelle affertion omife par les écrivains préc
é d e r , étoit effentielle , parce que le duché de
Bouillon appartenoit à Yves d’Ardennes, mere de.