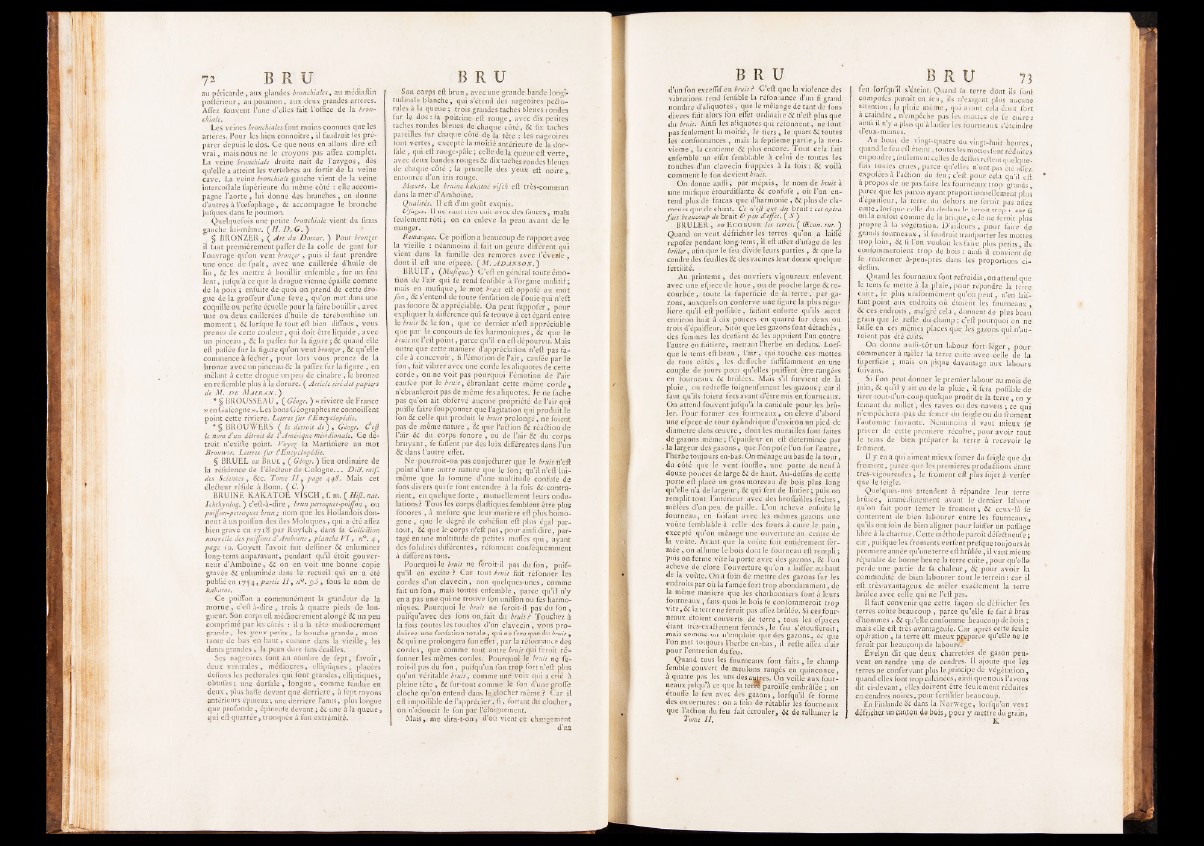
au péricarde , aux glandes bronchiales, au médiaftin
poftérieur, au poumon, aux deux grandes arteres.
Affez fouvent l’une d’elles fait l’office de la bronchiale.
Le$ veines bronchiales font moins connues que les
artères. Pour les bien connoître, il faudroit les préparer
depuis le dos. Ce que nous en allons dire eft
v ra i, mais nous ne le croyons pas affez complet.
La veine bronchiale droite naît de l’azygos, dès
qu'elle a atteint les vertebres au fortir de la veine
cave. La veine bronchiale gauche vient de la veine
intercoftale fupérieure du même côté : elle accompagne
l’aorte, lui donne des branches, en donne
d’autres à l’oefophage, & accompagne le bronche
jufques dans le poumon.
Quelquefois une petite bronchiale vient du lirius
gauche lui-même. ( H. D . G. )
§ BRONZER , ( Art du Doreur. ) Pour bronzer
il faut premièrement paffer de la colle de gant fur
l’ouvrage qu’on veut bronzer, puis il faut prendre
une once de fpalt, avec une cuillerée d’huile de
lin , 6c les mettre à bouillir enfemble, fur un feu
lent, jufqu’à ce que la drogue vienne épaiffe comme
de la poix ; enfuite de quoi on prend de cette drogue
de la groffeur d’une fe v e , qu’on met dans une
coquille ou petite écuelle pour la faire bouillir, avec
une ou deux cuillerées d’huile de térébenthine un
moment ; 6c lorfque le tout eft bien diffoüs , vous
prenez de cette couleur, qui doit être liquide , avec
un pinceau , 6c la paffez lur la figure ; 6c quand elle
eft paffée fur la figure qu’on veut bronzer, 6c qu’ elle
commence à fécher, pour lors vous prenez de la
bronze avec un pinceau 6c la paffez fur la figure , en
mêlant à cette drogué un peu de cinabre , le bronze
en reffemble plus à la dorure. ( Article tirédespapiers
de M. d e Ma ir a n . )
* § BROUSSEAU, ( Géogr. ) « ri viere de France
»enGafcogne». Les bons Géographes ne connoiffent
point cette riviere. Lettres fur Ü Encyclopédie.
* % BROU WERS ( le détroit de ) , Géogr. Ceft
le nom et un détroit de tAmérique méridionale. Ce détroit
n’exifte point. Voye^ la Martiniere au mot
Brouwer. Lettres fur tEncyclopédie.
§ BRUEL oïi Brul , ( Géogr. ) lieu ordinaire de
la réfidence de l’élefteur de-Cologne.. . Dicl.raif.
des Sciences , &c. Tome I I , page 448. Mais cet
éleûeur réfide à Bonn. ( C. ) ’
BRUINE K A K A TO E VISCH , f. m. ( Hiß.nat.
Ichthyolog. ) c’eft-à-dire,, brun perroquet-poiffon , ou
poiffon-perroquet brun ; nom que les Hollandois donnent
à un poiffon des îles Moluques, qui a été affez
bien gravé en 1718 par Ru yfch, dans fa Collection
nouvelle des poiffons d'Amboine, planche V I , n°. 4 ,
page 10. Coyett l’avoit fait deffiner 6c enluminer
Iong-tems auparavant, pendant qu’il étoit gouverneur
d’Amboine, 6c on en voit une bonne copie
gravée 6c enluminée dans le recueil qui en a été
publié en 1754, partie / / , n^. § 5 , fous le nom de
kakatoe.
Ce poiffon a communément la grandeur de la
morue , c’ eft à-dire , trois à quatre pieds de longueur.
Son corps eft médiocrement alongé & un peu
comprimé par les côtés : il a la tête médiocrement
grande, les yeux petits, la bouche grande, montante
de bas en haut, comme dans la vieille, les
dents grandes , la peau dure fans écailles.
Ses nageoires font au nombre de fept; favoir,
deux ventrales , médiocres, elliptiques, placées
deffous lespeûorales qui font grandes, elliptiques,
obtufes ; une dorfale , longue, comme fendue en
deux, plus baffe devant que derrière , à fept rayons
antérieurs épineux ; une derrière l’anus, plus longue
que profonde , épineufe devant ; 6c une à la queue,
qui eft quarrée, tronquée à fon extrémité.
Son corpis eft brun, avec une grande bande longitudinale
blanche, qui s’étend des nageoires pectorales
à la queue ; trois grandes taches bleues rondes
lur le dps : la poitrine, eft rouge, avec dix petites
taches rondes bleues de chaque côté, 6c fix taches
pareilles fur chaque côté de la tête : les nageoires
font vertes, excepte la moitié antérieure de la dorfale
, qui eft rouge-pâle; celle de la queue eft verte,
avec deux bandes rouges & dix taches rondes bleues
de chaque côté ; la prunelle des yeux eft noire •
entourée d’un iris rouge.
Moeurs. Le bruine kakatoe vifeh eft très-commun
dans la mer d’Amboine.
Qualités. Il eft d’un goût exquis.
Ufages. Il ne vaut rien cuit avec des fauces, mais
feulement rôti; on en enleve la peau avant de le
manger.
Remarque. Ce poiffon a beaucoup de rapport avec
la vieille : néanmoins il fait un genre différent, qui
vient dans la famille des remores avec l’évewfe ,
dont il eft une efpece. ( M. A d a n s o n . )
BR U IT , (.Mufique.) C ’eft en général toute émotion
de l’air qui fe rend fenfible à l’organe auditif;
mais en mufique, le mot bruit eft oppofé au mot
fo n , 6c s’entend de toute fenfation de i’ouie qui n’eft
pas fonore 6c appréciable. On peut fuppofer,. pour
expliquer la différence qui fe trouve à cet égard entre
1 s bruit'El le fon, que ce dernier n’eft appréciable
que par le concours de fes harmoniques, 6c que le
bruit ne l’eft point, parce qu’il en eft dépourvu. Mais
outre que cette maniéré d’appréciation n’eft pas facile
à concevoir, fi l’émotion de l’air, caufée par le
fon, fait vibrer avec une corde les aliquotes de cette
corde, on ne voit pas pourquoi l’émotion de l’air
caufée par le bruit, ébranlant cette même corde §
n’ébranleroit pas de même fes aliquotes. Je ne fâche
pas qu’on ait obfervé aucune propriété de l’air qui
puiffe faire foupçonner que l’agitation qui produit le
fon 6c celle qui produit le bruit prolongé, ne foient
pas de même nature, 6c que BaCtion & réaCtion de
l’air 6c du corps fonore , ou de l’air 6c du corps
bruyant, fe faffent par des loix différentes dans l’un
6c dans l’autre effet.
Ne pourroit-on pas conjeCturer que le bruit n’efl:
point d’une autre nature que le fon; qu’il n’eft lui*
même que la fomme d’une multitude confufe de
fons divers qui fe font entendre à la fois &-contra-
rient, en quelque forte, mutuellement leurs ondulations?
Tous les corps élaftiques femblent être plus
fonores , à mefure que leur matière eft plus homogène
, que le dégré de cohéfion eft plus égal partout
, 6c que le corps n’eft pas, pour ainfi dire, partagé
en une multitude de petites maffes qui, ayant
des folidités différentes, réfonnent conféquemment
à différens tons.
Pourquoi le bruit ne reroit-il pas du fon, puif-
qu’il en excite ? Car tout bruit fait réfonner les
cordes d’un clavecin, non quelques-unes, comme
fait un fon, mais toutes enfemble , parce qu’il n’y
en a pas une qui ne trouve fon uniffon ou fes harmoniques.
Pourquoi le bruit ne feroit-il pas du fon ,
puifqu’avec des fons on.fait du bruit ? Touchez à
la fois toutes les touches d’un clavecin , vous produirez
une fenfation totale, qui ne fera que du bruit,
6c qui ne prolongera fon effet, par la rélonnance des
cordes, que comme tout autre bruit qui feroit réfonner
les mêmes cordes. Pourquoi le bruit ne feroit
il pas du fon , puifqu’un fon trop fort n’eft plus
qu’un Véritable bruit, comme une voix qui a crié à
pleine tête , 6c fur-tout comme le fon d’une groffe
cloche qu’on entend dans le.clocher même ? Car il
eft impoffible de l’apprécier, f i , fortant du clocher,
on n’adoucit le fon par l’éloignement.
Mais,, me dira-t-on, d’oit vient ce changement
d’un
d’un fon exceflif en bruit t C ’ eft que la violence des
vibrations rend fenfible la réfonnance d’un fi grand
nombre d’aliquotes, que le mélange de tant de fons
divers fait alors fon effet ordinaire & n’eft plus que
du bruit. Ainfi les aliquotes qui réfonnent , ne font
pas feulement la moitié, le tiers , le quart & toutes
les copfonnances ,. mais la feptieme partie, la neuvième
, la centième & plus encore. Tout cela fait
enfemble un effet femblable à celui de toutes les
touches d’un clavecin frappées à la fois : 6c voilà
comment le fon devient bruit.
On donne ajuffi, par mépris, le nom de bruit à
une mufique étourdiflante oc confufe , où l ’on entend
plus de fracas que d’harmonie , & plus de clameurs
que.de chant. Ce n'ejl que du bruit : cet opéra
fait beaucoup de bruit & peu d'effet. ( S~)
BRULER, ou ECOBUER les terres. ( OEcon. rur.J
Quand on veut défricher les terres qu’on , a laifle
repofer pendant long-tems, il eft allez d’ulage de les
brûler, afin que le feu divife leurs parties , & que la
cendre dès feuilles 6c des racines leur donne quelque
fertilité. •
Au printems, des ouvriers vigoureux enlevent,
avec une efpece de houe, ou de pioche large 6c recourbée
,, toute la fuperficie de la terre, par galons,
auxquels on conferve une figure la plus régulière
qu’il eft poffible, faifant enlorte qu’ils aient
environ huit à dix pouces en quarré fur deux ou
trois d’épaiffeur. Sitôt que les gazons font détachés ,
des femmes les dreffent 6c les appuient l’un contre
l ’autre en faitiere, mettant l’herbe en dedans.. Lorfque
le tems eft beau , l’air , qui touche, ces-mottes
de tous côtés , les defl’eche fuffifamment en une
couple de jours pour: qu’elles puiffent être rangées
en fourneaux 6c brûlées. Mais s’il furvient de la
pluie, on redreffe foigneufement les:gazons; car il
faut qu’ils foient fecs avant d’être mis en fourneaux.
On attend fouvent jufqu’à la canicule pour les brûler.
Pour former ces fourneaux, on éleve d’abord
une efpece de tour cylindrique d’environ un pied de
diamètre dans oeuvre, dont les murailles font faites
de gazons même; l’épaiffeur en eft déterminée par
la largeur des gazons, que l’on pofe l’un fur l’autre,
l’herbe toujours en-bas. On ménage au bas de la tour,
du côté que le vent fouffle, une porte de neuf à
douze pouces de large 6c de haut. Au-deffus de cette
porte eft placé un gros morceau de bois plus long
qu’elle n’a de largeur, 6c qui fert de Entier; puis on
remplit tout l’intérieur avec des broffailles lèches,
mêlées d’un peu de paille.. L’on achevé ènfuite le
fourneau, en faifant avec les mêmes gazons une
voûte femblable à celle’ des foqrs à ;cuire le pain,
excepté qu’on ménage une ouverture au centre de
la voûte. Avant que la voûte foit entièrement fermée
, on allume le bois dont le fourneau eft rempli;
puis on ferme vîte la porte avec des gazons, & l’on
achevé de clore l’ouverture qu’on a laiffée au haut
de la voûte. On a foin de mettre des gazons fur les
endroits par où la fumée fort trop abondamment, de
la même maniéré que les charbonniers font à leurs
fourneaux » fans quoi le bois fe confommeroit trop
vîte, & la terre ne feroit pas allez brûlée. Si ces fourneaux
étoient couverts, de terre , tous les elpaces
étant très-exaCtement fermés, le feu s’étouffèroit ;
mais comme on n’emploie que des gazons, & que
l’on met toujours l’herbe en-bas, il refte affez d’air
pour l’entretien du feu.
Quand tons les fourneaux font faits , le champ
femble couvert de mettions rangés en quinconce,
à quatre pas les uns des autres. On veille aux fourneaux
jufqu’à ce que la terré paroiffe embrâfée ; on
étouffe le feu avec des gazons, lorfqu’il fe forme
des ouvertures : on a foin de rétablir les fourneaux
que l’a&ion du feu fait écrouler, & de rallumer le
Tome II,
feu lorfcjlt’il s*éteint. Quand la terre dont ils font
! compofés paroît en. feu, ils n’exigent plus aucune
, attention; la pluie même, qui avant cela étoit fort
à craindre, n’empêche pas.les mottes de fe cuire t
amli il n’y a plus qu’à laiflèr les fourneaux s’éteindre
d eux-mêmes.
Au bout de vingt-quatre Ou vingt-huit heures,
quand le feu eft eteint, toutes les mottes font réduites
en poudre ; feulement celles de deffus reftent quelquefois
toutes crues, parce qu’elles n’ont pas été affez
expofées à l’aCtion du feu ; c’eft pour cela qu’il eft
à propos de ne pas faire les fourneaux trop grands,
Parce q»e les parois ayant proportionnellement plus
d’épaiflèur, la terre du dehors ne feroit pas allez
cuite, lorfque celle du dedans le feroit trop : car fi
onia cuifoit comme de la brique, eile ne feroit plus
propre à la végétation. D'ailleurs , pour faire de
grands fourneaux , il faudroit tranfporter les mottes
trop loin, ôc fi Ion vouloit les faire plus petits, ils
confommeroient trop de bois: ainfi il convient de
fe renfermer à-peu-près dans les proportions eide
fliis.
Quand les fourneaux font refroidis, on attend que
le tems.fe mette à la pluie, pour répandre la terre
cuite, le plu$ uniformément qu’on peut, n’en laif-
fiint point aux endroits où étoient les fourneaux,
6c ces endroits, malgré cela , donnent de plus beau
grain que le refte du champ : c’eft pourquoi on rie
laifle en ces mêmes’p}acés.que les gazons qui n’aii-
roient pas été'cuits.- " v‘
On donne aufli-tôt un labour fort-léger, pour
Commericer à mêler la terre cuife.-avee cellé de la
fi,iperficie ; mais on pique davantage aux labours
fuivâris»
Si l’on peut donner le premier labour ait mois dé
juin, & qu’il y ait eu de la pluie, il fera poffible de
tirer tout-d’un-coup quelque profit de la ferre, en y
femant du millet, des raves ou des navets ; ce qui
n’empêçhera .pas de femer du feigle ou du froment
1 automne fuivante. Néanmoins il vaut mieux fe
priver de Cette première récolte, pour avoir tout
Je tems de bien préparer la terre à recevoir le
froment.
11 y en à qui aiment mieux femer du feigle que du
froment, parce que les premières productions étant
très-vigoureufes , le froment eft plus fujet à ver fer
que le feigle.
Quelques-uns attendent à répàridfe leur terre
brûlée, immédiatement avant le dernier labour
qu’on fait pour femer le froment ; 6c ceux-là fe
contentent de bien labourer entre les fourneaux,
qu’ils ont foin de bien aligner pour laiffer un paflàge
libre à la charrue. Cette méthode paroît défeéhieufe ;
car, puifque les froments verfent prefque toujours la
première année qu’une terre eft brûlée, il vaut mieux-
répandre de bonne heure la terre cuite, pour qu’elle
perde une partie de fa chaleur, 6c pour'avoir la
comrtiodité de bien labourer tout le terrein : car il
eft très-avantageux de mêler exactement la terre
brûlée avec celle qui ne l’eft pas.
Il faut convenir que cette, façon de défricher lés
terres coûte beaucoup , parce qu’elle fe fait à bras
d’hommes , 6c qu’elle confomme beaucoup de bois ;
mais elle eft très-avantageufe. Car après cette feule
opération , la terre eft mieux préparée qu’elle ne le
feroit par beaucoup de labours.
Evelyn dit que deux charretées de gazon peuvent
en rendre une de cendres. 11 ajoute que les
terres ne confervant plus le principe de végétation,
quand elles font trop calcinées, ainfi que nous l’avons
dit ci-devant, elles doivent être feulement réduites
en cendres noires, pour fertilifer beaucoup.
En Finlande Sc dans la No.rwege, lorfqu’on veut
défricher un çantçn de bois, pour y mettre du grain,