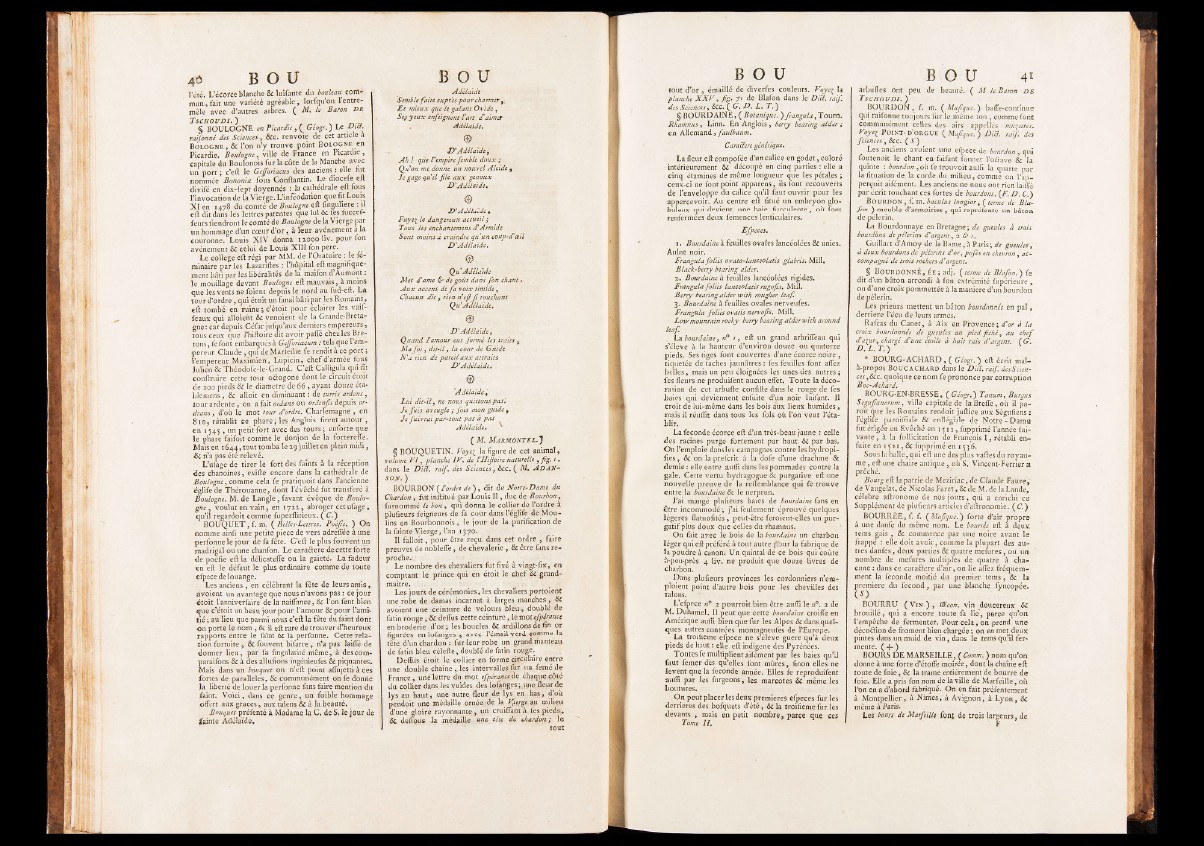
l’été. L’écofce blanche & luifante du bouleau^ commun,
fait une variété agréable, lorfqu’on l’entremêle
avec d’autres arbres. ( M. le Baron d e
T s c h o u d i .')
§ BOULOGNE en Picardie , ( Géogu) Le Dicl.
raifonnè des Sciences, &c. renvoie de cet article à
Bologne , & l’on n’y trouve point Bologne en
Picardie. Boulogne, ville de France en Picardie,
capitale du Boulonois fur la côte de la Manche avec
un port ; c’eft le Geforiacus des anciens : elle fut
nommée Bononia fous Conftantin. Le diocefe eu
divifé en dix-fept doyennés : la cathédrale eft fous
l’invocation de la Vierge. L’inféodation que fit Louis
XI en 1478 du comté de Boulogne eft finguliere : il
eft dit dans les lettres patentes que lui ôç fes fuccef-
feurs tiendront le comté de Boulogne de la Vierge par
un hommage d’un coeur d’o r , à leur avènement à la
couronne. Louis X IV donna 12000 liv. pour fon
avènement & celui de Louis XIII fon pere.
Le college eft régi par MM. de l’Oratoire : le fe-
minaire par les Lazariftes : l’hôpital eft magnifiquement
bâti par les libéralités de la maifon d’Aumont :
le mouillage devant Boulogne eft mauvais, à,moins
que les vents ne foient depuis le nord au fud-eft. La
tour d’ordre, qui étoit un fanal bâti par les Romains,
eft tombé en ruine ; c’étoit pour éclairer, les vaif-
feaux qui alloient & venoient de la Grande-Bretagne:
car depuis Céfar jufqu’aux derniers empereurs,
tous ceux que l’hiftoire dit avoir paffe chez les Bretons
, fe font embarqués à,Gejforiacum : tels que l’empereur
Claude, qui de Marieille fe rendit à ce port ;
l’empereur Maximien', Lupicin, chef d’armee fous
Julien & Théodofe-le-Grand. C’eft Callrgula qui fit
conftruire cette tour oftogone dont le circuit étoit
de 200 pieds & le diamètre de 66 , ayant douze età*
blemens , & alloit en diminuant : de turris ardens,
tour ardente j^on a fait or dans ou ordenjis depuis or-
drans, d’où le mot tour £ ordre. Charlemagne , en
8 10 , rétablit ce phare ; les Anglois firent autour ,
en 1545 , un petit fort avec des tours ; enforte que
le phare faifoit comme le donjon de la fortereffe.
Mais en 1644, tout tomba le 29 juillet en plein midi,
& n’a pas été relevé.
L’ufage de tirer le fort des faïnts à la réception
des chanoines, exifte encore dans la cathédrale de
Boulogne, comme cela fe pratiquoit dans i ’ancienne
églife de Thérouanne, dont l’évêché fut transféré à
Boulogne. M. de Langle, favant évêque de Boulogne
, voulut en vain, en 172 2 , abroger cet ufage,
qu’il regardôit comme fuperftitieux. ( C.')
BO U Q U E T , f. m. { B elles-Lettres. Poéjie.) On
nomme ainfi une petite piece de vers adreffée à une
perfonne le jour de fa fête. C ’eft le plus fouvent un
madrigal ou une chanfon. Le carattere de cette forte
de poéfie eft la délicateffe ou la gaieté. La fadeur
en eft le défaut le plus ordinaire comme de toute
efpece de louange.
Les anciens , en célébrant la fête de leurs artfis,
avoient un avantage que nous n’avons pas : ce jour
étoit l’anniverfaire de la naiffance, & l’on fent bien
que c’étoit un beau jour pour l’amour & pour l’ami*
tié ; au lieu que parmi nous c’eft la fête du faint dont
on porte le nom , & il eft rare de trouver-d’heureuk
rapports entre le faint & la perfonne. Cette relation
fortuite , & fouvent bifarre, n’a pas: laiâè- de
donner lieu, par fa fingularité même, à descomr
paraifons & à des allufions ingénieufes & piquantes;
Mais dans un bouquet on n’ eft point affujetti à Ces
fortes de parallèles, & communément onfe donne
la liberté de louer la perfonne fans faire mention du
faint. V o ic i, dans ce genre, un foible hommage
offert aux grâces, aux talens & à la beauté.
Bouquet préfenté à Madame la C . de S. le jour de
fainte Adélaïde,
Adélaïde
Semble faite exprès pour charmer
E t mieux que le galant Ovide ,
Stf yeux enfeignent l'art d'aimer
Adélaïde.
é
D'Adélaïde,
Ah ! que l'empire femble doux ;
Qu'on me donne un nouvel Alcide %
Je gage qu'il file aux genoux-
D'Adélaïde.
D'Adélaïde ,
Fuye^ le dangereux accueil ;
Tous les enchantemens d? Armide
Sont moins à craindre qu'un coup-cCoeil
D'Adélaïde.
; '©,■
Qu Adélaïde
Met ddame & de goût dans fon chant t
A u x accens de fa voix timide ,
Chacun dit, rien n'efl J ï touchant
Qu' Adélaïde.
é
D'Adélaïde ,r
Quand t amour eut formé les traits %
Ma fo i , dit-il, la cour de Gnide
N'a rien de pareil aux attraits
D'Adélaïde* ,
® -
’Adélaïde é
Lui dit-il, ne nous quittons pas'.
J e fuis aveugle ; fois mon guide ,
Je fuivrai par-tout pas a pas
Adélaïde. '
( M. M ARMONT EL.*)
§ BOUQUETIN. Foye^ la figure de cet animal,
volume F l , planche IF . de CHijtoire naturelle ,fig. 1.
dans le Dicl. raif. des Sciences& c . ( M. A d AN-
s o n . )
BOURBON ( tordre de ) , dit dé Notre-Dame du
Chardon, fut inftitué par Louis I I , duc de Bourbon,
furnommé le bon, qui donna le collier de l’ordre a
plufieurs feigrieurs de fa cour dans l’églife de Moulins
en Bourbonnois, le jour de la purification de
la fainte Vierge, fan 1370.
Il falloit, pour être reçu dans cet ordre , faire
preuves de nobleffe, de chevalerie, & être ians reproche..,:
:: :/. : r
Le nombre des chevaliers, fut fixé à vingt-fix, en
comptant le prince qui en étoit le chef 6c grand-
maître. # -
Les jours de cérémonies, les chevaliers portpient
une robe de,damas incarnat à larges manches, &
avoient une ceinture de velours bleu;, doublé de
fatin rouge , & deffus, cette ceinture, le motlefpérancc
en broderie, d’or, ; les boucles &. ardillons de fin or
figurées en lofariges j avec l’émail verd çoinme la
tête d’un chardon: fur leur .robe un grand manteau
de fatin bleu célefte, doublé de fatin rouge.
Deffus étOit le collier en forme circulaire entre
une double chaîne ,, les intervalles fur un femé de
France , unélettre du mot tfpérance de chaque çôté
du collier dans les vuides. des lo(anges ;,upe; fleur de
lys au haut, une autre, fleur de lys,en,.bas, d’où;
pendoit une médaille ornée^de la Fjefge au milieu
d’une gloire rayonnante -, un croiffant à, fes pieds ,
& defious la médaille une tête de chardon i le
tout
tout d’or , émaillé de diverfes couleurs. Foye^ la
planche X X F , fig. 7/ de Blafon dans le Dicl. raif.
des Sciences, &C. ( G. D. L. T .)
§ BOURDAINE, ( Botanique. ) frangula,T ourn.
Rhamnus, Linn. En Anglois, berry bearing aider ;
en Allemand , faulbaum.
Caractère générique.
La fleur eft compofée d’un calice en godet, coloré
intérieurement & découpé en cinq parties : elle a
cinq étamines de même longueur que les pétales ;
ceux-ci ne font point apparens, ils font recouverts
de l’enveloppe du calice qu’il faut ouvrir pour les
appercevoir. Au centre eft fitué un embryon globuleux
qui devient une baie fucculente, où font
renfermées deux femences lenticulaires.
Efpeces.
1. Bourdaine à feuilles ovales lancéolées & unies.
Aulne noir.
Frangula folïis ovato-lanceolatis glabris. Mill.
Black-berry bearing aider.
2. Bourdaine à feuilles lancéolées rigides.
Frangula foliis lanceolatis rugojis. Mill.
Berry bearing aider with rougher leaf.
3. Bourdaine à feuilles ovales nerveufes,
Frangula foliis ovatis nervojis. Mill.
Low mountain rocky berry bearing aider with around
leaf.
La bourdaine, n° / , eft un grand arbriffeau qui
s’élève k la hauteur d’environ douze ou quatorze
pieds. Ses tiges font couvertes d’une écorce noire ,
tiquetée de taches jaunâtres : fes feuilles font allez
belles, mais un peu éloignées les unes des autres ;
fes fleurs né produifent aucun effet. Toute la décoration
de cet arbùfte confifte dans le rouge de fes
baies qui deviennent enfuite d’un noir luifant. Il
croît de lui-même dans les bois aux lieux humides,
mais il réuflit dans tous les fols où l’on veut l’établir.
La fécondé écorce eft d’un très-beau jaune.: celle
des racines purge fortement par haut & par bas.
On l’emploie dans les campagnes contre les hydropi-
fies, & on la preferit à la dofe d’une drachme &
demie : elle entre aulîi dans les pommades contre la
gale. Cette vertu hydragogue & purgative eft une
nouvelle preuve de la reffemblance qui fe trouve
entre la bourdaine & le nerprun.
J’ai mangé plufieurs baies de bourdaine fans en
être incommodé ; j’ai feulement éprouvé quelques
légères flatuofités, peut-être feroient-elles un purgatif
plus doux que celles du rhamnus.
On fait avec ie bois de la bourdaine un charbon
léger qui eft préféré à tout autre jtour la fabrique de
la poudre à canon. Un quintal de ce bois qui coûte
à-peu-près 4 liv. ne produit que douze livres de
charbon.
Dans plufieurs provinces les cordonniers n’emploient
point d’autre bois pour les chevilles des
talons.
L’efpece n° 2 pourroit bien être auffi le n°. 2 de
M. Duhamel. Il peut que cette bourdaine croiffe en
Amérique auffi bien que fur les Alpes & dans quelques
autres contrées montagneufes de l’Europe.
^ La troifieme efpece ne s’élève guere qu’ à deux
pieds de haut : elle eft indigène des Pyrénées.
Toutes fe multiplient aifément par les baies qu’il
faut femer dès qu’elles font mûres, finon elles ne
lèvent que la fécondé année. Elles fe reproduifent
auffi par les furgeons, les marcotes & même les
boutures. .
On peut placer les deux premières efpeces fur les
derrières des bofquets d’é té, & la troifieme fur les
devants , mais en petit nombre, parce que ces
Tome 11,
ârbuftes Ont peu de beaiité. f M le Baron DE
Ts c h o u d i . )
BOURDON, f» m. ( Mujique. ) baffe-continue
qui raifonne toujours fur le même ton , comme font
communément celles des airs appelles musettes.
Foyei Point-d’orgue ( Mufique. ) Dicl. raif. des
fcïences, &CC. ( S )
Les anciens avoient une efpece de bourdon, qui
foutenoit le chant en faifant fonner l’oâave & la
quinte : bourdon ,‘oîi fe trouvoit auffi la quarte par
la fituation de, la corde du milieu, comme on l’ap-
perçoit aifément. Les anciens ne nous ont rien laiffé
par écrit touchant ces fortes de bourdons. (F . D. Cf)
BOURDON, f. m. baculus longior, ( terme de Blafon.
) meuble d’armoiries, qui repréfente un bâton
de pèlerin.
La Bourdonnaye en Bretagne ; de gueules à trois
bourdons de pèlerins d'argent, 2 & 1.
Guillart d’Amoy de la Bame, à Paris; de gueules,
a deux bourdons de pèlerins d’or, pofés en chevron, accompagné
de trois rochers d'argent.
§ Bourdonné, ÉE ; adj. ( terme de Blafon. ) fe
dit d’un bâton arrondi à fon extrémité fupérieure ,
ou d’une croix pommettée à la maniéré d’un bourdon
de pèlerin.
Les prieurs mettent un bâton bourdonnée en p a l,
derrière l’écu-de leurs armes.
Rafcas du Canet, à Aix en Provence; d'or à la
croix bourdonnée de gueules au pied fiché, au chef
da\ur, chargé d'une étoile à huit rais d'argent. ( G.
D .L .T . ) ' ■ ■
* BOURG-ACHARD, ( Gèogr.} eft écrit malà
propos BoUCACHARD dans le Dicl. raif. desScien-
ces, &c. quoique ce nom fe prononce par corruption
Boc-Achard.
BOURG-EN-BRESSE, {Gèogr.) Tanum,Burgus
Segujianorum, ville capitale de laBre ffe,où il pa-
roît que les Romains rendoit juftice aux Ségufiens :
l’églife paroiffiale & collégiale de Notre-Dame
fut érigée en Evêché en 1511, fupprimé l’année fui-
vante , à la follicitation de Frahçois I , rétabli en-
fuite en 15 2 1, & fupprimé en 1536.
Sous la halle, qui eft une des plus vaftes du royaume
, eft une chaire antique, où S. Vincent-Ferrier a
prêché.
Bourg eft la patrie de Me2iriac, de Claude Faure,'
de Vaugelas, de Nicolas Faret de M. de la Lande,
célébré aftronome de nos jours, qui a enrichi ce
Supplément de plufieurs articlesd’aftronomie. (C .)
BOURRÉE, f. f. ( Mujique. ) forte d’air propre
à une danfe du même nom. Le bourrée eft à deux
tems gais , & commence par une noire avant le
frappé : elle doit avoir, comme la plupart des autres
danfes, deux parties & quatre mefur.es, ou un
nombre de mefures multiples de quatre à chacune
: dans ce caraûere d’air, on lie affez fréquemment
la fécondé moitié du premier tems, & la
première du fécond, par une blanche fyncopée.
k > .
BOURRU ( Vin ) , (Ëcon. vin doucereux &
brouillé, qui a encore toute fa lie , parce qu’on
l’empêche de fermenter. Pour cela, on prend une
décoélion de. froment bien chargée ; on en met deux
pintes dans un muid de v in , dans le tems qu’il fermente.
( + )
BOURS DE M ARSEILLE, ( Comm. ) nom qu’on
donne à une forte d’étoffe moirée, dont la chaîne eft
toute de foie, & la trame entièrement de bourre de
foie. Elle a pris fon nom de la ville de Marfeille, où
l’on en a d’abord fabriqué. On en fait préfentement
à Montpellier, à Nîmes, à Avignon, à Ly on , &
même à Paris.
Les bours de Marfeille font de trois largeurs, de