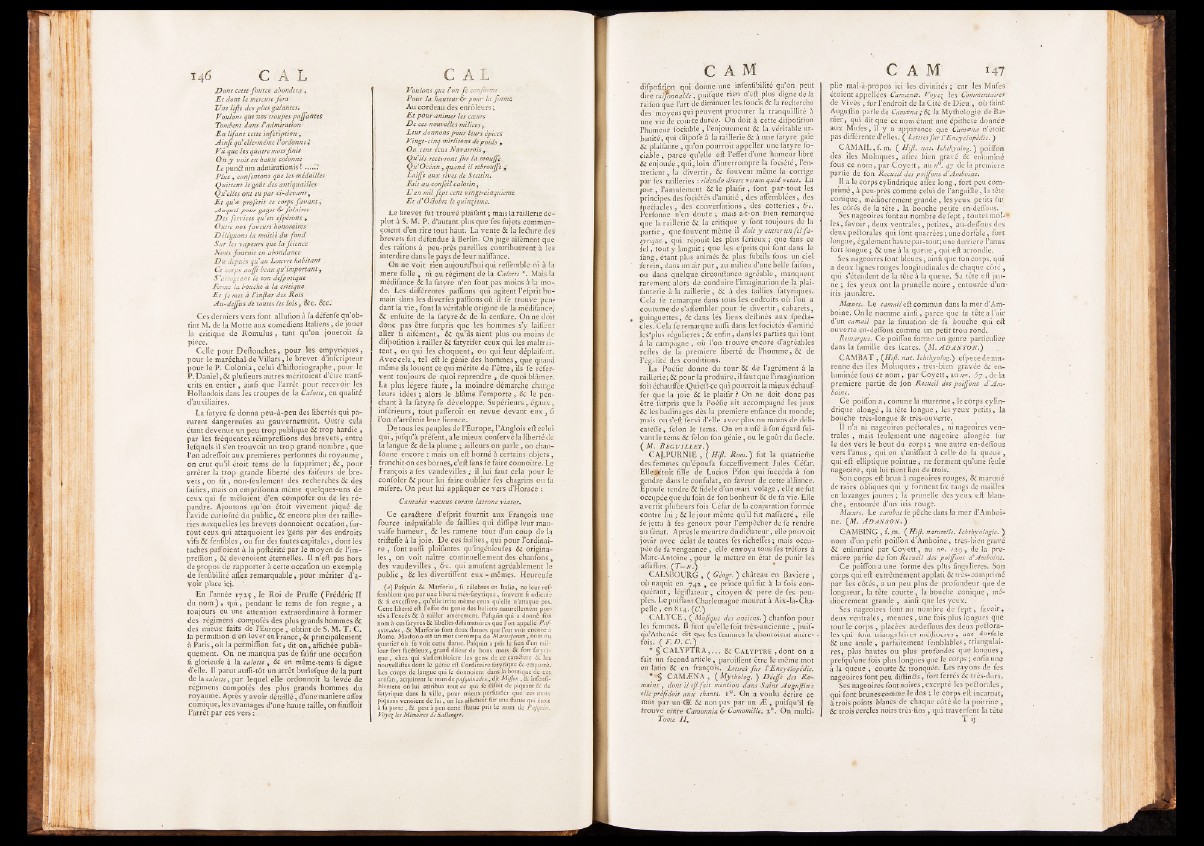
Dont cettefource abondera.
E t dont le mercure fera
Une lijle des plus gâtantes.
Voulons que nos troupes payantes
Tombent dans P admiration^ .
En lifant cette infcrïption ,
Ainfi qu'elle-même F-ordonne^
Vu que les quatre mots fihis
On y voit en haute talonne
Le punéhim admirationis !.*<..?
Plus , confentons que les médailles
Quittent le goût des antiquailles
Qu!elles ont eu par ci-devant,
E t qu-a proferit ce corps J'avant
Auquel pour gages & falaires
Des fervices qu’en efpérons >
Outre nos faveurs honoraires
Déléguons la moitié du fond
Sur les vapeurs que la fcience
Nous fournit en abondance
D u depuis-quau Louvre habitant
Ce corps auffi beau qu’important,
S ’arrogeant le ton defpotique
Ferme la bouche à la critique,
£ t f c met à Finjiar des Rois
Au-deffus de toutes les lois, & c . &C.‘
Ces derniers vers font allufion à la défenfe qu’obtint
M. de la Motte aux comédiens Italiens, de jouer
la critique de Romulus, tant qu’on joueroit fa
piece.
Celle pour Deftouches, pour les empyriques,
pour le maréchal de V illars, le brevet d’inlcripteur
pour le P. Coloniâ, celui d’hiftoriographe, pour le
P.Daniel,& plufieürs autres méritoient d’être tranf-
crits en entier, ainfi que l’arrêt pour recevoir les
Hollandois dans les troupes de la Calotte, en qualité
d’auxiliaires.
La fatyre fe donna peu-à-peu des libertés qui parurent
dangereufes au gouvernement. Outre cela
étant devenue un peu trop publique & trop hardie ,
par les fréquentes réimprefîions des brevets, entre
lefquels il s’en trouvoit un trop grand nombre, que
l’on adreffoit aux premières perfonnes du royaume,
on crut qu’il étoit tems de la fupprimer; & , pour
arrêter la trop grande liberté des faifeurs de brevets
, on f it , non-feulement des recherches & des
faifies, mais on emprifonna même quelques-uns de
ceux qui fe mêloient d’en compofer ou de les répandre.
Ajoutons qu’on étoit vivement piqué de
l’avide curiofité du public, & encore plus des railleries,
auxquelles les brevets donnoient occafion, fur-
tôut ceux qui atta.quoient les -gens par des endroits
vifs & fenfibles, ou fur des fautes capitales, dont les
taches paffoient à la poftérité par le moyen de l’im-
preflion, & devenoient éternelles. Il n’eft pas hors
de propos de rapporter à cette occafion un exemple
de fenfibilité affez remarquable > pour mériter d’a-
,yoir place icj.
En l’année 1715 , le Roi de Prufle (Frédéric II
du nom ) , q ui, pendant le tems de fon régné, a
toujours eu une attention extraordinaire à former
des régimens compofés des plus grands hommes &
des mieux faits de l’Europe, obtint de S. M. T . C.
la permiffion d’en lever en France, & principalement
à Paris, où la permiflion fut, dit-on, affichée publiquement.
On ne manqua pas de faifir une occafion
fi glorieufe à la calotte , & en même-tems' fi digne
d’elle. Il parut aufli-tôt un arrêt burlefque de la part
delà calotte ) par lequel elle ordonnoit la levée de
régimens compofés des plus grands hommes du
royaume. Après y avoir détaillé, d’une maniéré affez
comique, les avantages d’une haute taille, on finifloit
l’arrêt par ces vers :
Voulons que Fon fe conforme
Pour la hauteur-& pour- la forme.
Au cordeau dés enrôlenrs;
E t pour animer les coeurs
De ces nouvelles milices , .
Leur donnons pour leurs épices
Vingt-cinq-mirlitons de poids>
Ou cent ecus Navarrois.,.
Qu’ils recevront fur la mouffe
Qu Océan, quand, il rebroujfe ,
Laijfe aux rives de Stettin.
Fait au confeil calot in,
L’an mil fept cent vingtrcinquieme
E t d ’Octobre le quinzième.
Le brevet fut trouvé plaifânt ; mais la raillerie déplut
à S. M. P. d’autant plus que fes fujets commèn-
çoient d’en rire tout haut. La vente & la leâure des
brevets fut défendue à Berlin. On juge aifément que
des raifons à peu-près pareilles contribuèrent à les
interdire dans le pays de leur naiffance.
On ne voit rien aujourd’hui qui reflemble ni à la
mere folle , ni au régiment de la Calotte *. Mais la
linédifance & la fatyre n’en font pas moins à la mode.
Les différentes pallions qui agitent l’efprit-humain
dans les diverfes pallions oii il fe trouve pendant
la v ie , font la véritable origine de la médifance;
& enfuite de la fatyre & de la cenfure. On ne doit
donc pas être furpris que les hommes s’y laiffent
aller fi aifément, & qu’ils aient plus ou moins de
difpofition à railler & fatyrifer ceux qui les maltraitent,
ou qui les choquent, ou qui leur déplaifent.
Avec cela, tel eft le génie des hommes, que quand
même ils louent ce qui mérite de l ’être , ils fe réfervent
toujours de quoi reprendre , de quoi blâmer.
La plus légère faute, la moindre démarche change
leurs idées; alors le blâme l’emporte, &c le penchant
à la fatyre fe développe. Supérieurs,,égaux,
inférieurs, tout pafferoit en revue devant eu x , fi
l’on n’arrêtoit leur licence.
De tous les peuples de l’Europe, l’Anglois eft celui
q ui, jufqu’à préfent, a le mieux confervé la liberté de
la langue & de la plume ; ailleurs on parle, on chan-
fonne encore : mais on eft borné à certains objets ,
franchit-on ces bornes, c’eft fans fe faire connoître. Le
François a fes vaudevilles ; il lui faut cela pour le
confoler & pour lui faire oublier fes chagrins ou fa
mifere. On peut lui appliquer ce vers d’Horace :
Cantabit vacuus coram latrone viator.
Ce caraftere d’ efprit fournit aux François une
fource inépuifable de faillies qui diflipe leur mau-
vaife humeur, & les ramene tout d’un coup de la
trifteffe à la joie. De ces faillies, qui pour l’ordinaire
, font auffi plaifantes qu’ingénieufes & originales
, on voit naître continuellement des chantons,
des vaudevilles , &c. qui amufent agréablement le
public, & les divertiffent eux - mêmes. Heureufe
(a) Pafquin & Marforio, fi célébrés en Italie, ne leur ref-
femblent que par une liberté très-fatyrique, fouvent fi odieufe
& fi e xceflive, qu’elle irrite même ceux qu’elle n’attaque pas.
Cette liberté eft l’effet du genie des Italiens naturellement portés
à l’excès & à railler amèrement. Pafquin qui a donné fon
nom à ces fatyres & libelles diffamatoires que l’on appelle Paf-
quinades, & Marforio font deux ftatues que l’on voit encore à
Rome. Marforio eft un mot corrompu de Martisforum, nom du
quartier où fe voit cette ftatue. Pafquin a pris le fien d’un tailleur
fort facétieux, grand difeur de bons mots & fort fatyri-
que , chez qui s’affembloient les gens de ce cara&ere & les
nouvelliftes dont le génie eft d’ordinaire fatyrique & emporté.
Les coups de langue qui fe donnoient dans la boutique de cet
artifan, acquirent le nom de pafquinades,, dit Mijfon, & infenfi-
blement on lui attribua tout ce qui fe difoit de piquant & de
fatyrique dans la v ille , pour mieux penuader que ces mots
piquans venoient de lui, on les affichoit fur une ftatue qui étoit
à fa porte , & peu à peu cette ftatue prit le nom de Pafquin.
Voyeç les Mémoires de Sallengre.
difpofition qui donne une infenfibilite cp’ôn peut.
d ire ra^M f lte i p.uifque rien n’eft plus digne de la
faifon que l’art de diminuer les foucis & la recherche
des moyens qui peuvent procurer la tranquillité à
ûne vie de courte durée. On doit à cette .difpofition
l’humeur fociable , l’enjouement & la véritable urbanité,
qui difpofe à la raillerie & à une fatyre gaie
& plàifante , qu’on pourroit appeller une fatyre fociable
, parce qu’elle eft l’effet d’une humeur libre
& enjouée , qui, loin d’interrompre la fociété, l’entretient
, la divertit, & fouvent même la corrige
par fes railleries : ridendo dicere verum quid vetat. La
joie , i’amufement & le plaifir, font par-tout les
principes desfociétés d’amitié , des affemblées, des
fpedàcles, des converfations, des cotteries , &c.
Perfonne n’en doute ; mais a-t-on bien remarqué
que la raillerie & la critique y font toujours de la
partie , que fouvent même il doit y entrer un fel fa tyrique
, qui réjouit les plus férieux ; que fans ce
f e l , tout y languit ; que les efprits qui font dans le
fang, étant plus animés & plus fubtils fous un ciel
ferèin, dans un air pur, au milieu d’une belle faifon,
ou dans quelque circonftance agréable, manquent
rarement alors de conduire l’imagination de la plai-
fanterie à la raillerie, &; à des faillies fatyriques.
Cela fe remarque dans tous les endroits où l’on a
coutume de s’affembler pour fe divertir, cabarets,
guinguettes, & dans lés lieux deftinés aux fpe&a-
cles. Cela fe remarque auffi dans les fociétés d’amitié
les’plus régulières ; & enfin, dans les parties qui font
à la campagne , où l’on trouve encore d’agréables
reftes de la première liberté de l’homme, & de.
l’égalité des conditions.
La Poéfie donne du tour & de l’agrément à la
raillerie; & pour la produire, il faut que l’imagination
foit échauffée.Qui eft-ce qui pourroit la mieux échauffer
que la joie & le plaifir ? On ne doit donc pas
être furpris que la Poéfie ait accompagné les jeux
& les badinages dès la première ehfance du monde;
mais on s’eft fervi d’elle avec plus ou moins de déli-
careffe, félon le tems. On en a ufé à fon égard fui-
vant le tems & félon fon génie, ou le goût du fiecle.
{ M. B e g u il l e t .)
CALPURNIE , ( Hiß. Rom.') fut la quatrième
des femmes qu’époufa fucceffivement'Jules Céfar.
Elle^étoit fille de Lucius Pifon qui fuccéda à fon
gendre dans le çonfulat, en faveur de cette alliance.
Epoufe tendre & fidele d’iin mari volage, elle ne fut
occupée que du foin de fon bonheur & de fa vie. Elle
avertit plufieurs fois Céfar de la conjuration formée
contre lui ; & le jour même qu’il fut maffacré, elle
fe jetta à fes genoux pour l’empêcher de fe rendre
au fénat. Après le meurtre dudiftateur, elle pouvoit
jouir avec éclat de tontes fes richeffes ; mais occupée
de fa vengeance, elle envoya tous fes tréfors à
Marc-Antoine , pour le mettre en état de punir les
afl'affins. ( 7’—v . ) ■
CALSBOURG , ( Géogr. ) château en Bavière ',
où naquit en 74z , ce prince qui fut à la fois conquérant
, légiflateur, citoyen & pere de fes peuples.
Le puiffant Charlemagne mourut à Aix-la-Chapelle
, ën 814. (C.)
CALYCE , ( Mufique des anciens.) chanfon pour
les femmes. Il faut qu’elle foit très-ancienne , puif-
q'u’Athenée dit que les femmes la chantoient aufre-
fois. ( F. D. C. )
* § C A L Y P T R A ,... & C alyptr e ,dont on a
fait un fécond article, paroiffent être le même mot
en latin & en françois. Lettres fur F Encyclopédie.
*"*§ CAMÆNA , ( Mytkolog. ) Déejfe des Romains
, dont il efl fait mention dans Saint Auguftin:
elle preßdoit aux chants. i ° . On a voulu écrire ce
mot par un CE & non pas par un Æ , puifqu’il fe
trouve entre Camonnia & Camomille, i ° . On multi-
■ Tome II,
plie mal-à-propos ici les divinités; car les MufeS
étoient appellées Camcenoe. Voyez les Commentaires-
de Vivès , fur l’endroit de la Cité de Dieu;, où faint
Auguftin parle de Camoena ; & la Mythologie de Ba> '
mer, qui dit que ce nom étant une épithete donnée
aux Mufes, il y a apparence que Camoena n’étoit
pas différente d’elles. ( Lettres fur L'Encyclopédie. )
CAM A IL ,f.m . ( Hijl. nat. Ichthyolog.) poiffort
des îles Moluques, aflez bien gravé & enluminé
fous ce nom, par Co ye tt, au n°. 47 de la première
partie de fon Recueil des poijfons d!Amboine.
Il a le corps cylindrique affez long , fort peu Comprimé
, à peu-près comme celui de l’anguille, la tête
conique, médiocrement grande , lesyeux petits fur
les côtés de la tête , la bouche petite en-deflbus.
Ses nageoires font au nombre de fept, toutes mol-*
les, favoir , deux ventrales, petites, au-deflbüs des
deux pectorales qui font qua.rrées ; une dorfâle , fort
longue, également haute par-tout; une derrière l’anus
fort longue ; & une à la queue , qui eft arrondie.
Ses nagèoires font bleues, ainfi que fon corps, qui
a deux lignes rouges'longitudinales de chaque côté ,
qui s’étendent de la tête à la queue. Sa tête eft jaune
; fes yeux ont la prunelle noire , entourée d’un‘
iris jaunâtre.
Moeurs. Le camail eft commun dans la mer d’Amboine.
On le nomme ainfi, parce que fa tête a l’air
d’un camail par la fituation de fa bouche qui eft
ouverte en-deffous comme un petit trou rond.
Remarque. Ce poiffon forme un genre particulier
dans la famille des feares. (M. A d a n s '-o n .)
CA MB AT , (Hifl. nat. Ichthyolog!) efpece de mu-
renne des îles Moluques , très-bien gravée & enluminée
fous ce nom, par C oye tt, au no. Sy , de la
première partie de fon Recueil des poijfons d!Amboine.
Ce poiffon a , comme la murenne, le corps cylindrique
alongé , la tête longue , les yeux petits, la
bouche très-longue & très-ouverte.
Il n’a ni nageoires pe Clorai es, ni nageoires ventrales
, mais feulement une nageoire alongée fur
le dos vers le bout du corps ; une autre en-dëffous
vers l’anus, qui en s’uniffant à celle de la queue ,
qui eft elliptique pointue, ne forment qu’une feule
nageoire, qui lui tient lieu de trois.
Son corps eft brun à nageoires rouges, & marqué
de raies obliques qui y forment fix rangs de mailles
en lozanges. jaunes ; la prunelle des yeux eft. blanche,
entourée d’un iris rouge.
Moeurs. Le cambaf fe p'êche dans la mer d’Amhoi-
ne. (Af. A d a n s o n . )
GAMBING , f. ,m. ( Hijl. naturelle. Ichthyologie. )
nom d’un petit poiffon d’Amboine, très-bién gravé
& enluminé par C o y e tt , au no. île ) , dé la première
partie de fon Recueil des poijfons d!Amboine.
Ce poiffon a une forme des plus fingulieres. Son
corps qui eft extrêmemenLapplati & très-comprimé
par les côtés, a un peu plus de profondeur que de
longueur, la tête courte, la bouche conique , médiocrement
grande , ainfi que les yeux.
Ses nageoires font au nombre de fept, favoir,'
deux ventrales, menues, une fois plus longues que
tout le corps , placées au-deffous des deux pe Cio raies
qui font triangulaires médiocres ; une dorfale
& une anale , parfaitement femblables, triangulaires,
plus hautes ou plus profondes que longues,
prefqu’une fois plus longues que le corps ; enfin une
à la queue ^ courte & tronquée. Les rayons de fes
nageoires font peu diftinfts, fort ferres & très-durs.
Ses nageoires font noires, excepte les pe&orales,
qui font brunes comme le dos ; le corps eft incarnat,
à trois points blancs de chaque côté de la poitrine ,
& trois cercles noirs très-fins, qui travèrfent la tête
T i j