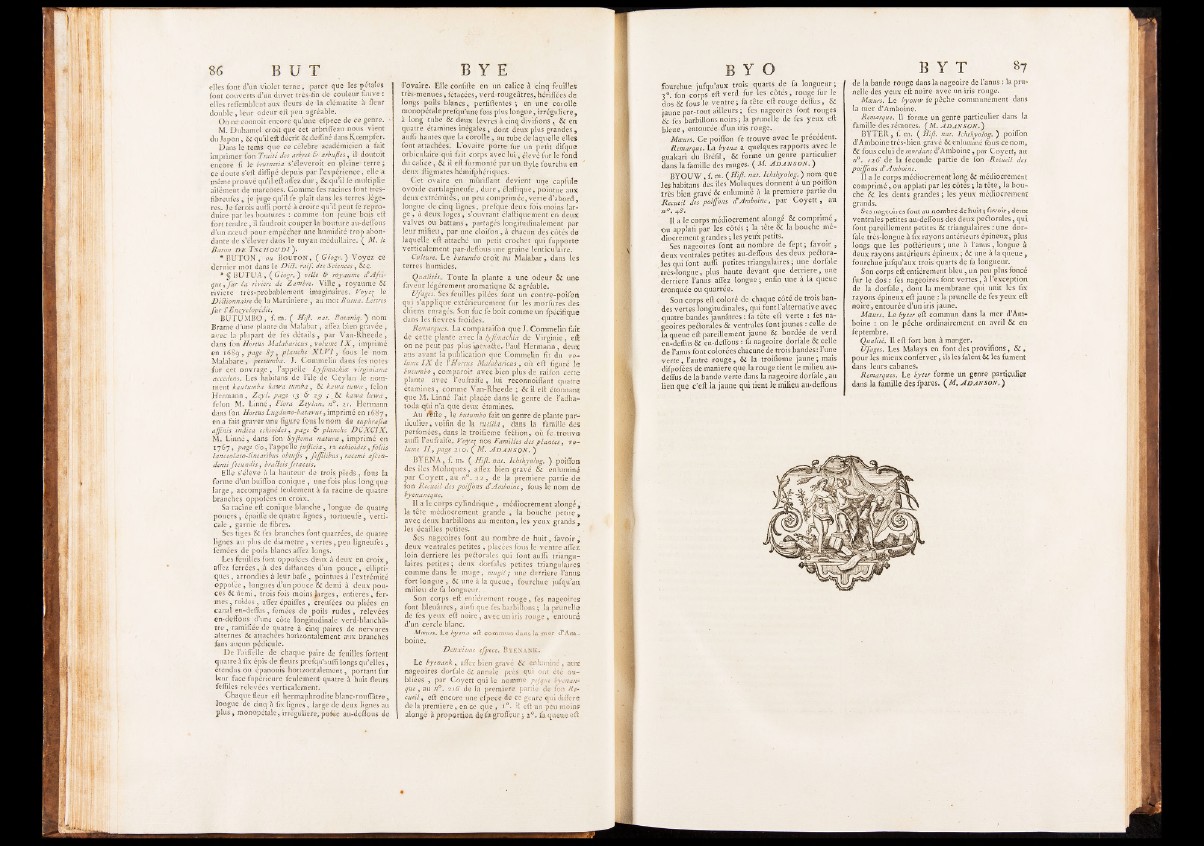
elles font d’un violet terne, parce que les pétales
font couverts d’un duvet très-fin de couleur fauve :
elles reffemblent aux fleurs de la clématite à fleur
double , leur odeur eft peu agréable.
On ne connoît encore qu’une efpece de ce genre. *
M. Duhamel croit que cet arbrifleau nous vient
du Japon, 6c qu’il eft décrit & defliné dans Koempfer.
Dans le tems que ce célébré académicien a fait
imprimer fon Traité des arbres & arbuftes, il doutoit
encore fi le brutneria s’éleveroit en pleine terre ;
ce doute s’eft diflipé depuis par l’expérience, elle a
même prouvé qu’il eft a fiez dur, Sc qu’il fe multiplie
aifément de marcotes. Comme fes racines font très-
fibreufes , je juge qu’il fe plaît dans les terres légères.
Je ferois aufii porté à croire qu’il peut fe reproduire
par les boutures : comme fon jeune bois eft
fort tendre, il faudroit couper la bouture au-deflous
d’un noeud pour empêcher une humidité trop abondante
de s’élever dans le tuyau médullaire. ( M. le
Baron DE T s e H ou d i ).
* BUTON , ou Bo u to n , ( Géogr. ) Voyez ce
dernier mot dans le Dict. raif. des Sciences, 6Cc.
* § BUTUA , ( Géogr. ) ville & royaume d'Afrique,
fur la rivière de Zambre. Ville , royaume &
riviere très-probablement imaginaires. Voyeç le
Dictionnaire de la Martiniere , au mot Butua. Lettres
fur l'Encyclopédie.
BUTUMBO, f. m. ( Hijl. nat. Botaniq. ) nom
Brame d’une plante du Malabar, allez bien gravée ,
avec la plupart de fes détails, par Van-Rheede,
dans fon Hortus Malabaricus, volume I X , imprimé
en 1689, page 8y, planche X L V 1 , fous le nom
Malabare, peetumba. J. Commelin dans fes notes
fur cet ouvrage, l’appelle Lyjimachioe virginiance
accedens. Les habitans de l’île de Ceylan le nomment
kautumba kawa tumba , Sc kawa tuwa , félon
Hermann, Zeyl. page 13 & zg ; 6c kawa luwa,
félon M. Linné, Flora Zeylan. n°. 21. Hermann
dans fon Hortus Lugduno-batavus, imprimé en 1687,
en a fait graver une figure fous le nom de euphrajioe
affin'ts indica tchioides, pdge & planche DCXCÏX.
M. Linné , dans fon Syftenia naturce , imprimé en
1 76 7 , page 60, l’appelle jujlicia, 12 echioides, foliis
lanceolato-linearibus obtujis , fejjîlibus, racemi afeen-
denti fecundis, bracleis fetaceis.
Elle s’élève à la hauteur de trois pieds , fous la
forme d’un buiflon conique , une fois plus long que
large, accompagné feulement à fa racine de quatre
branches oppofées en croix.
Sa racine eft conique blanche , longue de quatre
pouces , épaifle de quatre lignes, tortueufe, verticale
, garnie de fibres.
Ses tiges 6c fes branches font quarrées, de quatre
lignes au plus de diamètre , vertes, peu ligneufes ,
femées de poils blancs aflez longs. .
Les feuillés font oppofées deux à deux en croix
aflez ferrées,'à des diftances d’un pouce, elliptiques
, arrondies à leur bafe , pointues à l’extrémité
oppofée, longues d’un pouce 6c demi à deux pouces
6c demi, trois fois moins larges, entières, fermes
, roides , aflez épaiflès , èreufées ou pliées en
canal en-deflus, femées de poils rudes, relevées
en-defîous d’une côte longitudinale verd-blanchâ-
t r e , ramifiée de quatre à cinq paires de nervures
alternes & attachées horizontalement aux branches
fans aucun pédicule.
De l’aiflelle de chaque paire de feuilles fortent
quatre à fix épis de fleurs prefqu’aufli longs qu’elles,
étendus ou épanouis horizontalement, portant fur
leur face fupérieure feulement quatre à huit fleurs
feflîles relevées verticalement.
Chaque fleur eft hermaphrodite blanc-rouffâtre,
longue de cinq à fix lignes, large de deux lignes au
plus, monopétale, irrégüliere, pofée au-deflous de
l’ovairè. Elle confifte en un calice à cinq feuilles
très-menues, fétacées, verd-rougeâtres, hériflèes de
longs poils blancs, perfiftentes ; en une corolle
monopétaleprefqu’une fois plus longue, irrégüliere,
à long tube 6c deux levres à cinq divifions ^ 6c en
quatre étamines inégales , dont deux plus grandes ,
aufli hautes que la corolle, au tube de laquelle elles
font attachées. L’ovaire porte fur un petit difque
orbiculaire qui fait corps avec lu i, élevé fur le fond
du calice, 6c il eft furmonté par un ftyle fourchu en
deux ftigmates hémifphériques.
Cet ovaire en mûriflant devient une capfule
ovoïde cartila^ineufe , dure, élaftique, pointue aux
deux extrémités, un peu comprimée, verte d’abord,
longue de cinq lignes, prefque deux fois moins large
, à deux loges, s’ouvrant élaftiquement en deux
valves ou battans , partagés longitudinalement par
leur milieu, par une cloifon, à chacun des côtés de
laquelle eft attaché un petit crochet qui fupporte
verticalement par-deflous une graine lenticulaire.
Culture. Le butumbo croît au Malabar, dans les
terres humides.
Qualités. Toute la plante a une odeur 6c une
faveur légèrement aromatique 6c agréable.
Ufages. Ses feuilles pii ées font un contre-poifon
qui s’applique extérieurement fur les morfures des
chiens enragés. Son fuc fe boit comme un fpécifique
dans les fievres froides.
Remarques. La comparaifon que J. Commelin fait
de cette plante avec la lyfimachia de Virginie, eft
on ne peut pas plus igexa&e.. Paul Hermann , deux
ans avant la publication que Commelin fit du volume
I X de l’Hortus Malabaricus, où eft figuré le
butumbo , comparoit avec bien plus de raifon cette
plante avec l’eufraife, lui reconnoiflant quatre
étamines,, comme Van-Rheede ; & il eft étonnant
que M. Linné l’ait placée dans le genre de î’adha-
toda qui n’a que deux étamines.
Au refte , le butumbo fait un genre de plante particulier
, voifin de la ruellia, dans la famille des
perfonées, dans la troifieme feftion, où fe.trouve
aufli l’eufraife. Voye{ nos Familles des plantes, volume
I l , page 210. ( M. A d a n s o n . )
BYENA, f. m. ( Hiß. nat. Ichthyolog. ) poiflon
des îles Moluques, aflez bien gravé 6c enluminé
par C o y e tt , au n°. 2 2 , de la première partie de
fon Recueil des poiffons cCAmboine, fous le nom de
byenaneque.
Il a le corps cylindrique , médiocrement alongé
la tête médiocrement grande , la bouche petite ,
avec deux barbillons au menton, les yeux grands ,
les écailles petites.
Ses nageoires font au nombre de huit, favoir
deux ventrales petites , placées fous le ventre aflez
loin derrière les pectorales qui font aufli triangulaires
petites; deux dorfales petites triangulaires
comme d'ans le muge, mugil; une derrière l’anus
fort longue , 6c une à la queue, fourchue jufqu’au
milieu de fa longueur. ,
Son corps eft entièrement ronge, fes nageoires
font bleuâtres, ainfi que fes barbillons ; la prunelle
de fes yeux eft noire, avec un iris rouge, entouré
d’un cercle blanc.
Moeurs. Le byena eft commun dans la mer d’Am-
boine.
Deuxieme efpece. Byenank.
Le byenank , aflez bien gravé 6c enluminé , aux
nageoires dorfale 6c annale près qui ont été oubliées
, par Coyett qui le nomme pej'que byenati-
que, au n°. 216’ de la première partie de fon Recueil,
eft encore une efpece de ce genre qui diffère
de la première, en ce que , i° . il eft un peu moins
alongé à proportion de fa groflçur ; x°. fa queue eft
fourchue jufqu’aux trois quarts de fa longueur ;
3°. fon corps eft verd fur les côtés, rouge fur le
dos 6c fous le ventre ; fa tête eft rouge defliis, 6c
jaune par-tout ailleurs ; fes nageoires font rouges
6c fes barbillons noirs ; la prunelle de fes yeux èft
bleue, entourée.d’un iris rouge.
Moeurs. Ce poiflon fe trouve avec le précèdent.
Remarque. byena a quelques rapports avec le
guakari du Bréfil, 6c forme un genre particulier
dans la famille des muges. ( M. A d a n s o n . )
B YO UW , f. m. ( Hijl. nat. Ichthyolog. ) nom que
les habitans des îles Moluques donnent à un poiflon
très bien gravé & enluminé à la première partie du
Recueil des poiffons eTAmboine, par C o y e t t , au
718.48.
Il a le corps médiocrement alongé 6c comprime,
ou applati par les côtés ; la tete 6c la bouche médiocrement
grandes ; lès yeuk petits.
Ses nageoires font au nombre de fept; favoir ,
deux ventrales petites au-deflpus des deux peftora-
les qui font aufli petites triangulaires ; une dorfale
très-longue, plus haute devant que derrière, une
derrière l’anus aflez longue ; enfin une a la queue
tronquée ou quarrée.
Son corps eft coloré de chaque côté de trois bandes
vertes longitudinales, qui font l’alternative avec
quatre bandes jaunâtres : fa tete eft verte : fes nageoires
peûorales & ventrales font jaunes : celle de
la queue eft pareillement jaune 6c bordée de verd
en-deffus 6c en-deflbus : fa nageoire dorfale 6c celle
de l’anus font colorées chacune de trois bandes: l’une
verte, l’autre rouge, 6c la troifieme jaune ; mais
difpofées de maniéré que. la rouge tient le milieu au-
deflus de la bande verte dans la nageoire dorfale, au
lieu que c’eft la jaune qui tient le milieu au-deflous
de la bande rouge dans la nageoire de l’anus î la prit“
nelle des yeux eft noire avec un iris rouge.
Moeurs. Le byouw fe pêche communément dans
la mer d’Amboine.
„ Remarque. Il forme un genre particulier dans la
famille des rémores. {M. A d a n so n .')
B Y T E R , f. m. ( Hijl. nat. Ichthyolog. ) poiflon
d’Amboine très-bien gravé 6c enluminé (ous ce nom,
6c fous celui de mordant d’Amboine, par Coyett, au
n°-. 126 de la fécondé partie de fon Recueil des
poiffons d'Amboine.
Il a le corps médiocrement long & médiocrement
comprimé, ou applati par les côtés ; la tête, la bouche
6c les dents grandes ; les yeux médiocrement
grands.
Ses nageoires font au nombre de huit ; favoir, deux
ventrales petites au-deflous des deux pé&orales, qui
font pareillement petites 6c triangulaires : une dorfale
très-longue à fix rayons antérieurs épineux, plus
longs que les poftérieurs ; une à l’anus, longue à
deux rayons antérieurs épineux ; 6c une à la queue ,
fourchue jufqu’aux trois quarts de fa longueur.
Son corps eft entièrement bleu, un peu plus foncé
fur lé dos : fes nageoires font vertes, à l’exception
de la dorfale, dont la membrane qui unit les fix
rayons épineux eft jaune : la prunelle de fes yeux eft
noire, entourée d’un iris jaune.
Moeurs. Le byter eft commun dans la mer d’Amboine
: on le pêche ordinairement, en avril 6c en
feptembre.
Qualité. Il eft fort bon à manger.
Ufages. Les Malays en font des provifions, 6c
pour les mieux conferver, ils les falent&c les fument
dans leurs cabanes.
Remarques. Le byter forme un genre particulier
dans la famille des fpares. ( M. A d an so n . )